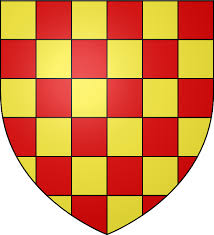études et archives
Registre des Archives départementales de la Corrèze - Références
Sénéchaussée ducale de Ventadour
La sénéchaussée ducale de Ventadour fut créée en 1578 après l'érection du comté en duché-pairie, par démembrement de celle de Tulle. D'abord établi à Égletons, le siège de la juridiction fut définitivement fixé à Ussel en 1599. Une transaction de 1601 a permis de délimiter les ressorts et compétences respectifs des officiers de la sénéchaussée de Tulle et de celle du duché-pairie de Ventadour.
. plumitif des audiences, 1700-1702, 1708-1712, 1721-1725, 1736-1789, B 414-479
. audiences, sentences préparatoires, défauts, etc., 1715-1717, 1776, B 2047-2048
. transcriptions des jugements, 1784-1789, B 480-481
. présentations au greffe, 1735-1747, B 482-484
. présentations et défauts, 1759-1789, B 485-493, 2053
. sentences, appointements et sentences, 1675-1789, B 494-567, 500 bis, 2054-2055
. sentences sur procès, 1785, 1787, B 2050-2051
. procès-verbaux, enquêtes, significations, etc., 1676-1789, B 568-636
. procès-verbaux, 1707-1789, B 2056-2060
. instructions criminelles, 1697-1789, B 637-687
. informations criminelles, 1709-1777, 1780-1789, B 2061-2063
. distribution des procès, 1743-1744, B 2052
. procédures, 1766-1785, B 2064-2067
. procédures concernant Meymac, 1785-1788, B 2533
. exploits de J.-Bl. Perpezat, huissier, 1744-1770, B 2190
Sources complémentaires :
2 F 46 cour de la sénéchaussée ducale de Ventadour, XVIe s.-1782.
6 F 1 factum du procès entre Pierre de Fénis, lieutenant général en la sénéchaussée de Tulle, et les officiers du siège ducal de Ventadour.
6 F 21 transaction entre les officiers des sièges de Tulle et de Ventadour, 1601.
6 F 135 juridiction de Ventadour, 1680 ; liste des papiers de la sénéchaussée, 1773.
6 F 179 sénéchaussée et cour ducale de Ventadour à Ussel, v. 1657.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre : Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze
Auteur : Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze. Auteur du texte
Éditeur : (Brive)
Date d'édition : 1942
Type : texte
Type : publication en série imprimée
Langue : français
Langue : Français
Format : Nombre total de vues : 33810
Description : 1942
Description : 1942 (T64).
Description : Collection numérique : Fonds régional : Limousin
Droits : domaine public
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6548559b
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-89252
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344265167
Provenance : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 100 %.
UNE JUSTICE DUCALE
La Sénéchaussée d'Ussel (1599-1789)
Jean Faucher
« Ussel était le siège de la sénéchaussée du duché de Ventadour. La juridiction s'étendait sur (quatre) villes et près de cinq cents fiefs, la plupart très considérables, abbayes, prieurés marquisats et baronnies, entre autres celui de Saint-Chamans, apanage de la maison d'Hautefort et des Cars. »
(DELMAS, Histoire d'Uael, p. 3.).
Etablissement de la Sénéchaussée à Ussel Au milieu du xn" siècle la justice de Ventadour était encore ambulatoire : un lieutenant du comte allait de ville en ville, à travers le fief, tenir périodiquement de solennelles assises, où il s'entourait d'un conseil formé de notables du lieu. L'érection de la seigneurie comtale en duché, au mois de février 1578, entraîna un changement profond. Henri III, voulant, disait-il, rendre le jeune duché « esgal en authorité aux aultres du royaulme », « permit », dans ses lettres
N.-B. — Ces pages d'histoire locale, écrites à la demande des « Pelauds d'Ussel », à Paris, devaient leur être lues un soir de l'hiver 1939-1940.
Le fonds de la Sénéchaussée de Ventadour, dans lequel a été puisée la partie essentielle et inédite de cette étude, est immatriculé aux archives de la Corrèze sous les numéros 414 à 493 de la série B et sous les numéros 501 à 687 de la même série.
Mes remerciements cordiaux vont à mon excellent ami, M. Régis Rohmer, archiviste du département, pour m'avoir permis, avec toute son obligeance et sa bonne grâce, de consulter librement les documents qu'il détient.
patentes, de « créer et [d'] ériger perpétuellement un estat et office de seneschal, qui sera nommé seneschal de Ventadour, un lieutenant-général et aultres officiers nécessaires » ( 1). Cette décision, qui accordait une compagnie de magistrats, instaurait en même temps une justice permanente et imposait au nouveau duc, implicitement, l'obligation de la rendre sédentaire, de l'établir à demeure, en un lieu déterminé.
Quelle serait la résidence? Le choix présentait une importance capitale à cause des avantages matériels et moraux que le bénéficiaire en retirerait. Excluant Donzenac et les faubourgs de Tulle, le Parlement de Bordeaux prescrivait de placer le siège « en une ville du duché » (2). Seraitce Egletons, Meymac, Neuvic ou Ussel Voisine du château de Ventadour ?, Egletons fut désignée d'abord (2 bis); mais, au bout de vingt ans d'efforts et de luttes, Ussel obtint une préférence définitive, et le duc décidait le transfèrement du siège dans la cité usselloise, indiquée entre toutes par la situation géographique, le nombre d'habitants, le prestige d'un passé valeureux. C'est à la présence de cet organisme, à son maintien dans la localité, qu'Ussel, principale ville du pays montagneux, dut, deux siècles plus tard, d'être élevée au rang de sous-préfecture et de recevoir un tribunal de première instance, continuateur de la sénéchaussée.
L'engagement de fixer le siège à Ussel fut enregistré par notaire, dans un acte du 15 novembre 1599, signé « anvyron l'heure de vespres, au logis de Pierre Soulhac, marchant de nostre ville ». Anne de Lévy, 2e duc de Ventadour et pair
(1) Cité par HUOT : « Les archives municipales de la ville d'Ussel », p. 24 (1 vol., Ussel, imp. B. Faure, 1856).
(2) Arrêt du 4 décembre 1578 entérinant les lettres-patentes de février (Huot, id., p. 102). Donzenac, acquis par Gilbert de Lévis en 1572, appartenait « pour les deux tiers » aux Ventadour « et pour l'autre tiers au curé dudit Donzenac » (Arch. Corrèze).
(2 bis) Installation de la sénéchaussée à Egletons : 15 janvier 1579.
Tulle serait devenue probablement le siège de la juridiction si le Parlement de Bordeaux n'y avait mis obstacle (Biill. Soc. Lettres Cor., t. VIII, pp. 412-413, en note).
de France (3), « conseiller du roy en ses conseils privés et d'Estat, chevallier de ses ordres, cappitaine de cent lances de ses ordonnances, lieutenant-général en Languedoc et sénéchal de Limousin », baron d'Herment, de Donzenac, d'Annonay, comte de la Voulte (4), promit solennellement « d'establir le siège ducal en ladicte ville, de lui faire avoir sa séance en icelle » et, autant pour ses successeurs que pour lui, « de rendre le siège perpétuel » (5). Loyalement devait être tenue la promesse. On ignore ,à quel moment débutèrent les audiences : il semble que ce ne fut pas aussitôt, que l'installation des services, la mise en marche des rouages ont été lentes et longues, si l'on en juge par l'état des frais d'aménagement qui porte la date du 3 novembre 1612, c'est-à-dire de 13 ans après le contrat de 1599 (6).
1
Le Personnel. — Sénéchaux. Lieutenants-généraux; Bonnet, Fontmar- tin, Diousidon, Duptantadis, Delmas. Lieutenants particuliers et conseillers: Bonnet, Demichel. Greffiers. Avocats et procureurs principaux: Chastagner, Montlouis. — Incidents entre magistrats. L'embûche du 30 septembre 1753. — Procureurs et avocats. Entrée en fonctions. Serment annuel. Meschin. Chabannes. — Huissiers. — L'interdit de 1784.
Cette court de la duché-paierie de Ventadour comprenait cinq magistrats : au siège, un président et deux assesseurs; au parquet, l'avocat et le procureur ducaux. Le président était le sénéchal de Ventadour. François d'Hautefort, baron
(3) Les Ventadour-Lévy étaient pairs de France depuis 1589.
(4) Voir l'appendice sur les Ventadours.
(5) Bull de la Soc. Arch. et Hist. de la Corrèze, tome XXIII, pp. 451 et suiv. - Et Huot, id., p. 29.
(6) Pièce reproduite par Huot, id., -pp. 21 et 22.
Pour juger les différends fiscaux, Ussel posséda jusqu'en 1686 une élection particulière composée de 64 paroisses. Elle fut réunie à celle de Tulle (DELMAS, « Histoire de la ville d'Ussel », p. 2). Les appels étaient portés devant la Cour des Aides de Clermont.
de Saint-Chamans, premier sénéchal, eut pour successeur Pierre de Lentillac, vicomte de Sédières (1602, 1613), que remplaça Charles de Lentillac, vicomte de Sédières et baron de Brignat (1638). Vinrent ensuite (7) : le marquis Anne de Soudeilles, « seigneur de la Gane, Gouteyrie, Roussille et Roussillon » (1659, 1680.) (8); le marquis Louis-Marie de Soudeilles, fils d'Anne; Louis-Charles de Combarel du Gibanel, chevalier, baron de Sartiges, la Rebeyrotte, le Boy (1747) (9); et, en dernier lieu, le comte François de Combarel du Gibanel (1783) (10), fils de LouisCharles. Grands seigneurs, pourvus d'emplois, ces officiers — les plus hauts du fief ducal — ne voulurent point s'astreindre à présider et à diriger les débats. L'eussent-ils pu, sans avoir fait auparavant quelques études juridiques (11)?
On les vit rarement exercer leurs fonctions, dans lesquelles ils furent suppléés par les lieutenants-généraux.
Durant les 190 ans de la sénéchaussée usselloise, ceux-ci ont été, suivant l'ordre chronologique (12) : Nicolas Dupuy, docteur ès droicts, mentionné l'an 1600 (13); Antoine de
(7) DELMAS : « Histoire de la ville d'Ussel », 2e éd., 1810, pp. 71-73 (1 vol., imp. Veysset, à Clermont-Ferrand, rue de la Treille).
(8) Archives de la Corrèze, B. 49. — Son fils L:Hlis-l\farie (le suivant) : « Seigneur du Lieuteret, de la Ganne, du Bazaneix. » (Bull.
Soc. Hist. Cor., VIII, 391.)
(9) Arch. Cor., B. 428.
(10) Arch. Cor. B. 467.
(11) « Attestation des officiers du siège portant que la ville d'Ussel est régie par le droit écrit (1772). » (Arch. Cor., B. 619.) Le duché de Ventadour était pays de droit écrit.
(12) DELMAS, id., pp. 74 et 75. En sa première organisation, la justice ducale, siégeant « au lieu de Gloutons » (Egletons) était rendue par un sieur Carvillier, venu du présidial d'Aurillac (arrêt d'avril 1583, cité par Laveix : « La Sénéchaussée de Ventadour », pp. 12 et 13).
(13) Nicolas Dupuy « était de la ville de Meymac, et de la même famille que les seigneurs de Mirambel ». (DELMAS, id., p. 74.) C'est en 1629 que le duc de Ventadour céda Mirambel, par échange, à Jean Dupuy, de Meymac, et à Nicolas Dupuy, écuyer, son fils (CHAMPEVAL : Le Bas-Limousin seig. et rel., p. 342). A Mirambel, baronnie du xv" siècle (paroisse de Saint-Rémy), les Dupuy se maintinrent jusqu'à leur extinction dans les Monamy (vers 1740-1745).
1700 : Antoinette Dup. de Mir., épouse de Jean de Cardaillac. —
Fonmartin, seigneur de la Mauriange, trouvé titulaire en 1603; Jacques de Fonmartin, fils d'Antoine, démissionnaire en 1628 (7 décembre) (14); Pierre du Plantadis, sieur de Charboudèche, investi en 1629 (23 janvier); son fils Etienne, qui exerça de 1654 (25 avril) à 1680 (23 octobre); JeanAntoine de Bonnet, seigneur de La Chabanne, nommé en 1681, mort en 1719 (15); Antoine de Bonnet, fils de celui-ci, lieutenant-général de 1719 à 1740 (30 avril); Pierre-Léonard Diousidon de Charlusset, reçu en 1740, décédé l'année suivante (31 octobre); Antoine-Alexis Milange, en exercice de 1741 (16) à 1757; Pierre du Plantadis, de 1757 à 1772 (1er octobre); enfin, Jean-Baptiste Delmas, seigneur de la Rebière, installé le 1CT décembre 1772, à son poste en 1789.
Si l'on excepte Diousidon qui ne fit que passer, la durée moyenne des fonctions fut de 19 ans. La charge était vénale : elle a été payée 18.000 livres « vers le milieu du XVII" siècle » (17). Avant d'exercer, le titulaire, qui devait
1781, Jeanne (de la branche de Margnac et du Madiolet), sœur SaintLouis, religieuse ursuline à Ussel (Arch. Cor., B. 580, 559, et rég. par.
d'Ussel).
Une seconde branche issue du lieutenant général eut pour auteur Pierre Dupuy, Sr de Saint-Pardoux, marié à Catherine de Mary. Leur fils aîné, Baptiste-Antoine, docteur en théologie, fut curé de Meymac (1683). César-Rigal, leur autre fils, d'abord curé de Peyrelevade, devint archiprêtre de Saint-Exupéry, où il fit bâtir le presbytère (Bull. Soc.
Hist. Cor., t. VIII, p. 232). Il était connu des gens de lettres par son oraison funèbre de Louis de Lascaris d'Urfé, évoque de Limoges (DELMAS, id., p. 80).
(14) Il « se démit en faveur de Pierre du Plantadis ». (DELMAS, id., p. 74.)
(15) Son acte de sépulture, et donc la date de son décès, ne se trouve pas dans les registres d'Ussel.
(16) Arch. Cor., B. 423. Milange venait de Bort, où il était juge-châtelain; et l'intendant de la province limousine le comptait au nombre de ses subdélégués. Anne Chassagnac, sa femme, lui donna un fils, Jean-Joseph, qui, le 9 août 1752, eut pour parrain Joseph Milange, bachelier de Sorbonne et supérieur du séminaire d'Avignon (Reg. par.
d'Ussel). Ce lieutenant-général ne fut pas inhumé à Ussel.
1564 : A. Milanges, greffier de Bort (Bull. Soc. Lettres Cor., VII, 468).
(17) Selon HUOT, id., p. 103. C'est en 1604, on le sait, que fut institué la Paulctte.
être docteur ou licencié ès lois, conformément à l'ordonnance royale de 1498, et avoir 25 ans accomplis, prêtait serment devant la Cour du Parlement de Bordeaux. Six sur onze décédèrent en exercice; un cessa volontairement; le dernier se trouva destitué par la Révolution; pour les trois autres, l'on ne sait rien de précis.
Parmi ces lieutenants-généraux civils et criminels, les Bonnet méritent une mention spéciale. On les trouve notaires au XVIe siècle. Antoine est consul en 1599 et signe au contrat d'établissement du siège; François, curé d'Ussel en 1615; Gérald, consul en 1631. Go-seigneurs de Charlus (1622), ils s'attachent aux Ventadours qui font juge de la Garde (1660) un autre Antoine, fils de Gérald, procureur à la sénéchaussée (1625), marié à Marguerite Jaloustre, et, en 1681, leur cèdent le fief de La Chabanne avec pleine justice. Un fils de cet Antoine, Jean de Bonnet, advocat en parlement, époux de Marie Delmas de Grammont, devient lieutenant particulier du sénéchal (1660), juge de BelleChassaigne (1660), puis, et en même temps (1670), intendant de la maison de Ventadour (18). Autant qu'on peut s'en rendre compte par les actes de l'état-civil, trop sommairement rédigés à cette époque, il a trois sœurs : Marie, femme d'Annet de Monloys, avocat; Halis, de Jean de Fon-
(18) Contrairement à l'opinion de Delmas qui en fait le successeur d'Etienne du Plantadis et « le croit pourvu en 1680 » (p. 57), Jean de Bonnet n'a pas été lieutenant-général. Mais il fut lieutenant particulier. « 25 octobre 1680 : Enterrement de M. Etienne Duplantadis, lieutenant-général d'Ussel. » « 22 décembre 1681 : M1' Me Anthoine de Bonnet, Sr de la Chabanne, lieutenant-général au sénéchal de la présente ville. » « 11 novembre 1687 : M1' Me Anthoine de Bonnet, seigneur de la Chabanne et Chasseil, lieutenant-général de cette ville. »
« 24 mars 1693 : Anthoine de Bonnet, seigneur de la Chabanne et lieutenant général. » — « 13 janvier 1681 : Mr Me Jean de Bonnet, lieutenant particulier civil et criminel en lad. sénéchaussée. » « 20 avril 1681 : Sr Me Jean de Bonnet, intendant de Monseigneur le duc de Ventadour. » « 20 mars 1688 : Monsieur Me Jean de Bonnet, intendant de la maison de Ventadour ». (Actes paroissiaux d'Ussel.) La qualité de lieutenant-général attribué à Jean de Bonnet par le rédacteur de l'acte mortuaire de sa veuve, un quart de siècle après son décès, ne peut constituer une preuve.
martin, seigneur de Lespinasse; et Anne, d'Elie de Pomerie, seigneur de la Vaysse (Neuvic). Sa tante Gabrielle a fait mariage avec Pierre de Monloys, sieur du Masviel. Une autre tante, Catherine, est ursuline à Ussel sous le nom de sœur Aymée de Jésus. Sa fille Marie-Anne — dont le parrain fut Anne de Soudeilles, sénéchal, et la marraine Marie de La Guiche, duchesse douairière de Ventadour (1662) — épouse (1684) M. de Fonmartin, seigneur de La Mauriange, et une autre fille, Marie (1686), Joseph Chazal, sieur de Maussac (Jean)-Antoine, aîné de ses fils, cumule avec la lieutenancegénérale (1681-1719) la subdélégalion en chef de l'Intendance d'Auvergne et la mairie d'Ussel. Conseiller du roy, écuyer, premier maire perpétuel de notre ville (Jean)Antoine reçoit l'investiture le 7 septembre 1693. Il s'est allié à Marie-Virginie de La Vergne, et laisse une descendance : Antoine, le dernier lieutenant-général (1719-1740), époux de Marguerite du Couderc (1716), également maire d'Ussel et subdélégué de l'Intendance, mort prématurément vers la cinquantaine; Marie, devenue la femme de Guillaume Espinet, avocat du roi au présidial de Tulle.
Un autre Antoine enfin, le fils du précédent, né à Ussel en 1717, peut-être un peu trop jeune au décès de son père, abandonne les charges officielles assumées par les siens depuis trois générations. Cependant, il gère la mairie de 1749 à 1763 avec le concours d'un adjoint (19). Avocat en Par-
(19) Pierre de Bonnet de la Chabanne en 1751; Pierre Bonnot de Charlus en 1753. On relève aussi : 1741, « M. Dufour, secrétaire du Roy et lieutenant du Maire d'Ussel ». Précédemment : « 15 septembre 1707 : Mr Guilhaume Dufour, conseiller et secrétaire du Roy en la chancellerie de Tulle et lieutenant du Maire de la présente ville » d'Ussel. (Reg. par. d'Ussel.) — « Le titre de Lieutenant du Maire correspondait en réalité à un office payé au fisc et accordé par le roi contre argent comptant, office créé par un édit de 1702. » Cf. Louis DE NUSSAC, Un lieutenant de Maire à Brive, Bul. Soc. hist. Cor., t. XL, pp. 436 et suiv.
Procureurs du roi en l'Hôtel de Ville : 1752-1758, Antoine Conchon de la Mazière (Arch. Cor., B. 601, B. 437); 1773, Jean-Baptiste Conchon (époux de Marie Chnuveau de Rochefort); 1783, « Jean Conchon, seigneur de la Mazière, conseiller et procureur du Roy en l'Hôtel de Ville et juge de police de cette ville » (époux de Françoise Pradinas).
lement de Paris, chevalier, seigneur de La Chabanne, des Salles, de Pontic, de l'Ebraly, du Bech « et autres places » (20), « l'un des deux cents chevau-légers de la garde du Roi » (1741) (21), il épouse (1739) Rose-Angélique de Vaurillon de l'Estang, fille de Gabriel de Vaurillon, ancien président de l'Election de Joinville, et d'Antoinette-Rose de
USSEL. — Eglise paroissiale.
A droite, Maison Montloy, dite de Mareille (Cliché du Syndicat d'Initiative d'Uiael).
Brienne, puis (1752) convole avec Gabrielle Fumât, très jeune personne encore pensionnaire au couvent des Ursulines de Montferrand (22). Les Bonnet possèdent à l'inté-
(Reg. par.) A quelques mètres de l'église, en direction de la tour de Soubise, la demeure des Conchon, bâtie en 1647, serrée entre d'autres, présente deux étages aux fenêtres ouvragées, un rez-de-chaussée en arcade et, à gauche, une tour avec entrée en ogive.
(20) Arch. Cor., B. 587 et registres de catholicité d'Ussel. - La Chabanne : par. de Saint-Fréjoux. Les Salles, Pontic : par. d'Ussel.
L'Ebraly : par. de Saint-Dezéry. Le Bech : par. de Saint-Bonnet-IePort-Dieu (près Bort). 1782 : seigneur du Bazaneix (Saint-Fréjoux).
(CHAMPEVAL : Bas-Limousin, p. 265.)
(21) Arch. Cor., B. 649.
(22) Reg. par, d'Usuel,
rieur d'Ussel cette grande maison à trois étages, en pierres de taille, sans caractère architectural sauf quelques moulures au-dessus de l'entrée, qui, sur la place d'Armes, fait l'angle de deux rues, en face de l'immeuble ayant appartenu aux Cosnac : c'est là qu'Antoine habite, à moins qu'il ne séjourne en son manoir et sur ses terres de La Chabanne.
Son frère Charles est prêtre et docteur en théologie (1782); un autre frère, François, mari d'Antoinette Chrestien, revêt l'uniforme d'officier au régiment de Nicolaï-Dragons; et leur sœur, Anne, s'allie à Charles-Annet de Roziers, chevalier, seigneur de Moncelet (1753). La même, ou une seconde sœur de pareil prénom, contracte mariage avec M. Lespinasse de Maffrand (?), dont elle reste veuve (1782). — Lorsqu'éclate 1789, les esprits, surexcités, ne ménagent point Antoine de Bonnet qui, à vrai dire, a plusieurs fois cherché chicane à ses inférieurs (23). Une plainte remise à la sénéchaussée par une femme et une fille qu'il a publiquement traitées de « carognes » et de « salopes », le déclare « connu par son opulence et par la haine qu'il a vouée à presque tous les citoyens de la ville » (24). Cela finit mal. Certaine nuit de messidor an I, des gens « à visage sinistre armés de piques » enfoncent les portes de La Chabanne, pillent le château, saisissent « le comte » qui était dans son lit, et, l'ayant garotté, transportent en prison, sur une charrette, ce vieillard maintenant « dans l'enfance » : traduit devant le tribunal révolutionnaire et condamné à mort le 15 germinal, il est guillotiné à Tulle, à l'âge respectable de 76 ans (25).
Quelques mots sur les Chassain de Fonmartin, les Diou-
(23) Plainte de Messire Antoine de Bonnet de la Chabanne contre ses locataires de l'auberge du Pont-Barrat (1774). (Arch. Cor., B. 674.) Plainte pour fait de chasse portée par Messire Antoine de Bonnet contre Jean Monteil, garde des bois de l'abbaye de Bonnaigue (1774).
(Arch. Cor., B. 549.) Poursuites de Messire Antoine de Bonnet de la Chabanne contre Antoine Rebeyrix et Jean Mignon, tenanciers du Friaudcix (1780). (Arch. Cor., B. 465.)
(24) Arch. Cor., B. 687.
(25) Raymond LACOSTE; : « Le dernier d'une race éteinte : l'abbé
sidon et les Duplantadis. Les Chassain étaient, voilà quatre siècles, une famille notariale d'Egletons. Guillaume devint conseiller royal en l'élection du Bas-Limousin et, l'an 1545, hominagea Fonmartin, près de Darnets, aux Ventadours.
Martial, son fils, élu du même siège, en charge au moment où le vicomte de Turenne s'emparait de Tulle (1585), représenta le pays aux Etats généraux de 1588. Le mariage de Françoise, fille de Martial, avec Pierre Geouffre porta le fief de Fonmartin dans la maison de Chabrignac, qui le transmit plus tard à celle des Lavaur de Sainte-Fortunade.
Venus à Ussel au commencement du XVIIe siècle en la personne du frère de Françoise, Antoine, les Chassain de Fonmartin, écuyers, furent, dans les alentours, seigneurs de La Mauriange, de Lespinasse et de Charlusset : — de La Mauriange dont se titrait (1603) cet Antoine, premier lieutenant général, et qu'une branche ayant pour auteur son fils Jacques, second lieutenant-général, détenait encore en 1836, quand mourut la dernière des Fonmartin, Jeanne, laissant l'héritage aux Demasson de Saint-Félix, ses enfants; — de Lespinasse, leur domaine principal, avec château à tour quadrangulaire et portail crénelé, que Jean, autre fils d'Antoine, posséda dès 1627, mais qui, durant les XViIIe et XIXe,appartint aux Delpeyrou de Bar (1754) en suite de l'union de Marguerite avec Jean Delpeyrou, puis, par l'effet d'alliances successives, aux de Meynard, aux Fontanges, aux de Selve et aux Flaghac; — de Charlusset, dont Jean-Guillaume, frère de Marguerite, officier de grenadiers royaux, chevalier de Saint-Louis, se disait seigneur en 1763. Un frère de Martial (1588) était aumônier du roi et chanoine d'Agen. Geneviève avait épousé Charles de Lafageardie de La Praderie (environ 1600); Jacques, lieutenant-général, Sibylle de la Baylie (vers 1620); une autre Geneviève, Antoine de Gombarel du Gibanel (1654). Des mariages ussel-
lJcmichel », pp. 39 à 43. — Victor FOHOT : « Les Emigréss corréziens », p. 154. — CHAMPEVAL : lias-Lim., p. 265.
« .Antoine Bonnet, dit lu Chabanne, ev-devant noble, condamné à mort. » (26 fructidor an II.) (Arch. Cor., Q. 89.)
lois unirent aux Fonmartin les Pascal, de Bonnet, Delmas, Laval, Demichel, Conchon; d'autres, les Dartois, Laplène, Marche, Perry. L'aîné des enfants de Jean-Guillaume et
USSEL. — Vieille rue.
Sur la droite au premier plan, Maison Esparvier; au second plan, après le croisement de rues, Maison Chassain de Fonmartin.
A l'extrémité, le clocher de l'Eglise.
(Cliché de la Corrèze Républicaine, à Brive).
d'Anne Moncorrier, Jean-Baptiste, marié à Françoise de Mary, laissa deux filles que mes aïeuls, leurs parents, connurent et fréquentèrent : Emilie (+ 1871), femme de l'avocat Redon, maire de notre ville, et Louise (+ 1858) épouse
d'Antoine Diousidon (26). C'est avec Emilie que les Fonmartin s'éteignirent à Ussel, et ce sont les descendants de Louise qui, sous d'autres noms, conservèrent Charlusset.
Bourgeois remontant au xve siècle, les Diousidon se mêlèrent à la vie judiciaire du fief de Ventadour. On relève aux XVIIe et XVIIIc : Guillaume, consul (1628, 1641); Jean, procureur au siège ducal (1643); un autre Jean, advocat en la Cour et juge du prieuré de Saint-Angel, marié à Louise Combes (1668); Jean, notaire (1669); Pierre, avocat (1700); Jean-Baptiste, praticien (1715); Gabriel, notaire et procureur, greffier de Bellechassagne, marié à Elisabeth Besnard (1729); Jean-Baptiste, huissier, époux de Marie Chabanne (1738, 1748); François, notaire et juge ou lieutenant de neuf juridictions, mari de Jacquette Sautarel (1769); Jean, juge de la baronnie d'Anglards, de Margerides, Fleurac et SaintJulien, lieutenant de Beyssac, procureur fiscal de Mirambel (1785); Jean, avocat (1789). On trouve encore, en 1721, Louise, fille dévote de Saint-François; en 1737, Jeanne Saint-Supéry, veuve d'un Diousidon; en 1740, Joseph, pro-
(26) Reg. par.; Arch. Cor., B. 526, 573; POULBRIÈRE : Dict. des par., I, 433; II, 82; CHAMPEVAL, Bas-Lim., 292, 376, 270, 849; Bull. Soc. Hist.
Cor., XII, 304; René FAGE : « La prise de Tulle et son occupation, 1585-1586 », pp. 79 à 80 et 171 à 175.
La Mauriange, par de Veyrières (Antoine, 1623-1663, mari de Jeanne Pascal; Antoine, époux d'Anne de Bonnet, 1684-1729; Jean-François, 1752; Louis, 1770-1823). Lespinasse, par. de Latourette (Jean, 1627, marié à Halis de Bonnet; Jean, époux de Gabrielle (de) Laval, 1666; Jean (1733-1754). Charlusset, par. d'Ussel, domaine suburbain au. nord de la ville.
Les Fonmartin habitaient une maison de la rue Esparvier dont le jardin s'étendait jusqu'aux fortifications. Par côté, la maison bordait une impasse (aujourd'hui commencement de la rue Neuve-du-Palais), impasse butant contre les jardins qui, de la porte du Thuel à la porte Duchier, de la porte Duchier à la porte Bourbounnou, de la porte Séclide à la porte du Thuel, séparaient alors les habitations des remparts. Sur son emplacement et dans son jardin, des immeubles neufs ont été construits. La demeure voisine appartint aussi aux Fonmartin, avant d'être à Cécilie de Lachaze, née Badour, mère de Gaston. Ces vieilles bâtisses, dépourvues de caractère artistique, empiétaient sur la rue Esparvier dont elles contribuaient au pittoresque en la rendant tortueuse.
vincial des Jésuites en Guyenne; en 1746, Jeanne, fille de feu Antoine, en son vivant notaire et procureur; en 1751, Thérèse, fille dudit Gabriel (27). Les Diousidon étaient propriétaires de Charlusset avant les Fonmartin de Lespinasse.
Pierre-Léonard ajoutait à son nom celui de cette terre.
Juge de Saint-Angel et subdélégué de l'Intendance provinciale, Pierre-Léonard coulait sa vie dans le fauteuil de second lieutenant du siège, lorsque, inopinément, il occupa la première place rendue libre par la brusque mort d'Antoine de Bonnet. Son frère Joseph, « habile dans les négociations », lui procura cette charge, rapporte Delmas (28), « et cela sans finances », à cause qu'il était d'un grand âge et n'avait point d'enfant. Sa nouvelle carrière ne pouvait être longue : elle dura seulement quelques mois.
Un Duplantadis, Antoine, lieutenant-général de la HauteMarche, fut député du Tiers aux Etats de Blois (1588). Trois autres ont été lieutenants-généraux du duché de Ventadour : le père, le fils et l'arrière-petit-fils. Le premier des trois, Pierre (1629-1654) tenait la terre de Charboudèche, dont il se titrait, de Martin Duplantadis, élu en l'élection de la Marche, son père, qui l'avait acquise en 1628 dans la paroisse de La-Mazière(-Haute). Etienne, deuxième lieutenant (1654-1680), eut Gabrielle Esparvier pour épouse et laissa des enfants en bas âge. Un de ceux-ci, Pierre, devint avocat (1692), consul (1696), « conseiller du Roy et assesseur en la maison de ville d'Ussel » (1697). Son mariage avec Louise Andrieu du Teil produisit au moins sept enfants, dont encore un Pierre, lequel, né le 19 novembre 1701, baptisé le 20, devait, à cinquante-six ans, être pourvu de la lieutenance générale (29). Après des études « de droit canonique, civil et français » (30), ce Pierre du Plantadis, troisième
(27) Reg. par. d'Ussel, et Arch. Cor., B. 642, B. 536, B. 646, B. 594, B. 669, B. 622, B. 632, B. 416, B. 653, B. 597, B. 645, B. 477, B. 421.
(28) Id., pp. 75 et 85.
(29) Bull. Soc. Hist. Cor., XII, 304; POULBRIÈRE : Dict. des par., II, 43; DELMAS, 74; Reg. par. d'Ussel.
(30) Copie de l'attestation du premier avocat général du Parlement (le Paris : Arch. Cor., B. 423.
lieutenant (1757-1772), écuyer, d'abord avocat à Ussel, prit femme en Catherine de Sarrazin de Saint-Dionis (13 octobre 1732) (31). Sortirent de leur union : Louise, mariée (1758) à Jean-Joseph Brival, seigneur de Nouzeline et de Lavialle, dans la suite lieutenant particulier à Ussel, fils de Joseph Brival, avocat du roi au siège de Tulle, et de Jeanne Baubiat; Gabrielle, baptisée le 14 février 1738, devenue (1761) mon arrière grand'tante en épousant un gentilhomme du haut pays d'Auvergne, Jean de Baron de Layac, petit-fils de Jean de Baron, écuyer, seigneur de Layac et de Boussac, et de Marie Faucher de Cisternes; Joseph, Augustin, et Françoise. Reçu lieutenant particulier en 1741, consul d'Ussel en 1745, Pierre du Plantadis fut investi de la charge de lieutenant-général seize années plus tard, succédant à Milange décédé. Lui-même mourut au bout de dixhuit ans d'exercice, le 1er octobre 1772, septuagénaire et veuf de Catherine de Sarrazin (32).
Parlerai-je aussi des Delmas? Le plus ancien connu, Etienne, vivait à la fin du XVI" siècle, avec Jeanne d'Adhémar, sa femme, originaire du Languedoc. Jean Delmas, leur fils, argentier de la duchesse de Ventadour (1602), maître d'hôtel du comte de la Voulte, « épousa, à Ussel, en 1603, Marie de la Forest, qui lui apporta la seigneurie de Feyt, le fief de Grammont, divers autres biens » (33). François, fils de Jean et mari de Jeanne de Fonmartin, était procureur ducal en la sénéchaussée d'Ussel (1666). Après lui on distingue deux branches principales : l'aînée, dite de Gram-
(31) Bull. Soc. Hist. Cor., t. XV.
(32) Reg. par. d'Ussel — Armes : d'azur a un palmier d'or. —
1764 : .« La maison appelée de Loyac appartenant à Me Pierre Duplantadis, dont jouit Joseph Goudounesche, Me tailleur. » Arch. Cor., B. 610. Cette maison, sise entre la porte Ducher et le couvent des Ursulines, hors des murs, vient d'être démolie pour faire place à la Caisse d'épargne.
(33) DELMAS, id., p. 17. — Grammont : domaine de la paroisse d'Ussel, à la sortie nord-est de la ville. — Feyt : paroisse du BasLimousin confinant à l'Auvergne et à la Marche. Il ne s'agirait que de la terre de Feix, par. de Saint-Pardoux-le-Vieux. (CHAMPEVAL, id., p. 273.)
mont, et la cadeLLe, ou de la Rehière. Pierre Delmas fut Tailleur de la branche de Granimonl. Il épousa Antoinette du Couderc, fille d'un conseiller au siège, et remplaça son père comme procureur principal (1681, 1703). De cette branche émergèrent : un autre François, avocat en parlement, marié à une autre Jeanne de Fonmartin, qui détint à son tour la charge de procureur principal (1707, 1723), et JeanLouis, avocat en la Cour, époux de Marie Lejeune, qui remplit les mêmes fonctions (1730, 1741), après son père. son grand-père et son aïeul. Jean-Louis était petit et de coloration noirâtre : à en croire une mauvaise langue de l'époque, il mesurait 3 pieds 1/2 seulement et paraissait « plus noir que nègre ». On note aussi Marguerite, fille de François et de Jeanne de Fonmartin, devenue femme (en 1668) de Jean Combes, bourgeois de Saint-Angel, né par sa mère des La Salvanie; Antoine, qui, entre le 6 août 1765 et le 1er janvier 1784, eut treize enfants de Charlotte-Claudine Autier de Villemontée; Marie-Antoinette, épouse d'André-Robert Vi 11 il tel (1773). Le père Delmas, cordelier, fut en son temps (1720, 1762) « célèbre par ses voyages du Levant. Il avait visité tous les lieux de la Palestine consacrés par la résidence du Sauveur, et en avait fait une relation qui n'a pas été imprimée » (34). Parmi les autres, on peut citer un vicaire d'Ussel (1726), un directeur du collège (1730), un curé de La-Mazière(-Basse) (1762-1772), un maire de la cité (1769). Une fille, Antoinette, vécut « dévote du Tiers-Ordre de Saint-François » (1730, 1778) (35).
Dans la branche cadette, Antoine Delmas, écuyer, docteur en médecine, était le fils d'un frère de Pierre. Des six enfants que Jeanne Desplas lui donna, le 4° devait être le lieutenant-général Jean-Baptiste Delmas de la Rebière. Né le 11 mai 1724, marié à Louise Despert de la Borderie
(34) P. 34, « Histoire de la ville d'Ussel », de J.-B. DELMAS, son petitneveu.
(35) Armes des Delmas (de Grammont) : de sinople îi trois fasces ondées d'argent. -- - L'auteur de la loi protectrice des animaux, du 2 juillet 1850, est un Delmas de cette branche.
(1753), Jean-Baptiste se titrait (1780) « chevalier, seigneur de Naugenac, du Veisset, du Chiroux, co-seigneur de la Rebière et du Mont » (36). Avocat en Parlement, gendarme de la garde ordinaire du roi, subdélégué dans la généralité de Limoges, il fut d'abord lieutenant particulier (1761) avant d'être nommé lieutenant-général (1772). Il eut la gérance de la mairie pendant la suspension du titulaire, Firmin Barbier de Villeneuve, de 1776 à 1780. La nuit fameuse du 4 août, en abolissant l'organisation existante, fit perdre à Delmas charges et dignités. II reçut, mais ne garda point, la présidence du Tribunal constitué en remplacement de la justice seigneuriale. Porté sur la liste des émigrés, rayé de la liste le 29 messidor an III, il s'éteignit le 21 juillet 1810, à 86 ans, comme il publiait la 2" édition de son Histoire d'Ussel. Un arrêt du Parlement de Bordeaux, de 1784, annulé par le 4 août 89, avait accordé la survivance de la lieutenance-générale à son fils Antoine, seigneur de Loches et du Loubeix, subdélégué de l'Intendance à Ussel (36).
(36) Reg. par. d'Ussel. - Naugenac, par. de Soursac. Le Veysset, Chiroux, la Rebière, par. de Chaveroche (1744 : « .Antoine Delmas, docteur en médecine, acquéreur du domaine de la Rebieyre. » Arch.
Cor., B. 652). Le Mont, par. de Saint-Fréjoux..1672 : François Delmas, avocat, possède Chiroux et le Veysset.
Delmas écrivit encore un Essai sur l'histoire du duché de Ventadour et de la maison de Rohan, dont le manuscrit fut, au cours de la Révolution, brûlé sur la place publique.
J.-B. Delmas ne dit pas comment ses ancêtres — ni lesquels — ont été anoblis. Le mot « écuyer » titrant son père a été ajouté sur son acte de baptême (14 mai 1724). — Du côté des Grammond, collatéraux, on descend jusqu'à Jean-Louis, contemporain de Jean-Baptiste et de son père, pour rencontrer ce titre. (Retenir que les Delmas furent des magistrats seigneuriaux, et non royaux; d'autre part, que les Ventadours ne possédaient pas le droit d'anoblir.) — Avant la scission en deux branches (1670), aucun Delmas n'est qualifié d'écuyer ou de chevalier, aucun n'est trouvé gentilhomme. — Un moraliste du XVIIIe siècle constatait que trop de gens prenaient des titres auxquels ils n'avaient point droit.
(36) Arch. Cor., B. 634, B. 473. — DELMAS, id., p. 75, renvoi 1.
Une nièce du lieutenant-général, Marie-Agathe Delmas (1782-1864), épousa, le 13 floréal an X, Michel Lacliaze, fils de Joseph et de Marie Bayle, petit-fils de Paul et de Marie Lacliau. Ce Joseph était veuf en
Les occupations du lieutenant-général étaient absorbantes. Lui incombait tout le travail de président, qu'aurait dû faire le sénéchal, et, en outre, il menait l'instruction des affaires pénales. Le premier des deux assesseurs, dénommé lieutenant particulier, lui venait directement en aide, tandis que le deuxième assesseur, le conseiller, remplissait seulement les fonctions de juge. Vous avez remarqué l'appellation de ces magistrats : c'était la même que dans les présidiaux. Leur prestation de serment s'effectuait devant le lieutenant-général. Ainsi que ce dernier, ils achetaient leur charge, ce qui les rendait, comme lui, indépendants et inamovibles, sauf « forfaiture préalablement jugée » (37) (le cas devait se produire peu d'années avant 1789).
Gaspard de Lametz était lieutenant particulier en 1623 (probablement dès 1605), Joseph Chavialle en 1630 (38), Jean-François Clédière, sieur du Rigouneix et du Gardet, en 1647; Jean de Bonnet en 1660, Joseph Barrot en 1708 (39), Pierre-Léonard Diousidon en 1721, Pierre Duplantadis en 1740, Pierre Demichel en 1758, Jean-Baptiste
premières noces, sans enfant, de Marguerite (de) Labarre : il tenait d'elle le fief de Saint-Germain(-la-Volps). Marie-Agathe et Michel sont les grands-parents de Gaston de Lacliaze, avocat, maire d'Ussel (+ 1912), et de Mme Marthe Mazelreix, toujours vivante (décembre 1939).
(37) En application des lettres le Louis XI, du 21 octobre 1467.
(38) 1630 : Joseph Chavialle, époux de Marguerite de Lametz, 1630, 1641 : Jacques Larnetz, sacristain, 1638 : Isabeau de LaIIietz, femme de Jacques Breulh, docteur en médecine (consul en 1637). 1637, 1662, Honorette de Lametz, épouse de Jean (de) Forsse, bgs d'Ussel.
(39) Barrot. — 1667 : Marguerite (de) Barrot, femme de Joseph (de) Combes, Sr de Chassaignolles (Valiergues). 1680 : François, consul, époux de Charlotte Musnier; 1690, Anthoine, prestre et docteur en théologie. — Joseph (de) Barrot, Sr de la Gorse, (1719), fils de François et de Charlotte, marié à Marguerite Chaminade (1690), advocat en parlement (1690), juge du Port-Dieu (1695), capitaine-major de la milice bourgeoise d'Ussel (1699-1706), lieutenant particulier (1708), (+ 13 décembre 1719). — 1743 : Jean-François, bachelier de Sorbonne, curé du Bourg-Lastic. 1759 : Hélène de Charlus, veuve du Sr Barrot; 1780 : Antoine, avocat au siège, juge de la Gane et de Veyrières — (Reg. par.; Bull. Soc. Hist. Cor., XXII; CHAMPEVAL; DELMAS; Doc. personnels.)
Delmas de la Rebière en 1761, Jean-Joseph Brival de Lavialle en 1772, Pierre Bonnot de Bay en 1786 (40). — Pierre de Mary (1639), Pierre du Couderc, sieur de la Veyssière (1648), Jean du Couderc (1684) (41), Joseph-François Bonnot, sieur de Bay (1725), Guillaume Demichel (1774), détinrent la charge de conseiller (42).
, Oh note des Bonnot à Ussel en 1599. Dans la suite, Antoine, sieur de Chasselines, est procureur du roi en l'élection de Tulle; Jean, son fils, Etienne et Martin, acquièrent des charges de conseillers en la même élection (1624, 1647, 1677); Pierre est avocat principal à Ussel (1661), un autre Antoine syndic de l'hôpital (1680). Un fils de Jean, Pierre (de) Bonnot, sieur du Monteil, lieutenant de cuirassiers,
mort en 1735, épouse (1703) Jeanne Lavai, qui lui porte en dot la terre de Bay, dont se qualifie l'aîné de leurs enfants, Joseph, conseiller du sénéchal (1725). Ce Joseph, mari d'Anne Lacroix, est le père de Jean-Baptiste Pierre, dit Piarretou (1753), qui lui-même fait alliance avec Catherine du Couderc et devient (1786) lieutenant particulier au siège. Des autres enfants de Joseph et d'Anne, une fille, Jeanne, est la femme d'un sieur Richon, une deuxième Jeanne celle d'un Rochon de Montazel, cependant que Marie-Anne et une troisième Jeanne s'unissent tour à tour, en 1767 et 1778, avec
(40) Reg. par.; Arch. Cor., B. 638, B, 505; B. 417, B. 422, B. 447, R. 457, B. 472, B. 716. — CHAMPEVAL, id., 263, et HUOT.
(41) Du Couderc. — 1638 : Pierre Couderc (du Couderc, 1661), S* de la Veyssière (Ussel), advocat en la Cour (1645), époux de Jacqueline Bonnot (1645), conseiller au siège (1648-1672). 1666 : Antoinette, mariée à Pierre Delmas de Grammond. 1680 : Jean, Sr de la Veyssière, époux d'Antoinette Nochèze, conseiller (1684) (+ 1er novembre 1721). 1689 : M. du Couderc, consul. 1690 : Antoinette, veuve de Pierre Laporte.
1694 : Marguerite (de) Monloys, veuve de Hélie du Couderc. 1707 : Antoinette du Couderc, mariée à Guillaume Dufour (+ 1713), secrétaire du Roy. 1716 : Margueritê (fille de Jean et d'Antoinette Nochèze), épouse d'Antoine de Bonnet. 1764 : Catherine, mariée à Pierre Bonnot de Bay. 1663, Jean, 1769, Jacques, prieurs et curés de la Tourette.
1782, Pierre Léonard, époux de Léonarde Méalet. (Reg. par., CIUMPEVAL; POULBRIÈRE; Doc. pers.et divers.)
(42) Arch. Cor., B. 496, B. 505, B. 417, B. 438. B. 465, B. 716, et reg.
par. d'Ussel.
Augustin de Tournemire, paroissien de Chirac. Le fils du lieutenant Pierre, Jacques, époux de Madeleine Monteil (1795), est l'aïeul des Bonnot que nous avons connus (43).
Martin Demichel, procureur au siège ducal (1624), fut consul d'Ussel en 1644 et 1645. De Pierre, notaire et procureur (1666), juge de la Garde et de Chasselines, procureur d'office d'Aix et d'Eygurande (1676) (44), époux Andrieu (1677), et de Jean, fils de celui-ci, également notaire et procureur (1708), agent du duc de Ventadour (1723), juge du Port-Dieu et d'Aix (1735, 1751), marié à Marguerite Pascal (1711), est issu Pierre-Léonard Demichel, tenu sur les fonds baptismaux, le 17 février 1723, par Pierre-Léonard Diousidon. Contrôleur des actes (1741), directeur des fermes du Roy (1751), juge d'Aix, d'Eygurande et du Port-Dieu (1751, 1757), seigneur du Theil et de Saint-Dezéry (postérieurement au 13 juin 1752, date du décès de Joseph Andrieu, titulaire de ces fiefs), lieutenant de la commanderie de Belle-Chassagne (1758), enfin lieutenant particulier au siège, (1759), Pierre-Léonard Demichel eut de sa femme, Jeanne de Fonmartin de Lespinasse : Guillaume, avocat en parlement, reçu conseiller au siège en 1774; Antoine, docteur en théologie, chapelain de Malte, vicaire de Gimel, curé d'Ussel (1802, 1817), « dernier d'une race éteinte » aujourd'hui, « grand cœur et grand d'âme », selon les expressions de son
(43) Reg. par.; Bull. Soc. Hist. Cor., XXIII et XXII; Doc. personnels et divers. — Antoine (de) Bonnot : époux de « damoiselle » Anthoinette (de) Forsse, fille de Jean et d'Honorette de Lametz. - L'hôpital d'Ussel dont il fut syndic a été fondé, l'an 1269, suivant « lettres données par les seigneurs Eble de Ventadour et Hélie d'Ussel, damoiseaux, aux consuls de la ville d'Ussel pour recevoir, autoriser et approuver la donation que font Aymar, dit de Geneau aux Pratz* et Jeanne del Veldior, dite la Douairière, d'une maison et dépendances sises audit lieu, pour les pauvres et même pour les passants ». Un vidimus de cette charte est aux Archives municipales. Il en existe un autre, du 11 septembre 1766, dans les Archives du comte d'Ussel, à Neuvic.
(44) Le procureur d'office « était celui qui faisait les fonctions de ministère public dans une moyenne ou basse justice seigneuriale. On l'appelait procureur d'office parce qu'il pouvait agir ex officio, c'està-dire d'office et de son propre mouvement, sans aucune instigation ni réquisition de partie » (Encyclop. méth. du XVIIIe siècle).
biographe (45); Marie-Victoire, sœur jumelle d'Antoine, qui contracta mariage à Ussel, le 3 février 1780, avec le chevalier Gaspard de Pouthe; et Marie-Jeanne, qui, au même moment, épousa le frère de Gaspard, François-Augustin de Pouthe, chevalier, garde du corps, et vint demeurer au château de Mareille, près du grand'oncle et de la grand'tante de son mari, Antoine de Pouthe et Marguerite de Monloys (46).
Assistant les magistrats, établissant les minutes, délivrant les grosses, le personnel assermenté du greffe comprenait le greffier en chef et un ou plusieurs greffiers commis. Gérald Laval (1623), Guillaume Lescrivain (1628), Mondon (1703), Antoine Lescrivain (1704), Pierre Moncourrier (1737, 1753), Antoine Redon (1768), Pierre Moncourrier de Beauregard (1777) ont été greffiers en chef. Maignac (1700), Diouzidon (1744), encore un Maignac (1744), Queyriaux (1749), Martinot (1753), Gendre (1759), Dupeyroux (1759), François Badour (1760), Eybraïlh (1763), François Redon (1773), un Moncourrier (1778), Goudounèche (1787), Rouffiat (1787), furent greffiers commis. Le greffier en chef, bien qu'il ne perçût aucun émolument pour les affaires concernant le duc, devait verser à celui-ci, chaque année, le mon-
(45) Raymond LACOSTE, id., p. 48.
(46) Reg. par.; Bull. Soc. Hist. Cor., XXIII; Doc. divers et personnels.
Joseph Andrieu, seigneur du Theil et de Saint-Dezéry (+ 1752), devint, par son mariage avec Antoinette l'Ebraly, le beau-frère de Jean Forsse, bgs d'Ussel, mon ancêtre, et de Annet Sauty, seigneur de Chalons, notaire royal.
Les Andrieu, bgs, détenaient le Teil (Ussel) depuis 1630. Ils eurent, 1625, la sieurie de l'Ebraly (Saint-Dezéry). A partir de 1629, ils possédèrent Bay (La Tourette) dont une de leurs branches se titra. C'est d'eux que Bay vint aux Bonnot, la mère de Jeanne (de) Laval étant Marguerite Andrieu de Bay — sœur aînée d'une autre Jeanne qui épousa Pierre Demichel (1677).
Les seigneurs de la Ganne (Saint-Exupéry) (1500-1630), de Roussilhe (Bort), la Maison-Rouge (Saint-Bônnet-le-Port-Dieu), qui avaient nom Andrieu, étaient écuyers. (Reg. par. — CHAMPEVAL : Bas-Lim.)
tant du bail de son greffe (200 livres en 1777) (47). Pierrè Moncourrier et son fils, Pierre Moncourrier de Beauregard — fils et petit-fils d'un notaire et procureur à la sénéchaussée (1668) — étaient aussi notaires et procureurs, en même temps que greffiers en chef (48). Le premier épousa Marie Monlouis; le second, Marianne Mornac de Badour. Ils appartenaient à une famille essentiellement usselloise, connue depuis la fin du XVIe siècle, éteinte en ces dernières années (49).
Voilà pour le siège. Auprès des trois juges le duc de Ventadour avait placé un avocat et un procureur qui le représentaient et requéraient en son nom. Ces officiers, d'abord ducaux, ensuite principaux (50), ou encore « du prince », représentèrent au XVIII" siècle les princes de Rohan-Soubise que leur alliance avec la fille du dernier Lévy (1694) avaient faits ducs de Ventadour. De même qu'on trouvait ailleurs les gens du roi, ils étaient, eux, les gens du prince.
Comme avocats, il y eut : 1623, Jehan Clédière, sieur du Breuil (51); 1630, Anthoine Esparvier; 1661, Pierre (de)
(47) Lettres de provision du 20 mars 1777 (Arch. Cor., B. 461).
(48) Arch. Cor., B. 419, B. 469, B. 461, B. 637, B. 569, B. 521, B. 449.
Arch. personnelles.
(49) Reg. par. et de l'état civil d'Ussel; Arch. Cor., B. B. 22.
(50) On note le mot principal (« advocat principal ») dès 1625 dans les actes baptistaires de l'église Saint-Martin d'Ussel. En 1662, dans le contrat de fondation du couvent des Récollets, signé le 25 octobre à « l'hosteil Vantadour », cette même expression est employée. Elle désignait l'avocat le plus important, et le premier de tous, comme étant du siège.
(51) Sur les Clédière et sur les Esparvier, voir : J. FAUCHER, « Vieilles maisons, vieilles familles d'Ussel. » (1 br., 1939.) Jehan Clédière : Sr du Breuil et de Rigannes, advocat en la Cour du Parlement de Bourdeaux (1623), advocat principal de Vanthadour (1626), procureur principal du duché de Vantadour (mars 1628), procureur général de Monsieur de Vantadour (novembre 1628) ; feu Me Jehan Clédière, procureur général et domanial du duché de Vanthadour (20 mars 1630). — Anne de Mary, sa veuve (1631, 1670).
Catherine de Clédière, leur fille (+ 1693), épouse vers 1640 Mathieu Forsse, bgs, consul (1646).
Jean-François Clédière, lieutenant particulier; marié (avant 1647)
Bonnot; 1683, Jean du Couderc (52); 168., Pierre (d')Esparvier (53); 1699, 1705, François Delmas de Grammont; 1735, 1762, Antoine Chaminade (54); 1769, Antoine-Joseph Monlouis; 1787, Pierre-Marc Monlouis de Laval; — comme procureurs : 1628, Jehan Clédière, sieur du Breuil; 1632, François Delmas, sieur de Grammont; 1681, Pierre Delmas de Grammont; 1707, un autre François Delmas de Grammont; 1730, Jean-Louis Delmas de Grammont; 1742, Antoine Chas'tagner du Teil ; 1769, 1786, Pierre-Joseph Chastagner du Mazeau. Le lieutenant-général recevait leur serment (55).
à Marguerite (de) Laval. Sa fille, Anne de Clédière, filleule d'Anne de Mary, épousa, 10 février 1669, François Dubois, écuyer, SI' de Clavières, frère du seigneur de Margerides.
1623 : noble Jehan de Clédière, vice-sénéchal pour le Roy au païs de Bas-Limousin.
Pierre de Mary, seigneur de Curziat, vice-sénéchal du Limousin, marié, en décembre 1609, avec Catherine d'Ussel, fille d'Antoine, chevalier, baron de Châteauvert, coseigneur d'Ussel, et de Claudine de Lestrange. — 1639, 1646, Pierre de Mary, conseiller au sénéchal. 1679, « feu Messire Martial de Mary, vivant vice-sénéchal du Bas-Limousin ».
1700, Jean de Mary, sieur de Laval. (Reg. par. d'Ussel. Bull. Soc. Hist.
Cor. Arch. Cor., B. 498.)
(52) Au 17 octobre 1684, sur les registres d'Ussel, on remarque cette mention : « M. de la Veyssière, avocat fiscal. » Ceci laisse penser que Jean du Couderc fut avocat principal entre le 28 juin 1682 (« advocat en la Cour ») et le 23 octobre 1684 (« conseiller au siège » ).
(53) « 17 juin 1692 : Marguerite de Laval, veuve de M. Pierre d'Esparvier, avocat principal au siège sénéchal de cette ville (Reg. de la par. d'Ussel).
(54) Chaminade. 1545 : Michel Chaminade (Livre Noir). 1553 : Chaminade, consul. 1559 : X. Chaminade (établissement de la sénéchaussée). 1670 : Antoine, bgs, époux de Marie-Marguerite Dallet; juge de Bonnaigue et de Monestier (1692), de Bonnesaigne (1694). Marguerite, leur fille, mariée à Joseph Barrot (1690, 1706). — 1680, Annet et, 1681, Antoine, notaires et procureurs. 1703 : Pierre, « philosophe ». 1707 : Guinot, praticien. 1721 : X. Chaminade, vicaire à Ussel. - 1704 : Antoine, avocat principal (1735, 1762), et Marie-Jeanne de Plasse du Chassaing, son épouse. Leur fils, Antoine-Xavier, sieur de Montéjoux, marié (1744) à Marie-Anne Désortiaux de la Ceppe. Leurs petitesfilles : Marie-Michelle, femme (1763) de Jean-Baptiste Forsse; Marguerite, unie (1772) à Mathurin du Faure. — 1770 : Marguerite, fille dévote du tiers-ordre de Saint-François. (Reg. par.; Bull. Soc. Hist.
Cor.; HuoT; Doc. pers.)
(55) Reg. par. d'Ussel; Arch. Cor., B. 422, B. 615, B. 494, B. 414 et supplément; et HuoT, id., p. 104.
A l'origine, l'avocat avait la prééminence sur le procureur et, en la pensée du duc, constituait le plus important des deux agents. C'est du moins ce qui ressort du règlement sur les préséances, du 15 novembre 1599 (56). Mais, dans la suite, on vit au contraire le procureur, chef d'un parquet organisé, primer hiérarchiquement l'avocat réduit à n'être plus désormais qu'une sorte de substitut. L'une des causes de cette transformation fut assurément l'imitation des cours royales, qui ne cessa de hanter nos magistrats, dont la juridiction avait une étendue supérieure à celle de certains présidiaux.
Mialaret, le Teil, le Vige, les Vergnes, le Mazeau — domaines de la région de Neuvic - fournirent des surnoms aux Chastagner. Procureurs ducaux, les Chastagner détinrent eux aussi la subdélégation de l'intendance au XVIIIe (1742-1769). Pierre-Joseph, fils d'Antoine et de Marie-Anne Giraud, s'unit à Marianne Ternat, parente de Pierre Ternat, curé d'Ussel (1761-1783), ancien curé de Neuvic, originaire de Mauriac; et de ce mariage sont issues les générations qui ont perpétué la famille jusqu'à nos jours. Thérèse eut pour mari (1752) Joseph de Plaigne, écuyer, seigneur de Pradniau, et leur fille Clémence, Pierre Salviat, avocat, rereveur domanial. Le fils du dernier procureur, Jean-Joseph, épousa Marie-Magdelaine de Cosnac. En 1685, on rencontrait à Ussel Pierre Chastagner, sieur du Mialaret; en 1676, Marguerite Pradinas, « veufve de Jean Chastagner, avocat »; et, en août 1666, Marguerite Chastanier, veuve de Michel Tixier, bourgeois, dont le fils Jean, avocat, célébrait sa noce avec Jeanne de la Farge (57).
Assez nombreux, les Monlouis descendaient de ces Monloys dont j'ai parlé dans mon étude sur les « Vieilles familles ». Habileté, décision, énergie, telles sont les qualités que
(56) « Règlement accordé pour les précéances et démarches de Messieurs les officiers et consuls de la ville d'Ussel. » (Reproduit Bull.
Soc. Hist. Cor., XXIII, 454-455.)
(57) Reg. par.; Arch. Cor.; CHAMPEVAL, Dict. des familles, I. 508; Documents personnels,
montrèrent les Monloys, notamment Martin, dont la belle attitude, en 1532, rangea les siens parmi les meilleurs ussellois. Les Monlouis, riches bourgeois titrés, de cette catégorie sociale qu'on a qualifiée de sous-noblesse, possédèrent un certain nombre de terres : Mareille, Consergnes, la Rebeyrotte, Loche, le Maschat, le Masviel, le Gardet, la Grange du Bost, Pontic, Rouberteix, Toylias, sur la paroisse d'Ussel; Séjéat, sur la paroisse de Saint-Exupéry; la Maison-Rouge et Sudrie, sur la paroisse de Saint-Bonnet-le-Port-Dieu (58).
La branche d'Ussel, tige originaire, produisit des avocats, des procureurs, des notaires, des juges seigneuriaux, un receveur d'amendes, des consuls, un maire électif, des prêtres, des magistrats (Guinot, 1624, 1635); Michel, 1629, 1647; Joseph, 1676) au tribunal d'élection qu'Ussel posséda quelque temps. Elle s'est alliée aux Clédière, aux Bonnot, aux Laval, aux de la Farge, aux de Bonnet, aux Esparvier, aux Jaloustre, aux Andrieu, aux du Couderc, aux Bastisse, aux Pascal, aux Demichel, aux Giraud, aux Danjolie (famille de la mère de Marianne Ternat), aux Rochefort, aux Désortiaux de la Geneste. Antoine épousa (1764) Thérèse Forsse dont le père, Joseph, est le trisaïeul des Forsse encore vivants (58 bis); leur fils, Antoinette Choriol de Ruère, fille de Jean Choriol, ci-devant seigneur de Ruère et notaire royal d'Eygurande. Marie-Jeanne (+ 1763) revêtit le costume gris et blanc des Menettes de Saint-François; MarieUrsule (+ 1758) et Jeanne (+ 1779), le costume noir et blanc des Menettes de Saint-Dominique : c'étaient deux sociétés de pieuses filles qui, explique Delmas (59), « ne faisaient point de vœux, mais vivaient dans une grande régularité, donnant aux enfants les premiers principes de la religion et de la piété, et s'occupant des œuvres de charité recommandées par l'Evangile ». De la branche d'Ussel se
(58) CHAMPEVAL : Bas-Lim., passim.
(58 bis) En 1939, lorsque ces lignes furent écrites. Depuis, les Forsse d'Ussel sont décédés (juin-août 1941). — Les Forsse avaient leurs tombeaux dans l'église paroissiale, au temps de la sénéchaussée. Six d'entre eux y ont été inhumés entre 1669 et 1733 (Reg. par.).
(59) Id., p. 96,
détachèrent, au cours du XVIIe, les Monloys de Mareille et les Monloys de Séjéat. Jean de Monloys, seigneur de Séjéat et de la Maison-Rouge, épousa (vers 1730) Marie de Labarre de Saint-Germain. Joseph-François, seigneur de Séjéat, était allié aux Dupuy de Mirambel (1765). Une petite-fille de Joseph, Gilberte-Marie Monloys, devint, le 18 fructidor an XIII, la femme d'Antoine Laveix, notaire, et lui donna une postérité qui se continue à Séjéat. Ceux de Mareille se distinguèrent par leurs alliances. Marguerite de Labarre de Saint-Germain s'unit à Léonard de Monloys, « seigneur dudit lieu ». Leur fils, Martin-Joseph (1697-1769) (60), entra dans une famille de haute chevalerie en obtenant la main d'Aimée de Lentillac, propre nièce du marquis de Sédières.
De cette union naquit, le 14 décembre 1733, Marguerite de Monloys, qui devait être la femme d'Antoine de Pouthe de la Roche-Aymon, seigneur de la Ville-du-Bois (61).
Dans ce tribunal tranquille, où ne paraissait probable aucune complication grave, il semble qu'une entente parfaite, une mutuelle estime, une confiance réciproque dussent exister entre les magistrats. Il n'en fut pas toujours ainsi, et des dissentiments s'élevèrent en plusieurs circonstances. Je laisse de côté le mémoire Diousidon, excessif et empreint de parti-pris. D'autres pièces sont plus sûres, dont je vais me servir pour citer quelques-uns des faits, heureusement rares, mentionnés dans les archives.
Jean-Louis Delmas et Antoine de Bonnet s'affrontèrent (1746) dans un procès pour affaires de famille. Ils étaient apparentés. Le cousinage résultant de l'union de Jean de Bonnet et de Marie Delmas de Grammont avait été resséré par des alliances communes avec les du Couderc : par celle du grand-père de Jean-Louis Delmas avec Antoinette du
(60) « M. Monlouis de Mareille de la Rebeyrotte. » (1747.) (Arch.
Cor., B. 704.)
(61) Dans la Haute-Marche, près d'Evaux, diocèse de Limoges. Reg.
par.; Doc. divers et personnels.
Couderc, en 1666, et par celle du père d'Antoine de Bonnet avec Marguerite du Couderc, en 1716. Marguerite descendait de Pierre, père d'Antoinette. Cette parenté assez étroite fut la cause du procès. Bonnet gagna au fond; mais, comme chacun avait, dans l'ardeur de la polémique, inséré, en ses écritures, des termes inj urieux pour l'adversaire, Millange, rejetant les demandes de réparation d'honneur, mit sur ce point les parties hors de cour (62).
Delmas de la Rebière, lieutenant-général, et Brival de Lavialle, lieutenant particulier, furent en désaccord. Vous verrez ce qui en résulta, en 1784, de leur mésentente (63).
Un jour, à l'audience, le lieutenant particulier Diousidon et le conseiller de Bay protestèrent contre l'habitude du lieutenant-général de prendre seul certaines décisions. JeanAntoine de Bonnet répondit : d'où s'ensuivit une altercation très vive (64).
Cet incident-ci ne fut, au fond, qu'une manifestation de l'inimitié persistante des Bonnot envers les Bonnet. En 1753 cette inimitié durait « depuis près d'un siècle » (65). L'épisode navrant que voici, succédant à des menaces, des injures, des tentatives d'agression, provoqua une information judiciaire.
Vers dix heures et demie du soir, le dernier dimanche de septembre 1753, Antoine de Bonnet, maire d'Ussel, venait de se coucher en sa maison donnant sur la Place, derrière l'église, quand il entendit frapper au heurtoir de la porte d'entrée. Il se leva, ouvrit une fenêtre, et aperçut un petit drôle qui lui dit apporter une lettre pressante de M. de Saint-Angel (66). Seul ce soir-là, sa jeune femme et ses domestiques étant restés à la Chabanne, il endossa une robe de chambre et, sans bas ni culottes, en coiffure de nuit, un flambeau d'argent à la main, descendit du premier étage.
Le drôle ne se trouvait plus à la porte. Bonnet pensa qu'il
(62) Arch. Cor., B. 521.
(63) Arch. Cor., B. 468.
(64) Arch. Cor., B. 854.
(65) Arch. Cor., B. 854.
(66) Messire de Clary, chevalier, baron de Saint-Ange], conseiller en la Cour des aides de Clenyiont,
était allé s'asseoir sur un banc de la boucherie disposée vis-à-vis et « au-dessous » de l'immeuble. Posant le flambeau sur les dernières marches de l'escalier, il sortit et s'avança vers la boutique. Pas de bruit dans la rue; les gens dormaient, ou se mettaient au lit. Après avoir fait quelques pas, il fut tout à coup assailli par quatre individus munis de gourdins et d'armes, qui le saisirent, deux par devant, deux par derrière, le frappèrent d'un coup de bâton dans le dos, d'un autre coup sur le front, lui donnèrent un coup de poing dans l'œil, écorchèrent son visage avec les ongles, et tentèrent de l'assommer par un nouveau coup de bâton sur la tête que Bonnet parvint à éviter. Aux cris de : Au feu! on m'assassine! poussés par le seigneur de la Chabanne, des voisins ouvrirent leurs volets : aussitôt les malandrins lâchèrent prises, et leur victime courut se réfugier dans la maison du sieur de Mareille, en face de la sienne, « devant l'église ». Joseph de Monloys rentrait de « souper » en ville. Il accueillit Bonnet sur le pas de sa porte, à la seconde même où une balle tirée par un autre bandit caché dans un recoin, manquant son but, passait en sifflant au-dessus de leur tête et allait frapper le volet puis ricocher sur une vitre de la fenêtre basse du sieur de Mareille.
Antoine de Bonnet, « pâle et ensanglanté », avait, rapporteront des témoins, « une grande noirceur et contusion sur un œil, le visage égratigné, une blessure dans le coude du bras droit, et une autre noirceur au bas de la main, où il disait avoir été mordu ». On lui donna les premiers soins.
Accompagné par M. de Mareille et suivi de deux ou trois personnes, il rentra chez lui. Bonnet constata que le flambeau était éteint; il s'assura qu'aucun malfaiteur ne se cachait dans les pièces et, après avoir reçu quelques visiteurs et vérouillé soigneusement sa porte, il se recoucha. Le lendemain tout Ussel prononçait le nom des coupables, et le surlendemain la grand'mère et mère de ceux-ci venait en pleurant exprimer ses regrets à la victime de l'odieux guetapens (67).
(67) Arch. Cor., B. 854, B. 857. — Celui qui tira la balle était le père des jeunes gens qui assaillirent Bonnet lorsqu'il s'avança sur la place,
Des magistrats, passons aux hommes d'affaires. Pour postuler au nom des plaideurs et défendre leurs causes, il y avait des procureurs — les avoués d'aujourd'hui — et des avocats. Ces hommes de loi étaient nommés par le duc.
Les procureurs recevaient des lettres de provision. Presque tous joignaient à leur charge celle de notaire et cumulaient ainsi deux offices distincts. Ils furent nombreux et s'appelèrent Andrieu. Arestier, Aubar, Audouze, Badour, Bastisse, Bessoles, Bonnet, Bonnot, Bonsir, Bosdeveix, Bourzac, Cayre, Ceyrac, Chabanes, Chaminade, Chassagnac, Chaudergues, Conchon, Couffy, Danail, Daubard, Delfau, Demichel, Desplas, Diousidon, Dupuy, Durand, Durand de Beauregard, Durriou, Esparvier, Forsse, Fourest, Friou, Giraud, Giroud, Goudounesche, Guinard, Holier, Jaloustre, Laval, Laveix, Lavigne, Lescrivain, Loche, Longevialle, Martinot, Meschin, Millac, Moncourrier, Moncourrier de Beauregard, Mondon, Monlouis, Monloys, Nochèze, Pascal, Paynot, Pelletaud, Plaze, Pollot, Pradinas, Redon, Rochefort, Roubinet, Roudet, Roussange, St-Supéry, Tessier, Tournadre, Triou, Vergne, Vermeil, Vialatte, etc. Parmi les avocats, on remarque Barrot, Berbray, Bertrand, Blanchet, de Bonnet, Bonnot de Bay, Boyer, Brival, Brousse, Chabanes, Chaminade, Chastanier, Chavialle, Clédière, Counil, Delmas, Desper, Diousidon, Du Couderc, Dumon, Du Plantadis, Esparvier, de Foninartin, Forsse, Galand, de la Farge, de la Geneste, Labou- • noux-Desvergnes, Langlade, Lavergne de Lajugie, Lescrivain, Lissac, Longevialle, de Monloys, Monlouys, SaintSupéry, Sauty de Châlons, Sudour, Tixier (68). Avocats et procureurs avaient leur doyen.
Avant d'entrer en fonctions, ils devaient, devant le tribunal assemblé, prêter serment « de bien et fidèlement exercer leur profession en leur âme et conscience ». Ils pro-
Bonnet porta plainte en s'adressant par « requête, au lieutenantgénéral criminel ès sièges royaux de la ville de Tulle ». (Jarrige du Bournazel.) (Arch. Cor., B. 854.)
(68) Arch. Cor., B. 414 à 493 et B. 501 à B. 687, passim; Reg. par.; HUOT; divers, -
mettaient spécialement de « prêter leur ministère aux pauvres gratis » (69) : et ceci montre que l'assistance judiciaire était pratiquée avant qu'une loi en consacre l'obligation.
Les honoraires des procureurs, fixés par un tarif semblable à celui des cours présidiales du ressort de Bordeaux, furent augmentés le 14 janvier 1744 (70).
Conformément à l'ordonnance royale de 1667, le serment était renouvelé tous les ans, à l'audience de rentrée. Ce jour, le tribunal se rendait en cortège et en robe « dans la chappelle du palais et du collège », à moins que ce ne fût à l'église paroissiale, où il entendait la messe solennelle du Saint-Esprit, précédée du chant du Veni Creator (71). Après quoi, l'audience s'ouvrait « au palais du sénéchal ». Avocats, procureurs, greffiers, huissiers, chacun à tour de rôle, à l'appel de son nom, s'avançait, montait sur le siège et, « devant la Passion figurée de Notre-Seigneur JésusChrist », « entre les mains du lieutenant-général », réitérait le serment, « la main levée à Dieu et un genou en terre » (72).
En dépit de belles qualités, ces hommes ne furent pas sans reproche. A plusieurs reprises la sénéchaussée dut sévir contre eux. C'est ainsi qu'en 1717 il fut interdit à Guillaume Meschin d'exercer pendant quelques temps, parce qu'il s'était, en diverses occasions, ingéré dans la connaissance des causes « nonobstant la présence des magistrats » et « sans suivre même l'ordre du tableau » (73). En 1735 le procureur Chabanes ayant, à l'audience, « manqué de respect » envers le lieutenant particulier Diousidon, celui-ci demanda réparation de « l'injure », et le tribunal, après réquisitoire de l'avocat principal Xavier Chaminade, con-
(69) Arch. Cor., B. 467, 5e feuillet.
(70) Arch. Cor., B. 425.
(71) La dernière messe célébrée « dans la chappelle du collège »,
est du 12 novembre 1789. (Arch Cor., B. 478.)
(72) Arch. Cor., B. 459, B. 4(;3, B. 471, B. 469.
(73) Arch. Cor., B. 642.
damna Chabanes à rester en prison tout le jour et le suspendit pendant trois mois (74).
Au degré inférieur, les huissiers - parmi lesquels Beaune, Bonnefon, Bouhaud, Bourdanchon, Bousset, Chaize, Chiniac, Chirol, Continsouzas, Diousidon, Goudounèche, Ignie, Machat, Maignac, Marchandon, Mauriac, Mongenot, Montanier, Peyrelade, Pourville, Pradinas, Vedrenne, Vennat — méritèrent, eux aussi, des punitions sévères, L'un, étant « d'une ignorance crasse », dit le texte, dut rembourser les frais qu'il avait engagés dans une saisie. Pour négligences jugées inexcusables, un autre subit la suspension temporaire. Un troisième, ayant fait à tort un procès-verbal d'exécution, paya dix livres de dommages-intérêts. Une amende de vingt livres fut infligée au sieur Besson qui avait exploité sans être provisionné ni avoir prêté serment. Un autre encore, fils d'huissier, s'étant attribué le titre et les fonctions, avait été ajourné devant le tribunal et subissait un interrogatoire au moment, heureux pour lui, des événements de 1789 (75).
Mais voici que les officiers du siège — sanctionnant leurs subordonnés hiérarchiques — étaient à leur tour frappés par leurs supérieurs. En 1741, le duc de Ventadour révoquait Jean-Louis Delmas, procureur principal (76). En 1784, la Souveraine Cour du Parlement de Bordeaux, dont ressortissait la sénéchaussée, punit sévèrement le tribunal pour une faute qui, maladroitement révélée, parut grave. Il s'agissait de ces épices sur lesquelles comptaient nos magistrats qui avaient acheté leur charge et ne recevaient point de traitement de l'Etat. Je laisse parler le procureur général.
Il y eut « scandale » à notre audience, dit-il , « par la représentation d'un billet écrit par le lieutenant particulier au lieutenant-général de Ventadour », aux termes duquel « le premier annonçait au second que certain procès dont
(74) Arch. Cor., B. 417.
(75) Arch. Cor., B. 447, B. 660, B. 452, B. 521, B. 628, B. 630, B. 471, B. 467, B. 534, B. 524, B. 478, B. 636.
(76) Arch. Cor., B. 422,
les épices avaient été consignées d'avant venait d'être terminé par une transaction, et que les parties voulaient retirer les épices. Sur quoi il invitait le lieutenant-général à rapporter à juger à eux deux ce procès sans appeler un troisième juge, et à partager entre eux ce qui reviendrait au troisième sur lesdites épices. Le lieutenant-général qui le produisit, continue le Procureur, espérait de faire reverser toute l'horreur de ce crime sur le lieutenant particulier son adversaire, parce qu'il se flattait de pouvoir dérober à la Cour la connaissance de la sentence qu'ils rendirent de concert et qu'ils ne craignirent pas d'antidater de six jours avant le billet ». En punition, le tribunal entier, composé de Jean-Baptiste Delmas, lieutenant-général; Brival, lieutenant particulier; Demichel, conseiller; Chastagner, procureur principal; Monlouis, avocat principal, et du greffier en chef, Pierre Moncourrier de Beauregard, estimé « pas moins coupable », fut, par arrêt du 10 juillet 1784, transcrit sur les registres du sénéchal le 17 juillet, suspendu de ses fonctions et remplacé par le présidial de Tulle. L' « interdit » devait être levé le 31 août en faveur de Monlouis, Demichel et Moncourrier. Delmas dut attendre jusqu'au 21 juillet 1785, et Chastagner jusqu'au 7 août suivant (77).
Restait Brival. Au début de 1786, Pierre (de) Bonnot, juge de la Gane, avocat en parlement, était nommé lieutenant particulier (78).
(77) Arch. Cor., B. 468, B. 469, B. 470, B. 633, B. 472.
(78) Provisions du 4 avril 1786. Prestation de sermet et installation du 26 juin 1786. (Arch. Cor., B. 633, B. 472.)
II
Où siégeait la Sénéchaussée?
Dans quel bâtiment la sénéchaussée ducale était-elle installée? Où tenait-elle ses audiences?
Aux termes du contrat de 1599, l'édifice attribué à la sénéchaussée devait être la « Maison de Vanthadour » sur la place « appelée le marché du bled ». Mais quelle place était, au XVIe siècle, celle du marché au blé, place désaffectée par la translation du marché sous la Halle au commencement du XVIIe? II y avait, autour de l'ancien château, plusieurs points pouvant servir à cet usage. En vain, j'ai cherché dans les manuscrits l'indication des immeubles entourant le marché. Delmas lui-même n'a, deux siècles après, produit aucune justification écrite.
Laquelle était cette « Maison de Vanthadour » qui existait en 1599 et, indique l'acte, « avec toutes ses appartenances et deppendances demourera et sera perpétuellement acquise pour la séance, tenue et administration dudict siège et officiers d'iceluy », Fût-ce dans cet immeuble qu'a été installé le tribunal? Devant désigner le Palais de Justice suivant les conventions originaires, le mot « Maison de Ventadour » aurait-il suivi le tribunal, à quelque endroit qu'il fût installé, plutôt que de rester l'appellation particulière d'un seul et même immeuble? Et pourtant, nulle part, même dans les placets présentés au lieutenant-général ou à un membre du siège, je n'ai relevé ce nom; et pas davantage je n'ai entendu citer cette maison par de très vieilles dames qui vivaient, jeunettes, au temps où Paul Huot composait son ouvrage. La Maison Ventadour : c'est le château ducal qu'on désigne habituellement ainsi.
L' « estat des frais » d'établissement de la sénéchaussée mentionne l'achat d'une « maison » où l'on fit « blanchir » une salle et faire des « sièges au barreau ». Cet état, s'il précise le prix d'acquisition (684 « escuz »), ne dit point
qu'il s'agisse de la « Maison de Vanthadour » (non plus d'ailleurs que de toute autre); et, en supposant que le tribunal siégeât dans cet immeuble en 1612 (1), a-t-il continué d'y demeurer? D'autre part, quand les contractants de 1599 affectèrent la « Maison de Vanthadour » à la sénéchaussée, ils ne parlèrent nullement d'opération pécuniaire. Néanmoins, comme on vient de le voir, un immeuble fut acheté dans le but d'en faire « la maison du siège ducal ».
Lorsque Paul Huot (vers 1855) étudia les Archives municipales d'Ussel, il dut constater l'imprécision des actes.
Pour reconnaître le « palais du seneschal », il disposait d'un passage du livre de Delmas situant l'ancien marché au blé « entre les maisons de MM. Lacoste, Cayres, Lanly et Damarzid » (2) ; et lui-même avait entendu appeler « Maison de Ventadour » un bâtiment sis en ce coin et « flanqué d'une tour à porte ogivale » (3). Sans être sûr de l'emplacement du marché (4), puisque Delmas n'apporte la moindre preuve, mais frappé par la similitude du terme « Maison de Venthadour » avec l'expression employée en 1599, le commentateur du Livre Noir inféra que la sénéchaussée avait son siège dans l'habitation qui touche à la tour de Soubise et sert actuellement de presbytère. Il s'efforça d'appuyer son dire par des témoignages oraux.
Que penser de cette désignation? Elle est basée sur la transmission orale, et l'on sait quelle déformation subissent les faits en passant de bouche en bouche. Pour comble, les indications verbales recueillies par Huot sont vagues et ne présentent aucun intérêt historique. Huot ne sait pas où placer exactement la salle d'audience : « vraisemblablement », dit-il, elle se trouvait au rez-de-chaussée; j'ai la « conviction » qu'elle n'était pas « en haut »; cependant,
(1) Date de l'état des frais. (HUOT, p. 22.) Voir ci-dessus, p. 2.
(2) Id., p. 65.
(3) HUOT, id., p. 19, en note.
(4) « .une petite place qui a dzÎ, en effet, servir de marché au blé. »
(HUOT, id., même page, même note.)
il est possible qu'elle fût au premier étage (5). Hésitation frappante, et qui montre la fragilité de ce qu'il avance, sans justification, sur l'immeuble dont il parle! Les personnes interrogées ont été incapables de lui indiquer, dans cet immeuble, l'emplacement de la pièce la mieux connue : la salle d'audience! En réalité, il n'a obtenu de ces personnes nul renseignement précis et sûr, et il écrit d'après des dires improbants. « La tradition orale s'efface vite, ne dépasse jamais le siècle », — estimait Maurice Barrés : après une période de soixante-cinq ans marquée d'événements qui troublèrent les esprits, cette tradition était devenue incertaine et confuse.
S'il semble exact que la maison renferma des services de la sénéchaussée, il est permis de douter qu'elle fut le siège du tribunal. J'ai peine à croire que les audiences avaient lieu dans la pièce en contre-bas dite présentement salle Jeanne-d'Arc; qu'une salle aussi exiguë et mal placée, sombre, humide, utilisée un moment comme écurie à chevaux, ait été l'endroit choisi pour la tenue de l'audience et le développement des débats d'une sénéchaussée ducale. Huot ne paraît guère persuadé. Pourquoi, au lieu d'inclure dans son texte l'importante fixation du local judiciaire, se bornet-il à signaler l'endroit par deux courtes notes imprimées en petits caractères au bas des pages? Et n'est-ce pas remarquable que le dernier président de la sénéchaussée, JeanBaptiste Delmas, qui publia l'Histoire d'Ussel en 1810, ait donné à la demeure le nom de son propriétaire du moment (Lacoste), et n'ait point indiqué, ou seulement laissé entendre, que les officiers du sénéchal avaient siégé là? Raymond Lacoste n'en dit rien non plus en décrivant cet étroit logis dans sa brochure sur l'abbé Demichel.
L'immeuble est formé de deux petits bâtiments distincts, liés ensemble. Le plus ancien, celui de droite, existait-il à la fin du XVIe siècle? Dans ce quartier on a utilisé des restes du vieux château pour faire plusieurs habitations. L'enca-
(5) HuoT, id., p. 22, en note.
drement des fenêtres, le fronton des portes, le devant des cheminées ont peut-être été rapportés d'ailleurs, et nous risquons d'attribuer à telle maison plus d'ancienneté qu'elle n'a. En admettant qu'il existât en 1599, et que la sénéchaussée y fût établie au commencement du XVII", il sied
USSEL. — Tour de Soubise et presbytère actuel (à gauche).
Au fond, Ancienne Maison Chaminade-Forsse.
(Cliché du Syndicat d'Initiative d'Unel).
d'imaginer que celle-ci, ne pouvant tenir dans un logement aussi mince, occupait aussi la tour de Soubise et se prolongeait dans la construction posée sur le roc à l'extrémité droite. Cette construction, qui fait corps avec la tour et doit être de même date, n'a qu'une pièce à chaque étage, mais possède des fenêtres ouvragées dans le style de la Re-
naissance et garde, à l'intérieur, deux belles cheminées qui sont un témoignage de son luxe d'autrefois. On accédait aux étages par la tour de Soubise, à l'aide d'un escalier en pierre et à vis transporté depuis peu dans la tourelle du clocher de l'église paroissiale. Plus tard — car il n'est point question d'agrandissement, mais seulement d'achat et de réparations en l'état de 1612 — fut bâti le côté gauche, élargissant l'espace.
Etait-ce là réellement? A la vérité, rien ne l'établit. Delmas, qui connaissait, a gardé le silence, et Huot, qui ne connaissait pas, désigne un local. Que Huot ait nommé le véritable endroit, c'est possible; mais il n'a pu trouver aucun texte justificatif, et les déclarations verbales par quoi il a tenté de suppléer à 'Cette insuffisance ne lui ont valu que déceptions. La preuve convaincante lui a manqué : il nous laisse dans une incertitude.
Que penser et que conclure? A défaut de textes, la tradition subsiste — cette transmission orale dont un écrivain disait qu'elle « va, avec le temps, en se déformant et en s'amenuisant ». Du moment qu'il n'y a mieux, il faut l'accepter telle qu'elle se présente et, ainsi, admettre que la sénéchaussée occupait les bâtiments accolés à la tour de Soubise, avec une petite salle de réunion dans la pièce du bas. Mais, puisqu'il est permis de croire, devant l'insuffisance des documents et le vague de la tradition, que le siège, en sa hantise des présidiaux, disposait d'une autre salle d'audience réservée sans doute aux séances importantes, quels locaux avoisinants pouvaient donc convenir à celle-ci?
Le bâtiment à tour quadrangulaire situé devant le château actuel et séparé de lui par une petite place qu'une autre petite place (6) prolonge, contint, au rez-de-chaussée, la prison ducale : détail émanant de Delmas (7) qui, je pense, appelle rez-de-chaussée la partie basse regardant le château
(6) L'ancienne place Saint-Pierre.
(7) Id., p. 66.
I
et servant aujourd'hui de remise et de bûcher. Ce qu'il y avait aux deux étages, Delmas ne le dit pas; mais chacun d'eux, le premier surtout, qui donne de plain-pied sur « la Halle », offrait la disposition d'une salle d'audience appropriée. Serait-ce là?
Ou encore à la mairie (8). Un manuscrit du XVIII", déjà cité, parle de la « chappelle du palais et du collège », à l'occasion d'un office religieux célébré devant le corps judiciaire (9). Il n'y avait qu'une seule chapelle pour les deux institutions. Or, le collège, fondation des Ventadours au XVIe siècle, était, antérieurement à la Révolution, établi dans les bâtiments devenus ensuite et à la fois hôtel de ville, prison et sous-préfecture, bâtiments précédés d'un espace assez large pour avoir pu constituer une place, autrefois, dans l'enceinte des fortifications. Et comme le tribunal ae première instance qui succéda en 1790 à la sénéchaussée résida dans cet immeuble jusqu'en 1826, on est peut-être en droit, ici également, de ne pas suivre Huot lorsque, en tout temps et en toute circonstance, il met la salle d'audience dans un local indigne de la Cour de Justice d'un grand fief de France (10).
(8) Rue des Sans-Culottes.
(9) Arch. Cor., B. 471, et ci-dessus, p. 20
(10) Bien qu'enseignant depuis la 7" classe jusqu'à la rhétorique, le collège d'Ussel logeait en un espace fort restreint. Le règlement de 1771, qui le rétablit après un temps de suppression, lui attribue quatre chambres de professeurs, deux salles (étude, dortoir) pour les pensionnaires, trois pièces pour les classes, une cuisine, des logements pour les domestiques, « les greniers, caves, basse-cour et jardin nécessaires ». Le corps professoral devait comprendre un principal et trois régents, chacune des trois classes étant doublée. Au cours des années suivantes, le collège « essuya une émigration » telle qu'on ne prévoyait, en 1780, que 40 à 50 écoliers. On espérait de prochaines arrivées qui doubleraient le nombre des élèves dans un délai de quatre ans, et l'on envisageait pour 1785 un 4e professeur. Une partie des locaux et des dépendances restait disponible, comme indique le rédacteur du statut de 1771 en exprimant le regret que « tous les bâtiments » ne soient pas occupés par le seul collège. (Arch. dép. HauteVienne. Bull. Soc. Hist. du Lim., t. XXII, pp. 296 à 307.)
III
Nature des rapports entre la ville d'Ussel et les Ventadours
Comment se présentait les rapports entre Ussel et les Venladours à l'époque de la sénéchaussée?.
USSEL. — Hôtel ducal de Ventadour.
(Cliché de la Corrèze Républicaine i Brive).
La transaction de 1532, que vint renforcer celle de 1622, avait fixé la nature des rapports. Mais les transactions étaient* elles-mêmes l'aboutissement d'une lutte de plusieurs siècles qui va être brièvement rappelée.
Du vivant d'Ebles VI, en 1264, il se produisit un de ces désaccords assez fréquents entre le vicomte et les consuls,
qui soutenaient énergiquement les intérêts de la communauté. Le cas était si grave qu'il fallut prendre un arbitre.
On choisit Bernard de Ventadour, archidiacre de Limoges, oncle d'Ebles. L'arbitre put amener les parties « à composition »; et Ebles donna peu après, à Ussel même, des lettres patentes ainsi conçues : « Nous, Ebles, vicomte de Ventadour, scavoir faisons à tous (ceux) qui ces présentes lettres verront que nous confirmons et approuvons toutes les coustumes que les consuls et la communauté de la ville d'Ussel ont, tiennent et possèdent., et promettons pour nous et nos héritiers et successeurs, sous serment corporel, à l'avenir et perpétuellement, défendre et irrévocablement observer lesdictes coustumes. » (1).
Ce serment, un des plus anciens titres d'Ussel, constitue aussi une pièce des plus importantes. Ebles approuve toutes les coutumes locales. Il promet de les respecter, de ne rien faire contre elles. Bien plus : il s'engage à les défendre.
Mieux encore : l'engagement vaut, non seulement pour luimême, mais encore pour ses successeurs, et à perpétuité.
Pourquoi de pareilles promesses, de la part d'un tel seigneur? Parce que les Ussellois n'étaient pas unis aux Ventadours par le lien féodal, et que ceux-ci ne furent pour eux que des seigneurs haut-justiciers. Les Ventadours, en 1264, n'eurent peut-être d'autre geste à faire que de « reconnaître », une fois de plus, les droits dont la ville jouissait depuis un temps immémorial, et qui provenaient, suivant Huot, de son allodiale origine. Mais Ebles VI dut faire ce geste de mauvaise grâce, puisqu'il y eut « composition ».
Après des affirmations si nettes, les Ussellois pouvaient avoir, ce semble, une tranquillité entière. Fût-ce méfiance?
A la requête de leurs consuls, le serment était renouvelé solennellement par le successeur d'Ebles, vicomte Hélie, à son entrée dans la ville, « l'an de l'Incarnation 1298, le jeudi après la fête Saint-Hilaire ». Hélie jura, entre les mains des consuls, sur les saints Evangiles, de « tenir et
(1) Charte de 1264 et vidimus de 1343 (Archives d'Ussel) et HUOT, pp. 28 et 46,
conserver les franchises, coustumes et statuts que les consuls,.- communauté et habitans de ladicte ville ont eus et tenus de toute antiquité » (2).
Les Ussellois n'oublieront point cette cérémonie. Nous les voyons au xv" siècle refuser de prêter au comte Louis le serment de fidélité, tout en le reconnaissant comme seigneur de justice. Au XVIe siècle, ils maintiendront qu'ils ne doivent aucun serment à titre de fief et de domesticité, puisque, remarquent-ils, leur communauté « n'a, du comte, nulle chose en fief noble » et qu'ils ne sont ni ses domestiques ni ses serviteurs (3). Dans un moment difficile, ils prendront texte de l'acte de 1298 pour rappeler que les comtes leur doivent, au contraire, le serment de garantie. Et ils auront gain de cause. Par la transaction du 2 février 1532, ils obtiendront une nouvelle confirmation des « libertés, privilèges, authorité, prééminence, juridiction, franchises et coustumes » dont ils ont « usé et joui par le passé » et, de nouveau, l'assurance qu'ils continueront à en user et jouir « de la même manière et dans la même forme ». En une autre clause du même traité, le comte reconnaîtra enfin que les consuls, manants et habitants d'Ussel ne sont pas tenus envers lui au serment de fidélité (4). Quand le même seigneur entrera solennellement à Ussel, il s'arrêtera tout d'abord devant la porte Duchier pour prêter aux consuls en robe rouge et tête nue le serment que le vicomte Hélie, son lointain prédécesseur, avait déjà renouvelé en 1298 (5).
Henri de Lévy, duc de Ventadour, pair de France, comte de la Voulte, refera lui aussi, en des circonstances semblables, le même serment devant la même porte (6).
On doit admirer ici de belles qualités de l'âme usselloise : une volonté, affirmée à travers les générations, de maintenir
(2) Acte de 1298 (Archives d'Ussel) et HUOT, p. 30.
(3) « .nec habebant aliquam rem in feudum nobile ab ipso domino comité., nec domestici nec familiu. »
(4) Livre Noir, pièce 4° (HUOT).
(5) Livre Noir, pièce 6" (HUOT).
(6) Livre Noir, pièce 7" (HUOT).
intactes les libertés communales; une énergique résistance aux prétentions qui pourraient les amoindrir; une fidélité constante à la signature inscrite au bas des actes. La transaction de 1532 est un chef-d'œuvre : les Ussellois ont su négocier un accord sans faire aucune concession au délégué comtal et obtenir pleine satisfaction sans céder quoi que ce soit des droits précédemment reconnus. Leur énergie se manifesta encore lorsqu'il s'agit d'obtenir de l'autorité seigneuriale la ratification de l'accord. Le comte et sa mère se trouvaient au château de la Voulte, en Vivarais. Au bout d'un an ils n'étaient pas rentrés à Ventadour. Avec raison les Ussellois s'inquiétaient, craignant que le comte Gilbert ne veuille plus signer une décision que son mandataire (7) avait dû accepter dans des conditions désavantageuses. Il fallait en finir. Résolument et courageusement, l'un des consuls, Martin Monloys, enfourche un cheval, se fait suivre d'un notaire et d'un témoin, et tous les trois chevauchent vivement vers la Voulte par le pont des Salles et Saint-Angel.
Ils arrivent sur les bords du Rhône. Auprès de la comtesse et de son fils, Monloys opère adroitement et obtient la ratification. Il est si habile et si résolu qu'il introduit dans l'acte une disposition supplémentaire. Et il revient, triomphant, vers ses compatriotes soulagés.
Audacieuse démarche, couronnée d'un succès éclatant, et belle page de l'histoire d'Ussel!. C'est également un aperçu de la lutte, tantôt violente, tantôt sourde, menée par les consuls contre les seigneurs, durant cinq siècles, pour le maintien des libertés traditionnelles et l'accroissement du bien-être de la population. Avec quelle ardeur, quel dévouement, quelle conviction, quelle fermeté, quelle persévérance, les consuls agissaient! Et quelles réussites, parfois brillantes, récompensaient leurs hardis et opiniâtres efforts!
En 1622, « toutes contestations entre les seigneurs de Ventadour et les habitants d'Ussel furent terminées par
(7) Antoine Andrieu, écuyer, seigneur de la Ganne, élu pour le roi en Bas-Limousin (HuoT, id., pp. 3 et 4),
une transaction passée devant les Conseillers du Roi, notaires au Chàtelet de Paris » (8).
Ainsi, entre Ussel et les Ventadours, aucun lien féodal : les Ventadours n'étaient pas, n'avaient jamais été, ne seraient jamais seigneurs féodaux de la ville. Mais ils possédaient sur celle-ci des droits de justice, que les ducs continuèrent d'exercer par l'intermédiaire de leur sénéchal (9).
IV
Les Affaires. — Audiences. Fériés. Composition du Tribunal. Compétence. Etendue juridictionnelle. — Causes civiles. Noms de plaideurs.
Appels de justices ordinaires et seigneuriales. — Décision d'intérêt général. — Enregistrement et publication d'actes d'autorité supérieure.
— Décès du duc de Ventadour. — Au Criminel. Faits punissables. —
Les fours banaux. L'Aubépin. Barbier de Villeneuve. — L'émeute de Maumont. Les incartades de trois jeunes Ussellois. — Recèlements de grossesses. Marie Astier. Autres peines. Libertinage. - L'assassinat du Seigneur de Margerides.
Une fois par semaine, le tribunal siégeait, assez régulièrement durant toute l'année, à l'exception de la période des fériés. En 1700 — date à partir de laquelle les plumitifs ont été conservés — il y eut 21 audiences en 7 mois; en 1701, 35 en 10 mois; en 1735, 27 en 7 mois; en 1770, 23 en 7 mois. Les fériés ne commençaient ni ne s'arrêtaient à jour fixe; elles allèrent, en 1700, du 13 septembre au 15 novembre; en 1701, du 7 septembre au 14 novembre; en 1708, du 20 juillet au 2 octobre; en 1735, du 18 juillet au 12 septembre; en 1736, du 20 juillet au 10 septembre; en 1737, du 19 juillet au 20 septembre; en 1770, du 16 juillet au 10 sep-
(8) DELMAS, id., p. 77.
(9) En 159!), les « seigneurs de Chasteauvert et d'A ngla rdz » avaient « quelque droict en la justice de la ville » (Contrat du 15 novembre 1599). Ils vendirent leurs parts aux Ventadour : les Chateauvert, le 7 novembre 1612, les d'Anglards le 17 juillet 1658.
tembre; en 1771, du 19 juillet au 9 septembre; en 1785, du 2 septembre au 14 novembre, avec audiences extraordinaires les 12, 17, 20, 23 septembre, les 29 et 31 octobre et le 6 novembre (1). On désignait, du nom général de « séance » (2) tout le temps de travail compris entre la première et la dernière audience de l'année judiciaire : séance, c'est-à-dire le temps durant lequel le tribunal était séant, siégeait.
C'est le lundi qu'avaient lieu les audiences. Rarement furent-elles tenues un autre jour. Il y en eut seulement 3 le mardi et 2 le mercredi en 1700; 9 le mardi et 2 le mercredi en 1701; 2 le mardi en 1735; 5 le mardi et 2 le vendredi en 1770. Elles s'ouvraient, soit à neuf heures, soit à dix heures du matin, suivant la saison. Le règlement de 1784 les fixa au lundi et au vendredi de chaque semaine, à dix heures de l'ouverture de la séance à « quasimodo », et à neuf heures « depuis quasimodo jusqu'à la fin de la séance » (3). Une heure avant le commencement des audiences, les procureurs devaient, à peine de rejet, « présenter en l'hôtel du président leurs cartels et placets » (4). Il n'y avait pas d'audiences spéciales pour les affaires criminelles (5).
Quand le lieutenant-général manquait, le lieutenant particulier présidait l'audience et un avocat ou un procureur complétait le tribunal. Le conseiller, le procureur principal, l'avocat principal présidèrent quelques fois. En même temps conseillers, le procureur et l'avocat purent exercer les fonctions de juge, le cas échéant (6).
(1) Arch. Cor., B. 414 à B. 479.
(2) Arch. Cor., B. 463, B. 469. Voir aussi le contrat du 15 nov. 1599.
(3) Arch. Cor., B. 414 à B. 479. — Règlement pour la tenue des audiences (1784) : B. 469.
(4) Arch. Cor., B. 469. — « .A Ussel, en nostre hôtel, par devant nous, Antoine de Bonnet. » (1723); « .A Monsieur le Sénéchal de Ventadour ou Monsieur son lieutenant. » (1702-1750). (Documents personnels.)
(5) Au présidial de Tulle les affaires civiles ne furent séparées des affaires criminelles qu'à partir de 1780 (Arch. Cor., B. 804),
(6) Arch. Cor., B. 414 à B. 687, passim.
Henri III de France avait octroyé au sénéchal de Ventadour des pouvoirs équivalents à ceux des autres sénéchaux du royaume, réservant toutefois les « cas royaux » (1578).
Ressortissaient de la cour ducale les causes civiles et criminelles que les vassaux et arrière-vassaux eussent auparavant intentées en première instance devant le siège royal de Tulle. La sénéchaussée formait le tribunal d'appel des justices ordinaires et seigneuriales incluses dans le duché, tandis que les appellations des jugements du sénéchal allaient, suivant leur importance, devant le présidial de Tulle ou devant le parlement de Guyenne (7). Privilège insigne accordé à un simple duc, hier comte, demain pair.
En première instance, écrivait Pierre-Léonard Diousidon, la sénéchaussée de Ventadour comprend la ville d'Ussel avec ses cinq faubourgs et près de cent villages qui en dépendent. En appel, elle embrasse « plus de cent cinquante juridictions, un grand nombre d'abbayes ou de prieurés, et plusieurs terres composées de dix, douze ou quinze paroisses. Son ressort est plus étendu que ceux de Tulle et de Brive; ceux de Nevers et de Montpensier sont les seuls qui puissent lui être comparés » (8). Le ressort s'étendait d'Herment à Tulle, de Neuvic à Donzenac, de Saint-Setiers à Saint-Chamans, et couvrait, de l'aveu d'Henri III, « une des plus belles et antiennes » terres du « royaulme ».
Parmi les affaires jugées en première instance — de 1700 à 1789 — on remarque assez fréquemment des poursuites contre des tenanciers. Les grands noms du pays limousin apparaissent ici : Joseph de Bort, chevalier, seigneur de
(7) Lettres patentes de février 1578 (reproduites par HuoT, id., pp.
24 et 25). Arch. Cor., B. 583.
On pouvait donc, pour les litiges nés dans le ressort, s'adresser directement au sénéchal, sans passer par un juge subalterne. Si l'on avait saisi ce dernier, et que l'on fit appel de sa sentence, l'appel devait être interjeté, obligatoirement, devant le sénéchal.
(8) Cité par HuoT, id., p. 103. — « Ce ressort, un des plus étendus de l'époque. » (René FAGE, Excursions limousines, II, 130.)
Pierrefitte (1769); Jacques de Castries, baron d'Anglards (1743); Marie d'Escars, veuve de François d'Hautefort, marquise de Saint-Chamans (1743); Françoise de Fontanges, marquise de Maumont (1743); Louis, marquis de Fontanges (1771); Joseph de Gains, seigneur de Montaignac (1744); Jean de Joussineau, comte de Tourdonnet (1784); Jean de Lauthonie, seigneur de Lagarde (1771); Raymond de Lavaur, comte de Sainte-Fortunade (1748); Hercule-Mériadec, prince de Rohan, et Charles de Rohan, prince de Soubise, seigneurs du duché de Ventadour (1747); LouisFrançois de SOlldeilles, marquis de Saint-Yrieix, la Gane, le Bazaneix, lieutenant du roi en la province du Limousin (1741); le marquis d'Ussel, baron de Chateauvert (1763).
Il y a aussi François Dubois, seigneur de Margerides et de Saint-Julien (1787); Gabrielle Fénis de Lacombe et son fils, Charles-Ignace Chauveau, baron de Rochefort (1772); Jacques de Fénis de Tourondel, brigadier des gardes du corps (1786); Guillaume Chassain de Fonmartin, seigneur de Charlusset (1777); Jean de Fonmartin, seigneur de la Mauriange (1755); Antoine de Pouthe de la Roche-Aymon, seigneur de la Ville-du-Bois, Mareille, etc. (1778). Les tenanciers s'appellent Beynes, Chambiges, Clément, Combes, Faugeron, Lacroix, Manzagol, Mempontel, Monéger, Mignon, Rebeyrix.; les lieux, Bourbouleix, ChantegriJ, Chassagnac, la Doullange, Lespinasse, le Mazel, la Rebière, Valiergues, Vernéjoux, Vernengeal (9).
Les demandes d' « avérations » de signatures ou de promesses entraînèrent des procès entre Jean Arzilier, voiturier d'Ussel, et le seigneur de la Chabanne (1745); entre Guillaume Blatin, négociant de Clermont-Ferrand, et Guillaume Demichel, de Saint-Dezéry (1789); entre François Boy, sieur de la Combe, et Roger Dufayet de la Tour, écuyer, seigneur de la Bastide (1760) (époux d'Angélique Ebrail); entre Antoine Dufayet de la Tour, lieutenant au régiment de Poitou-Infanterie (fils de Roger), et Antoine Demasson,
(9) Arch. Cor., 13. 414 à B. 479, passim.
seigneur de Saint-Félix, écuyer (son gendre; marié à Jeanne du Fayet) (1783); entre Catherine Champeval, veuve de Jean Laselve, maître chirurgien à Neuvic, et Jean Lavergne, curé de Saint-Etienne-aux-Clos (1745); entre Michel Clédière, étudiant au collège de Tulle, et Jean Chavaignac, bourgeois d'Ussel (1760); entre François Dupont, marchand de la ville de Tulle, et Marguerite de Bonnet, veuve du sieur de Badour (1735); entre M. de Lasserre, de Neuvic, et M. de Lamazière (1700); entre les frères Mandon, d'Ussel, et Jean de Fonmartin de Lespinasse (1737); entre Jean Puyraimond, marchand de Saint-Julien-près-Bort, et Annet Sauty de Châlons (1769), procureur d'office de la justice d'Aix, notaire royal, époux de Catherine Eybraly (fille de GilbertVincent Eybraly, sieur de l'Ebraly, et de Marie Lignareix) ; entre, d'une part, haut et puissant seigneur Léonard, marquis d'Ussel, officier au régiment du Roi, et Jean-Hyacinthe, vicomte d'Ussel, chevalier honoraire de Malte, et, d'autre part, Antoine de Bonnet, seigneur de la Chabanne (1787); entre Martin Vialatte, syndic de l'hôpital d'Ussel, Mathieu Vialatte, cavalier de la maréchaussée, et M. de Fonmartin de la Mauriange (1750) (10).
(10) Arch. Cor., B. 426, B. 479, B. 439, B. 564, B. 426, B. 417, B. 414, B. 419, B. 541, B. 474, B. 431. — Gilibert l'Ebraly et Marie Lignareix étaient déjà (1724) les beau-père et belle-mère de Jean Forsse, bgs, chirurgien.
Annet Sauty : avocat; notaire royal (1759, 1774); procureur d'office des juridictions d'Aix (1769), d'Eygurande (1777), du Chavanon et de Charboudèche (1782), seigneur de Châlons (1763, 1785). (Arch. Cor., B. 446, B. 485, B. 541, B. 626, B. 629, B. 440, B. 470.) 1766 : « D'après l'examen d'une reconnaissance de 1497, il est reconnu haut, moyen et bas justicier du village de Chaslon. » (B. 446.) Châlons, par. d'Aix.
L'Ebraly, par. de Saint-Dezéry. — Aux environs de 1744, GilibertVincent Eybraly, riche négociant de la région, acquit la terre noble de l'Ebraly (le petit Eybrail, l'Eybraily), ancien fief des Bonnet de la Chabanne et des Andrieu du Teil, et, comme les Andrieu, se titra sieur de l'Ebraly. Peu d'années après, à la suite du mariage d'une de ses filles, cette propriété devint la possession et la résidence des Sauty de Châlons. Les Eybraly demeurèrent dans le voisinage, principalement à Catalot, même paroisse; au village de la Jaloustre, par. d'Aix, dans un domaine acheté en 1741 par Gilibert qui l'habitait en 1753; et au Chassergue, par. de Courteix, où se fixa un des derniers enfants de Gilibert, François, époux d'Anne Redhon. Le fils aîné de François,
Retrait féodal, retraits lignagers, rétribution de messes, contestations de droits de justice, rentes dues, comptes entre parties, successions, saisies, dettes, autorisations de justice, vérifications d'écritures, interprétations d'écrits, provisions alimentaires, propriété, passage, serments décisoires, exécutions d'obligations ou de promesses, troubles de possession, recours de tenanciers, telles sont des affaires inscrites sur les plumitifs d'audience (1700-1789), où figurent aussi des séparations de biens et des séparations de corps : séparations de biens poursuivies par Marie-Charlotte Autier de Villemontée contre Antoine Delmas de Grammont (1783); par Françoise Bouharde contre JeanBaptiste Meschin (1712); par Marguerite Gorsse contre Jean Dubois de Margerides (1763); par Pierre de Laborde contre Elisabeth de Neuchèze (1771); séparation de corps, par Jeanne Arzilier contre Firmin Barbier de Villeneuve (1781), par Irénée Col de la Porte contre Joseph de la Croix de Castries (1782), par Françoise de Loyac de la Bachellerie contre Hierosme de Douhet d'Auzers qui l'avait un jour dé-
Gilbert (1773-1813), marié à Françoise Sapin (a), vécut au Chassergue, et son fils Charles-Eugène y naquit en 1809. Cette branche était la plus riche, la mieux apparentée, la plus cultivée de la famille dont certains membres, moins favorisés, retombèrent en paysannerie. Son nom changea progressivement : Eybraly, Leybraly, Lébraly (1809), L'Ebraly, l'Ebraly (b). Maire de Courteix sous l'Empire, Gilbert signait avec soin : L'Ebraly. Ce sont les Eybraly du Chassergue, devenus l'Ebraly, qui, entre 1829 et 1837, après l'éloignement (c) ou la mort des Sauty de Châlons, s'établirent au lieu et sur la terre de l'Ebraly, actuellement héritage des arrière-petits-enfants de Charles-Eugène.
(Reg. de l'état civil; Arch. Cor., B. 517, B. 658, B. 594, B. 550, B. 622; CHAMPEVAL, Bas-Lim., pp. 268 et 354.) (a) D'abord Sapin (1809-1811), puis Sappin de Roussine (1829-1837).
(b) Pour le rameau de Chassagnac-Chaveroche (auteur : Noël JeanBaptiste, 1789-1839, frère cadet de Gilbert) la transformation s'est arrêtée à : Lébraly.
(c) Août 1940 : X. Sauty de Châlons, conseiller honoraire à la Cour des Comptes. — Guillaume, son fils.
Février 1941 : Louis Chalus du Chéry et sa femme, née Sauty de Châlons, au château des Maillets, près de Dornes (Nièvre).
pouillée de ses vêlements et fustigée dans la basse-cour de leur résidence de Laveix (1771) (11).
Pour tous ces procès, une foule de plaideurs vint en justice. Leur énumération exigerait un volume et dépasserait le cadre de cette étude. Il convient toutefois d'ajouter quelques noms à ceux indiqués ci-dessus. Voici Jean Beaune, tambour-major de la milice (1759); Jérôme de Boucheron, curé d'Ussel en 1701, Jean Ternat en 1717, Pierre Laurens (licencié ès droits civil et canon) en 1742, Pierre Ternat en 1761, Pierre Forest de Masmoury en 1789; Etienne de Cardaillac, prieur de la Fage (1732); Jean de Cardaillac, écuyer, seigneur de la Nouaille (1715); Jean Chauveau, écuyer, seigneur de Rochefort (1701); Antoine Conchon, marchand (1675); Joseph-Mathieu de Cosnac, chevalier, seigneur du Tillet et d'Arsac (1779); Jean Dellestable, fermier des revenus du monastère de SainL-Angel (1760); Jacques Dumont, menuisier, et Suzanne Goudounesche, sa femme; Jean d'Escorailles, comte de la Roussille, marié à Eléonore Desplas (1679); Théodore d'Escorailles-Fontanges, marquis de Roussille (1744), brigadier des armées du roi; Gaspard Esparvier, commissaire général des saisies pour le duché de Ventadour (1700). Voici Joseph-Mathieu Forsse, docteur en théologie, curé du Puy-d'Arnac (1715), fils de Pierre, advocat en parlement; Antoine Forsse, vicaire de Sérandon (1758); François-Antoine Forsse, curé de Saint-Pardoux-IeNeuf (1775); François Bernard du Giraudès, seigneur de Lacoste, subdélégué de l'Intendant, juge de Neuvic (1751); dame Charlotte du Gibanel, épouse de « haut et puissant seigneur Messire Jean de Gonzague, de Mantoue et Monferrat, marquis de Gonzague » (1727); François de Salles d'Hautefort, marquis de Saint-Chamans (1732); François de Labarre, écuyer, seigneur de Saint-Germain (1738) et Joseph Lachaze, bourgeois, seigneur de Saint-Germain (1771); Antoine Lachau, juge de Meymac (1780); Joseph
(11) Arch. Cor., B. 414 à B. 479, notamment B. 467, B. 440, B. 455, B. 507, B. 562, B. 560, B. 671. Procureur de Françoise de Loyac : JennBaptiste Forsse (Documents personnels).
Lalée, receveur général aux saisies réelles du duché de Ventadour (1741); Joseph de Lestrange, marquis « dudit lieu » (1739); dame Claude de Lévy-Ventadour, abbesse de Bonnesaigne (1700); Gaspard-André de Long-Vert, principal du collège d'Ussel (1776); François Mornac de Badour, prêtre, curé de Saint-Dezéry et principal du collège (1785); Michel Martinot, fermier des droits de prairies et regains d'Ussel (1741); Joseph-François Masson-Dumas, écuyer, garde de la porte du Roi, gouverneur d'Ussel (1780); François Meschin, lieutenant de la milice bourgeoise d'Ussel (1701); Joseph-Martin de Monloys, seigneur de Mareille, « habitant ledit château » (1735); Louis de Paule, chevalier, seigneur de Soudeilles, du Lieuteret, du Bazaneix, de la Gane (1741).
C'est encore Philippe de Peyrissac, abbé de Bonnaigue (1700); Robert Pascal, abbé de Bonnaigue (1713); Antoine de Fondary, abbé de Bonnaigue (1723); François Dulac, seigneur-abbé de Bonnaigue, vicaire général de l'ordre de Citeaux (1770); Martin Prouzergue, chantre et organiste à Ussel (1769); Joseph Randon de Chateauneuf, marquis d'Apcher (1781); la marquise de Salvert, tutrice des enfants de feu le marquis d'Ussel (1777); Louis de Soudeilles, veuf de Philiberte de Sédières (1708). Et Guy d'Ussel, baron de Chateauvert, du Bech, héritier de feu Gilibert d'Ussel, son père (1678); et Marc-Antoine d'Ussel, chevalier, baron de Chateauvert, seigneur de Lagarde (1762); et reverendissime dame Léonarde-Gabrielle d'Ussel de Chateauvert, dame abbesse de l'abbaye royale de Bonnesaigne (1762); et Gabriel de Valon, comte d'Ambrugeat, lieutenant au régiment de Maine-Infanterie (1784). Oublierait-on Joseph Bardinet, syndic des Bénédictins de Meymac (1769), Pierre Boucher, prieur bénédictin de Saint-Angel (1742), Françoise Cramouzaud, supérieure des Ursulines d'Ussel, en religion sœur Saint-François (1781)?. (12).
Outre les procès intentés directement devant lui, le tribunal de sénéchaussée statua sur les appels civils et crimi-
(12) Arch. Cor., B. 414 à B. 493 et B. 501 à B. 636.
rieis des juridictions inférieures ordinaires ou seigneuriales. dont il avait, suivant les prescriptions d'Henri III, la connaissance immédiate et le privilège exclusif (13).
Dans un espace d'environ cent ans, j'ai compté, pour 150 juridictions ressortissantes, 87 appels seulement. 23 sentences furent confirmées sous la forme d'un « congé de bien jugé » ou d'une ratification; 64, infirmées ou cassées. Que les appellations aient été assez rares, les jugements réformés peu nombreux, et donc la justice inférieure bien rendue dans le duché de Ventadour, quoi d'étonnant? Les juges du premier degré n'étaient-ils pas, presque tous, des bomines.de loi expérimentés : avocats ou procureurs (14)?
L'an 1748, un appel de la juridiction de Saint-Chamans mena devant les juges le nommé François Sudric, « valet de chambre de M.' de Segondat, conseiller au parlement de Bordeaux ». En.M. de Segondat, qui n'a reconnu le grand Montesquieu (15)? Le lieutenant-général et ses assesseurs durent résoudre des conflits de juridictions : en 1750, un conflit entre l'ordinaire de .VentadoUr et l'ordinaire de Neuvic et Peyrou,; en 1760, un conflit entre l'ordinaire de Neuvic et Peyrou et la justice prieurale de Saint-Etienne-la-Geneste (16).
Des tracasseries vinrent du siège royal de Tulle, qui ne pouvait admettre la diminution sensible de son ressort causée par la création de la sénéchaussée usselloise. Les Tullistes, s'exagérant les effets de cette diminution, craignaient de tomber « en pauvreté », de voir leur cité,« marchande et populeuse » devenir « déserte et non fréquentée ». Ils
(13) « Par devant lequel seneschal dudict duché de Ventadour toutes causes civiles et criminelles qui se dévolueront par appel "tant des officiers ordinaires dudict duché que des officiers des terres, juridictions et seigneuries qui rellèvent en fief, arrière-fief ou aultrement en foy et hommaige d'icellui, ressortiront immédiatement. » (Lettres patentes de 1578.) Voir ci-dessus, p. 32 et renvoi 7.
(14) Arch. Cor., B.414 à B. 493-et B. 501 à B. 636.
(15) Arch. Cor., B. 523. — En réalité, Montesquieu avait quitté le Parlement de Bordeaux en 1726 ou 1727, étant président à mortier.
(16) Arch. Cor., B. 43 à B. 438. -
réagirent, et leurs empiètements furent tels, malgré l'arrêt de 1601 approuvant l'érection, que les magistrats d'Ussel, outrés, durent se plaindre d'anticipations « immodérées ».
La lutte, sourde ou bruyante, dura jusqu'au dernier moment (17). Tulle recherchait la suppression du siège de Ventadour. Ussel demandait au contraire la transformation de la sénéchaussée en présidial, désir que l'on retrouve exprimé dans les Cahiers du Tiers, de 1789 (18).
En dehors des cas particuliers soumis à son jugement, le tribunal prit certaines décisions d'intérêt général. Il réglementa la vente de la viande et des volailles, et fixa le prix d'une livre de bœuf à deux sous six deniers (1760). Contre les abus des cabaretiers, il tarifia le prix du vin à sept sous la pinte pour le vin du Limousin et à six sous pour celui d'Auvergne (1766). Son règlement sur les poids et mesures prescrivit la confiscation des instruments, avec une amende de dix livres, au cas de contravention (1760). Afin d'éviter le trafic des revendeurs, il défendit aux marchands d'aller, aux alentours de la ville, à la rencontre des porteurs de denrées (1764). Pour protéger les maisons couvertes de bois et de paille, il ordonna que les cheminées devraient être ramonées quatre fois par an au moins (1764) : mesure d'autant plus sage qu'un incendie avait, peu d'années avant (1755), détruit quinze maisons dans le faubourg du Thuel (19) et un autre (vers 1739) « la plus grande partie de la ville » (20).
A cette époque de vie plus facile qu'aujourd'hui, les œufs coûtaient deux sous six deniers la douzaine (1747), et
(17) En 1788 encore, conflit à propos des appels de Saint-Julien (Arch. Cor., B. 455). Sur cette lutte, voir E. DEcoux-LAÚOUTTE : « Juridictions royales en Bas-Limousin. » (Bull. soc. Lettres Cor., t. IV, pp. 408 à 412, et t. V, pp. 555 à 557.)
(18) HUOT, id., p. 101. Arch. Cor., B. 477.
(19) Arch. Cor., B. 439, B. 446, B. 442, B. 604. — La porte du Thuel paraît avoir été démolie en 1773 (B. 622).
(20) CHAMPEVAL : Bas-Lim., p. 244.
les visites médicales hors ville quinze sous (1765). Un perruquier comptait treize livres dix sous « pour neuf mois consécutifs d'accomodage » (1782) (21).
Un aspect des fonctions du tribunal fut d'enregistrer et de publier diverses décisions royales transmises par le Parlement de Bordeaux. Ainsi en advint-il pour les édits de 1750 sur les établissements de main-morte, de novembre 1764 relatif aux Jésuites, de 1767 autorisant toutes personnes; sauf les magistrats, à faire le commerce en gros, de 1769 concernant la levée du second vingtième; des déclarations du Roi de 1737 sur les registres des marchands, de 1741 sur la levée du dixième des revenus, de 1742 sur les curés, de 1752 sur la création d'une noblesse militaire, de 1759 sur les biens des religionnaires, de 1769 sur les cures des villes murées, de 1788 sur la prochaine assemblée des Etats Généraux; des lettres patentes de 1779 relatives aux manufactures, de 1783 sur les maîtres et ouvriers, de 1786 sur les privilèges de la juridiction du Point d'Honneur.
Deux arrêts du Parlement de Bordeaux, l'un du 13 mai 1774 enjoignant aux sénéchaux de maintenir les peuples sous l'obéissance du Roi, l'autre de 1787 interdisant l'inoculation dans l'intérieur des villes du ressort, furent également au nombre des actes de l'autorité supérieure enregistrés par la Cour du sénéchal (22).
Au mois de juillet 1787, le 7e duc de Ventadour mourut.
C'était le fameux Soubise dont le souvenir est lié à la bataille de Rosbach (5 novembre 1757). A notre mémoire montent les vers satiriques le représentant avec une lanterne à la main, dans la nuit noire, à la recherche de son armée le soir du malheureux jour. Une telle raillerie, transmise de
(21) Arch. Cor., B. 596, B. 445, B. 466.
(22) Arch. Cor., B. 414 à B. 493 et B. 501 à B. 636.
génération en génération, a défiguré la physionomie historique de ce brave et intrépide soldat qui, l'année suivante, remporta deux succès dans la Hesse. Orphelin à neuf ans (1724), Charles de Rohan, prince de Soubise, d'Espinoy, de Maubuisson, maréchal de France (23), ministre d'Etat, avait hérité du fief de Ventadour au décès de son grand-père, Hercule-Mériadec, duc de Rohan-Rohan, survenu en 1749.
Après lui, le duché revenait à sa fille Armande-Josèphe, épouse du prince Henri de Rohan-Guéménée. En apprenant la mort de celui qui était duc de Ventadour depuis 38 ans, la sénéchaussée décida de faire célébrer un service solennel à l'église d'Ussel, et prescrivit aux desservants une cérémonie funèbre dans chaque paroisse de la mouvance (24).
Pénalement, ou plutôt criminellement, car c'était la seule expression en usage, la sénéchaussée ducale eut à réprimer, outre les vrais crimes, des infractions du genre de celles que nous voyons couramment se produire : vols, coups, menaces, disputes, rixes, bris, recel., tant il est vrai que l'être humain reste le même, au lieu d'aller en s'amendant.
Voulez-vous connaître quelques faits punissables? Ce sont des vols de poissons dans le réservoir des Salles, dans le réservoir de Couzergue, dans celui de Vigier, dans l'étang de Bonnaigue; de truites à Venard, de bestiaux à Neuvic, de bourses à Ussel, d'argent à Chassaignac. Voici des coups de bâton sur un bourgeois de la ville par un boulanger du nom d'Estrade, des blessures avec une canne à lance, ou
(23) Titres et qualités en 1755 : « Son Altesse Monseigneur Charles de Rohan, prince de Soubise, duc de Ventadour, capitaine lieutenant des gens d'armes de la Garde du Roi, gouverneur pour Sa Majesté des provinces de Flandre et de Hainaut, lieutenant-général des armées. » (Arch. Cor., B. 708.) En 1785 : « Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Mareschal prince de Soubise, duc de Ventadour. » (Arch.
Cor., B. 470.) C'est lui qui fit construire dans le quartier du Marais, à Paris, le magnifique hôtel où, depuis 1808, sont établies les Archives nationales.
(24) Arch. Cor., B. 474.
avec une mesure d'étain jetée à la tête; des menaces de mort et d'incendie; des disputes au cabaret, à la fontaine, sous la halle, sur les fossés; un soufflet par Gabriel Bardinot, meunier de la Rebeyrotte, à un huissier venu saisir ses meubles. Le cadenas d'un tronc de l'église Saint-Martin est brisé pendant la nuit; une serrure de la maison Bonnot saute. Des rixes ont lieu dans les auberges, dans les boulangeries, à Beauregard, à la Bardoire, au cours d'une fête à la porte Duchier, sur la place publique entre le soldat Graffoulière et le praticien Goudounesche. On se dispute au sujet des landes de Ratou et de celles de Vergnolles, et l'on se bat à coups de pierres pendant une réunion de cordonniers tenue « sous l'Aubépin » (25).
D'autres encore?. En passant « sous l'Aubépin », le lieutenant de Confolens, Jean Chabannes, est maltraité par Antoine Moncourrier et Jean Chavanon. Dans la rue allant des Ursulines à la porte Duchier, la nuit, les nommés Fenouillac et Faurin assaillent François Chassaing, domestique de Jean Arzilier, aubergiste. De folâtres jeunes gens s'amusent à lancer des cailloux à un groupe d'ouvrières se baignant dans la Sarsonne, et l'une d'elles, Jeanne Chiniac, soutient ensuite que ces jeunes gens les ont injuriées, obligées à sortir de la rivière et, finalement, frappées. Au domaine du Charlat, appartenant à Jean Demichel, on enlève du pain et de la farine. A l'église d'Ussel, un calice et sa patène disparaissent de l'armoire, cependant que le sacristain, François Martinerie, est soupçonné de retenir une partie des quêtes et de voler les sacs du curé Jean Ternat. Le fermier des fours banaux dénonce les habitants qui font cuire chez eux du pain de seigle, alors que la pâtisserie est seule permise. (Ces fours étaient placés dans la partie centrale de la ville, entre l'église et l'entrée du Thuel, à quelques mètres des maisons Bonnet et Cosnac) (1753) (26). Le
(25) Arch. Cor., B. 637 à B. 687, passim.
(26) 27e témoin de l'enquête Bonnet-Bonnot.
Fermiers des fours banaux : 1741, Jean Monestier (Michelle Basilie, veuve Lavergne, sa gérante). Arch. Cor., B. 421; 1754 : Marcel Chiniac (id., B. 603).
quartier avait sa « Rue du Four-Banal ». Une autre rue appelée « Derrière les fours » « est une rue peu usitée », prévenait un citadin rendu prudent par une mésaventure (1784) (27) : s'agirait-il de la rue Esparvier actuelle, si importante au moyen âge et bien déchue au XVIIIe?) Soit à la suite de plaintes, soit directement sur réquisitions du procureur principal, des informations s'ouvrent et se poursuivent contre des individus qui, au pont des Salles, la nuit, ont démoli les garde-fous et les ont jetés dans la Diège; contre Léonard Culinas, surnommé Gastepaste, et Marie Sudrie, appelée Navaronne, coupables de vols commis ensemble; contre les gens qui ont attendu François Diousidon à la sortie de l'auberge Maignac dans l'intention de l'assaillir; contre le sieur Demichel pour avoir « assommé » Jeanne Conches en passant au village de Ratou; contre François Estager, sur la demande des femmes de Bonnesaigne, vexées qu'il ait établi une liste des maris trompés de leur paroisse; contre Pierre Couderc, d'Aix, qui a tendu un guet-apens à Jean Veyssière, de Saint-Etienne, dans la rue « conduisant à la porte de l'Aubépin » (peut-être devant la maison Chastagner; peut-être à l'angle de l'enclos Chaminade) (28). - Ne pensez-vous pas que ce nom d'Aubépin revient un peu trop fréquemment? L'Aubépin (ou aubépine) se trouvait à la sortie de la porte Séclide, du côté de la prairie. C'était un arbre sous lequel il y avait une croix scellée dans une pierre. Les Ussellois en promenade s'as- seyaient volontiers sur cette pierre (29). Des artisans ve-
(27) Arch. Cor., B. 638, B. 665, B. 684, B. 640, B. 638, B. 639, B. 650, B. 683, B. 596, B. 536.
(28) Arch. Cor., B. 644, B. 649, B. 664, B. 650, B. 647, B. 641.
(29) Arch. Cor., B. 638, B. 647. — Aubépin, masculin d'aubépine.
« Le mot d'aubépine est beaucoup plus d'usage que celui d'aubépin qui ne se trouve que dans des poésies anciennes. » (Dict. de l'Académie fr., éd. de 1822.) « Aubépin a été employé par Régnier », Marot, Palissy, Paré. (Littré, éd. de 1875), par Ronsard aussi (Odes, 4" livre) : .« Vy, gentil aubespin. Vy sans fin. Vy sans que jamais tonnerre. Ou la coignée ou les vents. Ou les tems. Te puyssent ruer par terre. »
Une ruelle voisine a été dénommée « rue de l'Arbre-Pin. » Arbre
naient, les soirs d'été, tenir leurs réunions ici. Seulement, quand il faisait nuit noire en ce coin tranquille et retiré, le passant attardé, regagnant la ville, reconnaissait difficilement, franchie l'enceinte, les personnes embusquées dans un enfoncement de rue ou à l'entrée d'une ruelle obscure.
Au delà de l'Aubépin, ondulait la campagne à travers quoi les malfaiteurs pouvaient s'enfuir et se cacher. L'endroit était propice aux mauvais coups, aux traquenards.
Des plaintes m'attristèrent : celles de Jeanne Arzilier, deuxième femme du dernier maire perpétuel, qui accusait son mari de mauvais traitements et son ancienne « fille de chambre » d'injures « graves » et « grossières » (30). Et je pensais au dernier maire, à ce pauvre Firmin Barbier de Villeneuve qui eut une existence déplorable. Fils d'un secrétaire du roi, investi par délégation d'une parcelle de l'autorité souveraine, il alla de chute en chute, pour tomber au rang de policier sous la Restauration. Après s'être uni en mariage à l'une de ces bonnes familles bourgeoises qui se confondent avec la petite noblesse, devenu veuf il épousait sa propre gouvernante, que bientôt il rouait de coups, et la fille issue de cette alliance disparate devait être, de son vivant, la femme d'un gendarme de notre localité. Il prit une troisième épouse dans un milieu semblable à celui de lr précédente. A la veille de sa mort, le gentilhomme qui, en son bel âge, mandataire du roi de France, avait tenu le premier rang à Ussel de concert avec le lieutenant-général, n'était plus, dans la même ville, qu'un insignifiant commissaire de police, grand beau-père d'un tenancier d'auberge (31).
Voici deux autres incidents sur lesquels informèrent les lieutenants du sénéchal. Gilbert de Boucheron, seigneur de
Pin? On constate ici une déformation populaire d'Aubépin sanctionnée innocemment par un Conseil municipal trop ignorant du passé de la ville.
(30) Arch. Cor., B. 680, B. 681.
(31) Reg. par. et reg. de l'état civil d'Ussel, et Arch. Cor., B. 675, B. 679, B. 680, B. 681, B. 682.
Saint-Hippolyte et de Chalusset, âgé d'environ 60 ans, était à table avec les siens, au château de Maumont, sa résidence, le 8 mai 1713, lorsque trois individus, conduits par le chapelain Dubois, vinrent « insolemment » — c'est son mot — lui demander quittance de rentes « qu'ils n'avaient pas payées ». Le sieur de Chalusset congédia « doucement » le groupe, qui sortit, mais presque aussitôt se rendit, armé de fusils, devant la chapelle du château. Les manifestants obligèrent le fils du marguiller à sonner la cloche. Ils savaient qu'à ce signal les paysans d'alentour, prévenus, accourraient avec des fourches, des piques, des fusils, des haches, et ils comptaient pouvoir, grossis en nombre, entourer le château et contraindre le seigneur. A ce moment survint le curé de Rosier et de Saint-Hippolyte auquel Boucheron avait eu recours. Les paroles de bonté que prononça le prêtre calmèrent un peu les séditieux. Ils firent un mouvement de retraite — vite arrêté par les hommes venus à leur aide : et, se portant derechef en avant, renforcés par des arrivées successives, ils pénétrèrent cette fois dans les dépendances, s'emparèrent de morceaux de bois qu'ils allèrent entasser devant le portail, puis allumèrent un grand feu. De nouveau, le curé, qui les connaissait tous, leur parla charitablement.
Mêlé au peuple, il n'ignorait point la rancœur de certains et avait compris le mobile du « tumulte ». Il raisonna si adroitement les mécontents, il sut être si persuasif, que, « après plusieurs remonstrances », dit simplement le texte, ils finirent tous par se retirer. La nuit étant venue, ils profitèrent de l'obscurité pour disparaître. Et ainsi s'acheva cette émeute, qu'on pourrait aussi bien placer 76 ans plus tard, parmi les scènes du début de la tragédie révolutionnaire (32).
Second fait. Trois gais lurons de notre ville, « enfants de famille », faisaient des leurs. Le soir, ils « vagabondaient » dans les rues, hantaient les pires cabarets, vivaient dans la débauche. En plein jour, ils poussaient jusqu'aux villages voisins où, pour s'amuser aux dépens des paysans,
(32) Arch. Cor., B. 641.
ils tuaient sous leurs yeux, avec des couteaux de chasse, la volaille qui se trouvait sur leur passage. A bout de ressources pécuniaires, ils convinrent de s'approprier une maison de campagne appartenant au père de l'un d'eux et habitée par une dame octogénaire. Ils connaissaient la demeure : déjà, ils y avaient bu quelques bouteilles de vin et consommé « du pain et du fromage ». Munis d'armes à feu, ils s'emparèrent sans peine de l'immeuble. Prestement, ils firent main basse sur tout ce qu'il renfermait : ustensiles de ménage, draps de lit et couverture de la vieille dame qu'ils chassèrent, sacs de grains qu'ils transportèrent « clandestinement » et « toujours armés de fusils » dans une maison d'Ussel, où ces objets furent mis en vente. Puis, ils ouvrirent un « cabaret public » au rez-de-chaussée. Continuant leur joyeuse existence, ils s'en furent à la Tourette en burlesque cortège, l'un battant du tambour, un nouveau compagnon jouant du fifre, et ils revinrent non moins comiquement, les autres portant, derrière l'orchestre, un seau rempli de vin. Ces plaisanteries, qui eussent mérité une sévère punition de la part des parents, se terminèrent fâcheusement par l'emprisonnement de celui de nos jeunes gens considéré comme le plus coupable. Mais ne se trompait-on pas? Dans les deux autres, il y avait un carme apostat, et c'était lui, des trois, le moins recommaridable (33).
Le crime qu'on appelait alors « recèlement de grossesse » étant sévèrement puni par les ordonnances de 1556 et 1585, une déclaration faite à temps mettait la personne à l'abri.
Sur les registres de la sénéchaussée on relève plusieurs de ces déclarations qui, dans l'ensemble, ont été peu nombreuses. La fille ou la veuve désignait d'ordinaire le séducteur : son maître, le fils de son maître, un parent de son maître, le domestique de son maître, le fils de son voisin, le procureur du Roi en l'Hôtel de Ville, un cavalier du régiment de Gramont, un cabaretier, un cordonnier, un avocat, un huis-
(33) Arch. Cor., B. 659, B. 660.
sier, un tailleur pour femmes, voire, certaines fois, un inconnu. De recherches de paternité, il ressortit ce curieux « usage du pays » que « les fils de la maison et les bergères ont toujours couché dans des lits jumeaux » (34).
Malgré la rigueur des peines encourues, quelques personnes ne voulurent jamais déclarer leur état. Et de temps en temps on trouvait, au réveil, des nouveau-nés exposés à l'entrée d'une église, ou abandonnés à la porte de l'Hôtel-Dieu ou devant l'oratoire de la Chabanne. Un cadavre fut découvert à l'étang de la Rebière (35).
Extrêmement dur était le châtiment. Marie Astier, journalière d'Ussel, convaincue d'avoir jeté une petite fille dans un puits, fut pendue sur le lieu de son forfait. La sentence est conçue en ces termes : « Veu le procès, (les) conclusions définitives du procureur principal du 6" du présent mois, les pièces du procès y référées, ensemble l'interrogatoire sur la sellette subi ce jourd'huy en la chambre du conseil par ladite Astier, le tout examiné, Nous, veu ce qui résulte desdites charges et informations, avons déclaré et déclarons ladite Marie Astier dhuement atteinte et convaincue de grossesse, accouchement et suppression de part; pour réparation de laquelle supretion de part l'avons condamnée et condamnons à faire amande honorable publiquement, la corde au col et une torche de cire ardente à la main du poids de deux livres au devant de l'église paroissiale de cette ville où elle demandera à genoux pardon à Dieu, au Roy et à la Justice de ladite supretion de part; (à estre ensuite) menée au devant de la porte par l'exécuteur de la haute justice, et, ce fait, à estre conduite par ledit exécuteur auprès du puits appelé de Redon situé au fauboug Ducher pour y être pendue et étranglée par ledit exécuteur à une potence qui sera à cet effet plantée proche le puits, où son corps mort de-
(34) Arch. Cor., B. 414 à B. 493 et B. 501 à B. 687.
(35) Arch. Cor., id. — 17 juillet 1782 : « Baptême d'un enfant trouvé ce matin à la porte de la Chabanne, qui a paru âgé de quelques jours, à qui nous avons donné le nom de Léonard Lafleur. » (Reg. par.
d'Ussel.) Manière en usage à l'époque. On se rappelle comment furent traités ceux qui devinrent d'Alembert et Chamfort.
meurera exposé pendant l'espace de 24 heures; et condamnons ladite Astier en trente livres d'amende envers le seigneur de cette justice, Son Altesse Monseigneur le prince de Soubise, et aux dépens envers ceux qui les ont exposés.
Fait et jugé en Chambre du Conseil du siège seneschal de Ventadour, à Ussel, le 19" jour du mois de juillet 1748, par nous, Antoine-Alexis Millange, lieutenant-général audit siège, assisté de Messieurs Duplantadis, lieutenant particulier, et de Bay, conseiller » (36).
Sévères, les juges ducaux le furent quelquefois. Ils condamnèrent le principal auteur d'un recel et d'une suppression à trois ans de galères, son complice à l'exposition et au fouet, la sage-femme à trois ans de bannissement (1780) (37). Ils infligèrent un bannissement de neuf années à Jeanne Peyrout, surnommée « Jeanne de la Galerie », une misérable, qui avait « coupé plusieurs bourses » un jour de foire à Ussel (1713) (38).
Désirez-vous savoir si ces peines étaient trop rigoureuses? Prenez celles d'un tribunal voisin, le présidial de Tulle, dont le ressort touchait celui du sénéchal et s'étendait aussi en Bas-Limousin. On y punit de mort une boulangère d'Ussel, pour avoir caché son accouchement; une servante, Tounitou, de Tulle, coupable d'infanticide; une voleuse, Elisabeth Armand, déjà flétrie de la marque; un individu qui, au cours d'une rixe, en avait tué un autre. A des vagabonds le présidial infligea 7 ans de galères; à d'autres vagabonds, la marque et le bannissement; à deux échappés des galères, le supplice de la roue. Des recèlements de grossesses, dans la région du Port-Dieu, entraînèrent le fouet et le bannissement, tandis qu'un vagabond récidiviste subissait 3 ans de galères (39). C'était donc le même ordre de peines à Tulle et à Ussel.
(36) Arch. Cor., B. 655. — Le droit de condamner à mort (haute justice) — dont ne disposent pas les tribunaux de première instance - suffit à montrer l'importance et l'étendue des pouvoirs de la sénéchaussée.
(37) Arch. Cor., B. 679.
(38) Arch. Cor., B. 641.
(39) Arch, Cor., 6. 909, B. 910, B. 891, B. 892, B. 922, B. 944, B. 895.
Un autre cas de répression intéressait la police des mœurs. Marie Goudouneix, fille d'un armurier de la ville, quoique « encore toute jeune », menait « depuis plusieurs années la vie la plus scandaleuse » : et ce libertinage était favorisé par d'indignes parents qui en retiraient un profit pécuniaire. Le procureur principal, s'appuyant sur les ordonnances de 1254, 1391, 1566 et 1586, demanda au siège, tant pour les parents que pour la fille, une « punition extraordinaire » (1741) (40).
Enfin, je relaterai un événement qui fit du bruit à l'époque : l'assassinat du seigneur de Margerides.
Le lundi 15 mars 1700, à l'heure de midi, Jean Dubois, écuyer, seigneur de Margerides, et son frère Jacques, seigneur de Saint-Julien, adolescent de 17 ans, chevauchaient en compagnie de Jacques Forsse. Nos gentilshommes étaient, tous deux, montés sur le même cheval, Margerides devant, Saint-Julien derrière. Ayant pénétré dans le bois de Montagne, propriété du sieur de Vaux, près de Beauregard, ils aperçurent, dans ce bois, un groupe de gens armés, où ils distinguèrent d'abord des valets à M. de Vaux. Sur le conseil de Margerides, Saint-Julien descend de cheval. Les gens s'approchent et, « d'une furie », menacent le seigneur de Margerides, l'avertissant qu'il lui arrivera ce jour-là « ce quy est préparé depuis longtemps ». Parmi eux, il y a, maintenant bien visibles, le sieur de Vaux, le sieur Langlade, frère de celui-ci, le sieur de Saint-Cantin de Beaufort, le sieur de Bonnefon : les autres ont « plutôt la figure de satellites ». Margerides est toujours à cheval, allant au petit pas; Saint-Julien le suit à pied. Langlade se détache du groupe, un fusil à la main, épaule et tire sur le seigneur de Margerides qui, atteint à la poitrine et à l'estomac, tombe de cheval. Saint-Julien veut porter secours à son frère; mais aussitôt la troupe l'entoure, et le sieur de Vaux s'empresse de lâcher un second coup de fusil sur Margeri-
(40) Arch. Cor., B. 649,
des « dont luy farssy tout le costé droict ». Pensant avoir achevé celui-ci, les assassins se retournent contre SaintJulien, lequel n'ayant aucune arme pour se défendre, prend la fuite, poursuivi par les agresseurs dont les balles se logent dans les arbres. Il sort du bois en criant : « Ayde!
Ayde! MM. de Vaux ont thué mon frère! » ; sur quoi, Forsse, qui s'est tenu à cheval, se met à galoper, demandant : « Justice! On nous assassine! » Le seigneur de Margerides reste dans le bois, étendu par terre, tout ensanglanté, le visage tourné vers le ciel, les mains sur la poitrine, l'épée dans le fourreau, mais le ceinturon « rompu en deux endroits »; du sang sort de la bouche; lorsqu'il est tombé, il a demandé un confesseur. Les assassins se sont éloignés : six ont pris la direction de Vaux.
Cependant le seigneur de Saint-Julien s'est rendu chez le juge ordinaire auquel il a fait une déposition écrite.
Celui-ci va sur les lieux : il trouve Margerides étendu « quasy mort », rendant le dernier soupir, revêtu de son habit bleu, en justaucorps et haut de chausses; ses poches sont vides, et la bourse ne contient plus rien. Le magistrat mande le sieur Mornac, maître-chirurgien juré de la ville d'Ussel, qui arrive précipitamment; et, après examen médical du cadavre, le corps est transporté au château de Margerides.
Dans les jours qui suivirent, l'information ouverte par le juge inférieur, Géraud Monestier, à la demande de SaintJulien, était poursuivie par le lieutenant-général de Ventadour, Antoine de Bonnet de la Chabanne. Le 10 avril, après réquisitions du procureur principal Delmas, Bonnet signait un décret de prise de corps « contre le sieur Langlade, cadet de Vaux » et contre son valet Mourguès, et un décret d'ajournement personnel « contre le sieur de Vaux aysné », « pour raison de meurtre commis en la personne dudit sieur de Margerides ».
Langlade et Mourguès, arrêtés, furent emprisonnés à Ussel. Vaux ne tarda pas à les rejoindre. Puis, tous les trois durent être transférés à Tulle. Ils languissaient dans les cachots de cette ville en attendant de gravir l'échafaud, quand
arrivèrent des lettres du Roi délivrées en leur faveur, à Versailles, au mois de mai de la même année 1700. Par l'effet de ces lettres — qui leur rendaient la liberté Louis XIV, délibérément, absolvait les assassins d'un crime qu'ils avaient indéniablement perpétré (41).
(Cette clémence royale pour des assassins aussi bien déterminés et convaincus ne peut s'expliquer et s'excuser que pour des motifs souverains, qui restent inconnus, mais n'en devaient pas moins être sérieux et valables.)
V
Fin de la Sénéchaussée. — Conclusion
1789. La suppression des justices seigneuriales, durant la pathétique nuit du mardi 4 août au mercredi 5 août, entraîna celle de la sénéchaussée, deux cent onze ans après qu'Henri III en décidait la création.
A cette date la cour ducale vaquait depuis quatre semaines. Sa précédente audience avait eu lieu le 7 juillet 1789, et le plus récent jugement, rendu ce jour-là, rejetait l'appel d'une sentence d'un magistrat ordinaire. Néanmoins, quinze mois s'écoulèrent avant que la suppression devienne effective. Une nouvelle année judiciaire commença, se poursuivit, s'acheva. En septembre 1790, la sénéchaussée continuait de tenir des audiences. Le 3, elle prononçait six jugements. Le 10, par un appointement, elle autorisait des plaideurs à prouver certains faits. Delmas présidait l'audience du 10 septembre, avec deux avocats, Brival fils et Jean Diou-
(41) Arch. Cor., B. 637 (« Assassinat de Messire Jean Dubois, seigneur de Margerides, par Jean-Joseph et Antoine Langlade, sieurs de Vaux, et leurs domestiques » ).
Relevé : 1694, « Anthoine de Langlade, seigneur de Vaux, Crouzat et autres places ». (Reg. par. d'Ussel.) — 1721, « Joseph Langlade de Vaux, bourgeois de Saint-Julien ». (CHAMPEVAL, Bas-Lim., p. 355.)
sidon, comme juges assesseurs, en « l'absence » des autres officiers du siège (1).
Comme la « séance » annuelle élait terminée, les vacations commencèrent. Mais il n'y eut alors aucune réunion pendant les fériés, et l'on sut bientôt que la « séance » ne se rouvrirait pas. Le moment approchait. Avant de disparaître définitivement, la sénéchaussée voulut siéger une dernière fois. Ce fut le 20 novembre 1790, un samedi, en audience « extraordinaire » tenue par Delmas, « lieutenantgénéral », assisté du même Jean Diousidon. Une seule affaire avait été fixée. Avocats et procureurs parlèrent, puis déposèrent sur le bureau les pièces de la procédure. Les juges allèrent prendre connaissance de ces pièces en chambre du conseil, rendirent leur sentence et se retirèrent.
Telle a été la fin digne et simple de la justice du sénéchal (2). Cinq jours plus tôt, le 15 novembre 1790, Louis XVI avait signé la nomination de Delmas au poste de président du nouveau tribunal qui allait, sans heurt, se substituer au siège de Ventadour.
Nous voici aux termes de cette étude.
Jusqu'ici la sénéchaussée d'Ussel était peu connue et mal connue. On avait une tendance à la juger d'après le mémoire de Pierre-Léonard Diousidon, que Huot eut tort de reproduire (3), et qu'il aurait dû plutôt enfouir au fond d'une armoire poussiéreuse : d'autant que ce mémoire, daté de 1731, ne concerne que l'époque où il fut écrit et ne peut, de surcroît, être regardé comme une juste peinture du milieu judiciaire. Diousidon me paraît un esprit chagrin : il critique tout le monde, il dénigre tout, sauf lui, sauf les fonctions de lieutenant particulier qu'il exerce; des faits et
(1) Arch. Cor., B. 481, B. 479. — Guillaume Oemichel, conseiller, « absent » le 10, avait, le 4 septembre, établi un procès-verbal de comparution de parties (id., B. 2.511).
(2) Arch. Cor., B. 2.511.
(3) HUOT id., pp. 103 à 106, et ci-dessus, p. 16.
des paroles, il retient ce qui est défavorable et garde le silence sur le reste. Sa jérémiade déforme la physionomie du tribunal. Qu'il y ait eu quelques défaillances, des fautes, des erreurs, parfois des abus, cela tient d'abord à la nature de l'homme dont le faible est d'errer; cela vient aussi de ce que les magistrats ne se sentaient point retenus par un contrôle attentif et permanent, et qu'ils étaient, par là, trop laissés à eux-mêmes. Mais ces fautes, explicables et la plupart excusables, constituèrent l'exception.
Du travail de dépouillement auquel je me suis livré, résulte pour moi la conviction que, plus on étudiera la sénéchaussée, plus s'atténuera la nocivité du mémoire. On trouvera des magistrats qui purent avoir des torts — quelqu'un en est-il exempt? — mais considérés dans leur ensemble, furent compétents, assidus, probes, jugèrent de satisfaisante façon, avec sérieux et gravité. On trouvera des hommes de loi (avocats en parlement ou simples praticiens) actifs, adroits, sachant conseiller le plaideur et soutenir ses intérêts; un greffe ponctuel et dévoué; toute une catégorie de gens estimables, que méconnaît le rédacteur du Mémoire en son esprit de parti. A la lumière d'authentiques pièces de justice la sénéchaussée apparaîtra dans son vrai jour, et je crois, oui, je crois qu'elle sera en assez bonne posture lorsque l'impartiale histoire l'aura définitivement campée.
.Puis, n'oublions pas que cette Cour ducale, en résidant à Ussel, accrut l'importance de la cité qui devint, grâce à elle, capitale incontestée de la montagne bas-limousine et gardons lui, nous Ussellois, un souvenir reconnaissant.
APPENDICE
1
SUR LES VENTADOURS
Entre deux petits cours d'eau torrentueux qui l'enserrent aux trois quarts, sur le crête d'une montagne abrupte et rocailleuse dont la base est protégée par de profonds ravins, en un site sauvage de bruyères, de forêts, de hauteurs, le château de Ventadour se dressait jadis, fièrement, à quelques kilomètres de la villette d'Egletons. Sa position formidable, ses défenses naturelles, les ouvrages d'art qui furent ajoutés, le firent considérer par Froissart comme un des châteaux les plus forts « du monde ». Des ruines en indiquent l'emplacement aujourd'hui; et « parmi les débris du passé, il n'est rien peut-être de plus imposant que ce manoir solitaire, que la puissance féodale posa, comme un nid d'aigle, au milieu des landes, sur des rochers inaccessibles » (a).
Là grandit une famille dont la domination s'étendit sur le sud-est et jusqu'au centre du Bas-Limousin, cependant qu'au sud-ouest les Turennes régnaient supérieurs en puissance et en illustrations.
Trois branches de maisons différentes assurèrent la continuité des seigneurs de Ventadour : une branche des Comborn, du XIe au xv" siècles; une branche des Lévy, du xve au XVIIe; puis une branche des Rohan. A chacune d'elles appar-
(a) Extrait de l'Histoire des Villes de France : Tulle, Ussel-Ventadour, par Alexis DE VALON, 1. br. (1847), p. 14.
tint successivement le fief de Ventadour, vicomté d'abord, comté le 2 avril 1350, duché à partir de février 1578, duchépairie en juin 1589.
Archambaud Ier de Comborn, appelé Jambe-Pourrie, ou encore le Boucher à cause de sa férocité dans les combats, celui-là même qui s'empara du château de Turenne en 986, est le plus ancien seigneur connu. Il était à la fois vicomte de Comborn, de Turenne et de Ventadour. Ses domaines furent partagés entre ses descendants, et c'est Ebles, son arrière-petit-fils, le frère d'Archambaud III, vicomte de Comborn, et le neveu de Guillaume, vicomte de Turenne, qui commença la lignée proprement dite des seigneurs de Ventadour (vers 1035).
En 1472, Blanche de Comborn, fille de Louis-Charles de Comborn, comte de Ventadour, et de Catherine de Beaufort (celle-ci fille de Pierre de Beaufort, vicomte de Turenne, et de Blanche de Gimel) porta le comté de Ventadour dans la maison de Lévy par son mariage avec Louis de Lévy, seigneur baron de la Voulte, près de Viviers. Maréchaux de la foi depuis la croisade albigeoise, les Lévy prétendaient, dit-on, sortir de la tribu de Lévy, l'une des douze d'Israël, et par suite être apparentés à la Sainte Vierge. On raconta qu'ils possédaient un tableau « représentant le déluge, où l'on voyait un homme tendre hors de l'eau une liasse de parchemins en criant : Sauvez les papiers de la maison de Lévy! », et un autre tableau mettant en scène « un Lévy s'incliant, nue tête, devant la Vierge qui lui disait : Couvrez-vous, mon cousin. » Ces histoires, ajoute Huot qui les rapporte (b), « paraissent apocryphes et propagées, non par
(b) Les Arch. munie. d'Vssel, p. 16.
On raconte également que le duc de Lévy, passant un jour devant un calvaire avec le vicomte de Pons dont la famille déclarait descendre de Ponce Pilate, dit à celui-ci d'un air attristé : « Voyez dans quel état votre ancêtre a mis mon parent. » (Cité par VËRHYLLE, Essai sur Olliergues, 1 br., 1927, p. 32.) « Cette maison, quelque ancienne qu'elle soit, ne tire son nom que de la terre de Lévy, dans le Hurepoix. » (DELMAS, id., p. 88.) L'abbé Niel (Bull. Soc. Hist. Cor., XI, 104) précise que, « outre des doutes
les Lévy, mais par ceux qui voulaient tourner en dérision leur orgueil peut-être excessif ».
Marie-Anne-Geneviève de Lévy, fille unique de LouisCharles de Lévy, duc de Ventadour, et de Madeleine de In Motte-Houdancourt, veuve de Louis-Charles de la Tourd'Auvergne, prince de Turenne, tué à la surprise de Steinkerque le 3 août 1692, épousa, en 1694, Hercule-Mériadec de Rohan-Soubise, duc de Rohan-Rohan, prince de Soubise; et ainsi le duché de Ventadour passa dans cette grande maison de Rohan, issue des anciens rois de Bretagne, qui le possédaient au début de la Révolution.
Il y eut huit ducs de Ventadour : 5 Lévy, 3 Rohan. La pairie s'est éteinte avec le dernier Lévy. Ces ducs furent : Gilbert de Lévy (1578-1591), époux de Catherine de Montmorency ; Anne de Lévy (1591-1622), marié à Marguerite de Montmorency ; Henri de Lévy (1622-1629), époux de Marie-Liesse de Luxembourg. Il céda le duché à son frère Charles et se fit d'église (c); Charles de Lévy (1629-1649), marié à Suzanne de Lauzières, marquise de Thémines, puis à Marie de la Guiche.
Scarron parle de lui dans son « Voyage de la reine à La Barre « (d); Louis-Charles de Lévy (1649-1694), marié à Catherine de la Motte-Houdancourt, qui devait être gouvernante des enfants de Louis XV. Il était « petit et bossu » (e);
graves sur leur origine juive, les Lévy tiraient leur nom d'une terre qu'ils possédaient dans l'Ile-de-France, près de Chevreuse, dans l'ancien doyenné de Chèvres ?».
(c) Chanoine de Notre-Dame, il fonda la « Compagnie du Très Saint-Sacrement de lautel » dans le but de combattre l'hérésie calviniste. Cette Société parvint à la plus active période de son influence sous la minorité de Louis XIV. (R. DE BOYSSON, L'invasion calviniste, 2" éd., pp. 389 et 393.)
(d) HuoT, id., pp. 109 et 110.
(E) DELMAS, id., p. 88, en note.
Hercule-Mériadec de Rohan (1694-1749), époux de MarieAnne de Lévy (f) ; Charles de Rohan (1749-1787). Soubise a été marié trois fois : en 1734, avec Anne-Marie-Louise de la Tour-d'Auvergne-Bouillon, d'où la princesse de Condé; en 1741, à la princesse Thérèse de Carignan-Savoie, dont VictoireArmande-Josèphe; en 1745, à la princesse Christine de Hesse-Rhinsfeld; Henri de Rohan, prince de Guéménée (1787-1789), époux de Victoire-Armande-Josèphe de Rohan-Soubise.
On a pu voir que le duché de Ventadour, avant de passer dans la maison de Rohan, avait été porté (1691) dans celle de Turenne qui eût par là, de 1717 à 1738, sans la mort de Louis-Charles à Steinkerque, possédé la majeure partie du Bas-Limousin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre : Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze
Auteur : Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze. Auteur du texte
Éditeur : (Brive)
Date d'édition : 1902
Type : texte
Type : publication en série imprimée
Langue : français
Langue : Français
Format : Nombre total de vues : 33810
Description : 1902
Description : 1902 (T24).
Description : Collection numérique : Fonds régional : Limousin
Droits : domaine public
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5457715c
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-89252
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344265167
Provenance : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/01/2011
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97 %.
L'INSTRUCTION PRIMAIRE
A ÉGLETONS
Depuis 1650 jusqu'à nos jours
J. SEURRE-BOUSQUET ?
CHAPITRE PREMIER
L'Instruction au moyen-âge. — Le Séminaire du Moustier-Ventadour transféré à Égletons. — Règlement de l'évêque de Limoges pour les maîtresses d'écoles de son diocèse. — Traitement du maitre d'Egletons aux xvir et xvin* siècles. — Avènement dé Turgot à l'intendance de Limoges. — Ses efforts pour le développement de l'instruction dans les paroisses. — Augmentation du traitement du maitre d'école de la ville d'Egletons. — Considérations générales.
On sait que durant le moyen-âge l'enseignement fut Fapanage exclusif du clergé et que cette mesure est due à Charlemagne qui, dans un de ses capitulaires, ordonna à tous les prêtres de campagne de tenir des écoles dans les bourgs, d'y recevoir les enfants des fidèles, de les instruire avec charité et de ne rien exiger pour ce service.
Malgré les sages dispositions du grand empereur., malgré les efforts, dans la suite, du pouvoir royal, et sauf quelques écoles épiscopales et monastiques qui nous conservèrent dans l'ombre les traditions de la civilisation antique,, on peut dire de ces temps troublés et malheureux que le défaut d'instruction
et d'éducation était presque général, surtout en Limousin. (1)
" S'il faut en rechercher les causes, on les trouvera selon nous, non-seulement dans l'insuffisance des maisons d'école et des maîtres, dans l'indifférence et la parcimonie d'un grand nombre d'administrateurs de paroisses, auxquels il était difficile de faire comprendre que la fondation d'une école ou le traitement d'un régent Avalait une allocation de la commune ; mais aussi dans l'apathie des masses qui n'éprouvaient aucune sympathie pour l'instruction qu'elles considéraient le plus souvent comme un moyen de désunion dans les familles.
Aussi en face de toutes ces circonstances qui entravèrent si longtemps la diffusion de l'instruction primaire dans les campagnes, on comprend combien il était difficile de rencontrer de bons maîtres (2) s'attachant à une profession qui ne les mettait souvent pas à même de faire vivre leur famille ; et, par suite du défaut de fréquentation, combien peu d'élèves arrivaient à acquérir une instruction suffisante.
Néanmoins, beaucoup de villes et de bourgades
(1) Les écoles, dit M. Babeau, étaient plus répandues dans les régions de l'Est et du Nord de la France que dans celles du Centre, de l'Ouest et du Midi.
Dans l'Auvergne, la Marche, le Limousin, on ne rencontrait, dit M. Buisson daus son Dictionnaire de pédagogie, pas un maître d'école sur vingt villages. (Tome I, art. France).
(2) Dans un mémoire adressé par la communauté d'Egletons à Turgot vers la fin du ivni' siècle, il est dit que que : « vingt livres de traitement annuel sont affectés au maître d'école, quelquefois vingt-quatre quand on est content du sujet, ce gui arrive rarement. » (Pièce de mes archives).
— 9 —
comprenaient combien l'instruction était nécessaire au développement de l'intelligence humaine et combien était précieuse l'existence d'une école publique.
Pour l'honneur de la ville d'Egletons, empressonsnous de dire qu'elle était de ce nombre. Ajoutons même que ses habitants, en dépit des préjugés trop vite accrédités, ont de tout temps et de toutes manières témoigné en faveur de l'instruction un goût prononcé et un empressement peu ordinaire. (1)
De cette localité du reste et de ses environs sont sortis des hommes dont la renommée littéraire remplit toute l'Europe du Moyen-Age, des poètes dont les vers ont été regardés comme des modèles, non pas de leur temps, ni dans leur pays, mais un siècle plus tard à l'étranger, au jugement des plus grands, des plus beaux génies. Pétrarque dans le Triomphe d'Amour et Dante dans la Divine Comédie n'ont-ils pas consacré, en effet, les noms de Bernard de Ventadour et d'une foule d'autres troubadours issus du Bas-Limousin?
Ventadour surtout fut non-seulement le berceau de poètes célèbres, tels que ce Bernard dont nous venons de parler et qui sut par ses gracieuses chansons d'amour émouvoir le coeur de sa châtelaine et celui de la belle Éléonore de Guienne; mais il fut encore le centre d'une vraie Cour d'amour.
Un des seigneurs, Ebles II, vivant en 1109, fut
(i) C'est sinsi que nous les voyons en 1620 donner vingt écus pour aider à la construction du collège de Tulle (Voyez G. CLÉMENT-SIMON. Histoire du Collège de Tulle. Pièces justificatives, p. 265).
— 10 —
surnommé le Chanteur, à cause de son talent pour la poésie, de son goût pour les chansons et de la protection qu'il accordait aux troubadours.
La Cour de Marie de Yentadour, seconde femme d'Ebles V, fut encore un des rendez-vous des troubadours les plus illustres de son temps.
Maumont n'a-t-il pas fourni à l'Église deux papes, (1) des cardinaux, (2) des archevêques,, des évêques, (3) et des abbés sans nombre? (4) N'est-ce pas encore de ce lieu qu'est sorti un des plus grands érudits du xvi° siècle : Jean de Maumont? (5).
(1) Pierre-Roger de Beaufort, pape sous le nom de Clément VI, élevé au trône pontifical le 7 mai 1342, décédé le 5 décembre 1352, et son neveu autre Pierre-Roger de Beaufort, élu pape le 30 décembre" 1370 sous le nom de Grégoire XI, décédé en 1378.
(2) Hugues-Roger, frère de Clément VI, qui faillit devenir pape, fut ëvêque de Tulle et cardinal en 1342.
(3) Nicolas Roger, oncle de Clément VI, archevêque de Rouen de 1342 à 1347. — Jean Faure ou Fabri, né à Egletons, cousin-germain de Grégoire XI, cardinal et évoque de Tulle, décédé à Avignon le 6 mars 1372. — Jean-Roger de Beaufort, frère de Grégoire XI. — Guillaume de Maumont, évêque d'Angouléme au xn" siècle. — Bertrand de Maumont, évêque de Poitiers, où il mourut en 1385. — Autre Bertrand, évêque de Mirepoix, de Lavaur, de Béziers et enfin de Tulle, etc., etc.
(4) Entre autres Charles de Maumont, qui fut prieur de Vedrenne et abbé d'Uzerche le 10 août 1469, décédé le 18 septembre 1498.
(5) Jean de Maumont. érudit français, né au château de Maumont, paroisse de Rosiers-d'Égletons. 11 fut principal du collège de SaintMichel, autrement appelé de Chanac, et qui avait été doté en 1530 par la maison dePompadour pour les étudiants limousins. Selon La Croix du Maine, « c'était un homme très docte ès-langues et principalement dans celle de la Grèce, grand théologien et orateur fécond ». Il était grand ami de Jules Scaliger. Plusieurs de ses contemporains ont prétendu qu'il était le véritable auteur de la traduction de Plutarque qui porte le nom d'Amyot; cette assertion a été réfutée par La Monnoye dans une note sur YAnli-Baillel de ménage. On.a de Maumont :
— 11 —
Égletons vit naître aussi un troubadour du nom de Gui de Glotos, connu seulement par un tenson avec Diode de Carlus. (1)
Cette phalange glorieuse de poètes et d'hommes illustres nous montre qu'aux xne et xine siècles l'insLes
l'insLes de Saint-Justin, philosophe et martyr, Paris, 1538, in-folio. — Les Histoires et Chroniques du Monde, tirées tant du gros volume de Jean Zouare, auteur byzantin, que de plusieurs autres scripleurs, hébreux et grecs, avec annotations ; Paris, 1563, in-folio. — Remontrances chrétiennes en forme d'épître à la Reine d'Angleterre, traduit du latin de Hierasme Oserias, évêque porlugalais ; Paris, 1563, in-8°. — Le même auteur avait écrit en italien un ample discours de la vie de René de Birague, chancelier de France, mort en 1583, et la Gallia Christiana le cite comme un ouvrage exact et utile.
? (Voy. Nouvelle Biographie générale, publiée par MM. Fifmin Didot frères, t. XXXIV, p. 363. 1865).
(i) Diode de Carlus ou de Charlus-le-Pailloux, près Ussel, luidisait : « Glotos [l'avide), vous me paraissez plutôt un marchand qu'un jongleur. Ne me trompez pas, dites moi franchement votre nom et votre profession. »
Glotos répondit : « Oui, Diode, je sais acheter et vendre, mais je suis plus empressé de vendre et je suis venu' ici à vous pour vous vendre du mérite, si vous en voulez.acheter. »
Voici, en langue de l'époque, le tenson ou dialogue entre Diode de Carlus et Guy de Glotos :
DIODE DE CARLUS
En re no me semblaz joglar Vos que us faiz, en Gi de Glotos, E nos sia ja schirnilz per vos, Mas digaz mi lot vostr' afar, O'I vostr' autre nom verladier, C'almalme semblaz merchadier E si vos es, no'l me celaz per re, Que us assegur et asseguraz me.
GUI DE GLOTOS
Diode, ben sai mercandeiar, Mas del vendre sui plus coitos, ,Per qu'eu soi sa vengutz a vos Vendrepretz si'n volelz comprar Pero, si vos faillon dinier, Penrai ronzin o blanc o nier, El s'el mercat nous agrada be, Tal com aura de vos,aurez de me.
(Voir Histoire littéraire de la France, t. XIX, p. 604, et Raynouard, Choix des Troubadours, t. V, pp. 174 et 175).
— 12 —
traction dut être dans la région distribuée assez largement aux nobles et aux vilains. « Tous ces troubadourSj a dit le savant M. G. Clément-Simon, avec leur langue épurée, leurs rythmes ingénieux, toutes les grâces et même toutes les afféteries d'une poésie raffinée, ne s'étaient pas créés sans enseignement; c'est la meilleure preuve de la diffusion de l'instruction dans cette contrée. »
Le plus ancien document que nous possédions et où il soit fait mention de « régents (1) ou maistres d'escholles » à Égletons, remonte au milieu du xvne siècle (2). C'est un contrat en date du 26 octobre 1650 concernant l'achat d'une maison pour y installer un petit séminaire.
(1) Le nom de régent était donné avant la Révolution aux maîtres qui enseignaient dans les collèges. On le trouve aussi quelquefois, mais rarement, employé pour désigner les maîtres des petites écoles. (Buisson, Dictionnaire de pédagogie, p. 2556).
(2) Pourtant si au xivc siècle la qualité de clerc avait le même sens et la-même définition qu'au temps de l'avènement du christianisme dans les Gaules, on pourrait affirmer l'existence d'une école ou tout au moins d'un maître d'école à Égletons dès 1347. Un acte passé en cette ville le mercredi après l'octave de la Saint-Michel de l'année précitée, mentionne en effet parmi les témoins, un Gérald Rigaud, clerc d'Egletons (Clericus de Glolonis).
Sommes-nous ici en présence d'un clerc maître d'école? C'est d'autant plus probable que les registres de notaires de la ville de Tulle au xv* siècle font mention de sommes payées à des professeurs par des pères de famille, lesquels professeurs avaient tous la qualité de clercs.
Quant à la fondation de l'école, nous en trouverions l'origine dans le droit qu'avait le seigneur, haut justicier, de pourvoir à l'instruction primaire de ses vassaux, droit qui était en même temps qu'un devoir, une obligation.
(Voy. G. Clément-Simon, La vicomte de Limoges, géographie et statistiques féodales, p. 63. Périgueux 1877, et son Histoire du Collège de Tulîe, pp. 25 et 27 de l'Introduction).
— 13 — -
Cet acte, dont le lecteur trouvera le texte à la suite de la précédente notice, est intéressant à plus d'un titre, d'abord parce qu'il nous révèle l'existence d'un maitre d'école qui exerçait là depuis 1639 (1) et ensuite parce qu'il nous apprend la création d'un séminaire à Égletons. . ?
Ce séminaire existait depuis 1617 au MoustierVentadour. (2)
Anne de Lévy, duc de Ventadour, pair de France, chevalier des ordres du roi, conseiller en ses conseils d'Etat et privé, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances et lieutenant-général en la province du Languedoc, l'avait fondé le 29 janvier 1617. Sa volonté avait été d'établir des places pour vingt
(1) L'Instruction primaire en Limousin sous l'ancien régime, par Louis Guibert. (Limoges, imp. V° H. Ducourtieux, 1888).
(2) On n'est point d'accord sur la date de fondation de ce séminaire. Plusieurs auteurs, entr'autres le distingué historiographe diocésain M. Poulbrière, le disent fondé en 1585. Un titre de 1644 émanant desbourgeois et prud'hommes de la ville d'Ossel, rappelle qu'il fut fondé en 15S5. L'Annuaire de la Corrèze pour 1815 dit qu'il fut établi en 1585 par Gilbert III de Lévy, duc de Ventadour, qui, le 8 août de la même année, le dota d'une rente de 1200 livres. D'autre part, les Calendriers ecclésiastiques et civils du Limousin, antérieurs à-la Révolution, le Pouillé de Nadaud, annoté par l'abbé Legros et publié par M. Clément-Simon (Bulletin de Brive, janvier-mars 1893, p. 60) le disent fondé en 1617 par le fils de Gilbert : Anne de Lévy. De tout cet ensemble, on peut en conclure que Gilbert III, duc de Ventadour, projeta, à la suite de la mission qui fut prêchée au xvie siècle, au Moustier, par le vénérable César de Bus, fondateur des Doctrinaires, la création d'un séminaire, qu'il en avait même jeté les bases, mais que n'ayant pu effectuer cette fondation pour des.causes que nous ignorons, son fils Anne de Lévy réalisa définitivement ce projet. C'est à cette dernière hypothèse que nous nous arrêtons. (Voy. à ce sujet : L'Archiprétré de Saint-Exupéry, par M. l'abbé Leclerc. Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 3™é livraison, pp. 294 et 295. Tulle, 1892.)
— 14 —
pauvres prêtres ignorant les lettres, qui seraient près du lieu de Ventadour ou de la châtellenie d'Ussel, Meymac, Neuvic, Pérols et Corrèze, ou du Haut et Bas-Limousin ; qu'ils apprendraient la langue latine, les cas de conscience, l'administration des sacrements, la manière de faire le catéchisme et de prêcher Fexposition des évangiles ; un docteur en théologie, séculier ou régulier, les instruirait et les ferait vivre religieusement, et dès qu'ils seraient capables, ils feraient place à d'autres. S'il ne se trouvait pas de prêtres pauvres et ignorants, on prendrait de pauvres garçons. Le docteur pouvait être changé par les ducs de Ventadour, officiers et consuls de la ville d'Egletons.
Anne de Lévy donna mille livres de rente perpétuelle et annuelle et les revenus du prieuré de Ventadour, que le cardinal de Guise, abbé de Cluny, avait consenti d'être unis à ce séminaire.
On l'installa dans le prieuré même du MoustierVentadour, mais soit à cause de la position défectueuse du lieu, soit à cause aussi du voisinage du collège de Tulle., le séminaire n'y eut guère de pros-, périté. Ce fut alors que l'évêque de Limoges tenta de le transférer à Égletons et qu'à cet effet, Martial Desplas, « régent de la présente ville, directeur et maître du séminaire, fait l'acquisition, le 26 octobre 1650, pour la somme de sept cents livres, d'une maison appelée « de la Bonne », située dans la dicte ville et dans laquelle maison le dict séminaire est logé de présent ». Cette maison se composait : « d'une cuisine en'bas, d'une boutique y joignant, d'une cave en dessoubs, chambre et grenier au-dessus des dictes
— 15 -
cuisine et boutique avec un degré en dehors de pierre pour monter à la dicte chambre » (1)
Le séminaire resta-t-il longtemps à Égletons?
La perte des archives ecclésiastiques et communales ne permet pas de nous prononcer, mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que le séminaire ne réussit pas mieux à Égletons qu'au Moustier. (2)
Laissons là pour l'instant l'histoire de cet établissement plus tard converti en collège à Ussel, elle nous occupera ailleurs plus longuement. (3)
Pour en revenir à celle de l'instruction primaire au Moyen-Age et sous l'ancien régime, disons que de cet enseignement à Egletons il subsiste peu de traces positives, ni plans d'études, ni programmes spéciaux qui nous permettent de caractériser à bon escient les principes et les méthodes des régents en cette matière. Le nombre des élèves qui fréquentaient l'école nous est également inconnu; il nous faut aller jusqu'à 1686, époque à laquelle Mgr Lascaris d'Urfé., évêque de Limoges, donna à son diocèse un règlement pour les petites écoles. (4)
(1) Voir aux pièces justificatives pour ce document qui fut publié pour la première fois dans la Semaine Religieuse de Tulle, n° du samedi 18 juin 1882.
(2) La mention suivante relevée aux actes d'état-civil d'Egletons indique que le séminaire y était encore existant en 1652 : « Le 1er juillet 1652" décéda Gaspard Espaignol, estant au séminaire de Monseigneur le Duc en cette ville, estait natif de la ville d'Ussel ». Quoi qu'il en soit, dès 1662, le séminaire avait fait retour au Moustier, où nous trouvons le 3 avril même année : Estienne Andrieu, docteur en théologie, directeur du séminaire à Ventadour et curé du Moustier.
(3) Dans l'histoire du collège d'LTssel-Ventadour que nous avons sur le métier.
(4) Au Moyen-Age, les petites écoles dépendaient des évêques pour la doctrine., des curés pour la surveillance et des communes pour la subsistance. (Voir, pour ce règlement, aux pièces justificatives).
— 16 —
Nous pouvons donc, d'après ce règlement, nous imaginer comment l'enseignement, surtout en matière religieuse, était organisé dans notre petite ville.
Tout d'abord, il était interdit aux maîtres et maîtresses de recevoir dans leurs écoles des enfants de sexe différent ; chaque matin les élèves étaient conduits à la messe dans les lieux où ils pouvaient avoir cette commodité ; les exercices de la classe commençaient toujours par la prière, et parmi les instructions que le personnel enseignant devait donner aux enfants, il était recommandé de leur apprendre, outre les règles de la civilité et de l'honnêteté, les principes de la foi et du christianisme et de prendre au moins une heure de temps chaque semaine pour les leur expliquer. A cet effet, les élèves devaient être pourvus non-seulement du catéchisme, mais aussi de VIntroduction à la vie dévote ou de quelques autres livres spirituels.
Sous l'ancien régime jusqu'à la Révolution, il est à présumer que l'école d'Egletons n'eut pas d'autre programme.
Comme les autres villes, Egletons votait chaque année des subsides pour son maitre d'école.
A quel chiffre s'élevaient-ils?
Un document qui remonte aux premières années du xvme siècle nous apprend que la communauté accordait en 1730 à Jacques Borie, et en 1738 à Jacques Bargy, régents, vingt livres de traitement annuel pour l'instruction de la jeunesse.
Il Bst infiniment probable que ce dernier chiffre était le chiffre normal du traitement de l'instituteur, même dans le siècle précédent.
- 17 —
Les comptes consulaires de ces années ont complètement disparu, se métamorphosant sans doute en cornets à poivre ou à tabac au fond de la boutique de quelque barbare et inconscient épicier ou devenant à l'occasion matières inflammables pour réchauffer les membres engourdis de nos édiles modernes. (1)
Vingt livres affectées aux gages du. régent, c'est certes un chiffre excessivement modeste; mais ce chiffre doit être augmenté des cotisations qu'apportaient les enfants dont les pères étaient à la tête d'une certaine aisance.
Malgré tout, la situation, matérielle du personnel enseignant de cette époque était plus que précaire et cette situation misérable, jointe à son état de dépendance, le déconsidérait malheureusement trop souvent aux yeux des habitants, aussi l'instruction la plus élémentaire était-elle irrégulièrement et parcimonieusement départie. (2)
(1) Malgré les circulaires ministérielles et préfectorales du 16 juin 1842, du 20 novembre 1879 et du 27 décembre 1885, les archives communales d'Egletons sont dans un état lamentable, les titres antérieurs à 1790 ont été disséminés un peu partout et beaucoup ont été détruits. Quant aux documents concernant la Révolution, ils sont intéressants et à peu près complets, mais entassés sans précaution, exposés à toutes les causes de destruction et dans un état qui en rend le classement sinon impossible, au moins très difficile. Pour ce qui regarde les registres paroissiaux, que la loi du 20 septembre 1792 ordonne de déposer « dans la maison commune », ils remontent à 1637 ; ils sont dans un état parfait et ne présentent pas de lacune. Quelques papiers sans grand intérêt, quelques registres paroissiaux provenant de l'ancienne paroisse de Vedrenne, aujourd'hui annexée à Égletons, complètent le fonds des archives communales de cette ville, qui dans son intérêt ferait bien de veiller à leur conservation. Serons-nous celui dont la voix prêche dans le désert, vox clamanlis in deserto ? Hélas !
(2) Les petites écoles étaient pourtant nombreuses, dit M. Taine. On
— 18 -
Il était donné à un homme que ses réformes et son amour pour le bien public ont rendu populaire dans notre province, de remédier à cet état de choses.
Turgot devait en effet, comme intendant de la généralité de Limoges, dissiper par des moyens salutaires un peu de cette ignorance générale qui l'émut si profondément dès son arrivée dans la capitale du Limousin.
« J'ai vu avec douleur, écrivait-il aux curés de la généralité dans sa lettre-circulaire du 25 juin 1762, que dans quelques paroisses le curé a signé seul parce que personne ne savait signer, cet excès d'ignorance dans le peuple me paraît un grand mal et j'exhorte MM. les Curés à s'occuper des moyens de répandre un peu plus d'instruction dans les campagnes et à me proposer ceux qu'ils jugeront les plus efficaces. »
Devant de telles exhortations, non-seulement l'instruction acquit un plus grand développement, mais le sort de ceux qui enseignaient fut sensiblement amélioré et c'est certainement sur les ordres de Turgot que nous voyons, dès 1765, le traitement du
en comptait autant que de paroisses et fréquentées et efficaces. (Taine, La Reconstruction de la France en 1800). Pourtant, et pour ne pas sortir de la région qui nous occupe, nous trouvons la preuve du contraire dans diverses assemblées d'habitants. Ainsi, en 1787, à une assemblée des habitants dé la paroisse du Jardin, sur 14 membres présents un seul savait signer. La même année, à Ohampagnac-laNoaille, à l'assemblée des habitants pour la nomination des collecteurs, sur 23 membres présents, 5 ont pu signer. Nous pourrions ainsi multiplier les exemples. (Voir A?'c/nues département, de la Corrèze, E supplément, 1898.)
— 19 —
maître d'école de la ville d'Egletons s'élever' d'un seul coup au chiffre de cinquante livres. (1)
Sans doute c'était encore un chiffre relativement modeste, mais le régent pouvait, comme on le dit vulgairement, joindre les deux bouts, et puis on vivait en un temps où la pensée de Dieu et des récompenses éternelles dominait tous les intérêts matériels et où la. satisfaction du devoir accompli était la fortune la plus enviée.
Durant cette longue période qui s'étend de 1650, époque à laquelle nous trouvons trace d'un maître d'école à Égletons, jusqu'à la Révolution, il n'est pas douteux que plus d'un incident sur les règlements intérieurs de l'école ainsi que sur le régime des études, dut s'élever entre les régents et le corps consulaire.
Assurément, il serait curieux et intéressant de les connaître, mais, hélas ! les documents font absolument défaut et c'est tout ce que nous avons pu recueillir sur l'instruction primaire sous l'ancien régime à Egletons, ainsi que sur l'existence publique et privée des membres de cette branche de l'enseignement. (2)
ÇA suivre). JEAN SEURRE-BOUSQUET.
(1) Extrait du rapport annuel des Arc'i. dép. de la Corrèze, années 1887-88. Bulletin de Tulle, 1888, p. 662.
(2) Voir la liste des maîtres d'école aux pièces justificatives.
LES BÉNÉDICTINES
DE
BONNESAIGNE
THOMAS BOURNEIX, prêtre. Nonars, samedi, 1900. Nativité de la B. H. V. Marie.
INTRODUCTION
Un fort intéressant ouvrage à faire et bien de nature à tenter la plume mélancolique de l'éminent supérieur de Servières, — après qu'il nous aura donné son IIP volume du Dictionnaire des Paroisses depuis si longtemps désiré, — serait, à notre humble avis, de grouper, dans un travail d'ensemble, toules les maisons religieuses, abbayes, prieurés, celles, qui se sont épanouis sur la partie du Limousin formant actuellement le diocèse de Tulle, comme on l'a déjà fait pour les sanctuaires de la T. S. V. Marie, en Auvergne.
Quelle belle cueillette fournirait, au cher historiographe diocésain, la zone montagneuse comprise jadis dans le grand duché de. A7entadour, lui-même englobé aujourd'hui, en majeure partie, dans l'arrondissement d'Ussel !
J'y vois quatre abbayes : Bonnaigue, Meymac, Bonnesaigne et Valette ;
Et puis, une infinité de prieurés dont quelques-uns en renom : Saint-Angel, Bonneval, le Bousquet, Port-Dieu, Saint-Projet, Saint-Vie tour, Bort, la Celette, MoustierVentadour, Vedrenne, etc., sans parler de plusieurs celles ou cellules qui ne vécurent qu'un temps, comme la communauté de Tarnac établie sur le tènement des Franches, entre les villages de Chabane et de Parneix, de l'ordre de Citeaux, T. xxiv 2 — 5
— 206 —
pour les dîmes de laquelle il y eut Mémoire dressé contre Joseph Green de Saint-Marsault, abbé d'Obazine, le 14 septembre 1771, par le curé du lieu réclamant.
Ce serait, non la Gallia Christiana, mais son diminutif, le Lemovicinum Christianum.
Pour nous, pauvre chroniqueur des paroisses que nous avons eu la charge de desservir, nous chantons moins haut. Nos ailes n'ont pas assez d'envergure pour planer ainsi d'un horizon à l'autre du cher diocèse. Nous nous contenions de voltiger de saule en saule le long du ruisseau limpide qui arrose la verdoyante vallée de Soudeilles. ou de sauter de branche en branche dans la forêt de Ventadour. Tout au plus si, dans un élan téméraire, nous nous permettons une envolée timide sur deux autres rivages : la Soudaine et la Menoire, dont les fraîches ondes nous ont désaltéré bien souvent ;
« Racan chanta Phylis, les bergers et les bois ».
Tel est notre modeste rôle.
Hier, nous chantions les pâtres de la Basse-Luzège et les filles de nos grands seigneurs montagnards qui s'enfuirent de Soudeilles et de Ventadour pour être changées, dans le monastère de Moulins, non en amandiers sauvages chargés de fruits amers, mais bien en fleurs mystiques de sainteté, parfumées des plus odorantes vertus.
Aujourd'hui, nous voudrions chanter les bois touffus de la forêt ducale et les dames bénédictines de Bonnesaigne qui se cachèrent, à l'ombre de son épais feuillage, durant plus de mille ans.
La tâche est engageante, mais délicate au possible ! Les dames de l'ancien duché montagnard, en effet, rendent leurs historiens méchants... Chaque fois qu'un cantador a essayé de les chanter, il n'a pu s'empêcher de distiller sur elles le venin de la confusion ou du ridicule.
Le troubadour vagabond d'Uzerche, Gaucelm Faydit, les chanta en fort beaux vers ; mais finalement prit congé d'elles Irademen et leur lança ensuite un sirvente sanglant.
— 207 —
L'auteur du passage du Prince grec, à Ussel, les a célébrées en fort belle et bonne prose. A la fin de la plaisante comédie si bien jouée par le marquis de Gorse, le comte de Bournazel, les sieurs de Soudeilles, de la Salle, de Bansson, de Chabannes, consul dans la ville et bailli de la Ribéiï, et quantité d'autres gentilshommes des environs, il ne put s'empêcher de leur servir un grain de mystification dans les salons de Mme de Charlus... Finalement, le prince grec, dont elles se disputaient les faveurs, se trouva n'être que le vulgaire plaisant Boyer de Solignac
Plus près de nous, un autre écrivain a chanté les Dames de Meymac et les Fines de Saint-Angel. Dans l'ouvrage qu'il leur consacre, l'auteur : « Mêle le grave au doux, le plaisant au sévère v. On peut appliquer à son oeuvre l'épigramme qu'Arouet lançait je ne sais plus à quel auteur : « Les uers se sont mis dans sa prose ! »
L'essentiel pour.lui est de poursuivre de toute manière, en vers, en prose, suivant l'inspiration du moment, les personnages qu'il a en vue.
. En sera-t-il ainsi de nous pour les Dames de Bonnesaigne ?
Telle n'est pas notre intention. Ce n'est pas une satire que nous voulons tirer de notre plume contre les abbesses de Bonnesaigne, mais bien une élégie en leur faveur.
L'abbaye de Bonnesaigne, en effet, a toujours été la plus dolente de nos communautés montagnardes. Commencée dans le trouble et la confusion du vme siècle, elle a vécu dans les malheurs que nous attirèrent nos interminables guerres, tantôt avec les Normands, tantôt avec les Anglais ou les protestants, et finalement elle est allée sombrer dans les horreurs de notre grande révolution.
C'est cette malheureuse abbaye que, dans quelques pages émues, M. l'abbé Laubie nous a dépeinte avec la pâleur effrayante d'une morte couchée dans un tombeau, au milieu de débris informes qui n'ont aucun nom dans aucune langue. • Nous, voudrions, pour un instant, réveiller cette grande endormie de son sommeil séculaire ; souffler sur elle pour la
— 208 —
ramener à la vie ; l'étaler en pleine lumière avec les couleurs riantes de la jeunesse sur le visage, les accents de la prière sur les lèvres et le front ceint d'un diadème « d'or à trois chevrons de sable ».
L'abbaye de Bonnesaigne, la plus dolente assurément mais la plus aristocratique de toutes nos maisons religieuses, est connue de notoriété publique dans les annales de la province ; mais, à notre avis, sous un faux jour, jeté sur elle par la haine de la noblesse que souffla Luther, qu'entretinrent si bien les encyclopédistes du xvme siècle dans les bas-fonds de la société et qu'exploitent encore à. merveille nos révolutionnaires modernes.
Pour juger l'abbaye de Bonnesaigne, les anciens historiens de la province, plus ou moins imbus de l'esprit sarcastique de Voltaire, n'ont pas assez tenu compte du sage conseil du païen Horace, dont nous avons cité en première feuille les mémorables paroles qui seront toujours celles d'un homme réfléchi et plein de sens.
« Quand, dit-il, nous trouvons dans un ouvrage de nombreuses pages brillantes, pourquoi nous offusquer de celles, plus rares, qui ont quelques taches échappées ou à l'incurie de l'auteur, ou à l'imprévoyance de la pauvre nature humaine ? »
Ce qu'Horace dit en faveur de tous les Rapins, sur toile ou sur papier, de tous les siècles, est vrai pour les communautés,- les paroisses et les diverses associations d'hommes ou de femmes.
Quand, dans une communauté, nous trouvons des abbesses, des religieuses admirables de vertus, durant des siècles et des siècles, qu'importe que quelques-unes d'entre elles se soient ressenties, pour un temps, des misères de leur époque, de la faiblesse inhérente à la nature humaine, ou d'une certaine incurie difficile à éviter dans l'art délicat de gouverner les âmes : ars artium regimen animarum 1
A des époques néfastes de son histoire, Bonnesaigne a eu quelques abbesses dont certains actes ne peuvent être innocentés, d'une manière absolue, aux yeux de la postérité,
— 209 —
quoique chacun de nous s'en fût peut-être rendu coupable, en pareilles occurrences, en vertu du microbe morbide que tout homme garde toujours en son corps de boue, depuis la chute originelle. Malgré la profession que l'on exerce, le costume que l'on porte et la grâce des sacrements que l'on reçoit : « Nous restons toujours inclinés vers le mal ! »
Mais que sont quelques taches dans une communauté qui compte près de onze siècles d'existence ?
Lorsque, sur trente-neuf abbesses connues, on en trouve à peine deux ou trois de réprôhensibles, est-il raisonnable, est-il juste de jeter la pierre aux autres ?
Les autres ont été admirables de charité, de dévouement et d'intrépidité pour corriger les abus et ramener l'esprit de la règle dans leur malheureuse abbaye éprouvée, de tant de manières, par les sinistres événements qui se déroulèrent autour d'elle, pendant plusieurs siècles consécutifs de notre histoire nationale.
C'est pourquoi Bonnesaigne nous a toujours paru plutôt digne d'intérêt que de blâme. La vue de ses ruines et lé récit de ses malheurs nous ont toujours vivement impressionné et nous voudrions que les historiens, pris de la même commisération que nous, ne laissassent jamais glisser de leur plume l'épigramme, lorsqu'ils ont à parler de cette fleur des marais. Elle mérite qu'on s'apitoie sur le malheur de son sort, et, qu'au lieu d'exagérer ses fautes, on proclame hautement ses vertus.
Pourrons-nous réaliser un tel rêve, remplir un programme si beau !
Malheureusement l'ouvrage que nous livrons aujourd'hui, aux amateurs des choses antiques, sera encore plein de lacunes, comme les feuilles de tous ceux qui, avant nous, ont écrit sur Bonnesaigne. Nous en comblons quelques-unes pourtant, grâce aux grimoires découverts d'ici et de là ; grâce surtout aux riches fonds des bibliothèques de l'abbé Poulbrière et de MM. Champeval, de Valon et Rupin. Mais, pas plus que nos devanciers, nous n'avons pu soulever complètement le voile qui nous cache l'existence de Bonnesai-
— 210 —
gne, du vme au xne siècle et durant la période de nos guerres contre les Anglais et avec les religionnaires.
Pour le lever, ce voile mystérieux, il faudrait faire comme le pieux M. de Larouverade, quand il voulut écrire ses Etudes historiques et critiques sur le Bas-Limousin (1860); il faudrait, comme cet historien consciencieux, passer plusieurs fois le Détroit et aller butiner dans la Tour du Temple où se trouvent entassées les riches archives que les fils de la perfide Albion ont volées à nos églises et à nos abbayes,, durant leur longue et néfaste occupation de la terre des Lemovices.
Mais, pour bien des raisons faciles à deviner, nous sommes obligé de nous contenter des feuilles volantes échappées au pillage et à l'incendie, plusieurs fois réitérés, des archives de Bonnesaigne.
C'est à l'aide de ces précieuses mais par trop rares feuilles jetées aux quatre vents, par les ouragans de toute sorte qui s'abattirent terribles sur l'abbaye, que nous pourrons néanmoins servir à nos lecteurs quelques chapitres n'ayant jamais vu le jour, depuis que l'on s'exerce à écrire sur Bonnesaigne : celui, en particulier, des longs démêlés des abbesses avec les curés de Darnets, depuis 1348 jusqu'à notre grande Révolution ; chapitre piquant qui nous révélerait au besoin, si nous ne le savions déjà, que les gens d'église d'alors étaient non moins divisés que ceux d'aujourd'hui. Et pourtant nous n'avons plus, comme eux, dîmes et proférents pour nous fournir matière à nous chicaner. Ce qui prouve que les dissensions, les disputes, aussi bien que les guerres, filles du péché originel, ont toujours été et seront sans cesse de tous les temps et de toutes les générations, malgré les conférences de La Haye ou de COUCOULOGNE que pourront imaginer nos Princes de la Paix, après qu'ils auront réglé les affaires glorieuses du Transvaal et les lugubres événements qui se déroulent actuellement en Chine (1).
(1) Ce double règlement, plus ou moins glorieux pour les nations de l'Europe, vient d'avoir lieu. — T. U.
— 211 —
C'est ce malaise universel, ce sont ces tiraillements incessants de notre pauvre nature déchue, avec les êtres qui l'entourent, que le paysan Limousin exprime si bien, par un adage typique de sa belle langue d'Oc :
« Per tout poys lo dzeno le-i est ! »
ou par cet autre non moins expressif, de l'idiome d'Oïl :
« De quel côté que je me tourne, K Je vois la ville de Libourne ! »
Finalement nous verrons cette antique abbaye, lasse de lutter contre le malheur, plier sous le poids des épreuves et déserter nos bruyères parfumées pour un ciel plus clément.
Sur les bords de la Haute-Luzège, les Filles de saint Benoît ne respirèrent que rarement l'air fortifiant de la paix et du bonheur ; leurs poumons l'auront-ils davantage sur les rives enchanteresses de la Corrèze, au sein non plus d'un village champêtre mais de l'opulente capitale du Limousin inférieur ?
Guère mieux !
Là encore, nos Bénédictines émigrées vivront dans des ruines, au milieu des privations, jusqu'au jour, du reste assez rapproché, où une tempête, autrement effroyable que toutes celles qu'elles avaient entendues gronder dans la forêt de Ventadour, les emportera dans un tourbillon capable de déraciner les montagnes et les jettera aux quatre vents du diocèse.
C'est ce tableau lamentable des épreuves, des souffrances de Bonnesaigne, que nous voudrions pouvoir graver dans ce livre, comme sur une tablette « plus dure que l'airain », pour dire aux hommes de l'avenir :
O ! vous qui passez par les steppes d'Ussel à Combressol, que vous soyez voyageurs, touristes ou disciples de saint Hubert, quand vous touchez au gracieux village de la C/iapelle, de grâce, saluez d'abord la douce Madone de ce lieu ; et puis, prenez le petit sentier ombreux qui glisse entre le puy chauve du Deveix et la vaste prairie, il vous conduira
?j9
au bourg de Bonnesaigne. Là, contemplez à loisir les hautes murailles qui se dressent au levant du modeste village, au pied de la montagne du Fleuret. Pénétrez ensuite dans leur enceinte, et voyez les débris entassés qu'elles entourent de respect, comme un objet de piôlé. C'est tout ce qui nous reste d'une abbaye fameuse qu'elles gardèrent pendant mille ans et plus. Ces ruines pulvérisées, semblables à un monticule de sable, sont l'oeuvre de la main du temps, mais surtout de la main mercenaire de l'homme ; et dites-nous si jamais, dans vos excursions lointaines, vous avez vu désolation semblable à la désolation de l'abbaye villageoise !
Les autres abbayes, en effet, eurent leurs heures de bonheur, participèrent à la gloire du Sauveur et le suivirent au mont Thabor.
Bonnesaigne, au contraire, fut constamment la victime du Calvaire, et semble avoir eu pour mission spéciale d'imiter la vie souffrante de l'Homme-Dieu.
De là, pour cette abbaye, un jeu de physionomie, uniforme et changeant, comme le génie de la souffrance, difficile à décrire :
Il faudrait à l'artiste des doigts de fée et le ciseau d'un Phidias chrétien.
Et puis, Bonnesaigne n'a jamais été appelé à donner une orientation aux grands événements de l'histoire nationale. Jamais cette abbaye n'a été portée sur les ailes du « Génie de la France missionnaire du Christ à travers les Nations », comme Paray, Moulins et tant d'autres. Malgré la noblesse de ses religieuses, sorties toutes de familles au sang généreux, l'abbaye montagnarde resta toujours repliée sur ellemême, par suite de circonstances néfastes qui ne lui permirent jamais de s'épancher au dehors et la retinrent constamment éiendue sur un lit de misères terrestres, au milieu de ses marais. De là, aussi, le terre-à-terre forcé du narrateur de son histoire.
II a beau vouloir s'accrocher à un fait mémorable, faire corps avec un personnage important et partir ensemble pour le pays de l'enthousiasme ; ce personnage et.ee fait, — rares
— 213 —
oiseaux, — s'il a le bonheur de les rencontrer, ne le soutiennent qu'un instant ; et, malgré ses coups d'ailes réitérés pour se maintenir dans ces parages éthérés, il faut retomber lourdement dans une mare où flottent pêle-mêle mille petits bouts de papier portant des rentes, des dîmes, des proférents, des procès, des cabales, des fermes, des incendies, des ruines, quelques noms d'abbesses, des faits isolés ; disons le mot : mille riens et cent tripots ! Et pourtant :
Si vous ne les arrêtez au passage, pour les épingler ensemble, vous n'aurez jamais l'histoire de Bonnesaigne. Ils disparaissent, les uns dans la poussière, les autres sous la dent meurtrière des rongeurs, les autres enfin dans le fleuve de l'oubli d'où ils ne vous reviendront jamais plus sous la main.
Mais dans ce milieu, à ce métier de colleur, trouva-t-on jamais :
« Le lyrisme attablé, o Tout de neuf habillé ! »
Et le poète n'a-l-il pas dit à son tour :
« L'ennui naquit un jour de l'uniformité? »
Et encore :
« Le secret d'ennuyer, c est celui de tout dire ».
Autant de difficultés, presque insurmontables, pour un vulgaire rapsodiste
Sortons-en de notre mieux, c'est-à-dire comme nous pourrons !...
Après tout, ce n'est nullement, et pour cause ! une oeuvre sereine du Parnasse des Lettres que nous avons en vue, mais bien une excursion dans le royaume sombre de Pluton que nous entreprenons, pour la mise au jour de documents inédits que nos neveux et petits-neveux laisseraient encore, quand nous ne serons plus, dans d'éternelles ombres, au détriment de l'histoire de notre cher Limousin Hâtonsnous :
« Car la montagne prend sa coiffure de neige! »
Qui m'aime me suive, ou me suive qui voudra
— 214 —
De nouveau, je trempe ma plume dans les eaux diaphanes de la Luzège, pour moi la Fontaine de Jouvence ; et en route !
Malgré les récifs, aux vents propices ou contraires, j'abandonne ma gondole pour un voyage au long cours — onze siècles ! — dans les marais de Bonnesaigne.
« Ave, Maris Stella ! »
THOMAS BOURNEIX, prêtre. Nonars, samedi, 1900. Nativité de la B. H. V. Marie.
CHAPITRE PREMIER
Topographie. — Cimetière. — Eglise. — Cour d'honneur. — Greniers d'abondance. — Ecuries. — Promenade. — Monastère.
§ 1. — TOPOGRAPHIE
C'est une paroisse hien intéressante que celle de Darnets !
Au centre,, flanquée de deux châteaux historiques, se dresse l'église, toute blasonnée aux armes des Soudeilles, chargées de celles des Lieuteret, des Malengue de Lespinasse., des Saint-Georges 1 des d'Àubusson, des Luzançon et des Sédières (ou des Montaignac).
Dans le fond, ses pieds foulent les ruines du célèbre Ventadour, dont les tours mutilées apparaissent, dans le lointain, comme deux fantômes grisâtres.
Sur ses flancs glissent, semblables aux bras du corps humain, deux rivières également cristallines et poissonneuses : la Basse-Luzège, à l'Ouest; et à l'Est, la Haute-Luzège.
Elles viennent l'une et l'autre d'un même réservoir, du plateau de Mille-Vaches, et courent, sur un lit de galets, de moulettes, de bivalves et de grêlées, former un unique cours d'eau, — la Luzège tout court, — un peu en aval de l'ancien château ducal.
Au Nord, sa tête est couronnée d'un diadème de verdure par la forêt de Ventadour, se déployant en hémicycle de l'une à l'autre Luzège, sous forme d'un immense croissant de 400 hectares de superficie.
— 216 —
Parfois cette forêt, dans son exubérance, saute chez les voisins, par dessus la Haute-Luzège et forme alors, du côté où le soleil se lève, en guise d'aigrettes de couronne ducale : les bois de la Mazière-Basse, de Palisse, de Lerme et de Bonnesaigne.
C'est dans ce dernier massif, de la paroisse de Combressol, que dorment les ruines de l'abbaye bénédictine de filles dont nous entreprenons l'histoire.
Qu'on se figure au sein de ce massif, entre deux collines boisées, ouvertes comme un compas du Nord au Midi, un grand tapis de verdure, plat comme un lac ou un étang qu'il fut jadis, doucement incliné vers le soleil pour recevoir ses rayons réchauffants.
Tels les marais de Bonnesaigne !
Ils naissent au Nord, au bas de deux puys que relie ensemble le plateau de la Chapelle : le puy chauve du Deveix (Teoi, Deoi, Dephoi, les dieux) et le puy chevelu, qui abrite la chapelle et le gracieux village de ce nom contre les ardeurs du Midi. Ils naissent ensemble, ensemble ils meurent au Midi, en se resserrant un peu, dans les eaux claires de la HauteLuzège.
Un ruban d'eau dormante, nuance de saumure, étincelle au bon milieu, de la pointe au fond, des prairies et leur donne les airs aristocratiques d'un énorme écusson « De sinople au pal de gueules ».
De cette vaste pelouse, terminée brusquement en pacages rocailleux de pente rapide, avant d'arriver à la rivière, sortent d'ici de là, à fleur de gazon, des plaques de granit qui pourraient bien être autant de pierres tombales de guerriers fameux dans le temps, aujourd'hui oubliés.
— 217 —
Cette vallée, ainsi ouverte aux feux du Midi, est frangée, disons-nous, de deux collines, mais d'inégales hauteurs.
Celle du Levant, plus haute, surmontée des mamelons du Deveix, de la Côte et du Fleuret, — autant de propriétés, — se termine en arête de bruyère en arrivant à la Luzège. •
Celle du Couchant, surbaissée, est entièrement livrée à la culture. Elle porte sur ses crêtes : le bosquet de sapins derrière lequel se cachent le village, l'école congréganiste de filles et le modeste édifice dédié à Notre-Dame de Deveix, de La Chapelle. Viennent ensuite les fermes de Monlcliauzoux (retenons ce nom), du Naudet, de la Chastres, des Escures, de Germain, le village de Feyt (bas et haut) (retenons aussi celui-là) et le moulin de la Rochette, au bas d'un rocher dominant la Luzège.
Revenons à la colline du Levant.
De la base du mamelon du Fleuret sort, en forme de cor de chasse replié vers le midi, un ressaut granitique, à pente douce, qui s'enfonce comme un harpon dans le flanc oriental de la prairie, jusqu'à deux doigts de la rive gauche du ruissel.
C'est tout le long de cette langue de terre végétale, montant du ruisseau vers la ferme du Fleuret, que s'étage le bourg de Bonnesaigne, à droite et à gauche de l'antique charrière arquée que gravit, durant des siècles,Ta plus brillante aristocratie de plusieurs provinces à la ronde, en accompagnant ses Damoiselles à l'abbaye champêtre.
De l'extrémité orientale du village, à la bordure d'énormes châtaigniers qui font sentinelles tout le
— 218 -
long du pré de la Salle et du jardin de l'abbaye, entre la colline et la vallée, se déploie une surface plane à fleur de rocher. De cet endroit court, vers le Nord, un immense carré de murailles s'élevant, à mesure que le terrain de la prairie décline, afin d'avoir le même niveau tout autour des personnes et des choses qu'elles doivent protéger.
C'est au milieu de ce terrain, clôturé par ces quatre murailles, qu'émergeait l'abbaye, avec son église et ses dépendances accessoires.
« Pendant six mois de l'année, a écrit M. l'abbé Laubie, ce pays granitique est souvent refroidi par le vent Nord-Est, qui a passé sur les neiges du MontDore ou sur celles du Cantal.
« L'abbaye était heureusement abritée, au milieu de ces vastes prairies. Les champs du Fleuret, la Côte et le bois du Deveix, qui n'est aujourd'hui qu'une colline découronnée en face de la Chapelle, forment, sur le Levant, les trois châssis d'un long paravent derrière lequel Bonnesaigne pouvait se chauffer aux feux du Midi et du Couchant ».
Dans ce robuste carré de murailles blanchâtres, s'élevant à certains endroits, vers le Nord, du côté du pré de la Salle, jusqu'à dix mètres de hauteur, se trouvaient, disons-nous, les multiples dépendances de l'abbaye : cimetière, église, monastère, greniers d'abondance et les écuries.
L'église et l'abbaye formaient, elles aussi, un grand carré dans un immense carré.
Le jardin, très vaste enclos aux murailles élevées, était au Midi, dans l'arc du ressaut granitique, en dehors du mur d'enceinte, séparé de la communauté
— 219 —
par la charrière rustique. Les religieuses y pénétraient, sans être vues, par un viaduc jeté sur le chemin rudimentaire, au bas du Fleuret. Ce jardin avait deux pièces d'eau, une pour le poisson, l'autre pour le lavoir ; une grande charmille était au fond. Cette pièce forme à présent une grande prairie triangulaire en face du village vers l'Orient.
La nouvelle voie publique de Meymac à Neuvic, arrivée dans les marais, passe le ruisseau sur un rustique ponceau, gravit ensuite l'ancienne charrière améliorée du ressaut jusqu'au milieu du bourg ; et là, tournant brusquement à droite, elle longe la muraille méridionale de ce bel enclos, encore tout clôturé des pierres moussues de l'ancien jardin abbatial ; puis, elle s'élève à travers les flancs cultivés de la colline jusqu'au niveau du Fleuret et disparaît enfin, au-dessus du vallon, petite comme un « Pal d'argent sur un champ d'azur et de pourpre » formé par le ciel bleu et les bruyères en fleurs, du côté du Bos des Pères (de Saint-An gel), dans la direction de Palisse et de Neuvic.
Et cet endroit, autrefois si solitaire, est aujourd'hui un peu récréé par les grelots du Rossinante qui tire péniblement la patache lambrissée portant les dépêches de l'un à l'autre immense canton montagnard.
De cette position entourée de marais, qu'améliora le travail, venait à notre abbaye son nom de Bonnesaigne : « Jacet in paludosa planitie à quà et nomen Bonoesanioe accepit » (Gallia ChristianaJ.
L'expression vulgaire Saigne, Sania, a la même signification que fonds gras el humide : « Sanioe
— 220 —
enim vernacula idem sonat ac fondus pinguis et humidus » (Idem.)
Les notaires du Moyen-âge appelèrent aussi Bonnesaigne : Vallis, vallis calida, vaïles etuva, vallée, vallée chaude, vallée étuve ; ou bien, Podium maris, Puy du marais.
Et certaines abbesses, au lieu d'employer dans les actes leur nom patronymique, se servirent de celui du lieu qu'elles habitaient : de Voile, de Valle-Eluvâ, ou simplement de Val-Tuvâ, Val-Tuve, comme Adelaïs de Ventadour. D'autres, comme Blanche II de Ventadour, signaient : Domina Blanchia de Podiomoris, aliàs Bonnesanhioe. Ce qui a désorienté certains écrivains et leur a fait croire à l'existence d'abbesses dont les noms de famille étaient ceux de Vallée, du Val-Tuve et de Puy marais. Nous le constaterons au chapitre sixième de cet ouvrage.
Le portail d'honneur était du côté du bourg, à gauche du visiteur ; et le Fort à droite, vers la montagne du Fleuret, l'un et l'autre dans la partie supérieure, c'est-à-dire dans la muraille méridionale de clôture que longe l'ancienne voie publique grimpant à plein collier vers les champs du Fleuret.
C'était près du Fort qu'était jeté le viaduc conduisant les religieuses au jardin.
Le portail situé dans la muraille de clôture du Nord — partie inférieure de l'enclos — ne conduisait qu'aux écuries, aux greniers d'approvisionnements, sans qu'on pût pénétrer de ce côté dans le cloître; il ne servait qu'à l'exploitation du pré de la Salle et des domaines.
— 221 —
Et maintenant, pénétrons par le portail d'honneur
,dans cet enclos muré, dont une faible partie est
ouverte au public et le reste uniquement réservé aux
religieuses, aux parents des élèves et aux visiteurs
autorisés.
§ 2. — CIMETIÈRE — ÉGLISE
Le Portail d'honneur, surmonté d'un « Damier d'or et de gueules » (des Ventadour primitifs), plus tard remplacé par un « Ecusson d'or à trois chevrons de sable » (des Lévis), s'ouvrait sur une avenue, d'une muraille à l'autre de l'enclos, coupée vers le milieu par une grande grille, et, presque au fond, par un mur percé d'une porte basse.
Cette avenue était gardée, à gauche du visiteur, par la muraille occidentale de clôture, et, à droite, par une série de constructions ajourées.
Ouvrons la première porte.
Nous voilà dans le champ des morts ; au milieu se dresse une haute croix de chêne peinte en rouge, avec Christ passé en blanc, que nous nous rappelons encore comme un rêve d'enfance. C'est là que dorment, sur le flanc méridional de l'église abbatiale, en attendant le signal du grand réveil, les pieux fidèles du village.
La seconde porte nous donne accès dans l'église orientée suivant toutes les règles liturgiques. Jetons, avant d'y entrer, un coup d'oeil sur son haut clocher, grande tour carrée que nous verrons, dans la suite, plusieurs fois visitée par la foudre et la mitraille.
A l'intérieur, l'église abbatiale présente une croix
T. XXIV 2 — 6
— 222 —
latine, à trois nefs, avec dôme sur le transept, déambulatoire et chapelles circulaires.
C'était, rapporte la tradition, la soeur de celle de Saint-Angel, sauf pour le clocher, que cette dernière attend toujours et n'a jamais eu.
Les trois nefs terminées par une grille, en arrivant au transept, étaient réservées aux fidèles de l'annexe paroissiale.
Les bras de la croix, dans lesquels on montait par trois marches, étaient à l'usage de l'aumônier, des soeurs converses, des élèves et des employés de l'abbaye.
La tête de la Croix (ou chevet) était uniquement réservée aux soeurs de choeur, derrière une seconde grille qui les séparait de l'aumônier, des frères oblats, des soeurs converses et des employés de l'abbaye.
Leurs stalles circulaient tout autour, en hémicycle, sur trois rangs surélevés.
Le maître-autel (ou de communauté) était sous le dôme du transept.
Cette église, du patronage de la T. S. V. Marie (Présentation), existait dans toute sa splendeur longtemps avant 1165 et servait de sépulture aux religieuses.
La cure de Gombressol y avait une succursale d'environ 250 habitants, sous le vocable de saint JeanBaptiste (Nativité).
S'il faut juger des autels de cette église, par les vicairies établies dans l'abbatiale, ils étaient nombreux.
Sans parler du maître-autel et de celui de la succursale, on en trouve jusqu'à huit.
Ce sont :
— 223 —
1° La vicairie de saint Eustache, avec prébende, fondée en 1200 par le pieux vicomte Ebles V de Ventadour, un an avant d'entrer en religion à l'abbaye de Grandmonl, et par sa vertueuse épouse, Marie de Turenne, soeur de Boson III et de Raymond seigneur de Servières. L'abbesse y nomma en 1473, 1487, 1492, 1580, 1587, 1602.
Le duc de Ventadour y nomma aussi.
2° La vicairie de sainte Anastasie, fondée par dame Burgondie de Ventadour, épouse de Pierre de Gbâteauneuf, seigneur dudit lieu et de Saint-Germainles-Belles (Haute-Vienne), père de Mathe, abbesse de Bonnesaigne de 1275 à 1285. L'abbesse y nomma en 1437, 1527, 1531, 1573, 1585, 1627.
3° La vicairie de sainte Catherine, qui payait dix livres. L'abbesse y nomma en 1447, 1492, 1569, 1575, 1593, 1660, 1696, 1721, 1729, 1762.
4° La vicairie de saint Loup, évêque de Limoges, avec prébende. L'abbesse y nomma en 1483, 1585, 1603.
5° La vicairie de Chalus (plus probablement Charlus, ce qui dénoterait encore une fondation des Ventadour).
6° La vicairie de saint Antoine, dite de Bargaudie. 0
7° La vicairie de saint Nicolas, évêque de Myre (en Lycie), avec prébende, en 1592 ; l'abbesse y nomma en 1416 et 1465.
8° Enfin la vicairie dite du Deveix, sous le vocable de N.-D. de Pitié, en la chapelle que l'abbesse Gabrielle de Beaufort de Canillac bâtit dans l'église abbatiale, sous la date de 1629, en souvenir de Tanti-
— 224 —
que chapelle rurale que l'on voit en amont des prairies, sur le bord de la route nationale de Tulle à Clermont.
L'abbesse nommait à tous ces bénéfices.
Un quart de siècle environ après la mort du roi saint Louis, l'abbesse de Val-Tuve institua, dans son église, la confrérie de la Sainte Croix (1282-1292).
J'ai dit que les religieuses avaient leurs tombeaux dans l'église. A^oici un fait à l'appui de cette assertion qui n'a du reste pas besoin d'être prouvée, étant donné que, durant ces époques glorieuses de la foi, nos églises étaient autant de Nécropoles, dans lesquelles on ne pouvait faire un pas sans marcher sur l'Histoire, comme eût dit l'orateur romain : « Quàcumque enim ingredimur in aliquam historiam vesligium pominus » (Cic. Defnibus, liv. V, 2).
Voici donc le fait :
Le 4 mai 1875, mardi des Rogations, tandis que l'Eglise célébrait la fête de sainte Monique et qu'Ussel tenait sa grande foire, un paysan de Palisse fit, dans les décombres de l'abbatiale, une trouvaille sensationnelle.
En déchaussant un tronçon de colonne, il ouvrit un tombeau bâti à chaux et à sable. Dans ce tombeau se trouvaient deux statues de saints, un groupe de N.-D. de Pitié, et enfin un crâne humain parfaitement conservé. Le tout fut religieusement déposé dans une humble chaumière du voisinage, qui était celle du propriétaire des ruines.
Dès le lendemain, le village de Bonnesaigne se crut aux plus beaux jours de son abbaye ! De tous les cantons voisins, les curieux accouraient en foule ; et,
— 225 —
durant plus d'un mois, la cahute fut un lieu de pèlerinage et des plus fréquentés.
Vingt jours après — c'était le lundi de la Sainte Trinité — j'y allai moi-même, en la compagnie de l'inoubliable M. Bazetou, revenant avec moi de prêcher la première communion à Palisse, sous le pastorat de M. J.-B. Furnestein.
Voici ce que nous constatâmes, après bien d'autres assurément, car la méprise n'est pas possible :
La première des statues est celle d'un évêque crosse, mitre; de saint Loup ou de saint Nicolas.
La seconde est celle de saint Antoine, avec l'emblème de son fidèle compagnon.
Notre-Dame de Pitié est assise, tenant sur ses genoux le corps inanimé de son divin Fils étendu de gauche à droite. Elle a les mains jointes et les yeux abaissés sur le corps de Notre-Seigneur. La Mère des douleurs est assistée de deux femmes : Marie-Madeleine et l'autre Marie dont parle saint Mathieu : « Erat autem ibi Maria Magdalena et altéra Maria » (XVII, 56-61). Celle de droite serre, avec compatissance, de sa main gauche, les mains jointes de la sainte Vierge, et de la main droite elle soutient la tête du Sauveur.
La femme de gauche passe son bras droit dans le gauche de la Mère de Jésus, et porte de l'autre main un vase de parfums.
Les divers personnages de ce groupe ont beaucoup souffert. Les têtes sont séparées des épaules et les figures grandement endommagées. La sainte Vierge a une partie du front emportée, et la sainte femme de gauche a le visage complètement détérioré. La tête
— 226 —
du Christ a disparu, ainsi que la main de la sainte femme qui la soutenait.
D'après la déchirure qu'elle porte, la statue d'évèque avait le flanc gauche encastré dans les parois de la muraille, ce qui indique le côté de l'Evangile.
La tradition locale rapporte qu'en 1793 les bons habitants de l'endroit avaient caché ces objets de leur piété, depuis tant de siècles, au fond de ce tombeau, pour les soustraire à la profanation des terroristes d'Ussel et de Meymac. Elle ajoute que bien d'autres statues sont de même enfouies sous les dalles de l'abbatiale.
Groupe et statues sont en calcaire de même provenance que la pierre à personnages du tombeau de Soudeilles.
L'église de Saint-Bonnet-la-Rivière possède une Mater ûolorosa, mais de proportions réduites, absolument semblable au groupe de Bonnesaigne.
Enfin, le crâne humain est allongé, avec une épingle en acier enfoncée dans l'occiput. Quel nom fut gravé sur ce front le jour de son baptême ? Quelle âme a habité cette boîte osseuse? Quelle fille de nos grands seigneurs limousins est entrée dans ce tombeau avec cette épingle, pour retenir, jusque dans la mort, le voile qui cacha les charmes de son visage aux visiteurs qui se présentèrent aux grilles du parloir ? Quelle abbesse de Bonnesaigne portera au front, le jour de la résurection, cette cicatrice d'épingle? Mystère du temps, que nous pénétrerons peut-être dans l'éternité !...
Se doutait-il, le brave paysan, que sa trouvaille d'alors servirait aujourd'hui, aux Chroniqueurs, pour
— 227 —
établir que l'église de Bonnesaigne avait les autels de saint Antoine, de saint Nicolas ou de saint Loup, de N.-D. du Deveix, et servait de tombeau aux filles de saint Benoît?
Des fouilles pratiquées avec intelligence sous ces décombres, ne tarderaient pas à nous révéler d'autres surprises.
Une nombreuse noblesse, dont il existe une longue liste dans l'obituaire du couvent, dort aussi dans cette église, à côté des abbesses; y a fondé des obits et fait d'abondantes aumônes. Je trouve dans mes notes :
& Le 1er mai 1665, décéda eh la maison de l'abbaye royale de Bonnesaigne, et fut inhumé dans l'église de ce lieu, Messire Léonard d'Ussel de Châteauvert, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Maissonnisse en Marche, âgé d'environ 76 ans, en présence de Joseph d'Espinet, avocat, et de Marie Ravet, tous habitants du bourg de Bonnesaigne ».
Anne de Montmorin était alors abbesse.
D'autres seigneurs demandaient, comme une faveur, de recevoir la bénédiction nuptiale dans l'église abbatiale. La coutume en était tellement bien établie que, dix ans après le départ de la communauté, les enfants de famille continuaient à aller s'y faire bénir :
ce En 1770, dans l'église abbatiale de Bonnesaigne, fut célébré le mariage de Joseph Mary, avocat au Parlement, du bourg de Saint-Angel, avec Mademoiselle Marie-Madeleine d'Espert, fille de Maître Michel d'Espert, notaire royal, et de demoiselle Marie-Rosa de Mirambel, du bourg de Bonnesaigne, en présence de M. Sourzac, chirurgien, et de M. Pierre Perrier,
— 228 —
avocat au Parlement, juge de l'abbaye de Bonnesaigne et de la châtellenie de Davignac ».
Une réflexion seulement et notre visite dans l'abbatiale est finie.
Est-ce que, ami lecteur, la chétive bourgade de Bonnesaigne, avec : avocats, huissiers, juges, chirurgiens, apothicaires ou droguistes, et prêtres blancs ou habitués, car il y en avait, ne vous paraît pas aussi vivante, disons le mot, aussi lettrée alors qu'aujourd'hui, malgré l'instruction gratuite, laïque et obligatoire? QSQSÏ ce que nous nous sommes demandé bien souvent, chaque fois que nous avons eu le plaisir de dépouiller les archives d'une église de campagne. Partout, non seulement dans les bourgs, mais encore dans les villages, nous avons constaté la présence de mêmes hommes marquants. Bien plus, à Soudeilles, petite paroisse alors de trois à quatre cents habitants, j'ai trouvé jusqu'à quarante-deux prêtres, vivant en même temps, répandus dans les villages, au sein de leurs familles, instruisant les enfants du peuple et se réunissant le dimanche, aux offices de la paroisse, sous la houlette du pasteur, supérieur de droit de cette phalange de prêtres habitués, formant la communauté des prêtres de Soudeilles.
Oui, l'instruction, l'aisance et l'éducation surtout étaient alors plus répandues dans les familles villageoises qu'elles ne le sont aujourd'hui, malgré notre siècle de Lumière et de Progrès.
Voilà ce que nous ont valu, à nous habitants des champs, cent ans de révolutions, avec émigration vers la capitale et les grandes villes de province :
« La campagne se meurt, la campagne est morte ! »
— 229 —
§ III. — COUR D'HONNEUR— GRENIERS D'ARONDANCE— ECURIES — PROMENADE ?—? MONASTÈRE
Après cette visite, sortons de l'abbatiale, et allons frapper à la porte de la grille qui s'ouvre à l'instant devant nous.
Nous voilà dans la cour d'honneur où parents, élèves, visiteurs et amis se succèdent à tour de rôle. Nous avons, sur notre droite, la façade occidentale du monastère, percée au bon milieu d'une porte d'entrée avec guichet soigneusement fermé.
Passons sans rien dire, même ce sans regarder au castel ».
La porte du fond de la cour d'honneur nous conduit dans la cour des greniers d'abondance et des écuries, vaste parallélogramme de l'une à l'autre extrémité de la muraille de ceinture du Nord. Les greniers sont à droite et les écuries à gauche du portail inférieur.
Admirons, en passant, l'ampleur des deux tours rondes, formant angles de la façade septentrionale du couvent. La porte, soeur de celle par laquelle nous sommes entrés dans la cour des employés subalternes, nous donne accès dans le préau, ou promenade des religieuses.
Nous voilà sur la façade orientale de l'abbaye, au bas du Fleuret, sur la lisière des énormes châtaigniers dont l'ombre bienfaisante saute par dessus la haute muraille de ceinture pour rafraîchir nos bénédictines. Dans le fond, au Midi, apparaissent le chevet de l'église, les murs du cimetière et le Fort avec son viaduc pour conduire les religieuses au jardin que nous connaissons déjà.
— 230 —
Cette fois, prenons notre courage à deux mains et frappons à la porte faisant vis-à-vis au guichet du couchant, devant lequel nous avons passé sans oser déranger la portière.
Nous voilà dans la cour carrée de l'intérieur de l'abbaye. Nous pouvons cette fois contempler à loisir l'aspect grandiose du monument, que la piété de nos pères se plut à élever pour abriter la vertu des filles des seigneurs du Limousin et des provinces environnantes, durant plus de dix siècles.
Au milieu de la cour glouglotte une conche, dont les eaux jaillissantes, descendues du Fleuret, clapotent dans un bac rond creusé dans un énorme bloc de granit.
Les bâtiments forment eux-mêmes un carré autour de la cour : à l'Est, au Nord et à l'Ouest les trois ailes des constructions de l'abbaye, et au Midi, l'église abbatiale.
Les cloîtres, avec voûtes et arcades, régnent tout autour.
Par dessus bâillent les croisées étroites des deux étages de l'abbaye, dont la porte principale est dans une énorme tour ronde faisant saillie sur la façade qui relie les deux ailes du bâtiment, au septentrion.
Telle est la physionomie générale de l'abbaye villageoise de Bonnesaigne ; physionomie que nous avons pu saisir, non sans peine, à l'aide des pages malheureusement trop laconiques que nous a laissées M. l'abbé Laubie; des notes que nous possédons de M. le curé Bazetou, et des visites nombreuses que nous avons nous-même faites — toujours le coeur serré — autour de ces ruines désolées.
— 231 —
Les greniers d'abondance et l'église mettaient l'abbaye à l'abri des vents du Nord et du Midi. Les coteaux boisés du Fleuret la défendaient contre ceux du Levant.
Ainsi gardée, ce l'abbaye se chauffait paisiblement, en hiver, aux feux du Midi et du Couchant ».
Défendue, sur les quatre côtés, par ses hautes murailles de ceinture, par son fort, son clocher et ses trois tours, l'abbaye pouvait aussi espérer que jamais injuste agresseur n'oserait venir troubler son repos, au milieu des marais et des bois, et que ses jours auraient une durée sans fin.
Hélas! ils étaient comptés, comme tous ceux des oeuvres sorties de la main des hommes !
De l'archiprêtré de Gimel, et à deux milles d'Ussel, Bonnesaigne formait un triangle avec T'abbaye et le prieuré bénédictins d'hommes de Meymac et de Saint-Michel-Archange de Saint-Angel.
Le monastère de Bonnesaigne relevait immédiatement du Saint-Siège et l'abbesse, élue à vie, qui le gouvernait, s'adressait directement et sans intermédiaire au Souverain Pontife :
ce Romanoe sedi immédiate subjacet locique Domina audit abbatissa » (Gai. Christ.J.
Cette abbaye valait 4,000 livres et en payait 500 au Saint-Siège à chaque nomination d'abbesse.
Du temps de l'abbesse Catherine de BeauvergerMontgon (1701-1747), on l'estimait valoir 8,000 liv. ; payait de décimes ordinaires 183 liv. 4 s. 6 d. ; de nouvelles, 22 liv. 13 s., et de subventions 440 liv.
Il y avait aussi, de son temps, une vicairie simple, qui valait 60 livres, en blé payé par la dame abbesse
— 232 —
qui y présentait ; le curé de Rosiers-Masléon en était titulaire et en payait : décimes nouvelles 5 sous et subventions 10 livres.
Mais, profanes que nous sommes ! c'est violer trop longtemps la clôture de ces lieux sacrés et nous exposer à encourir interdit ou suspense ; sortons au plus vite!... Et, gravissant mélancoliques et rêveurs la côte du Fleuret, demandons-nous, en jetant un dernier coup d'oeil sur ces murs que nous nous figurons encore debout : qui donc, dans le lointain des âges, a eu l'idée de bâtir une maison religieuse en cet endroit solitaire, humide et chevelu? '
C'est ce que nous allons essayer de dire dans le chapitre second de cet ouvrage.
CHAPITRE II . . -
Origine de Bonnesaigne : 1° Légendaire. — 2° Historique. — 3° Abbatiale. — 730, 1165, 1174.
A quelle époque et par qui ont été élevées ces robustes murailles de Bonnesaigne que nous venons de visiter et qui ont bravé tant d'orages déchaînés contre elles par les hommes et par le temps?
Bonnesaigne a trois périodes bien distinctes dans son existence : la période légendaire ou traditionnelle, la période écrite ou historique et la période abbatiale.
§ 1. —ORIGINE LÉGENDAIRE DE BONNESAIGNE 730, 780, 1095, 1147
Gomme cette communauté n'a fait son entrée dans l'histoire, d'une manière éclatante, qu'en 1165, à la suite du Bref de privilège, daté de Clermont, que le pape Alexandre III adressait à la prieure Jovite, le scepticisme contemporain refuse d'admettre la vérité traditionnelle de l'existence de ce monastère avant le xne siècle.
C'est aussi juste que si l'on faisait ce raisonnement étrange, en parlant d'un académicien :
ce Je ne connais de cet homme que deux ou trois' actes de sa vie, avant le jour de son immortalité; donc il n'existe que depuis son apothéose dans le palais des muses de Richelieu ».
— 234 —
La conséquence ne découle pas précisément de l'antécédent.
De même pour Bonnesaigne.
Son histoire nous est peu connue, durant 435 ans, par suite des événements sinistres de ces temps troublés de notre histoire nationale ; mais ce n'est pas une raison pour refuser de croire à sa préexistence au bref du pape et pour rejeter toute tradition conforme à cette croyance que l'on conservait précieusement dans l'abbaye montagnarde et que nous trouvons soigneusement consignée dans les auteurs anciens que nous nommerons bientôt.
C'est pourtant ce que font nos sceptiques modernes, ennemis jurés des traditions, dans de récentes publications.
L'un d'eux écrit, en effet :
ce L'abbaye (de Bonnesaigne) se prétendait, en son livre de Règles, fondée vers 731, par Eudes duc d'Aquitaine, et réformée en 1645. Soufflant sur cette fausse erreur pire que la nuit, reculons vers 1150 Vorigine de ce prieuré ; déjà en bonne voie en 1165; devenue abbaye VERS 1180 ».
Un autre continue :
ce Ce sont les Comborn, seigneurs de nos montagnes et fondateurs de l'abbaye de Meymac (3 février 1085), qui ont fait germer cette fleur des champs »...
D'autres s'aventurent à dire : ce Ce sont plutôt les Ventadour, rameaux des Comborn poussés dans nos bruyères en 1059, dans la personne d'Ebles Ier, fils d'Archambaud II et de Rotberge, fille d'Aiméric II vicomte de Rochechouard ».
Et ils ajoutent à l'appui de leur assertion, — ce
r-. 235 -^
qui est vrai du reste — : « Longtemps les Ventadour prétendirent à la qualité de fondateurs et se comportèrent comme tels en 1471, lors de la mise en possession de l'abbesse Blanche de Gimel ». Bien plus : ce A un moment donné, l'abbaye portait les armes des Ventadour, et ce fut de ces derniers qu'en 1280, l'abbesse Mathe de Ghâteauneuf fut obligée d'acheter le droit de justice dans l'endroit ».
Si les adversaires des traditions bénédictines sont à bout d'arguments-pour établir leur thèse, nous pouvons leur en fournir quelques autres, bien plus concluants, tirés des archives de M. J. Seurre-Bousquet, d'Egletons, et leur dire :
ec Non seulement Ventadour prétendit, durant des siècles, au titre de fondateur de Bonnesaigne; se comporta comme tel le jour- de l'installation de Blanche de Gimel ; donna ses armes à l'abbaye et vendit le droit de justice à Mathe de Châteauneuf, mais encore il avait des titres reconnus pour cela faire.
L'abbaye relevait, en effet, de Ventadour; et ce droit de ressort et de suzeraineté était établi, non seulement par l'usage plusieurs fois séculaire, mais aussi par des titres de 1280, 1338, 1341, 1444, 1599, 1603 et même de 1635... Retenons cette dernière date.
Hé bien! malgré tous ces actes, malgré tous ces titres — qui s'expliqueront du reste dans le cours de notre récit — tous militant en faveur de nos amis devenus nos contradicteurs dans la circonstance, les prétentions des Ventadour ne se justifient pas devant l'histoire et encore moins devant les tribunaux. Ils ne sont point les fondateurs de Bonnesaigne.
Ils en firent l'expérience en 1627.
— 236 —
Une femme de grand caractère, comme il y en avait tant au siècle de Saint-Vincent de Paul, une abbesse intrépide, Mme Gabrielle de Beaufort de Canillac, lasse sans doute des abus que de semblables prétentions avaient entretenus malheureusement trop longtemps dans son abbaye, résolut de les réduire à néant. Elle dressa un mémoire sur les véritables origines de sa communauté et le soumit au Parlement. Les raisons sur lesquelles reposaient ses dires parurent tellement convaincantes que l'auguste assemblée, après mûr examen du mémoire, rendit un arrêt en 1627 par lequel les Ventadour se trouvaient déboutés de leurs prétentions de fondateurs de l'abbaye de Bonnesaigne.
Le pieux duc Henri, futur chanoine de l'insigne église Notre-Dame de Paris, et sa vertueuse épouse, Marie-Liesse de Luxembourg, future carmélite de Chambéry, étaient battus, malgré les raisons qu'ils durent opposer aux assertions de l'abbesse et les aboutissants qu'ils avaient au Parlement.
Seul le titre de bienfaiteurs de cette abbaye leur resta.
On ne peut donc pas dire que Bonnesaigne vit le jour vers 1150, deux ans avant la mort d'Ebles II, vicomte de Ventadour. Ce vicomte est bien du reste un des seigneurs limousins qui s'occupèrent moins à fonder des cloîtres, qu'à prendre part aux guerres privées de l'époque. Né avec une imagination ardente et vive, enrichie d'une certaine instruction, il précéda, dans la carrière des troubadours, le célèbre Bertrand de Born qui sut, comme lui, manier l'épée aussi bien que la harpe. Il avait pour émule le duc
— 237 —
de Poitiers, Guillaume-le-Jeune, « bon troubadour, bon chevalier d'armes, qui courut longtemps le monde pour tromper les dames », et que la croisade ne corrigea pas de ses débauches. On connaît sa réponse à Gérard, évêque d'Angoulème, qui l'engageait à changer de conduite : ce Vous ramènerez, avec le peigne, vos cheveux sur le front, avant que je quitte la. princesse » (de Châtellerault). L'évêque était entièrement chauve (Guill. Malmesburg, t. V, p. 170 ; Marvaud, t. Ier, p. 241).
D'autres enfin écrivent, au Bulletin de la Société archéologique et historique du (Haut) Limousin :,
ce Cette abbaye n'était de son origine qu'un prieuré fondé, à ce que l'on croit, dès l'an 730 ; on ne le connaît pourtant que depuis un bref du pape Alexandre III, donné à Clermont le 18 juillet 1165, qui en fait mention et en confirme les biens à Jovite, prieure.
ce Si les seigneurs de Pompadour n'en sont pas les fondateurs originaires, au moins en sont-ils les bienfaiteurs insignes et les protecteurs, et ceux de Comborn, de Maumont, d'Anglars, de Chabannes, de Turenne, de Gastelneau, d'Ambrugeac, de Vars, de Chalon, de Penacors et autres seigneurs du BasLimousin y ont contribué » (t. XLVI, p. 350).
C'est-à-dire que Leduc, lui aussi, à l'air de ne pas connaître les traditions de Bonnesaigne ou en fait trop aisément litière (Etat du diocèse de Limoges, 9).
Pas plus que les Ventadour, les Pompadour ne sont les premiers fondateurs de Bonnesaigne.
Qui donc eut l'idée de bâtir ce monastère au fond de cette vallée grasse et humide des bords de la Haute-Luzège?
T. XXIV 2-7
— 238 —
Le mémoire de la triomphante abbesse, dressé contre les prétentions de Ventadour, pourrait seul nous l'apprendre d'une manière précise. Mais où estil? qui nous le dira? Heureux le pionnier de l'histoire qui arrivera un jour à la découverte d'un tel trésor !
Puisque donc, faute de documents précis, nos adversaires eux-mêmes, bon gré mal gré, reviennent toujours sur le terrain des suppositions en disant : ce C'est vers 1150, vers 1165, vers 1180 qu'il faut placer l'origine de ce prieuré d'abord, devenu abbaye ensuite; si les Pompadour, etc., etc. », pourquoi ne pas nous débarrasser de tous ces vers et de tous ces si et maintenir simplement les traditions conservées à Bonnesaigne, sans vouloir toujours innover dans le domaine de l'histoire?
Les voici donc les traditions concernant les origines primitives de cette abbaye, que nous trouvons dans les vieux historiens et que respectent des écrivains que nous sommes heureux de suivre jusqu'à preuve évidente que nous faisons fausse route avec eux.
D'après ces traditions respectables, que les découvertes des fouilleurs de grimoires enfumés viennent confirmer chaque jour, Bonnesaigne, durant cette période ténébreuse de son existence, nous donne quatre fois signe de vie : en 730, en 780, en 1095 et en 1147.
La première fois, notre abbaye sort de terre;
La seconde, elle balance ses tours dans des flots de lumière ;
La troisième, elle est parée des libéralités de nos seigneurs montagnards ;
— 239 — La quatrième, sa mense se complète.
1° Fondation de Bonnesaigne (730J
Ce serait, en effet, le terrible adversaire de CharlesMartel, le duc Eudes, couronné roi d'Aquitaine et comte de Poitiers, à Limoges (681-735), lors de la débâcle de la première race de nos rois, qui aurait jeté, en 730, les premiers fondements de notre abbaye.
C'est ce que nous apprend le R. P. Estiennot, bénédictin fameux qui, de 1673 à 1684, rédigea 45 vol. in-fol. sur les origines des maisons de son ordre en France ; recueil précieux de documents sur lequel ont travaillé Mabillon, Sainte-Marthe et les autres Bénédictins.
Le R. P. Bonaventure de Saint-Amable constate la même.tradition, dans son article sur Bonnesaigne, et nous donne également la date de 730, tout en nous avertissant que, faute de documents, il est obligé de ne commencer l'histoire de notre abbaye qu'à partir du xne siècle, c'est-à-dire du jour où le pape écrivit de Clermont à la prieure Jovite (t. III, p. 460).
Dans la Préface des Constitutions, que la révérende abbesse Gabrielle de Beaufort de Canillac fit donnera sa communauté, en 1645, par des hommes éminents en science et en sainteté que nous aurons occasion de nommer plus tard, nous trouvons ce qu'il y a de fortes conjectures de croire que c'est environ 731 que l'abbaye de Bonnesaigne vit le jour », un an avant la victoire de Poitiers à laquelle le duc Eudes, enfin réconcilié avec la nouvelle dynastie, participa d'une manière si" brillante (732).
Enfin, dans l'acte de résignation de l'abbesse Anne
— 240 —
de Montmorin, sous la date du 30 mai 1682, l'abbaye de Bonnesaigne est dite ce de fondation royalle ».
Les voilà les traditions de Bonnesaigne !
Et les historiens, arrivés après ceux que nous venons de citer, répètent les mêmes traditions et nous donnent la même date (730) :
ce On croit, dit Marvaud, que le fondateur (de Bonnesaigne) fut Eudes, duc d'Aquitaine, au vme siècle. Mais à la suite des guerres étrangères et intestines survenues peu de temps après, ce cloître avait été négligé. Plus tard, il s'enrichit de nombreuses concessions faites par les vicomtes de Comborn, de Ventadour, et par les seigneurs d'Anglars et d'Ambrugeac, qui ensuite s'en disputèrent longtemps la possession, toujours d'après les mêmes passions féodales que nous avons rencontrées si souvent » (t. Ier, p. 239).
Et le consciencieux M. de La Rouverade, ayant à parler de cette maison dans ses Etudes historiques el critiques sur le Bas-Limousin (1860), nous dit :
ce Bonnesaigne, abbaye de filles, contemporaine de Vigeois » (p. 172).
Or, cette dernière abbaye fut restaurée par saint Yrieix et sa mère Pélagie, qu'on croit avoir été la femme d'un comte de Limoges, en 571 (Hisl. du BasLimousin, p. 52).
Enfin, l'intrépide géographe Limousin, M. J.-B. Champeval, parlant de Bonnesaigne, nous dit dans ses notes : ce Bonnesaigne, prieuré fondé, croit-on, vers 730, connu cependant que par bref du pape 1165, érigé en titre d'abbaye plus tard, vers 1180 »...
De ce concert unanime d'historiens, anciens et modernes, il résulte clairement pour nous, malgré
— 241 —
les novateurs que nous avons en vue, que les premiers fondements de Bonnesaigne, prieuré ou abbaye, comme l'on voudra, — cette question s'éclaircira plus tard — furent jetés en 730, par Eudes, roi d'Aquitaine et comte de Poitiers.
Voilà un premier point de Y histoire légendaire de Bonnesaigne, qui me paraît digne de respect et de croyance.
Le second l'est aussi.
2° Achèvement de Bonnesaigne (180)
Mais ce n'est pas dans les quatre ou cinq ans qui lui restaient à vivre, après cet acte de piété chrétienne, que le duc pouvait conduire à bonne fin l'oeuvre qu'il avait commencée dans les marais de Bonnesaigne.
Il dut la léguer, comme un héritage de famille, à Hunald, son fils.
Mais Hunald, à son tour, put-il s'occuper activement de l'oeuvre de son père durant les dix ans de luttes incessantes qu'il eut à soutenir contre CharlesMartel, Pépin et Carloman, qui le forcèrent à abdiquer et à se retirer dans l'île de Ré? (745).
L'infortuné Waiffre, son fils et son successeur, le put-il davantage?
Durant ses vingt-trois ans de règne (745-768), il fut traqué, comme une bête fauve, par Pépin, qui avait envie du beau et riche royaume d'Aquitaine. Chassé de Y Auvergne, du Quercy et du Limousin, Waiffre alla tomber misérablement, sous le poignard d'un lâche assassin, son ami (Warston, que Pépin avait
— 242 —
soudoyé), dans la forêt à'Edobole, aujourd'hui Vergt en Périgord (765) (1).
Durant cette terrible levée de boucliers, où devaient périr la nationalité et l'indépendance de l'Aquitaine, les soldats de Pépin se comportèrent en vrais barbares : ce Monastères envahis, moines expulsés ou égorgés, églises dépouillées et châteaux renversés, ce furent là comme des jeux pour ces hommes sauvages ».
Pépin fit table rase en Auvergne ; Scorailles et autres châteaux furent renversés ; seul, celui de Tournemire nargua le puissant vainqueur : ce Turrim ne mira ! » Ne perds pas ton temps à regarder cette tour (765).
Le Limousin surtout fut livré à la merci des rudes envahisseurs. Ecoutons l'histoire :
ce Tout le Lemovicinum fut abandonné à la fureur des soldats de Pépin ». L'église de Nonars fut pillée et saccagée ; le château vicarial d'Arnac (Puy-d'Arnac) fut renversé depuis la Capfouillère jusqu'au jardin actuel de la cure (765) ; ce le castrum de Torenna (Turenne) fut visité aussi. Mais le lâche vicomte, qui avait attiré, en bonne partie, tous ces fléaux sur nos contrées, n'eut pas le courage de résister jusqu'à la fin. Il fit sa soumission et mérita, par cette félonie, de devenir l'unique seigneur du Limousin inférieur. Enfin, le castrum d'Isodunum (Yssandon), que Waiffre regardait comme faisant partie de son domaine privé, fut renversé de fond en comble ».
ce Tout le Pagus jusqu'à Isodunum, dit le chroni(1)
chroni(1) Ar.-D. de Chastres, par l'abbé Bessou, p. 35 et suivantes.
— 243 —
queur, souffrit beaucoup. Cette partie de l'Aquitaine, qui abondait en vignobles et fournissait des vins aux pauvres comme aux riches, fut ruinée pour toujours (765) ».
Et Frédegaire ne rappelle qu'avec douleur cette partie des vengeances de Pépin qui, après avoir dépossédé ses maîtres du trône, étouffé leurs descendants dans les cloîtres, poursuivait les restes de leur maison et leurs sujets fidèles par le fer et par le feu » (De Larouverade, Etudes, etc., p. 149).
Les oeuvres fondées par Waiffre et ses ancêtres attirèrent tout particulièrement les colères du soudarl vainqueur. Et si Bonnesaigne battait alors son plein, ce qui est peu probable, il est aisé de deviner le sort qui lui fut réservé, dans cette conflagration universelle du Limousin qui s'était choisi Waiffre pour maître et pour roi.
En apprenant tous ces maux tombés sur son royaume, Hunald sortit de l'île de Ré pour venger son fils lâchement assassiné. Mais vaincu à son tour et pris par Charlemagne, il put néanmoins s'enfuir chez Didier, roi des Lombards, pour lui souffler la guerre contre l'oppresseur de sa famille. Charlemagne le poursuivit par de-là les Alpes, et c'est durant le siège de Pavie qu'Hunald fut lapidé par les habitants de la ville, las des calamités que sa présence dans leurs murs leur avait attirées (774). Ses descendants régnèrent quelques temps encore sur une faible partie de l'Aquitaine.
Hunald et Wa'ïffre, malgré les malheurs qui les accablèrent, semblent pourtant ne pas avoir perdu de vue, un seul instant, l'oeuvre de leur ancêtre. Ils y
— 244 —
travaillèrent d'une manière plus ou moins active, selon les moments de repos plus ou moins longs que leur laissaient leurs guerres incessantes. Mais enfin, il paraît bien qu'ils s'en occupèrent, eux ou leurs successeurs amoindris. Les historiens Estiennot, Marvaud, de Larouverade, etc., en effet, s'accordent à dire que, six ans après la mort tragique d'Hunald sur la terre d'Italie toujours inhospitalière aux Français, Bonnesaigne était complètement achevée (780).
Voilà donc un second point de Vexistence légendaire de Bonnesaigne qui nous paraît solidement établi : commencée en 730, notre communauté aurait mis cinqante ans pour sortir de ses marais et faire son éclosion à la lumière. Mais en 780, tout était complètement fini. Elle était solidement établie, richement dotée et abondamment pourvue de sujets, et cela sous le règne bienfaisant de Charlemagne devenu empereur d'Occident (800).
Le troisième l'est aussi.
3° Bonnesaigne enrichie (1095)
ce S'il en est ainsi, d'où vient donc que Bonnesaigne est sans histoire, sauf pour quelques dates, de 780 jusqu'à 1095, l'espace de plus de trois siècles? » nous objectent les ennemis des traditions abbatiales.
ce Heureuses les abbayes qui n'ont pas d'histoire ! » pouvons-nous leur répondre.
Malheureusement, il n'en est pas ainsi de Bonnesaigne.
Nous ne connaissons que trop le sort qui lui fut réservé, ainsi qu'à nos autres communautés, après la mort du grand empereur d'Occident, durant l'in-
— 245 —
vasion Normande et l'émancipation des vassaux de l'Empire.
Pendant cette durée de 315 ans, l'histoire de Bonnesaigne se trouve écrite, dans nos bruyères, en caractères de feu et de sang, par les barbares sortis des brumes septentrionales, ou en larmes d'oppression, derrière les murailles sombres de nos puissants seigneurs.
Trente ans après la mort de Charlemagne, en effet, arriva l'invasion Normande (814-845).
Or, cette invasion, qui dura un gros siècle et dont la perspective avait, dit-on, arraché des larmes au grand empereur mourant, désola les contrées du centre^ de la France, et le Limousin en particulier, vers 845.
ce Débarqués aux bords de l'Atlantique, ou remontant sur leurs longs bateaux le cours de nos rivières, les barbares, cette année-là, ravagèrent tout le pays qui s'étend, de la mer à l'Occident, vers l'Auvergne à l'Orient.
ce Leurs mains ce écumaient » de telle sorte qu'on ne voyait plus, dans la campagne, un animal utile, et leurs pieds suivaient si bien le sol qu'aucune région, dit le chroniqueur de Maillezais, ny ville, ny village, ny cité n'échappa à leurs ravages » (Bonaventure-Saint-Amable, t. III, p. 814).
ce Ce qu'ils poursuivaient le plus, c'était le prêtre, et avant ou après le prêtre, l'objet ou l'instrument du culte. Aussi voyait-on de tous côtés processions de pauvres gens, et ce translation de corps et de reliques de saints, pour les contregarder de la tuerie de ces démons incarnés, qui détruisaient les églises et les
— 246 —
monastères, et consumaient par le feu les châsses et les ossements des saints » (Id., p. 320)
ce L'incursion recommença vers 885, avec des caractères non moins affreux et des suites non moins effroyables » (Poulbrière, Hist. du Dioc, 45-46).
Et l'abbaye de Bonnesaigne que devint-elle, durant cette période de malheurs sans nom qui s'étaient abattus sur les terres du Limousin ? Ne fut-elle pas « écumée » comme les autres maisons religieuses du centre de la France ? Que devinrent ses archives ? Ne furent-elles pas la proie des flammes? Rien ne le prouve, mais tout nous porte à le croire. Voilà pourquoi, non seulement Bonnesaigne, mais toutes nos autres maisons religieuses de ces temps barbares sont sans histoire,'ou n'ont que des lambeaux d'histoire, souvent quelques dates seulement, et c'est le cas de Bonnesaigne. Mais ce n'est pas fini.
Après l'épreuve Normande, arrive l'épreuve féodale, guère moins nuisible que la première à nos communautés.
Jusqu'à Charlemagne, les rois de France avaient été les bienfaiteurs-nés des communautés, sauf les exceptions lamentables qu'amenèrent la cruauté de la guerre et la barbarie d'hommes à peine touchés par les bienfaits de la religion. Mais, sous les successeurs du grand empereur, il en fut autrement. Les derniers Carlovingiens, en effet, étaient trop faibles pour porter droite la couronne et tenir haute l'épée que leur avait léguées leur glorieux ancêtre, pour faire respecter les personnes et les choses de l'Eglise.
Pendant les 173 ans que dura le règne de ces rejetons incapables du monarque d'Occident, règne plein
— 247 —
de commotions qui amenèrent au pouvoir la troisième dynastie de nos rois (987), la féodalité, à la faveur de l'invasion Normande, prit naissance en France et se substitua à la royauté.
Nos grands -seigneurs, profitant des désordres dé l'Etat et de la faiblesse de ceux qui le dirigeaient, de simples vassaux de la couronne devinrent petits souverains ; et plusieurs d'entre eux, comme les Turenne, s'arrogèrent le droit de battre monnaie et de se dire Seigneurs par la grâce de Dieu.
Ils se dirent aussi, à l'exemple des rois, protecteurs et bienfaiteurs des maisons religieuses qui se trouvaient sur leurs terres. Mais les faveurs, dont ils purent les combler d'abord, dégénérèrent bientôt en oppressions. \
Ecoutons ce que nous dit l'histoire des épreuves qui les attendaient pendant le xe et le xie siècle jusqu'à la date des Croisades (1095) :
ce Les cloîtres, enrichis par la piété des peuples, se virent en butte aux vexations d'une féodalité turbulente et jalouse, qui brûlait de ressaisir avec usure ce que ses doigts avaient laissé tomber. Des hommes comme Adémar, comme Géraud d'Aurillac sont rares en tout temps ; ils étaient alors l'exception et la vio-. lence de la règle.
ce N'ayant donc pour la désarmer d'autre ressource que de se jeter dans ses bras, l'Eglise conçut l'idée d'un protectorat aussi glorieux que lucratif dont elle investit ses puissants oppresseurs, en les honorant du nom d'abbés laïcs, comme jadis Constantin s'était décerné le titre d'évêque du dehors. Mais il en fut des barons du Moyen-âge comme des Césars du Bas-
— 248 —
Empire : l'institution dégénéra promptement en leurs mains » (Poulbrière, même Hist., p. 69).
Durant cette époque d'émancipation (814-1095), Bonnesaigne eut l'histoire d'un simple ce Domaine » de la Terre de Comborn.
Bonnesaigne ne devait ni ne pouvait échapper à cette influence des abbés laïcs. Ses biens passèrent aux mains des puissants seigneurs de nos montagnes, et ses affaires intérieures dépendirent également du bon caprice de ses primitifs PROTECTEURS, devenus ses OPPRESSEURS, qui avaient intérêt à empêcher leur victime de crier et de donner signe de vie. Lui permettre de crier, l'autoriser à appeler au secours, la laisser seulement cligner de l'oeil, c'eût été dire à cette grande détroussée : ce Réveille dans mon âme inquiète des remords mal éteints!... Clame et ne cesse de clamer mes injustices à ton égard ! »
Criants abus qui durèrent même plus ou moins jusqu'au xvne siècle et amenèrent souvent, dans Bonnesaigne, des scandales que nous aurons à déplorer dans le cours de ce récit.
Il fallait, l'ère bienfaisante des Croisades pour tirer notre abbaye de la loi du secret qui la muselait, depuis 780 jusqu'à 1095 qui nous permet de la contempler, balançant ses tours de sable sur un champ d'azur et de sinople au-dessus de la verte ramure de la forêt de Ventadour, dans le ciel bleu de nos montagnes.
Enfin, elle s'est levée cette ère bienfaisante des Croisades; elle a apparu radieuse au beau firmament de la France, ce la douce Fille aimée de l'Eglise, port assuré où se réfugie toujours la barque de Pierre battue par la tempête » : Filia Dulcis, more suo,
— 249 —
profugum suscepit Gallia patrem 1 (Ëpitaphe gravée sur la tombe de Gélase II).
Urbain II est venu au coeur de la France exhorter nos grands seigneurs à faire trêve à tant de dissensions qui désolent le beau royaume de France, et à tourner leurs armes, sans cesse mises au clair, contre les Contempteurs de la gloire de Jésus-Christ et les profanateurs de son tombeau. En moins de quinze jours, l'intrépide vicaire du Christ a terminé tout ce qu'il se proposait de faire au Concile de Clermont. Il visite ensuite le monastère de Saucillange, les villes de Brioude, de Saint-Flour, d'Àurillac, et arrive au monastère d'Uzerche en plein coeur de l'hiver, le vendredi 21 décembre 1095, jour de la fête de saint Thomas. Les archevêques de Lyon, de Bourges, de Bordeaux, de Tolède, et les évêques de Poitiers, de Saintes, de Périgueux, de Rodez et de Limoges l'accompagnent, ainsi que l'élite des seigneurs Limousins et plusieurs autres personnages portant, les uns sur l'épaule droite les autres sûr le coeur, des croix d'étoffe rouge, cousues à leurs habits, que le Souverain Pontife distribuait lui-même à ceux qui voulaient s'enrôler dans la sainte milice pour combattre les oppresseurs des chrétiens d'Orient. Sans Favis contraire de l'évêque diocésain, Urbain II aurait consacré l'église d'Uzferche ; mais devant les pieuses instances qui lui furent faites, il partit le lendemain, avec son brillant cortège, pour célébrer à Limoges les fêtes de la Noël (V. Combet, Hist. d'Uzerche, p. 43).
Hé bien ! c'est à partir de cette période d'élans généreux, qui passa sur la France comme un souffle régénérateur, que l'abbaye de Bonnesaigne, comme
— 250 —
beaucoup d'autres, put sortir des ténèbres épaisses qui l'enveloppaient depuis son berceau, et faire son entrée triomphale dans le domaine de l'histoire.
Assurément, nos seigneurs montagnards, si fortement attachés à leurs ducs d'Aquitaine malgré les malheurs qui les accablèrent, eurent à coeur de s'occuper de l'oeuvre de leur roi Eudes. Ils la relevèrent si elle succomba sous la violence des conquêtes austrasiennes ou les ravages de l'invasion normande ; ils la réintégrèrent dans ses droits, après l'avoir asservie eux-mêmes. Grâce aux terreurs de l'an mil, dès l'aurore de la première Croisade, les maîtres de nos montagnes, reconnaissant les méfaits dont, ils s'étaient rendus coupables en usurpant les biens des églises et des communautés, à la faveur des troubles qui la précédèrent, se montrèrent magnanimes de repentance et de générosité. Désireux de réparer, autant que possible, leurs torts envers Dieu, envers l'Eglise et envers les communautés qu'ils avaient opprimées et dépouillées au lieu de les défendre et de subvenir à leurs besoins, dans les malheurs des temps, ils se mirent résolument à l'oeuvre. Les uns bâtissaient des abbayes, comme Glandier, Meymac, sans parler d'une infinité de prieurés ; les autres relevaient les ruines que les orages politiques avaient amoncelées sur le sol ébranlé des églises et des maisons religieuses ; d'autres enfin, comme les Ventadour, abolissaient l'esclavage sur leurs terres ; rendaient largement aux communautés les biens qu'ils avaient enlevés, et bâtissaient des prieurés dans le bourg de Moustier, au village de Bonneval de Soudeilles, et jusque dans
— 251 —
les murs de leur inexpugnable forteresse de SaintGeorges de Ventadour, etc.
L'antique abbaye de Bonnesaigne, visitée de bonne heure par l'épreuve, ébranlée jusqu'au fond de ses fondements par les secousses politiques qu'amenait chaque changement de dynastie, dépouillée par les barbares ou asservie par ses défenseurs, méritait autant, sinon plus que ses soeurs, de ne pas être oubliée.
Elle ne le fut pas.
La preuve qu'il en fut ainsi je la trouve, non pas dans les grands historiens, mais bien dans les notes précieuses que nous a laissées le bon abbé Bazetou, sur cette abbaye éteinte et mal connne, qu'il désirait tant faire revivre et placer en pleine lumière.
Ce premier aumônier de l'école de la Chapelle, fondée par testament de l'abbé Laubie, principal du collège de Villefranche (Aveyron), le 14 novembre 1864 ; autorisée quatre ans plus tard par l'empereur, le 23 juillet, sous Mgr Berteaud, d'illustre et savante mémoire, qu'a si bien fait revivre (1897) M. Germain Breton, enfant de Darnets, brillant supérieur du petit séminaire de Brive, dans son ouvrage : Un Evêque d'autrefois, et enfin réalisée le 9 avril 1880, a droit ici à un mot d'éloge d'autant plus mérité qu'on s'est toujours montré avare d'encouragements envers cet homme de bien.
Ce modeste et intrépide bourreau de travail, nommé presque octogénaire à l'aumônerie de la Chapelle (1885-1891) comme poste de repos, a passé les six dernières années de sa vie de la manière la plus méritoire. Il continuait à donner des retraites; il
— 252 —
transcrivait les sermons des nombreuses missions qu'il avait prêchées dans presque toutes les églises du diocèse. Bien plus, il finissait d'user sa vue à déchiffrer les papiers poudreux de nos montagnes parlant de la malheureuse abbaye qui nous occupe.
Dans une des pages sorties de sa plume tremblante sur Bonnesaigne, pages encore humides de son dernier souffle de vie exhalé sur elles, il nous apprend ce qu'Ebles Ier, vicomte de Ventadour, fit du bien à Bonnesaigne ».
C'est court mais substantiel, comme une ligne biblique !
Ce simple mot suffit pour établir qu'au moment des Croisades Bonnesaigne, quoique sans histoire, vivait. Le vicomte Ebles Ie'', en effet, mourut en 1096, peu après le Concile de Clermont, au moment où nos chevaliers partaient pour la première Croisade.
Voilà donc un troisième point de Y existence légendaire de Bonnesaigne qui nous est acquis.
Commencée en 730, terminée en 780, notre abbaye était toujours debout en 1095, malgré les épreuves par lesquelles elle avait passé, pendant Yinvasion Normande et durant le règne de la féodalité.
Arrivé dans nos montagnes en 1059, Ebles Ier, pressé par un devoir de charité ou de justice, se hâta de soulager son âme et celle de ses ancêtres, en liquidant les charges qui pesaient sur son héritage paternel, depuis trop longtemps.
Il le fit envers Bonnesaigne ; la même année, il le fit aussi pour les moines de Tulle :
ce De plus, assuré de sa résurrection future, mais incertain de sa récompense éternelle pour son âme et
— 253 —
celle de son père, de sa mère et de tous ses parents, il fit don de la moitié de l'église de Marcillac-laCroisille à l'abbaye de Tulle; y joignit des mas, des borderies et un pré adjacents ; plus la dîme, les proférents de certaines terres et en général tout ce qu'il avait en seigneurie des appartenances de cette église ».
Les termes indiquent une restitution (Poulbrière, Dict., t. II, p. 178).
- Pour Bonnesaigne aussi, le bien qu'il lui fit devait avoir plutôt Y odeur de la restitution que le parfum de la donation !
Mais enfin, restitution ou donation nous prouve avec une égale certitude que Bonnesaigne a vu le jour avant 1150, date que veulent bien lui assigner certains écrivains.
Le quatrième point qui nous reste à établir le prouve également.
4° Bonnesaigne complète sa manse (1147)
. Après ce troisième jet dans le domaine de la lumière, Bonnesaigne retombe, pour 70 ans, dans la région des ombres.
L'oeuvre de restitution ou de donation qu'avait commencée Ebles Ier ne devait pas se finir de sitôt.
La première Croisade l'avait inspirée, en réveillant dans l'âme de nos vicomtes les aiguillons du remords ou les sentiments de la générosité ; la seconde seulement devait la terminer, en inspirant à Eblës II le désistement le plus complet, avant de partir pour les champs de la Palestine d'où il ne devait revenir malade que pour aller mourir au Montcassin, après avoir bien bataillé et bien chanté.
T. XXIV. 2-8
— 254 —
Dans son Bref de Clermont (1165), que nous résumerons bientôt aux chapitres III et VI de cet ouvrage, sauf à le donner en entier aux pièces justificatives, le Pape a la complaisance de reproduire la liste des domaines en la possession de Bonnesaigne, liste que lui avait adressée la prieure Jovite. De plus, il appelle par leur nom les bienfaiteurs qui l'avaient enrichi sous cette date. Or, Ebles le chanteur, son épouse AgnèsdeMontluçonet ses enfants : Ebles III, Archambaud et Aimon y figurent pour la meilleure part : «c Je mets sous la protection du bienheureux Pierre, etc., les biens que vous tenez du don d'Ebles vicomte, de son épouse et de ses fils », Ex dono Eblonis vicecomitis, uxoris et fliorum. Mais Ebles II n'a pas pu se montrer généreux, après 1147, envers le monastère qui nous occupe en lui donnant ce la forêt de Bonnesaigne » et diverses propriétés. Sa donation peut être antérieure à cette date, mais non postérieure, car c'est en 1147 que le vicomte partit pour la seconde Croisade. Il ne revit plus les terres du Limousin. A son retour, après un séjour prolongé en Palestine, il mourut en 1152 au Mont-Cassin, ce célèbre rendez-vous des illustres pénitents du Moyen-âge, où Ebles III, à son tour, devait aller, dix-huit ans après (1170), mêler ses cendres à celles de son père.
Pour la quatrième fois, nous sommes donc autorisé à défendre Yexistence légendaire de Bonnesaigne et à dire : la manse de Bonnesaigne était complète au départ d'Ebles II et d'Ebles III, son fils, pour la seconde Croisade (1147). Il n'est donc pas exact d'insinuer à ses lecteurs, dans des pages écrites un peu trop à légère, que le monastère de Bonnesaigne
— 255 —
ne sortit de ses marais que peu d'années (1150) avant l'apparition de l'écrit pontifical (1165).
De 730 à 1165, l'histoire de Bonnesaigne ne nous est, il est vrai, que peu ou point connue. Mais gardons-nous bien de faire imprimer que les lambeaux que nous en avons soient une ce fausse erreur pire que la nuit, sur laquelle il faille souffler ».
En effet, dans cette-nuit sombre, nous Aroyons déjà briller, au firmament de cette partie de l'histoire de Bonnesaigne, quatre étoiles pour l'éclairer un peu :
La première y a été piquée, comme un clou d'argent, par le R. P. Estiennot de la Serre ;
La seconde, par les historiens qui l'ont suivi ;
La troisième, parle fouilleur de grimoires, M. l'abbé Bazetou ;
La quatrième, par la logique des dates.
D'autres après eux, à force de piocher dans les noires archives de nos greniers, pourront peut-être, une fois ou l'autre, en exhumer un soleil!... Car, en effet, selon la belle expression d'un gracieux poète : ce La science habite les greniers ».
' Et alors nous aurons, non plus la lueur d'une nuit toujours pâle malgré la scintillante clarté de son monde d'étoiles, mais bien l'ardente lumière d'un jour sans nuage du mois de juin. Et cette partie ténébreuse des origines de Bonnesaigne sera sans ombre.
Mais finissons-en avec cette période ténébreuse de l'histoire de Bonnesaigne ; sortons du tunnel dans lequel nous marchons à tâtons depuis quatre siècles et demi, à l'aide du terne miroitement de trois ou quatre dates pour nous indiquer la trace de ses pas à
— 256 —
travers la longue nuit des siècles, depuis Eudes d'Aquitaine jusqu'au pape Alexandre III.
Désormais, travaillons en plein jour, comme les autres chroniqueurs, à la suite du vicaire de JésusChrist, et disons ce que fut en Limousin l'abbaye de Bonnesaigne, à partir de 1165 jusqu'à notre Révolution.
Passons à la période écrite de son existence. L'Histoire succédera avantageusement à la Légende, je le veux bien. Mais la légende ne sera pas détruite par l'histoire ; au contraire : l'histoire lui donnera raison. Nous allons le voir.
§ II. — ORIGINE ÉCRITE DE BONNESAIGNE (1165)
Cette fois, nous sommes arrivé à une date que personne ne conteste : en 1165, Bonnesaigne respirait à pleins poumons.
Voici sa genèse, d'après Bonaventure de S'-Amable :
ce Comme il y a un si grand silence parmi les auteurs de la naissance de ce monastère, et qu'il n'a paru qu'en ce siècle, je l'ai réservé pour en parler comme au lieu qui lui est le plus convenable. Car le pape Alexandre, dans son bref apostolique donné à Clermont le 18 juillet 1165 et le sixième de son pontificat, en fait honorable mention, et confirme à Jovite, prieure et à ses soeurs les biens dont elles jouissaient » (t. III, p. 460).
C'est après nous avoir rappelé, selon le R. P. Estiennot, la fondation de ce monastère, en 730, par ce Eudes, duc d'Aquitaine, père de Hunaud, ayeul de Gaïfre », qu'il nous avoue manquer de documents sur son
— 257 —
compte durant cette période reculée, et qu'alors il ne commencera son article sur Bonnesaigne qu'à partir du jour où il trouve cet établissement en pleine prospérité, c'est-à-dire à la date du Bref du Pape, 18 juillet 1165.
Mais, des restrictions mêmes du bon religieux, il ressort clairement que le monastère de Bonnesaigne est de beaucoup antérieur à la date du Bref apostolique (1165). Son éclosion à la lumière a eu lieu longtemps avant.
Le simple bon sens suffit pour démontrer la légitimité de cette assertion.
Ce n'est pas, en effet, dans un jour ni dans un an, qu'un monastère acquiert les proportions de celui de Bonnesaigne, recrute des sujets, s'entoure d'importantes propriétés et va en deviner au loin jusqu'à « Peyralevada » (Peyrelevade, canton de Sornac).
Or, lorsque le pape Alexandre écrivait de Clermont, à la prieure, Bonnesaigne avait déjà fait ses preuves ; la maison avait des sujets, et de vastes et nombreuses propriétés, que nous nommerons plus tard, étaient sous' sa dépendance. Et c'est parce que Bonnesaigne était déjà connue avantageusement au loin que le vicaire de Jésus-Christ en « fait honorable mention, confirme à Jovite, prieure, et à ses soeurs, les biens dont elles jouissaient et met sous la protection du Saint-Siège les biens que les religieuses de Bonnesaigne ont acquis, ou peuvent acquérir ».
Sous la date du Bref, le monastère en question était dans toute sa splendeur et en pleine efflorescence ; ses vastes et grasses fondrières étaient desséchées et rendues bonnes et saines ; ses divers bâti-
— 258 —
ments construits ; son église achevée avec son grandiose clocher, sous forme de tour carrée ; et les grandes demoiselles de la terre des Lémovices ou de YAlvernie circulaient sous les arcades du cloître, ou chantaient les louanges du Seigneur dans les stalles du sanctuaire, derrière un double rang de grilles austères.
Non, tout ce travail de géant, qu'exigeait l'appropriation de ces lieux insalubres pour les rendre habitables, ne se fit pas en un clin d'oeil et par enchantement.
Il a fallu de longues et pénibles journées de sueurs, à des centaines de malheureux esclaves, avant que les délicates et gentilles damoiselles de nos ce très grands, très puissants et très illustres seigneurs T> vinssent exposer leur santé dans cette vallée silencieuse, pour réveiller par leurs jeux et leurs chants les échos de nos montagnes endormies depuis de longs siècles, si non depuis le jour de la création.
C'est d'autant plus vrai encore, qu'à ces époques glorieuses de foi ardente, nos ancêtres, assurés de se survivre dans leur nombreuse descendance, ne bâtissaient pas uniquement pour eux, mais bien pour les générations à venir. Ils allaient lentement et faisaient oeuvre grande et durable. Souvent, en effet, du sommet des tours grises de leurs sombres repaires, nous contemplent deux ou trois siècles de générations éteintes à les construire.
Aujourd'hui, pour des raisons contraires, on est pressé de jouir ; on se hâte de construire et l'on fait oeuvre d'un jour. L'avenir n'est plus à la famille ! et souvent celui qui doit la fonder en est le propre destructeur dans son germe. 11 ne bâtit que pour lui et
— 259 —
l'ombre de sa Vie : siciit umbra talis viia ! De même pour les vénérables monastères, qui ont leur origine noyée dans la nuit des temps.
Les illustres croyants qui en jetaient les fondements savaient que, si leurs propres enfants n'avaient pas la vocation d'y entrer, ce seraient les rejetons de leurs fils aînés qui, un jour, iraient les habiter.
Voilà pourquoi ils prenaient le temps de faire oeuvre qui pût traverser les siècles et faire reluire, le long des générations les plus reculées, l'éclat de leurs royales libéralités.
Voilà pourquoi aussi, au sujet de la maison qui nous occupe, les traditions qui nous disent : « Commencée en 730, Bonnesaigne fut terminée cinquante ans après », nous ont toujours paru plus près de la vérité que les écrits juvénaux nous insinuant, timidement il est vrai, que, florissant en 1165, Bonnesaigne ne commença à faire son éclosion à la lumière que ce vers 1150 », c'est-à-dire 15 ans avant son éclat.
Mais à quelle date le florissant monastère de 1165 a-t-il été honoré du glorieux titre d'abbaye ?
C'est ce qui nous reste à élucider en terminant le chapitre que nous avons consacré aux origines de Bonnesaigne.
§ III. — ORIGINE ABBATIALE DE BONNESAIGNE (1165-74)
Il est certain qu'en 1165 Bonnesaigne n'était pas abbaye, mais simplement prieuré.
S'il en avait été autrement, JOVITE, en écrivant au pape de vouloir bien mettre sous sa haute protection les biens de son monastère, n'aurait pas manqué de
— 260 —
signer de son vrai litre l'objet de sa supplique. Et c'est parce qu'elle n'avait laissé tomber de sa plume que cette phrase : Jovite, prieure du monastère de la Bienheureuse Marie de Bonnesaigne, que le pape répète, dans sa réponse favorable, les mêmes expressions : Jovilm priorissoe monasterii Bealoe Marioe de Bonnasagnia.
Tout comme aussi, si les Ventadour en avaient été les fondateurs ce vers 1150 » ou avant, Jovite n'aurait pas omis de le dire au Souverain Pontife ; et le Pape, à son tour, qui reproduit dans son Bref, avec tant de complaisance, les noms des propriétés qui relevaient de Bonnesaigne, à cette date, noms que lui avait nécessairement transmis la prieure, se serait bien gardé de changer le titre de fondateurs en celui de bienfaiteurs, comme il nous présente les vicomtes dans l'écrit émané de sa suprême autorité. C'est parce que Jovite avait simplement dit, et sans réclamation de la part des chatouilleux seigneurs, que Bonnesaigne avait été enrichi par les dons ce d'Ebles, de son épouse et de ses enfants... et d'autres hommes de bien, que le vicaire de Jésus-Christ reproduit, dans son Bref, cette phrase significative et sans réplique possible : Ex dono Eblonis, uxoris el filiorum... et aliorum virorum.
Bonnesaigne n'était donc que prieuré en 1165. Mais alors, sous quelle date propice est-il devenu abbaye ?
M. Champeval nous dit, en parlant de ce prieuré : ce Déjà en bonne voie en 1165, devenu abbaye vers 1180 ».
Au Bulletin de Limoges, on écrit :
— 261 —
ce La dame de Canillac de Beaufort fist ériger ce prieuré en titre abbatial l'an 1633 et eut de grands démêlés avec les seigneurs de Pompadour ; mais enfin elle en fut la première abbesse, et depuis, les dames qui en ont été pourvues ont pris le titre d'abbesse » (Leduc, Etat du diocèse de Limoges, t. XLVI, p. 350).
Double inexactitude facile à redresser, à l'aide des auteurs anciens, si l'on veut bien ne pas les traiter tout à fait de radoteurs.
Ecoutons le bon Père Bonaventure de. Saint-Amable, parlant d'après le bénédictin Estiennot à qui il avoue ce devoir le principal de ce qu'il dit de Bonnesaigne et des autres monastères du Limousin » ; il nous dit :
ce Elle (Jovite) n'est appelée que prieure dans ce Bref (1165), mais le nécrologe lui donne la qualité d'abbesse, disant ainsi : ce Le huitième des Ides d'avril mourut Jovite, abbesse de Bonnesaigne ».
Or, ce décès se place forcément avant 1174, date sous laquelle nous trouverons plus tard une autre supérieure que Jovite à la lête de Bonnesaigne.
C'est donc après 1165 et avant 1174 que Bonnesaigne changea son nom de prieuré en celui d'abbaye. Et tout comme Arnaud de Saint-Astier, de dernier abbé, devint premier évêque de Tulle, Jovite, de dernière prieure, devint première abbesse de Bonnesaigne. Et cela, toujours sous le pontificat d'Alexandre III ; Gérald II étant évêque de Limoges ; Richard, duc d'Aquitaine ; Ebles IV, époux de Sybille de Faye, vicomte de Ventadour, et Gérald, seigneur de Sodellas (Soudeilles), quelques années avant l'invasion de nos montagnes par les armées d'Henri II,
- 262 —
roi d'Angleterre, qui alla se faire mettre en si piteuse déroute sous les remparts de Ventadour (1182).
Donnons maintenant, dans un autre chapitre, le nom des bienfaiteurs de Bonnesaigne et la nomenclature des terres dont ils se plurent à former la manse abbatiale, à l'envi l'un de l'autre.
(A suivre).
LES BÉNÉDICTINES
DE
BONNESAIGNE
(Suite)
CHAPITRE V
Importance de l'abbaye de Bonnesaigne : 1° Juridiction civile ; 2° Juridiction spirituelle ; 3° Règle de l'abbaye de Bonnesaigne.
g I. — JURIDICTION CIVILE
Ainsi constituée et dotée, Pabbaye de Bonnesaigne ne tarda pas à avoir un grand renom dans le Limousin et dans les provinces environnantes. Gomme un aimant puissant, elle attira à elle, à l'ombre de ses grandes murailles de clôture.,- au fond de ses marais, un grand nombre de familles honorables, comptant parmi leurs membres : des notaires, des médecins, des avocats, des juges, des huissiers, des guerriers même, etc. Tout un bourg se forma autour d'elle : le bourg de Bonnesaigne, avec quatre foires de vieille date et fort suivies.
Nous trouvons dans ce bourg : les Rigald et les de Belger, notaires (1343) ; les d'Espert, Espinet, Perrier, Mary, Magimel, Sourzat, de Mirambel, les d'Ussel-Châteauvert, les Tète-Blanche, huissier, etc. Et tous ces hommes de science, de loi, de guerre avaient à honneur de mettre leur savoir et leur expérience des affaires au service de la communauté, pour la bonne gestion de ses intérêts temporels.
C'est ainsi que messire Léonard d'Ussel de Cbâteauvert, chevalier de l'ordre de Jérusalem, commandeur de la commanderie de Maissonnisse, en Marche,
T. XXIV. 4 - i
— 454 —
après avoir longtemps guerroyé pour la patrie, se retire à Bonnesaigne et accepte l'office de procureur de l'abbaye. Le 10 avril 1760, nous le voyons traiter avec maître Pigeyrol, curé de Darnets, docteur en théologie/ au nom de révérende dame LéonardeGabrielle de Châteauvert, sa fille, pour la perception des revenus que la communauté avait à toucher sur la cure de Darnets.
L'abbesse était seigneuresse, ayant son tribunal, ses juges et ses autres officiers de justice. C'est en 1280, avons-nous dit, que Mathe de Châteauneuf acquit, d'Ebles VII de Ventadour, le droit de justice dans l'endroit. Dès lors l'abbaye eut sa prison.
Mais elle eut, en même temps, un lieu de refuge, comme il y en avait tant au Moyen-Age, où les criminels trouvaient un abri contre les poursuites de la justice abbatiale ou seigneuriale, abri qu'ils croyaient y trouver encore, longtemps après que la Révolution eut enlevé ce suprême espoir des malheureux. Ce lieu de refuge est le modeste sanctuaire de NotreDame de Deveix (N.-D. de Pitié), situé au Nord des prairies de Bonnesaigne, au milieu du village de la Chapelle, assis à droite et à gauche de la route nationale de Tulle à Clermont, entouré d'arbres fruitiers, de jardins et de bois de pins. Cette chapelle, autour de laquelle s'est formé ce gracieux village, berceau d'un homme de bien, M. l'abbé Laubie, mort principal du collège de Villefranche (28 mars 1865), est fort ancienne. Son origine doit être contemporaine de celle de l'abbaye (730). Mais le mystère qui plane sur le berceau du monastère, durant plusieurs siècles (730-1165), couvre pareillement le sien et
- 455 -
M. Hamon, dans son Histoire du culte de la sainte Vierge en France, se plaint ce de n'avoir rien pu apprendre de Notre-Dame de la Chapelle, dans le canton de Meymac ».
Ce que nous aurions pu apprendre, au pieux curé de Saint-Sulpice, d'après les notes manuscrites du notaire L. de Pezaret (6 mars 1497), conservées aux archives de Soudeilles, c'est qu'avant 1165 la chapelle de N.-D. du Deveix, avec la cure de Combressol qui comptait 860 habitants et payait 30 livres, fut donnée à l'abbaye de Bonnesaigne par Gérald II, évêque de Limoges. C'est en vertu de cet acte que l'abbesse nommait à la cure Saint-Pierre de Combressol, dont le titulaire était obligé d'assurer le service de la succursale fondée dans l'église abbatiale de Bonnesaigne.
Ce que nous savons encore c'est qu'en 1629, l'abbesse Gabrielle de Beaufort-Canillac voulut avoir, dans l'église de la communauté, une réminiscence de celle du gracieux village, en y établissant la chapelle, Y autel et la vicairie de N.-D. de Pitié (ou de Deveix), dont nous avons déjà parlé.
Cette chapelle-refuge était comme une sentinelle avancée, perdue dans les bois, pour appeler les voyageurs ; c'était une halte de recueillement avant de fouler le sol sacré de la communauté, et d'adieu après l'avoir visitée, avant de reprendre la direction de Saint-Angel, d'Ussel et de Meymac; c'était un refuge, avons-nous dit, dont la Terreur, promenée dans nos montagnes par les Sans-Culottes d'Ussel et de Meymac, qui vinrent abattre les tours du Lieuteret, ne firent qu'une ruine. Heureusement, les habitants de l'endroit avaient eu le temps d'enlever avant
— 456 —
la statue vénérée de la Madone et de la cacher dans une caverne rocheuse du bois du Deveix où elle attendit longtemps, mais en toute sûreté, l'arrivée de jours plus calmes qui lui permirent de se réfugier dans l'église paroissiale.
Sous le premier Empire, un préfet de la Corrèze ordonna, à la municipalité de Combressol, de débarrasser le terrain de l'ancienne chapelle villageoise, pour la raison, ou sous le prétexte que ces ruines servaient de repaire (comme autrefois) aux brigands des environs. Les bons habitants de l'endroit sauvèrent encore leur pèlerinage : ils refusèrent d'exécuter cet ordre destructeur.
Ils avaient l'espoir d'une restauration de leur chapelle !
Cette restauration s'accomplit en effet ; ce fut Jean Laubie, frère du curé de Combressol et père de l'abbé dont nous avons prononcé le nom, qui l'effectua.
Par permission de M. Brival, vicaire-général de Limoges, en date du 1er janvier 1821, la statue vénérée de N.-D. de Pitié revint de l'église paroissiale, le 12 juin, dans son sanctuaire rétabli et embelli.
Parmi ceux qui la portaient triomphalement, sur leurs robustes épaules, se trouvaient :
Le chevalier Marins de Meynard de Maumont, seigneur de Lachenal, garde du corps, maire de Darnets; (Nathali) Boumeix, sous-officier de cavalerie, du village de la Barrière, paroisse de Darnets ; Taguel de Barsanges, géomètre ; et Bobert, propriétaire, de la paroisse de Rosiers-d'Egletons.
M. Teyssier, curé de Meymac, présida la cérémonie. Il était assisté de MM. Antoine Laubie, curé
— 457 —
de Combressol; Joseph Souiller, curé de Darnets, qui célébra la messe d'action de grâce, ayant pour la lui servir le jeune Etienne-Joseph Bazetou, son élève, devenu plus tard curé de Puy-d'Arnac, de Soursac, de Maussac, et l'inoubliable missionnaire de nos campagnes, décédé, aumônier de l'école de la dite chapelle de Bonnesaigne, le 5 décembre 1891, à l'âge de 86 ans, et mis en terre le 7, dans le tombeau qu'il avait fait bâtir, pour lui et ses successeurs, au cimetière de Maussac, son église natale.
Se pressaient encore, autour du curé de Meymac, MM. Jean-Baptiste Bouharde, curé de Davignac; Léonard Mas, curé de Soudeilles et oncle de l'élève Bazetou ; Antoine Taysse, curé de Palisse, et Charles Lachaud, vicaire à Meymac.
Le procès-verbal de cette solennelle manifestation religieuse, en l'honneur de l'auguste Mère des Douleurs, fut signé par tous les prêtres que nous venons de nommer, et de plus par M. Lacombe de Lamazière, et Mme Champeval, née Lachaud.
Plus heureuse que l'abbaye qui lui donna le jour, la chapelle de N.-D. de Deveix est renée de ses cendres ; seulement au lieu d'être, comme par le passé, le refuge des repris de justice, elle est devenue, depuis 1821, Y abri des pauvres pécheurs, refugium peccatorum, où la Mère de la Miséricorde se plaît à presser sur son sein ses enfants égarés.
Avec N.-D. de Chaslres, paroisse de Bar, dont nous allons avoir l'histoire (1) par M. l'abbé Bessou, l'émment doyen de Lubersac, Notre-Dame de Deveix,
(1) Elle a déjà paru depuis que nous écrivions ces lignes.
— 458 —
ou de la Chapelle, me paraît le pèlerinage le plus ancien du diocèse de Tulle en l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie, malgré ce qu'on a pu écrire en faveur de N.-D. de Belpeuch.
C'est là que, tous les ans, le dimanche dans l'Octave de la Nativité, toutes les paroisses environnantes se donnent rendez-vous pour célébrer les louanges de l'auguste Mère de Dieu.
ce Un instant Notre-Dame de la Chapelle, deux fois désormais Notre-Dame du Deveix, rivalisa avec Notre-Dame d'Eygurande, de date bien plus récente (1720). Mais des abus s'étant glissés dans ce pèlerinage, l'autorité prit des mesures pour restreindre un concours qu'elle trouvait justement trop mêlé. Les fêtes d'aujourd'hui sont moins joyeuses et moins bruyantes ; elles présentent en retour plus de piété et portent plus de fruit. C'est au 8 septembre qu'elles ont lieu, comme à Eygurande et à Belpeuch, bien que là, comme à Belpeuch, l'image de la Vierge soit Notre-Dame de Pitié.
ce C'est là, qu'en 1875, se rendirent, pour les processions du jubilé, toutes les paroisses du canton de Meymac et quelques autres des environs : Saint-Angel et Palisse.
« Le matin, à la messe du pèlerinage, M. Bazetou, pour lors curé de Maussac, sa paroisse natale, déploya sa grande voix en disant la puissance et la volonté de Marie pour nous secourir. Le soir, à vêpres, ce fut le tour de l'élève de l'orateur du matin, M. l'abbé Chazal, doyen de Meymac, qui nous commenta en termes exquis l'antienne des suffrages : Sancla Maria succure miseris. On le voit, le vieux maître et
— 459 —
l'élève du presbytère de Servières nourrirent merveilleusement nos âmes du pain de la parole de Dieu. En retour, le titulaire de l'endroit, M. l'abbé Lafon, l'ancien émule de Mgr Dupanloup sur les bancs de Saint-Sulpice, nous servit à l'hôtel Guy, ancienne maison Aigueperse, les produits les plus succulents de la montagne pour la nourriture de nos corps brisés de fatigue » (V. Biog. de M. Bazetou, p. 45).
Et les chants des pèlerins, et les échos des bois, et les notes argentines de la petite cloche villageoise éclatent tous les ans sur les ruines de l'abbaye sans pouvoir les faire tressaillir !
Il en sera ainsi des pages que nous leur consacrons : elles les laisseront endormies dans un éternel sommeil de mort !
§ II. — JURIDICTION SPIRITUELLE
L'abbesse de Bonnesaigne, élue à vie, était un personnage important dans le diocèse de Limoges, non seulement au point de vue temporel, mais encore et surtout au point de vue spirituel.
Elle avait droit de collation et de nomination à tous les bénéfices du patronage de son abbaye.
Bien plus, elle avait droit de présentation aux cures et vicairies perpétuelles de Villevaleix, de Darnets, de Combressol, de Maussac, de Chaveroche, de Saint-Julien près Bort, de Saint-Frejoux-leMineur, de Davignac, d Ambrugeac et de Menoire, diocèse de Tulle, et de Champagnac et Veyrières au diocèse de Clermont (aujourd'hui de Saint-Flour); en
— 460 —
un mot, elle présentait à tous les bénéfices qui pouvaient dépendre de l'abbaye de Bonnesaigne et prieurés y annexés, ce pour, par la dite dame, jouir tant des droits que de tous les honneurs, fruits, profits, revenus et émoluments appartenant à l'abbaye ».
Ce sont les propres termes de l'official général de Limoges, le jour de l'installation de Mme de SaintMarsault, le 3 janvier 1781.
Je ne sais comment il en fut pour les autres cures, mais pour celle de Darnets les évêques de Limoges ne se faisaient pas scrupule d'y nommer, sous la présentation de la seigneuresse de Bonnesaigne. Dans tous les cas, si elle en présenta quelques-uns, elle n'eut pas le choix heureux, car tous sans exception, de 1348 à 1789, lui rendirent la vie dure ; nous le dirons dans un autre chapitre.
Pour le bon gouvernement intérieur de sa maison, l'abbesse était assistée d'une prieure claustrale et d'une sous-prieure, qu'elle nommait elle-même (1578).
La nomination de l'abbesse fut d'abord élective, comme partout, c'est-à-dire au choix des religieuses de l'abbaye et des prieurés qui en dépendaient.
Durant cette période, les religieuses furent parfois influencées dans leur vote par l'ingérence des seigneurs de Ventadour, mais surtout par les Gimel, les Saint-Chamant, les Ghabannes et les Lajugie de Maussac. Durant le Moyen-âge, nos seigneurs, en cela semblables aux Césars du Bas-Empire, se mirent « mitre en tête et glaive au poing », à régir ce qu'ils n'avaient qu'en tutelle et n'hésitèrent pas à s'imposer de force quand on n'accédait pas de gré. « Est-ce que les
— 461 —
abbayes ne sont pas à moi? disait l'un d'eux à un évêque ».
ce Ainsi, les maisons de Dieu devinrent simplement des fermes ou domaines pour des races grossières, que le temps et l'Eglise même ne devait assouplir que petit à petit ».
Ainsi s'exprime M. l'abbé Poulbrière, dans son Histoire du diocèse de Tulle, pp. 69-70.
Et avant lui, dom Vaissète avait dit : ce Au xe siècle, les grands vassaux, sous prétexte de patronat, se rendirent maîtres de la nomination aux évêchés et aux abbayes qu'ils regardaient comme des fiefs mouvans de leur domaine, et ils exerçaient sur les monastères une' autorité despotique en qualité d'abbés laïcités (Hist. du Languedoc, t. II, p. 118).
Bonnesaigne ne devait ni ne pouvait échapper complètement à cette funeste influence du dehors.
Durant plusieurs siècles, en effet, la maison de Ventadour disposa presque seule de la nomination des abbesses. Mais disons tout de suite, à la décharge des Ventadour, pour cette intervention indue malgré les biens insignes qu'ils avaient faits à l'abbaye, que les abbesses imposées par eux furent toutes admirables de vertus. Malheureusement il n'en fut pas ainsi de celles que lui donnèrent les Gimel, les Saint-diamant et les Chabannes. Le gouvernement de ces abbesses se ressentit trop souvent de son origine laïque, de l'ambition et des autres passions qui agitaient cette époque de notre histoire féodale. De là l'origine et l'explication des dissensions, des intrigues et des divisions qui éclatèrent trop souvent entre les religieuses et leurs supérieures, scandales que
— 462 —
nous aurons à déplorer dans le cours de cette histoire, mais qui ne sont pas imputables, nous le répétons, à la si chrétienne famille de Ventadour d'où sont sortis tant de prélats distingués, d'illustres religieux et de saintes religieuses. Et si les Ventadour ont paru, à certains historiens, se montrer un peu trop autoritaires lors de la nomination et de la mise en possession de l'abbesse Blanche de Gimel, en 1471, sous Louis-Charles, dernier représentant mâle de la branche de Comborn, nous dirons plus tard qu'ils avaient d'excellentes raisons de le faire.
Il en fut de même de la seconde race de nos vicomtes : Louis de Lévy, époux en 1472 de Blanche de Gomborn-Ventadour, fille unique de Louis-Charles dont nous venons de prononcer le nom, et héritier par alliance par conséquent de la fortune des Ventadour, put bien avoir aussi quelques prétentions sur Bonnesaigne, mais on ne voit pas qu'il en ait abusé outre mesure, pas plus lui que ses descendants.
Les maux dont eut à gémir Bonnesaigne, tant que la nomination de ses abbesses fut élective, ne venaient d'ailleurs que de Ventadour. Au xvne siècle, Ventadour fut bien évincé de ses prétentions sur Uabbave montagnarde ; mais les maux dont elle souffrait ne furent pas guéris pour cela; au contraire, ils allèrent en empirant à partir de ce jour.
D'élective, quand le pouvoir central de la Monarchie se fut accentué sous François 1er, la dignité abbatiale fut dévolue à la nomination du roi, et Bonnesaigne prit alors le nom pompeux d'abbaye royale.
Durant cette période, les intrigues cessèrent-elles ? Il ne le paraît pas.
— 463 —
Ce fut pour les faire tomber en partie et remédier aux maux qu'une-semblable intervention causait à la communauté, qu'en 1627 l'abbesse Gabrielle de Beaufort de Canillac, pour mieux donner congé aux familles secondaires qui, à la longue, s'étaient introduites dans son monastère, résolut d'en expulser la famille seigneuriale à laquelle l'abbaye devait le plus de reconnaissance. En femme politique qu'elle était, sachant parfaitement de quel côté venait le vent, l'abbesse de Beaufort, profitant de la mésintelligence qui existait déjà entre nos grandes familles et Richelieu, et du désintéressement des honneurs et des grandeurs de ce monde bien connu du duc Henri et de Marie-Liesse de Luxembourg, son épouse, appelés à être peu de temps après l'un chanoine de Paris et l'autre carmélite de Ghambéry, fit enlever aux Ventadour leur titre de fondateurs de l'abbaye de Bonnesaigne, avec les privilèges qui y étaient attachés de temps immémorial.
Ainsi le régla le Parlement, qui ne leur laissa que le titre de bienfaiteurs.
Cet acte d'autorité, de la part de l'intrépide abbesse, dût paraître à plusieurs d'une hardiesse souveraine ; mais il ne semble pas dénoter chez elle une sagesse et une prévoyance consommée dans les affaires. A partir de ce jour, les Ventadour, jusque là attentifs aux besoins d'une abbaye qu'ils avaient relevée, si non fondée, se désintéressèrent en effet des affaires de Bonnesaigne ; mais Bonnesaigne n'en marcha pas mieux pour cela. D'autres intrigues y surgirent, et à partir de l'intrépide abbesse qui lui avait rendu son éclat primitif durant son long règne de 46 ans, Bonne-
— 464 —
saigne, privé du puissant appui des Ventadour déboulés, alla toujours en déclinant.
Une fois nommée, l'abbesse, aussi bien que son monastère, ne relevait immédiatement que du saintsiège. Elle s'adressait directement, sans intermédiaire, au Pontife romain.
C'est ce que nous ont déjà appris les Bollandistes : Romance sedi immédiate subjacet locique Domina audit abbatissa (Gai., t. II).
Depuis le vin 0 siècle, l'abbesse de Bonnesaigne, fière de son glorieux privilège, acceptait bien visites, règlements, voire même subsides de la part des évêques de Limoges, mais sans leur reconnaître pour cela aucune juridiction sur sa maison. Ce ne fut pourtant pas sans bien des déboires que les choses marchèrent ainsi, durant plusieurs siècles. L'autorité épiscopale, jalouse de se voir ainsi arrêtée au seuil d'une maison religieuse, essaya plusieurs fois de happer ce privilège insigne ; mais les abbesses tenaient toujours la dragée haute. Au xvne siècle éclatèrent, à ce sujet, de graves et retentissants débats. L'évêque voulait, à tout prix, soumettre Bonnesaigne à sa juridiction ; et les religieuses refusaient d'abandonner le privilège qu'elles tenaient de leurs premiers fondateurs. L'abbesse, qui venait de faire tomber les prétentions des puissants ducs de Ventadour, se crut assez forte et assez habile pour arrêter celles des tenaces évêques de Limoges. Pour cela, elle fit agréger sa communauté, en 1648, à l'abbaye de Cluny, d'où il ne paraît pas, d'après Roy-Pierrefitte, qu'elle ait jamais reçu de visiteurs avant cette date. L'évêque, sans quartier, lança alors l'interdit sur la remuante communauté.
— 465 —
La lutte n'en continua que de plus belle, durant plusieurs années, entre les deux juridictions. Finalement, l'abbesse succomba, et François de La Fayette, premier aumônier de la reine Anne d'Autriche, fut accepté comme supérieur de l'abbaye de Bonnesaigne qu'il dota des règles dont elle pouvait avoir besoin. C'est en 1657 qu'eut lieu cette soumission, six ans après la mort de Mmû de Beaufort-Canillac.
Ce qui n'empêcha pas de nouvelles contestations, sous Mgr Louis de Lascaris d'Urfé. Alors le roi intervint pour faire cesser ces scandaleux débats. Par arrêt du Conseil privé, rendu le 15 février 1691, il soumit définitivement la tracassière abbaye à la juridiction des évêques de Limoges. C'est ce que veulent dire ces lignes de la Gallia Christiana : Moniales abbalioe Bonnesanioe in Lemovico tractatu superiore, paulo post ultro sese obtulere ut ab Francisco de la Fayette episcopo Lemovicensi visitationem et vitoe régulas acceperunl (T. II, p. 42).
§ III. — RÈGLE
Filles de saint Benoît, naturellement les religieuses de Bonnesaigne suivirent, dès le début de leur existence, autant que possible, la Règle du glorieux fondateur de leur ordre, c'est-à-dire de 730 à 930.
Plus tard, à cause des affinités qu'elles avaient avec l'abbaye de Tulle, elles acceptèrent le règlement de Cluny que saint Odon, abbé de Tulle, introduisit dans sa communauté (930-1318). Dès lors, elles se servirent
— 466 —
du bréviaire de Cluny, jusqu'à l'impression de celui du Concile de Trente.
Malgré ces deux règlements, on peut dire néanmoins que l'abbaye de Bonnesaigne n'eut guère d'autre Règle que la volonté de ses abbesses. Les religieuses spécifiaient bien, dans leurs lettres de profession, qu'elles embrassaient la Règle et la constitution de saint Benoît ; mais c'était une pure formule.
Les choses marchèrent ainsi jusqu'en 1645, que l'abbesse Gabrielle de Beaufort-Canillac voulut réformer sa communauté. Outre la clôture, elle fit faire les constitutions qui régirent sa communauté jusqu'aux mauvais jours de la Révolution. Pour les dresser, elle se servit du conseil de.quatre hommes très éclairés; l'un était l'abbé régulier des Pères de Citeaux; le second, M. Parrer, docteur de Sorbonne, grand maître de théologie du collège de Navarre ; le troisième, M. Guillaume Dumas de la Gouterie, bachelier de Sorbonne, ancien curé du Gros-Chastang (1594-1640), de Neuville (1640), traducteur de l'Octavius de Minulius-Félix, ami de saint Vincent de Paul et de Richelieu qui voulut lui donner l'évêché d'Alet, frère du poète franciscain Martial de Brive, et pour lors vicaire-général de Mgr Jean de Genouillac de Vaillac, évêque de Tulle ; le quatrième était M. Vincent de Paul, à cette date simple prieur de Saint-Lazare, qui, quinze ans plus tard, devait installer la mère Anne Ardemont à l'hospice d'Ussel, établi en 1269. Après mûre délibération, on trouva bon de se servir, pour Bonnesaigne, des constitutions que le Grand-Maître de Na,varre avait dressées autrefois pour les Bénédictines du diocèse de Clermont, en supprimant quel-
— 467 —
ques articles trop austères. On fit de même tout ce qu'on put pour en avoir de ces Bénédictines de Clermont, mais jamais on ne put en obtenir. On résolut encore de faire quelque peu d'altération à ces constitutions, et ensuite on les fit approuver aux supérieurs, après y avoir ajouté quelques additions consacrées par l'usage (V. Sem. relig., 21 avril 1883).
Cette réforme, depuis longtemps nécessaire, produisit-elle tous les bons effets qu'en attendait l'intrépide abbesse? Elle dut ramener la régularité dans ce malheureux monastère le plus éprouvé, le long des siècles, de toutes nos maisons religieuses ; mais il ne paraît pas qu'elle ait fait augmenter, d'une manière sensible, le nombre des vocations. D'après les chiffres que nous en a conservés l'histoire, il est aisé de deviner les jours heureux ou malheureux que traversa Bonnesaigne.
Sous l'abbesse Mathe de Châteauneuf (1276-1286), la communauté comptait quarante religieuses et dix frères oblats. Le nombre de ces derniers fut réduit de cinq et celui des religieuses augmenté d'autant ; c'était du temps d'Ebles VU de Ventadour, époux de Blanche de Châteauneuf, soeur de l'abbesse de Bonnesaigne.
Durant nos luttes interminables avec l'Angleterre, les trois fléaux qui ravagèrent le Limousin en particulier, la guerre, la peste et la famine, s'abbattirent terribles sur Bonnesaigne ; le nombre des religieuses descendit alors à quinze (1345), dont nous donnerons les noms plus tard.
En 1399, tandis que notre province était livrée à des bandes de pillards, Bonnesaigne comptait seize
— 468 —
religieuses ; c'était du temps de Gaillarde ,11 Robert de Blauge.
En 1407, durant le veuvage d'Isabeau de Vendat, mère de Jacques de Ventadour fait prisonnier à la bataille d'Azincourt (1415), elles n'étaient que neuf.
En 1471, peu d'années après le mariage de Blanche de Ventadour avec Louis de Lévy comte de la Voûte, sous l'abbesse Blanche de Gimel, elles montèrent au chiffre de dix-neuf. Il descendit à quinze sous Catherine de Chabannes, en 1597. En 1706, sous l'abbesse de Beauverger, elles étaient seize, y comprise l'abbesse.
En 1759, lors de leur émigration sous le ciel plus clément de Brive, elles étaient vingt-une soeurs et trois converses outre l'abbesse.
Enfin, quand éclata la Révolution, l'abbaye de Bonnesaigne comptait onze religieuses et trois converses, que nous ferons connaître en temps et lieu.
Et toutes ces religieuses furent gouvernées, l'espace de onze siècles (730-1790), par les demoiselles des plus hautes familles du Limousin et des provinces environnantes. Malheureusement, les archives de Bonnesaigne nous manquent de 730 à 1165 : un silence de mort règne sur l'abbaye durant ce long intervalle. Mais par les noms illustres que nous a livrés, à partir de cette date, Mme Marie Colas, religieuse de Mme Jacqueline de Blémur, qui a fait le catalogue des abbesses, avec chronique, il nous est facile de deviner la noblesse de celles qui nous restent inconnues.
C'est cette liste de Mmc Colas, reproduite dans les ouvrages du R. P. Bonaventure de Saint-Amable, de l'illustre publiciste Montesquieu et du savant Nadaud,
— 469 —
que nous allons nous-même donner, avec quelques compléments que nous fournissent les ouvrages de M. l'abbé Poulbrière, les notes de M. Bazetou combinées avec celles que nous possédons nous-même, et les recherches de M. Champeval.
Quelle série de noms aristocratiques ! Vraiment, l'abbaye de Bonnesaigne semble n'avoir été fondée que pour recueillir les vocations des demoiselles des plus illustres familles du Limousin, de la Marche, de l'Auvergne et de plusieurs autres provinces !
Pas un nom de la plèbe !
De nouveau : saluons donc avec respect ces grandes abbesses, en les voyant passer, la crosse à la main, sous les arcades du cloître, ou en les entendant chanter, dans les stalles du sanctuaire, les louanges du Seigneur :
Elles sont la gloire ce du monastère Beatoe Marioe de Bonnesaigne » !
Malheureusement, pour la plupart d'entre elles, les documents nous manquent ; l'histoire ne nous a livré que leurs noms, et, pour les mettre en relief, nous sommes obligé de les faire vivre hors de leur couvent, avec leurs contemporains et les événements de leur époque. De là, dans notre récit, beaucoup de traits qui ne viennent pas directement au sujet qui nous occupe : ce L'Histoire des Bénédictines de Bonnesaigne ».
Observons, une bonne fois pour toutes, que dès avant l'apparition de la première abbesse de Bonnesaigne nous étions en pleine guerre de cent ans avec l'Angleterre. Ce qui nous donne un peu la raison du court passage au pouvoir de certaines abbesses et du
T. XXIV. 4-2
— 470 —
manque de documents sur leur compte, durant cette longue et terrible levée de boucliers.
C'est en 1152, en effet, qu'eut lieu le divorce de Louis VII; en 1154 que commencèrent les hostilités. Elles devaient durer jusqu'en 1450, que les Anglais furent définitivement chassés de France.
CHAPITRE VI
Abbesses de Bonnesaigne (1165-1805)
l I. — JOVITE (1165)
Lorsqu'au xif siècle, Bonnesaigne, richement parée de ses anciens joyaux retrouvés, fait son entrée triomphale dans le domaine de l'Histoire, avec la majesté d'une reine revenant dans ses états après une longue et dure captivité, nous étions au lendemain de la seconde croisade à laquelle avait pris part, d'une manière brillante, sous les murs de Damas, Ebles II le Chanteur et Ebles III de Ventadour son fils. Le premier était mort depuis treize ans au Montcassin et le second ne devait pas tarder longtemps à aller à son tour y rendre le dernier soupir (1170).
Gérald était seigneur de Sodellas (Soudeilles), et le ceinturon de milice, avec les noms de Monseigneur et Dame, venait d'être donné au Paysan de Maumont et à son épouse, à la suite de la courtoise aventuré qui, grâce au vassal de Ventadour, tourna si bien à la confusion du puissant et malin comte de Poitiers, l'émule, avons-nous dit, du vicomte, dans l'art de trouver gentiment en vers (Chron. de Vig., p. 128).
La belle langue Lemozina était le parler de tous nos montagnards ; ils se flattaient même de ne pas
— 472 —
en connaître d'autre et disaient, avec un certain orgueil :
De to-ous lous porlomens co-eï lou ma-ï que me pla-i ; On aymo dzomais tro lou porta de so may !
Cette langue était, en effet, arrivée à son apogée. Ebles II et Bernard, hom fo de paura generatio, pZlh d'un sirven del castel de Ventadom que era fomiers de cozes pa, mais l'émule du grand vicomte, dans l'art des chansons et des tensons, lui avaient donné sa véritable formule.
Les cansos que Bernard avait adressées à Agnès de Montluçon : Molher del vescoms que era mot gentil damna el gaia, étaient encore sur les lèvres de tous nos villageois. Les bergers les fredonnaient discrètement le long des rives des deux Luzège, ou sur la lisière de la forêt vicomtale ; et durant les longues veillées d'hiver, le chaume de nos étables, ou le manteau de nos larges cheminées, retentissait de ces couplets plus brûlants que les tisons enflammés du foyer :
Quan vei lo laudeta mover De joi sas alas contra-l rai, Que s'oblida es laissa cazer, Ailas ! quai enucia m'en ve, De cui qu'ieu ne veia jauzion ! Meravelhas ai, quar desse Le cor de dezirier no-m fon.
Quand je vois l'alouette agiter avec joie ses ailes dans la lumière, s'abandonner et se laisser choir par la douceur qui lui va au coeur, hélas ! quel ennui m'en vient à moi qui ne goûte point de bonheur ! Je m'étonne qu'aussitôt mon coeur d'envie ne se brise.
— 473 —
Ailas ! quan cuiava saber D'amor, e quan petit en sai ! Quar ieu d'amar no-m peuse tener Celeis on ja pro non aurai ; Quar toit m'a-l cor, et toit m'a me, E si mezeis, e tôt lo mon ; E quam si-m tôle, no-m laisset re Mas dezirier e cor volon, etc.
Hélas ! combien je croyais savoir de l'amour et combien peu j'en savais! Car je ne puis m'empêcher d'aimer celle dont je n'obtiendrai jamais rien ; elle m'a ravi le coeur et m'a ravi à moi-même et à tout le reste du monde ; et elle ne m'a rien laissé, excepté le désir et le bon vouloir, etc.
Qui nous dira jamais les sourires malins, quoique contenus, de nos paysans, lorsque après chaque couplet de cette chanson, une des plus compromettantes que le téméraire poète se fût avisé d'adresser à la vicomtesse de Ventadour, quelque gars dégourdi de la joviale assemblée ajoutait, en guise de refrain :
El vescoms, le sieu senher s'apercebio de re !
Plus d'une fois, les échos de ces canzones champêtres durent aller mourir aux portes du couvent, si toutefois ils n'arrivèrent jamais aux oreilles de Jovite par dessus ses hautes murailles de ceinture.
Tout chantait alors, dans nos montagnes : les hommes et les êtres inanimés.. Les troubadours avaient tout poétisé : pics élevés, rochers osseux, fontaines cristallines.
Ici, c'étaient les Puys des Agneaux, des Eglises,
— 474 —
de Château-Merles, de Russy, de Cialfond, de la Tourte et de la Garde.
Là, la roche des Dames, de la Chouette, des Compliments, de las Meidas, où le vent en ronflant faisait entendre des sons de cloches lancées à grande volée; de las Graoulas, où se réunissaient les corbeaux de dix lieues à la ronde pour fixer le jour de leur départ avant l'arrivée des frimas et pourvoir aux nécessités du voyage, au moins jusqu'à la première station. Ils porteraient en leur bec l'un une noix, l'autre une châtaigne, l'autre un gland, l'autre une faîne, l'autre enfin un morceau de fromage oublié sur la pelouse ou sur un rocher par les bergères en folâtrant. De las Fonblantsas, où se miraient les âmes du paradis; de las Bouinas, c'est-à-dire des Fées, chargées de porter du puy de la Tourte les blocs de granit pour bâtir le château de Ventadour; le Gour do-Loulo, où tous les ans, aux messes de minuit, se faisait entendre le carillon de cloches accordées à différents tons ; la Bologrando, énorme monolithe, dont la plus forte des fées se.déchargea, dans les bruyères de Veuilhac, quand ses soeurs lui crièrent, des gorges de la Luzège, que Ventadour était fini.
Ailleurs, c'étaient las Fonfreidas, dont les eaux donnaient toujours la fièvre et souvent la mort ; de la Goutto-Egledzo, sur les bords de laquelle on avait voulu d'abord élever l'église de Darnets ; mais d'innombrables lutins, durant la nuit, s'abattaient sur les murailles naissantes, les renversaient, les labouraient. A l'aube, le lieu présentait l'aspect d'un terrain sillonné par la foudre. Le travail du jour devenait la ruine de la nuit. Lassé de la diabolique persistance,
— 475 —
le curé, s'étant recommandé à saint Maurice et à saint Martin, prend le marteau du maître-maçon, le jette au ciel. Le marteau vole et tombe juste à l'emplacement de l'église actuelle, au bas du coteau de ?sainte Valérie.
C'était la fon du'Droo où se désaltérait, en ricanant aux éclats, ce grand génie des lutins, après avoir ércinté hommes et chevaux.
C'était la fon de Miedzo-Fourel, autour de laquelle folâtraient d'innocentes nymphes que surveillaient de lubriques satyres cachés dans la ramure des grands arbres des bois de Ventadour. Malheur à la pastoure qui, poussée par la curiosité, s'aventurerait à troubler le mystère de ces lieux uniquement réservés aux puissances de l'air et des forêts !
C'était la fon des Etsontis où dansaient, falfadaient de Gais-Esprits-Follets, c'est-à-dire les âmes des enfants morts sans baptême.
C'était, pour en finir, la fon-cifer (Lucifer), où, par une permission spéciale de Dieu, esprits infernaux, fantômes, spectres, squelettes et gnoms tenaient parfois leurs assises malfaisantes et se livraient ensuite, pour retrouver leurs tombeaux, à des chasses volantes effrénées, avec des cris stridents capables de glacer d'effroi les coureurs de nuit, etc.
C'est au moment où, disons-nous, de Soudeilles à Miramont et de Ventadour à Montpensier, nos montagnes n'étaient qu'harmonies, que la voix toujours grave, solennelle, majestueuse du vicaire de JésusChrist, partie de Clermont le 18 juillet 1165, dominant les chants des bergers, les ris des moissonneurs, le bruissement de la forêt, le murmure de la Luzège et
— 476 —
le bourdonnement de nos bruyères en fleurs visitées par les abeilles, se fit entendre à la prieure Jovite, dans le vallon de Bonnesaigne.
Et le pape Alexandre annonçait à l'heureuse prieure, à ses filles, à tous ces chanteurs, trouvères, jongleurs et troubadours, aux serfs d'alentour et à la France entière, que ce monastère de Bonnesaigne, caché dans un coin ignoré du Limousin, était désormais étalé en pleine lumière, sous la haute protection du siège apostolique, lui, ses habitantes et les propriétés qui en relevaient.
Et après avoir fait mention que tous ces biens (déjà nommés chap. III, § II) lui venaient du vicomte Ebles, de son épouse, de ses fils, de plusieurs autres hommes de bien et de l'avoir des religieuses ou de leurs économies, le Pape les déclarait bénévolement placés, par un privilège spécial, selon la demande qui lui en avait été faite par la Prieure et ses Filles, sous la protection du Bienheureux Pierre et du Saint-Siège apostolique.
Après cette solennelle déclaration, il menace de la colère divine tout injuste agresseur qui aura la témérité d'empêcher, par la violence ou tout autre moyen défendu, la prieure Jovite et ses Filles de jouir des biens acquis, ou à acquérir, à leur communauté, soit par concession des pontifes, libéralités des rois et des princes, oblation des fidèles, ou autres légitimes moyens.
Et si, après deux ou trois admonitions, ce perturbateur ne s'est pas amendé, qu'il soit dépouillé de la puissance et de l'honneur dûs à la dignité qu'il occupe, et éloigné de la manducation du corps très saint et
— 477 —
du sang de Dieu Notre-Seigneur et rédempteur JésusChrist, et à son dernier soupir qu'il soit abandonné à la colère de Dieu.
Seules l'autorité du siège apostolique et la juridiction canonique fcanonica juslitia) de l'évêque de Limoges restaient pleines et entières sur les biens que la prieure présente possédait et que les supérieures de Bonnesaigne pourraient posséder et acquérir à l'avenir.
Et le Pape ajoutait :
ce Que la paix de Notre-Seigneur Jésus-Christ, avec les biens qui l'accompagnent en ce monde, et les récompenses éternelles dans l'autre, soit à tous ceux qui respecteront cette décision. Amen ».
Et ce Bref, donné à Clermont le 18 juillet 1165, est signé de : ce Moi Alexandre, évêque de l'Eglise apostolique», de onze cardinaux dont on trouvera les noms aux pièces justificatives, et enfin de ce Hermantius, sous-diacre et notaire de la sainte Eglise romaine », qui l'avait écrit.
Bonnesaigne était-il déjà abbaye sous la date mémorable de 1165?
Nous avons déjà répondu : le Pape appelle Jovite simplement Prieure. Mais peu de temps après, le nécrologe du monastère lui donne le nom d'Abbesse, disant ainsi : ce Le huitième des Ides d'avril mourut Jovite, abbesse de Bonnesaigne » (Bon. Sl-Amab., t. III, art. Bonnes.)
Cette dernière prieure et première abbesse de Bonnesaigne n'était plus de ce monde en 1174. L'abbesse Flore l'avait déjà remplacée sous cette date ; nous allons le voir.
— 478 —
§ II. — FLORE (1174)
Ce nom, glorieusement porté par quatre saints et six saintes, était fort à la mode à cette époque ; mais c'est surtout en Auvergne qu'il eut son complet épanouissement : saint Flour !
Deux siècles après la Fleur de Bonnesaigne, ce nom recevait un nouvel éclat de la vierge de Maurs (1309), morte à l'Hôpital-Beaulieu, diocèse de Cahors, le 11 juin 1347.
Illustre sur le catalogue des saints, il l'est aussi dans le monde des savants : Hugues de Flore, chanoine régulier de l'ordre des Prémontrés, de l'abbaye de Florens, au diocèse de Namur, a écrit vers 1230, par ordre de son abbé, la vie de sainte Juette, veuve et recluse à Hui, morte l'an 1227 ; celles de sainte Ide de Nivelle et de sainte Ide de Leuwe, religieuses d'un monastère de l'ordre de Citeaux, en Brabant (V. Moréri, t. III, p. 483).
Le même auteur nous parle aussi de Flore, fille savante, qui écrivit un livre de Contes amoureux. On lui attribue encore quelques autres ouvrages, et divers auteurs en font mention (p. 559).
Mais tout cela ne nous apprend pas d'où était sortie la Fleur de Bonnesaigne.
Le fait unique de sa vie que nous connaissons semble nous dire que si ce n'est pas une plante cueillie sur quelque montagne ou dans quelque vallée du Limousin, elle y avait du moins des racines. En 1174, le 13 septembre, l'abbesse Flore de Bonnesaigne se fit représenter aux funérailles du vénérable F. Pierre, abbé de Saint-Martin (Limoges), par Âmélius, jadis
— 479 —
abbé d'Uzerche, retiré ensuite à Bonnaigue, et pour lors aumônier de Bonnesaigne (V. Bon. S'-Amable, p. 503, et Combet, Hist. d'Uzerche, p. 84).
Ceci se passait sous Ebles IY de Ventadour, époux de Sybille, fille de Rodolphe de Faye, seigneur de •grande considération à la cour des rois d'Angleterre, ducs d'Aquitaine, et frère de Guillaume vicomte de Castelleyrac (Châtellerault).
Le nom de Flore pourrait bien être une coquetterie de Floret, aujourd'hui Fleuret, famille de Bonnesaigne qui a produit un grand nombre de prêtres, entre autres l'abbé Bernard de Floret que nous verrons, en 1348, figurer à côté de maître Pierre de Fait et de messire Pierre des Manaudies, ses compatriotes, parmi les procureurs qui députèrent le damoiseau Jean Lajugie, de Maussac, auprès de l'évêque de Limoges, pour en obtenir la fulmination de la Bulle d'union de la cure de Darnets à l'abbaye de Bonnesaigne.
Et alors notre Flore aurait vu le jour sur le mamelon de Floret ou Fleuret, au bas duquel s'élève l'abbaye, avons-nous dit à différentes reprises. Cette terre a toujours été un fief indépendant, ne figurant jamais dans les propriétés de l'abbaye.
De son temps, le vicomte Ebles IV et son épouse firent du bien à l'abbaye.
Flore eut Marguerite de la Jugie pour remplaçante.
§ III. — MARGUERITE DE LA JUGIE (1182)
Cette abbesse portait : d'azur à la face d'or. La famille La Jugie tire son nom de la terre de la
— 480 —
Jugie, paroisse d'Eyren, et se divise en plusieurs branches : d'Eyren, de Brive, de Theillac de Pérets, de Maussac, de Davignac, etc.
Elle a eu ses illustrations : Jacques de la Jugie, d'Eyren, épousa Guillaumette Roger, soeur du pape Clément VI, pour lors garde des sceaux. Il fut anno-. bli en 1338, grâce aux démarches de son illustre beaufrère. Guillaume et Pierre, issus de ce mariage, furent revêtus de la pourpre romaine, l'un par son oncle Clément VI, et l'autre par son cousin germain Grégoire XI (1342-1375).
L'humble religieuse de Bonnesaigne eût-elle jamais, dans ses oraisons, le pressentiment de la gloire qui attendait sa famille dans l'avenir? Elle eut probablement d'autres soucis que des rêves de gloire pour les siens et pour sa communauté ; nous le dirons bientôt.
Son petit castel d'origine était situé sur le flanc Nord de la modeste église de Maussac. Les La Jugie, seigneurs de Maussac, titrés de damoiseaux, figurent partout avantageusement, à côté de la haute noblesse limousine.
Le 15 mai 1206, Hugues Judicis, coseigneur de Soudeilles, signe une donation faite à la maison et aux frères du prieuré de Bonneval, paroisse de Soudeilles.
Le 7 juillet 1348, Jean de la Jugie, seigneur de Maussac, fut député par l'abbesse de Bonnesaigne, auprès de l'évêque de Limoges, pour en obtenir la sanction de l'union de la cure de Darnets à l'abbaye bénédictine, union opérée par notre compatriote Clément VI.
C'est du temps de notre abbesse que les armées
— 481 —
d'Henri II, roi d'Angleterre, époux d'Eléonore d'Aquitaine, la cause de tant de malheurs pour nos contrées, vinrent ravager nos montagnes avant d'aller échouer piteusement sous les remparts de Ventadour, si bien défendus par Jaubert, seigneur de Saint-Flour-leChâteau (Auvergne), et gendre d'Ebles IV dont il avait épousé la fille, Marie ou Marguerite, soeur d'Ebles V.
Jaubert fut admirablement secondé par Gérald de Sodellas (Soudeilles), dont nous avons déjà prononcé le nom (1182).
Nous avions donc bien raison de dire que l'abbesse de la Jugie eut, durant son court règne, d'autres soucis que des rêves de gloire pour sa famille et pour sa communauté.
Marguerite de la Jugie ne nous apparaît, dans Bonnesaigne, que pour passer le pouvoir à Almodie de Saint-Jal.
§ IV. — ALMODIE DE SAINT-JAL (1182-1184)
Cette abbesse portait : d'azur à la bande accompagnée de six étoiles de même, posées en orle, trois en chef et trois en pointe.
Elle était née au château de Saint-Jal, en la paroisse de ce nom, canton de Seilhac.
Emportée sans doute par l'ouragan qui s'était déchaîné sur nos montagnes avec les fléaux de la guerre, Almodie de Saint-Jal ne passa guère que deux ans à la tête de l'abbaye.
C'est probablement la raison pour laquelle Marie Colas ne la mentionne même pas au nombre des supé-
— 482 —
rieures de Bonnesaigne; Bonaventure de S'-Amable en fait autant. Mais les historiens venus dans la suite nous donnent son nom (Dict. des Par., t. I, p. 370).
Un demi-siècle environ plus tard, la famille de Saint-Jal, fondue dans celle des Robert de Lignerac, devait produire un cardinal, Aymard Robert de Saint-Gai, et diverses abbesses de Bonnesaigne dont nous parlerons bientôt (§ XII, XIX, XX).
Après deux ans de règne, Almodie disparaît, et fait place à Matabrune de Ventadour.
§ V. — MATABRUNE DE VENTADOUR (1184-1190)
Elle portait : Echiqueté d'or et de gueules, une tête d'enfant soufflant de chaque côté de Vécu avec cette devise : Inania pello !
ce Nommée au huitième des Ides de mai, Mathive Brune, peut-être, est-elle issue des Brun de Lusignan, comte de la Marche ».
Ainsi s'exprime l'historien de saint Martial.
Ses armes, pourtant, dénotent une Ventadour, et c'est bien ce que croyait Marie Colas, ainsi que le P. Bonaventure lui-même, sans s'en douter, puisqu'ils l'appellent l'un et l'autre Matabrune de Ventadour.
Ils ne se trompaient pas.
Son père, Ebles III, que nous avons dit être allé mêler ses cendres à celles du célèbre cantador au Montcassin (1170), s'était marié trois fois.
La première fois, il épousa Marguerite de Turenne, veuve du vicomte de Limoges, Aymard IV, et il en eut une fille du nom de Matabrune; après quoi, il
— 483 —
divorça avec elle pour raison de parenté au 3e degré avec son premier mari (1146).
L'infortunée Marguerite de Turenne épousa alors Guillaume IV Taillefer, vicomte de Toulouse. Sa fille Matabrune s'allia, d'abord avec Reynald V le Lépreux, vicomte d'Aubusson, et ensuite avec Eschivat de Chabannes, de Madic, dont elle eut, entre autres enfants, Marthe de Chabannes, que nous allons retrouver abbesse de Bonnesaigne (1208).
Ebles III, de son côté, convola à une seconde alliance; il épousa, après 1146, Adélaïde de Montpellier, fille de Guillaume et de Sybille, et eut de nombreux enfants :
Matabrune qui nous occupe, tenue à baptême par sa soeur paternelle, dame Eschivat de Chabannes ; le vicomte Ebles IV de Ventadour, dit Archambaud, qui épousa, avons-nous dit, Sybille de Faye ; Guillaume, abbé de Meymac (1201-1208), ensuite de Tulle, mort jeune d'une chute de cheval (1212) ; Bernard VI, abbé de Tulle après son frère (1212-1239) ; Ebles, moine de Cluny, puis doyen de Mauriac et enfin abbé de Figeac (1212) ; Guy, chanoine et prévôt de Maguelonne (1212) ; Raymond eï.Hélie, chanoines de SaintEtienne de Limoges ; Ebles, qui fit quelquefois la guerre à son frère aîné, Ebles IV, vicomte de Ventadour, et enfin, Marie-Gaillarde, que nous retrouverons abbesse-de Bonnesaigne (1220-1235).
La troisième fois, Ebles III épousa Agnès de Bourbon, dont il eut un fils puîné, du nom de Guillaume, auteur de la famille d'Ussel. Nous retrouverons ce nom plus tard (g XXXVIII, 1758-1780).
Par Matabrune, les Ventadour prennent possession
— 484 —
de Bonnesaigne et n'en sortiront pas de plusieurs siècles.
Quand cette première abbesse, sortie des GombornVentadour, prit la direction de Bonnesaigne, son père, Ebles III, était mort au Montcassin depuis 14 ans (1170).
Son règne ne dura que six ans, après lesquels arrive Almodie de Scorailles (1190).
§ VI. — ALMODIE DE SCORAILLES (1190)
Elle portait : d'azur à trois bandes d'or.
De cette illustre famille, si connue en Auvergne, en Limousin et en Berry, sont sortis de nobles caractères :
Raymond Ier et Raoul, qui prirent la croix en 1095 et rapportèrent de la Terre sainte les chefs de saint Gôme et saint Damien, qu'ils donnèrent à l'abbaye de Brageac ; de concert avec l'évêque de Clermont, ils vinrent délivrer l'abbé de Saint-Pierre-de-Sens, prisonnier à Ventadour ;
Bégon de Scorailles, disciple de saint Etienne d'Obazine, est le fondateur de l'abbaye de Valette (1145) ; Géraud est abbé de Tulle en 1153.
Et après notre abbesse, Marquis, seigneur de Scorailles, de concert avec son parent, Louis de Ventadour, fonda (1411), le couvent des Cordeliers de SaintProjet, d'où partit en 1793, pour la cure de Darnets, le malheureux intrus Jean-Jacques Saint-Bame.
Notre auvergnate, Almodie de Scorailles, était donc de haute lignée.
Sur la fin de son règne de dix ans, elle vit de nou-
— 485 .—
veau lés Anglais envahir nos' montagnes, toujours pour s'emparer du colosse de Ventadour, constamment fidèle à la sémillante Eléonore, mais rebelle au joug qu'Henri II et ses fils voulaient imposer aux seigneurs Limousins.
Dans toutes ces guerres il s'agissait, pour les seigneurs d'Aquitaine qui y prirent part, tous dans le secret de Bertrand de Born, d'affranchir leur pays, d'en faire même, s'il faut en croire le récit obscur des chroniqueurs du temps, un royaume indépendant de ceux d'outre-Loire et d'outre-Manche.
Richard, Coeur de Lion, l'avait compris. Voilà pourquoi à son retour de la troisième Croisade, pendant laquelle la belle Eléonore, sa mère, délivrée de sa captivité par le trépas d'Henri II (1189), mort de confusion sept ans après sa déconfiture dans-les bruyèîes du Moustier, avait gouverné l'Angleterre, il résolut de tirer le glaive contre' les barons du Midi, quoiqu'ils l'eussent secondé dans ses trois révoltes contre son père.
Alors une voix retentit d'une extrémité de l'Aquitaine à l'autre, criant aux nobles chevaliers et au peuple : ce Guerre aux hommes du Nord ! à nous sans partage la terre qui nous vit naître ! »
C'était celle de Bertrand de Born, le plus ardent ennemi du Coeur de Lion (Voir Bulletin, Brive, t. XXIII, janvier-mars 1901, p. 83).
Dans son indignation de voir les champs fertiles de l'Aquitaine foulés sous le pied brutal des Saxons et des Normands, il réveilla l'énergie et le courage des races du Midi par des sirventés, devenus autant de chants
T. XXIV. 4 — 3
— 486 —
nationaux, qu'on répétait au village comme dans les châteaux-forts :
Pois Ventadorns, e Comborn, ab Segur, E Torenna, e Montfortz, ab Guordo, An fait acort ab Peiregore e Jur, E li borzès se claven de viro
Lorsque, à son gré, quelques barons tardaient à prendre les armes ou semblaient vouloir rester en paix, le guerrier-troubadour avait encore d'autres chants ; il jetait aux chevaliers timides ses sarcasmes rimes et satiriques, qui devaient émouvoir une noblesse dont le principal mérite était la valeur :
Un sirvente je fais de ces mauvais barons ; Plus jamais d'eux, jamais ne m'entendrez parler ; Je les excite tous assez, avec mille éperons, En puis-je faire un courir ou trotter ? Ils se laissent ainsi, lâches, déshériter ! Soient-ils maudits de Dieu ! Qu'ont-ils donc à songer, Nos barons ?
Et pour mieux allumer la haine et la vengeance de nos seigneurs limousins contre Henri II et son fils plus tard, Bertrand de' Born courait, la nuit et le jour, de Turenne à Comborn, de Comborn à Ventadour, et de ce dernier à Gimel, etc.
Les voeux du fougueux châtelain de Hautefort furent exaucés ; bientôt tout le Limousin ne fut qu'un immense champ de bataille.
Tout fier de montrer aux barons limousins que les combats de la Palestine et les soucis de sa prison n'avaient pas nui à son courage, le Coeur de Lion se mit à courir notre province. L'épouvante le précédait
— 487 —
et la dévastation le suivait. Il fit raser plusieurs cha^- teaux en Périgord, en Limousin, surtout sur les terres du vicomte de Limoges et dans le comté de Ségur.
Les vicomtes de Comborn, Raymond III de Turenne, et Ebles IV de Ventadour entendaient retentir, autour d'eux, des menaces de ruines et de dévastations.
Ainsi que l'avait désiré son père, Richard, pour maintenir le Limousin sans cesse remuant, voulut faire de Ventadour le centre de ses opérations militaires.
Ce fut sur la fin de 1198, ou dans les commencements de 1199, que les voraces Anglais envahirent de nouveau la vicomte de Ventadour. Après avoir tout pillé et saccagé à plusieurs lieues à la ronde, monastères et églises, ils parurent sous les créneaux altiers du redoutable manoir.
Ventadour fuMl défendu par le vicomte Ebles IV en .personne, ou bien comme la première fois, dix-huit ans auparavant, par l'intrépide Jaubert son gendre?
L'histoire n'en dit rien. Mais nous savons de par ailleurs qu'Hélie de Soudeilles et le chevalier Pierre Ier de la Bardêche, du village de ce nom, paroisse de Darnets, revenus, comme Richard, de la troisième croisade, se couvrirent de gloire durant ce siège mémorable.
Malgré les efforts inouïs du fils qui avait à coeur de venger l'humiliation du père devant ces robustes murailles, Ventadour nargua les flèches, les javelots, la massue et les béliers de l'homme sorti des brumes septentrionales.
Comme la première fois, il fallut avouer son impuissance et se dire vaincu. Et lorsque le bruit se répan-
— 488 —
dit, dans les gorges de la Luzège, qu'Adémar V, vicomte de Limoges, venait de trouver un trésor dans le château de Ghâlus, le bouillant Richard, confus de son insuccès, fut heureux de ce prétexte pour quitter nos landes et aller assiéger la place en question, où, toujours âpre à l'or l'Anglais ! il espérait en trouver des monceaux semblables à ceux que recèlent les mines du Transvaal.
Comme ses rapaces compatriotes qui traquaient les vaillants Boërs au moment où nous tracions ces lignes, il trouva à Chalus la mort. Une flèche, lancée du haut des remparts par Bertrand de Gourdon, alla percer le farouche guerrier qui était assis sur la Pierre de Maumont (6 avril 1199).
Interrogé par le Coeur de Lion, le fier chevalier répondit : ce Tu as tué de ta main mon père et mes deux frères, me voilà vengé ! »
Longtemps après son départ piteux de nos montagnes, le souvenir de ce l'ogre anglais » fut la terreur de l'enfant et de la mère, comme il l'était en Palestine.
En apprenant cette fin tragique bien méritée, tous les troubadours limousins, Ebles IV, Sybille de Faye son épouse, Ebles V leur fils, Bertrand de Born et les chefs de son parti reprirent la lyre pour chanter leur joie de la mort de leur plus cruel ennemi.
Seul, Gaucelm Faydit, le troubadour vagabond d'Uzerche, osa célébrer, dans une complainte touchante, le triste sort de ce lugubre général, courageux si l'on veut, mais exécrable précurseur du sinistre Roberts, l'égorgeur des femmes et des enfants de la République Sud-Africaine.
— 489 —
Et Faydit disait dans sa complainte :
Bel senher Dens, vos qu'etz vers pardonnaire,
Vers Dens, vers hom, vera vida e merces,
Perdona-li, que ops e cocha l'es ;
E non gardetz, Senher, al si en fallir,
E membre vos com vos anet servir.
Beau seigneur Dieu, vous qui êtes vrai pardonnaire, vrai Dieu, vrai homme, vraie vie et récompense, pardonnez-lui s'il a pu vous offenser et exaucez-le ; et ne regardez pas, Seigneur, s'il a pu faillir, mais souvenez-vous comment il est allé vous servir (en Palestine).
Et il en avait besoin d'avoir cette bonne action à son actif pour paraître devant le Tribunal redoutable du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs !
Le ravisseur de Nonne, d'Uzerche, pouvait en effet le pleurer : il perdait en lui un ami intime et généreux ; mais il n'en est pas moins vrai que, pour notre province, pour la France et pour Philippe-Auguste, la mort de Richard fut un heureux événement. Plusieurs vassaux se rapprochèrent du monarque et le reconnurent pour suzerain. Les principaux seigneurs limousins en firent autant, et, ensemble, se préparèrent pour l'avenir, encore chargé de nuages belliqueux.
C'est au milieu de cette confusion, de ce cliquetis des armes, que l'abbesse Almodie de Scorailles gouverna ses filles bénédictines.
On devine aisément le désarroi universel qui régnait dans les communautés avoisinant Ventadour. Voilà pourquoi Bonnesaigne, pillée, saccagée par les
— 490 —
hordes d'Henri II et de Richard, manque d'archives, de documents précis, durant ces périodes agitées de notre histoire locale ; nous n'avons que des noms d'abbesses. Agnès de Tulle lui succéda.
§ VII. — AGNÈS DE TULLE (1200-1208)
C'est dans cet état de trouble, de désorganisation, de relâchement peut-être, qu'Agnès de Tulle trouva la communauté de Bonnesaigne lorsque, un an après la mort de Richard Coeur-de-Lion, elle succéda à Mme de Scorailles.
Cette abbesse nous vient, non plus de l'aristocratique Alvernie, mais bien des bords de la coureuse, de Tulle même. Elle sortait de cette vaillante famille de chevaliers, qu'après qu'Adhémar des Eschelles se fut dépouillé de ses biens en faveur de Saint-Martin et de ses moines de Tulle (843), nous voyons se former et grandir à l'ombre de la crosse abbatiale d'abord et de la mitre épiscopale ensuite (1318).
Parfois même, ils essayèrent de jouer à l'Adhémar, se disant suzerains de l'abbaye de Tulle. Mais l'abbé Bernard VI de Ventadour fit tomber de telles prétentions.
C'est ainsi que le père et le frère de notre abbesse, l'un et l'autre du nom d'Elie, le premier chevalier et le second damoiseau, furent amenés, en 1234, après de longues contestations, à renoncer aux droits de suzeraineté qu'ils exerçaient jusqu'aux portes de l'abbaye de Tulle, nonobstant la franchise de ses droits à elle octroyée par les anciens rois.
— 491
Le frère de notre abbesse, en présence de l'évêque de Limoges, se dessaisit, en effet, en faveur de Fabbaye, de la part qui lui revenait dans la tour de la Motte, de toutes ses autres possessions situées dans l'enceinte du château, et reconnut ensuite les tenir en fief de l'abbé qui, avons-nous dit, était alors Bernard de Ventadour (1210-1239), lequel lui paya cent vingt-six livres de la monnaie de la Marche.
Si l'on veut avoir de plus amples détails sur cette famille, ordinairement au service de l'église de Tulle, il n'y a qu'à lire le Gartulaire de l'abbaye que publie en ce moment, au Bulletin de Brive, notre savant et intrépide chercheur, M. J.-B. Champeval, géographe limousin; à parcourir aussi VHistoire de Tulle, par Bertrand de la Tour, et celle du grand Baluze sur son Ithaque bien-aimée, et l'on sera pleinement édifié sur la noblesse et les actes de vertu de la tige d'où sortait le rameau implanté dans nos montagnes.
Contemporaine d'Ebles IV de Ventadour, d'Hélie de Soudeilles et de Pierre de la Bardèche, les pourchasseurs de Richard Coeur-de-Lion, elle vit nos barons partir pour la cinquième Croisade (1198-1204).
Sous son administration, le Limousin, après la dérouté de Richard Coeur-de-Lion, fut entièrement enlevé à l'Angleterre sous Jean-Sans-Terre, par Philippe-Auguste, mais ce ne fut pas sans épreuves pour nos églises et nos communautés, toujours à la merci du plus fort après chaque bataille.
Bonnesaigne en particulierj trop dans le voisinage de Ventadour, toujours point de mire des envahisseurs, eut beaucoup à souffrir de cette lutte de géants.
— 492 —
Agnès de Tulle n'est plus en 1208; Marthe de Chabannes la remplaça.
§ VIII. — MARTHE DE CHABANNES (1208-1212)
Cette abbesse portait : De gueules au lion d'hermine, armé; lampassé, couronné d'or.
La noble et ancienne famille de Chabannes, venue du Bourbonnais en Auvergne et en Limousin (SaintExupéri), descendait des comtes d'Angoulême ; ses membres portaient le titre de cousins du roi, à cause de leurs alliances directes avec la maison de France.
Cette famille possédait, avant la Révolution, la terre et le château de Madic, dans la paroisse de ce nom, canton de Saignes, sur un monticule au bord de la Dordogne, non loin de Bort. Ce château flanqué de tours, aujourd'hui en ruines, présente encore un aspect majestueux.
Les de Chabannes étaient seigneurs de Madic, de Saignes, de Lapalice, d'Apchon, de Charlus en Limousin, paroisse de Saint-Exupéri, comtes de Rochefort, marquis de Curton.
Vers 1146, nous avons vu Eschivat de Chabannes s'allier aux Ventadour, en épousant Matabrune, fille d'Ebles III et de Marguerite de Turenne, épouse divorcée du vicomte montagnard pour raison de parenté.
Eschivat vivait encore en 1190. De son mariage avec la fille des Ventadour il eut : 1° Ebles 1er de Chabannes, qui vivait encore en 1271, et 2° Marthe, dont nous nous occupons.
— 493 —
D'après les archives de M. Longy, d'Eygurande, Marthe de Chabannes est dite abbesse de Bonnesaigne en juillet 1208 (V. notes de M. J.-B. Champeval).
Quatre ans après elle a disparu, et nous voyons à sa place l'abbesse Almodie....
Quarante-trois ans plus tard, nous trouverons à Bonnesaigne d'autres abbesses sorties du sang des Chabannes.
I IX. — ALMODIE (1212-1220)
Nous n'avons aucune donnée sur cette abbesse, pas même son nom complet.
Est-ce Almodie de Scorailles, revenue au pouvoir? Est-ce une Almodie de Saint-Jal, ou une Almodie de Montbrun, de la même souche que l'épouse d'Ebles Ier de Ventadour mort en 1095, avons-nous dit, ou en 1096 d'après les notes du chanoine Flamary? Nous l'ignorons d'une manière absolue. La Semaine religieuse du diocèse n'en sait pas plus long que nous (V. n° 31, 29 juillet 1882).
De 1212 à 1220 que dura le règne de cette Inconnue, le monde fut témoin d'un spectacle étrange : les peuples chrétiens, persuadés que les fautes des princes étaient la cause de l'insuccès des Croisades, organisèrent une expédition d'enfants, dont les mains pures devaient délivrer le tombeau de Jésus-Christ (1212). 11 s'en assembla jusqu'à trente mille en France et plus de vingt mille en Allemagne.
Ces pauvres enfants, si dignes d'admiration, périrent misérablement par les chemins ou furent dépouillés par les voleurs. Ce futle sort de ceux d'Allemagne.
— 494 —
Ceux de France, qui allèrent jusqu'à Marseille, se mirent entre les mains de deux marchands, insignes scélérats, qui, après leur avoir juré de les conduire gratuitement en Palestine, les chargèrent sur sept vaisseaux : deux firent naufrage., avec perte de tous les enfants qu'ils portaient ; les cinq autres arrivèrent en Egypte, où leurs infâmes et parjures conducteurs les vendirent aux Sarrazins.
Qui nous dira jamais les noms de ceux de nos montagnes qui, peut-être à l'instigation de dame Almodie, allèrent mourir dans les flots bleus de la Méditerranée, ou gémir dans l'esclavage sur la plage africaine !
Durant cette période, le vertueux Ebles V, époux de Marie de Limoges d'abord, et ensuite de la généreuse Marie de Turenne, était seigneur de Ventadour ; nous dirons, dans un instant, pourquoi nous employons ces deux épithètes.
Elle eut pour remplaçante Marie-Gaillarde de Ventadour, en 1220.
§ X. — MARIE-GAILLARDE DE VENTADOUR (1220-35)
Marie-Gaillarde était fille d'Ebles III, vicomte de Ventadour et d'Adélaïde de Montpellier, dont le mariage fut si fécond : neuf enfants que nous avons déjà nommés (V. § V, Malabrune).
Elle était par conséquent soeur de l'abbesse Matabrune (1184-1190), de Bernard VI, abbé de Tulle, d'Ebles IV, vicomte de Ventadour, et tante d'Ebles V, que nous allons admirer.
Quand elle arriva au pouvoir, son père était mort
— 495 —
depuis cinquante ans (1170), et son frère le vicomte Ebles IV depuis six ans (1214).
Son neveu, Ebles V, époux en secondes noces de Marie, soeur de Boson III de Turenne, était à la tête des affaires de Ventadour. Ce sont ces deux pieux châtelains qui fondèrent, dans l'église abbatiale, la vicairie de Saint-Eustache et donnèrent des rentes pour l'entretien d'une lampe qui devait être constamment allumée au dortoir de la communauté (1220).
De son temps aussi, Bernard VI, son frère, abbé de Tulle, fit du bien à Bonnesaigne (1212-1239).
L'année après son élection, l'abbesse Gaillarde fut singulièrement édifiée par un acte sublime de renoncement aux grandeurs de ce monde, de la part de ses neveux de Ventadour.
Voici ce que nous raconte, à ce sujet, le chroniqueur de Vigeois :
« L'an de l'Incarnation 1221. le seigneur Ebles V, vicomte de Ventadour, prit l'habit religieux de Grammont(l), en présence des nobles seigneurs Robert (ou Raymond, vicomte de Turenne, d'après Baluze), et de son honorable frère Raymond, vicomte de Servières ; des vénérables religieux Guillaume, abbé de Meymac (frère de l'abbesse de Bonnesaigne), Bertrand de Monceaux, et des chevaliers Constantin de la Chassagne et Hugues, son frère.
« Fait à Grammont, après l'octave de la Pentecôte, en présence de Guillaume, abbé de Tulle (le même que celui de Meymac ?), Guillaume, officiai de Limoges (ou plutôt Raymond, autre frère de l'abbesse), et Guillaume de Maumont, chanoine de Limoges » (Geof,, p. 148 ; — Marvaud, t. II, p. 95-97).
Baluze complète la liste des témoins de cet acte solennel et nous apprend que Marie de Turenne,
(1) Ou Grandmont.
— 496 —
épouse du vicomte, assistait, avec Raymond et Ebles VI leurs enfants, à cette prise d'habit, ainsi que Bernard VI de Ventadour, abbé de Tulle, autre frère de l'abbesse et par conséquent oncle de ceux-ci : istorum patruus (Eist. de Tulle, p. 160).
Avions-nous tort, tantôt, d'appliquer à Ebles V Fépithète de vertueux, et à Marie de Turenne, son épouse, celle de généreuse ?
Cet exemple sublime de vertu chrétienne devait jeter encore plus d'éclat, quatre cent vingt ans plus tard, dans cette même famille de Ventadour, en la personne du duc Henry de Lévy, et de Marie Liesse de Luxembourg, son épouse, qui se firent, après la bataille de Castelnaudary (1632), l'un chanoine de Notre-Dame de Paris, et l'autre religieuse du Carmel de Chambéry qu'elle avait fondé, ainsi que la maison des Carmes de cette même ville (V. Trois Limousines à la Visitation de Moulins, p. 44).
Savoir si nos deux seigneurs montagnards n'avaient pas été dégoûtés des grandeurs de ce monde par les horreurs de la guerre qu'ils eurent à soutenir, l'un contre les Anglais et l'autre contre les protestants, pour défendre le sol de la Patrie et les dogmes de la Religion catholique?
Avant cette prise d'habit, Ebles V avait fondé définitivement le prieuré de Bonneval, paroisse de Soudeilles, sur la rive gauche de la Basse-Luzège, après diverses tentatives infructueuses de la part de ses ancêtres sur le mamelon de Coty, entre le village de Montusclat et l'étang de la Forêt, paroisse de Darnets.
De concert avec sa généreuse épouse, il avait également exposé toutes ses terres à la juridiction et à
— 497 —
la puissance de l'archevêque de Bourges et de l'évèque de Limoges, afin que la communauté de Grammont fût indemnisée de toutes les dépenses qu'elle ferait pour lui, soit de son vivant, soit pour sa sépulture (Item, p. 137).
Brave troubadour chrétien ! qui, avec votre épouse, aimiez tant à rivaliser en cantilènes avec Faydit d'Uzerche, vous n'étiez pas partisan de l'infernale incinération moderne quand vous preniez tant de précautions pour régler à l'avance votre sépulture et votre enterrement ! Vous étiez partisan de la résurrection des corps, et voilà pourquoi vous vouliez qu'on traitât le vôtre avec respect et dignité le jour qu'on le confierait à la terre !
Grammont n'était pas inconnu au noble et pieux vicomte et gracieux troubadour. A différentes reprises, avant d'y entrer, Ebles, obéissant à un secret attrait de la grâce, l'avait visité, comme pour choisir la place qu'il devait y occuper un jour. Il s'était même montré généreux et bienfaiteur envers cette abbaye.
En effet, lorsque l'archevêque de Lyon vint visiter la célèbre abbaye, Ebles V l'accompagnait, et c'est alors qu'il donna aux moines, ses futurs frères, la forêt du Montusclat, plusieurs terres avec leurs serfs et une rente annuelle à percevoir sur les manses de Soudeillette, de la Massonie, paroisse de Soudeilles, et de Pécresse, de celle de Davignac. ' Mais les moines, instruits par le passé,'ne recevaient plus de concessions qu'en vertu de titresauthentiques ; celui du vicomte portait : « Afin de faciliter le tout, nous leur donnons pour pleiges et caution des choses promises, les nobles personnes
- 498 —.
Raymond de Turenne, Raymond son frère, seigneur de Servières ; Bertrand de Monceaux ; Constantin de la Chassagne et Hugues son frère.
On le devine sans peine, un tel exemple de vertu héroïque, parti de si haut, dût avoir du retentissement sous les voûtes de Bonnesaigne et y ramener la piété et la ferveur que les farouches Anglais en avaient peut-être bannies.
De fait, notre abbaye prospéra à vue d'oeil, à tous les points de vue, sous le règne bienfaisant de MarieGaillarde de Ventadour. Cette abbesse est comptée au nombre des grandes supérieures de Bonnesaigne et parmi les insignes bienfaitrices de la Chartreuse de Glandier que l'on venait de fonder (1219) (V. Hist. de Glandier, p. 51). Grâce à elle, bien des dégâts commis par les Anglais furent réparés à Bonnesaigne.
Mais après l'entrée en religion, à Grammont, du chef de la maison, que devinrent les autres membres de cette grande et admirable famille de Ventadour?
La généreuse vicomtesse-troubadour, Marie de Turenne qui, de concert avec son amie Marie Audier de Malemort, troubadour aussi, avait si bien éconduit l'importun et débauché Faydit : « Et près conjat d'ela iradamen », dût être une glorieuse mère dans le monde !
Sur huit enfants issus de son mariage avec le bénédictin Ebles V, six entrèrent également en religion : Raymond, fut chanoine de Saint-Etienne de Limoges (1239); Hélie, également chanoine de la même église (1239) ; Hélie, prévôt de Tulle (1241); Ebles, abbé de Figeac (1246) ; Bernard, évêque du Puy (1251); autre Bernard, archidiacre de Limoges, chapelain
— 499 —
du pape Innocent IV (1250), chanoine de Tours en 1260, et recteur du prieuré d'Argentat en 1263 (Voir Dicl. sigill., p. 408).
Les autres deux brillèrent dans le monde : Alix, épousa Robert Ier, dauphin d'Auvergne (Chroniq. de Vigeois, Baluze, notes du chanoine Flamary) ; enfin, Ebles VI, que nous venons de voir à Grammont assistant au généreux sacrifice de son père, devint, après cette mémorable journée, l'époux de Dauphine dé Latour d'Auvergne, fille de Bernard VI et de Jeanne de Toulouse, de laquelle il eut quatre enfants : Ebles VII, qui continua les Ventadour; Marie, morte jeune; Isabeau, qui vers 1263 épousa Faucon de Montgascon, après la mort duquel elle devint, en 1276, l'heureuse épouse de Robert de Montbron, tant loué par la chronique de Saint-Martial pour sa grande charité envers les pauvres; et Alix, qui fut seigneuresse' de Bonnesaigne (1292-1307).
Mais notre vieille abbesse, Marie-Gaillarde de Ventadour, ne vit qu'en partie tant de gloires religieuses de sa famille. Elle n'eut même pas le légitime orgueil de voir son petit-neveu, Ebles VI, partir (1245) pour le voyage d'outre-mer avec Alphonse, comte de Poitiers, frère du saint roi Louis IX, monté sur le trône en 1226 :' depuis dix ans elle avait passé de vie à trépas. Marie de Beaumont lui succéda en 1235.
§ XL — MARIE DE BEAUMONT (1235-1249)
Marie de Beaumont portait : De gueules à l'aigle d'or, à Vorle de chausse-trapes de même. Entre les mille bons résultats, toujours plus ou
— 500 —
moins contestés, qu'eurent les Croisades, il en est un que tout le monde peut accepter : « Elles mirent les grandes familles de France en relations ».
Les chevaliers de provinces et de nationalités si différentes purent, durant le repos des armes, échanger leurs vues sur les hommes et les choses de leurs pays respectifs.
Il me semble les entendre, durant les trêves ou les veillées, sous le gourbi, devisant chacun sur la terre qui l'avait vu naître. L'un vantait les murailles inexpugnables de son château ; l'autre la profondeur de ses fossés : « Toute la paille du royaume de France ne suffirait pas pour les combler! » (Ventadour); l'autre la beauté de son clocher villageois ; l'autre, enfin, les maisons religieuses d'hommes ou de femmes de sa province, etc.
Les chevaliers-troubadours de la vicomte montagnarde n'étaient pas des moins loquaces.
C'est sans doute leur faconde ou leur habitude de tout poétiser, même nos montagnes grises, nos marais humides, nos bois giboyeux, nos molles châtaignes et nos ruisseaux truiteux qui valut à Bonnesaigne la bonne fortune d'avoir pour abbesse, après Marie-Gaillarde de Ventadour, la fille d'une des familles les plus illustres de la province du Maine.
Marie de Beaumont nous arrivait de Beaumontle-Vicomte, petite ville sur la Sarthe, entre le Mans et Alençon, autrefois vicomte, plus tard duché et aujourd'hui petit chef-lieu de canton de 1,775 habitants.
Voici quelques-uns de ses ancêtres : Raoul Ier, fonda en 1109 l'abbaye des religieuses d'Estival, à la persuasion d'un saint ermite nommé Aleaume. On y établit
— 501 —
l'ordre de saint Benoît et Godechide, soeur du vicomte, en fut la première abbesse ; Richard Ier, grand-père de notre abbesse de Bonnesaigne, avait épousé une fille naturelle de Henri Ier, roi d'Angleterre, mort en 1135; Richard II, son père, eut de son mariage: 1° Raoul II, qui continua la famille ; 2° Guillaume, qui en 1202 succéda à Guillaume de Chémillé, sur le siège épiscopal d'Angers, qu'avait occupé Raoul de Beaumont, un de ses oncles, prélat d'un très grand mérite, mort en 1184; Guillaume aussi, mort le 2 septembre 1246, fut un prélat de beaucoup de réputation ; 3° Constance, dame de Conches ; 4° et enfin, Marie, qui nous occupe.
Le frère de notre abbesse, Raoul II, fonda aussi, en 1218, le prieuré de Loué, dont il fit présent à l'abbaye de la Couture ; de plus il donna, l'année même que sa soeur devenait abbesse de Bonnesaigne, le parc d'Orques à Marguerite, comtesse de Fif, sa nièce, fille de Constance, dame de Conches; et Marguerite, à son tour, céda ce parc aux Chartreux qui s'établirent dans le Maine. Raoul II avait fait cette donation avec le consentement de ses fils Richard III et Guillaume.
Richard III, d'un commun accord avec son épouse Mathilde, fit encore, en 1242 et 1243, de nombreux bienfaits aux mêmes religieux chartreux. La fille unique de Richard III, du nom d'Agnès, épousa en 1253 Louis de Brienne, fils puîné de Jean, dit d'Acre, roi de Jérusalem. De ce mariage naquit Robert, qui épousa Marie de Craon, et en eut Marguerite qui, en 1338, épousa Bernard de Ventadour.
Notre abbesse de Bonnesaigne appartenait donc à une famille illustre, s'il en fut en France ; mais, on le
T. XXIV. 4-4
— 502 —
voit par tout ce qui précède, à une famille avant tout chrétienne et bienfaisante. Bonnesaigne s'en ressentit, sous le supériorat de quatorze ans de cette noble et illustre religieuse. Elle laissa sa communauté en bon état, parfaitement relevée des secousses par lesquelles l'avait fait passer par deux fois les troupes d'Henri II et de Richard Coeur-de-Lion, rois d'Angleterre.
Marie-Gaillarde de Ventadour eut en elle une digne continuatrice de son oeuvre bienfaisante envers Bonnesaigne.
Les échos du bien que Marie de Beaumont faisait à sa communauté et des exemples de vertus qu'elle avait donnés à ses filles bénédictines, durent en arriver directement aux oreilles de ses parents, et sûrement de ses compatriotes, de la bouche même d'Ebles VI de Ventadour, dans les plaines de l'Egypte, sur la rive droite du Nil.
C'est, en effet, sur la fin de l'administration de Marie de Beaumont (1245), que nos chevaliers partirent pour la septième Croisade, ayant à leur tête le grand roi saint Louis.
Notre Limousin en fournit un beau contingent. Ebles VI voulut être de la partie : « Je le trouve, dit Baluze, ez année 1236 et 1249, en laquelle il partit pour aller en voyage d'outre-mer, avec Alphonse, comte de Poitiers, frère du roi saint Louis *>.
Marie de Beaumont ne devait pas voir la fin de cette expédition désastreuse (Mansourah, 1250).
« Elle décéda ou quitta sa place en 1249. Le nécrologe en fait mention le troisième des Nones d'avril » (V. Bonaventure de Saint-Amable).
La noble fille de la verte Armorique ne semble pas
— 503 —
avoir eu trop à se plaindre des Limousins, ni avoir fourni à sa famille de trop mauvais renseignements sur le compte de nos barons, car, moins d'un siècle plus tard (1338), Marguerite de Beaumont-le-Vicomte, fille de Robert de Brienne, petit-fils de Jean, roi de Jérusalem, et de Bérengère de Castille, avons-nous dit, devint l'épouse de Bernard, premier comte de Ventadour.
Notre abbesse fut remplacée par Gaillarde de Robert de Saint-Jal.
gXII. —GAILLARDE DE ROBERT DE SAINT-JAL (1249-63)
Cette supérieure était, par'sa mère, de la même famille qu'Almodie de Saint-Jal, quatrième abbesse de Bonnesaigne, en 1182.
Son père était Àymard de Robert de Lignerac, seigneur de Saint-Jal, qui fut grand-père du cardinal Aymard, son filleul, et d'une abbesse de Bonnesaigne, dont nous parlerons au paragraphe XIX de cet ouvrage.
' Sous l'administration de Gaillarde de Robert, les événements se précipitèrent en France et en Limousin surtout.
En 1250, le roi saint Louis est fait prisonnier à la mémorable bataille de la Mansourah.
Nos seigneurs étaient partis nombreux à la suite du vaillant roi ; c'étaient : le vicomte de nos montagnes, Ebles VI; Audoin d'Aixe ; Déodat d'Àlbignac ; Guillaume et Raoul Autier ; Guillaume Baudoin ; Bochard de Bochard ; André de Boisse, de Chamberet ; Hugues de Carbonnière ; Guillaume de Bonneval ;
— 504 —
Guillaume de Chassin, de Fonmartin ; Sanchon de Corn ; Etienne de Courteix ; Robert Coustin ; Bernard David ; Gilles de Flavignac ; Hugues de Fontanges ; Adhémar de Gain; Guillaume de Lacu; Pierre de Lasteyrie; Guillaume de Ligneyrac; Renaud de Montaignac ; Hugues de Noailles ; Hugues de Perpezac ; Amable de Plaignes ; Amblard de Plas ; Geoffroy Roger ; Jean de Saint-Privat ; Guillaume de Ségur ; Raymond de Ségur, et quantité de serfs émancipés et même faits nobles et chevaliers par cela même qu'ils prenaient la croix (Musée de Versailles).
Et plusieurs d'entre eux ne revirent jamais plus le clocher de leur village ; d'autres, ce ne fut qu'après une dure captivité, et d'autres enfin, ce ne fut qu'à la suite de leur roi, après qu'il eut retrouvé sa liberté.
Le vicomte de Ventadour fut de ce nombre.
La consternation dut être grande dans nos montagnes !
Le saint roi lui-même fut tellement frappé d'un tel désastre, qu'à son retour en France, pris d'un scrupule de conscience, il rendit à Henri III, roi d'Angleterre, la province du Limousin que PhilippeAususte avait définitivement arrachée des griffes de Jean-Sans-Terre.
Ce qui fut cause que Ventadour et Bonnesaigne virent de nouveau la croix blanche de France, céder le pas à la croix rouge d'Angleterre en Limousin.
De nouvelles désolations, durant plus d'un siècle, fondirent sur nos filles bénédictines : nous le dirons dans un autre chapitre ; mais Gaillarde de Saint-Jal était dans le tombeau depuis bien des années quand
— 505 —
elles arrivèrent. « Le nécrologe place sa mort le douzième des Calendes d'août (1263) ». Etiennette de Chabannes lui succéda.
§ XIII. — ETIENNETTE DE CHABANNES (1263-1276)
Cette abbesse portait : De gueules au lion dlier-* mines, armé, lampassé, couronné dor.
Eschivat de Chabannes, père de Marthe, huitième abbesse de Bonnesaigne, avait un frère du nom de Jourdain, cinquième comte de Chabannes.
Ce comte Jourdain épousa Abra de Montfort, et eut de son mariage, entre autres enfants, Etiennette qui nous occupe.
Notre abbesse, cousine germaiue de Marthe, était donc de haute lignée; ce qui ne l'empêcha pas d'avoir l'esprit sordide et de se faire accuser de ladrerie, par ses religieuses, pour une question de pitance, « afin d'accroître ses revenus » (Marvaud, t. Ier, p. 240).
Les religieuses se plaignaient des économies que leur abbesse réalisait sur leurs estomacs ; de là désaccord et graves démêlés, qui arrivèrent jusqu'aux oreilles de l'évêque de Limoges. Aimeric La Serre de Malemort crut devoir intervenir, et en 1272, durant les premiers jours du printemps, se trouvant à Bonnesaigne, l'abbesse passa, en la présence de l'auguste prélat, un accord avec ses religieuses, réglant la quantité de pain et la pitance qu'elle devait leur accorder journellement.
C'est le premier désaccord, survenu entre l'abbesse et ses filles, dont fasse mention l'histoire. Mais est-ce la faute des vicomtes de Ventadour, que certains his-
— 506 —
toriens semblent rendre responsables des mésintelligences qui régnèrent trop souvent dans l'abbaye montagnarde? Est-ce pour eux que, sur ses vieux jours, thésaurisait l'auvergnate abbesse?
Sous l'administration d'Etiennette de Chabannes une voix, vibrante comme un coup de clairon, éclata sur les remparts de Ventadour. Elle fit tressaillir les bois de Bonnesaigne, les gorges de nos Luzège, celles du Doustre, de la Triousoune, de la Diège, de la Sarsonne et du Chavanon ; elle retentit des bords de la Dordogne jusqu'aux rives de la Vienne. C'était Ebles VII, criant à nos barons montagnards de s'armer pour la huitième Croisade.
Il fut entendu cet appel patriotique et chrétien. Nos montagnards avaient à coeur de venger la déroute de la Mansourah.
Le vieux croisé, Ebles VI, se redressa sur ses jambes pour essayer ses forces d'autrefois ; mais il fallut retomber sur un lit de souffrances et se résigner à mourir (1270), tandis que son fils s'illustrait en Tunisie.
Ebles VII, marié depuis sept ans avec Blanche de Châteauneuf, fit alors ses adieux à son père pour la dernière fois en ce monde, à sa mère qu'il devait avoir le bonheur de garder jusqu'en 1299, à sa jeune épouse et à ses enfants en bas-âge, et partit de Ventadour avec ses varlets et ses deux voisins, Hugues de Soudeilles et Pierre II de la Bardèche, de Darnets, fils unique de Robert et de Delphine de Peyre-Faure (Petri-Fabri), de cette famille d'Egletons qui ,en 1371, devait donner à l'église de Tulle l'évêque Jean Fabri, qui fut cardinal.
— 507 —
Le l0,-mars 1270, nos héros montagnards s'embarquèrent avec saint Louis, oublieux des mauvais jours de sa première captivité.
Charles du Fresne, seigneur du Cange, dans VHisioire du saint Roi, par Joinville(1668, in-fol.), parle d'Ebles VII avec éloge. Il se distingua au siège de Garthage, à côté du'roi de France et de ses trois fils, Philippe, Jean et Robert. Et après la mort du pieux et vaillant monarque (25 août 1270), il fut fait chevalier, sous les murs de Tunis, par Edouard Ier, roi d'Angleterre.
Est-ce dans ces mêmes circonstances que les autres deux guerriers, Hugues de Soudeilles et Pierre de la Bardèche furent faits également chevaliers? Je l'ignore. Toujours est-il qu'ils le devinrent.
Dans le terrier des rentes de l'église de Darnets, nous voyons qu'au moment de sa mort le chevalier Pierre de la Bardèche donna, pour la communion pascale des habitants de sa paroisse natale, un sétier de vin et plus s'il était nécessaire. De plus, il fonda une rente de deux sols, payable à la fête du bienheureux saint Michel, pour l'entretien de la lampe de la Sainte Croix :
« Item Dominus Petrus de la Bardescha. MILES, legavit 1 setier vini in die paschoe vel plus, quod opus erit ad communionem ; et itemDictus Dominus, 2 solidos renduales, in festo Beati Michaëlis ad opus l&mpadis S- Crucis sitos in hospitio suo » (Terrier de 1383).
Qui nous dira jamais les prières de nos bénédictines durant cette expédition guère plus heureuse que la précédente, pour la conservation de nos croisés, leurs compatriotes ? Et lorsqu'ils reparurent sur nos
— 508 —
plateaux, qui nous dira les félicitations, quoique tempérées par la mort du roi magnanime, que leur adressa l'abbesse de Chabannes?
Etiennette se démit en 1275 et mourut l'année suivante. Elle fut ensevelie dans la chapelle de Gurton, devenue sacristie plus tard, vers 1600, dit M. Champeval.
Sa mémoire est au nécrologe, le troisième jour des Nones de juillet.
Le pouvoir passa alors à Mathe de Ghâteauneuf.
g XIV. — MATHE DE GHÂTEAUNEUF (1275-1285)
Encore une parente des Ventadour pour abbesse de Bonnesaigne !
Hâtons-nous de dire que ce fut aussi une bonne fortune pour notre abbaye.
La noble et illustre famille de Ghâteauneuf était fort connue en Quercy, en Périgord et en Limousin. C'est de cette source que sont sortis Raymond, évêque de Périgueux, et quantité d'autres grands personnages qui se sont fait un nom dans l'histoire.
Notre abbesse était fille de Pierre, seigneur de SaintGermain-les-Belles-Filles et Ghâteauneuf, aujourd'hui l'une et l'autre localité chefs-lieux de canton de la Haute-Vienne. Sa mère était Burgondie de Ventadour, fille d'Ebles IV (mort en 1214) et de Sybille de Faye.
Mathe était par conséquent nièce de l'abbesse MarieGaillarde de Ventadour (1220-1235), et soeur de Blanche de Ghâteauneuf, que nous avons dit avoir épousé en 1263 le preux chevalier Ebles VII, le héros de Tunis (1270).
— 509 -
Pendant les dix ans que dura son administration, l'abbaye de Bonnesaigne fut très florissante; ce fut l'apogée de sa gloire. Vers 1280, il y eut jusqu'à quarante religieuses et dix frères oblats. Le nombre de ces derniers fut réduit de moitié et celui des religieuses élevé d'autant, ce qui le porta au chiffre de quarante-cinq, chiffre que nous ne trouvons plus dans les annales de l'abbaye. Cet accroissement extraordinaire de religieuses tenait sans doute à-la ferveur du xmesiècle, mais aussi à la piété de l'abbesse et à la bonne gestion des intérêts matériels de sa maison. C'est cette grande abbesse, en effet, qui fit entrer sous la juridiction de Bonnesaigne l'important prieuré de Villevaleix, voisin de Châteauneuf, par le concordat qu'elle fit avec la prieure Dame Astor de Montledier.
C'est elle encore qui, en 1280, acquit de son beaufrère, le vicomte Eblon VII de Ventadour, toute la justice de Bonnesaigne.
Cinq ans après cette importante transaction, le 3 des Nones d'août 1285, la mort l'enlevait avant l'heure à l'affection de ses filles, et la crosse abbatiale passait à Adelaïs de Val-Tuve, ou de Ventadour, sa parente.
I XV. — ADELAÏS DE VENTADOUR (1285-1292)
Cette abbesse est une de celles dont le nom véritable a le plus désorienté les chroniqueurs de Bonnesaigne. Gomme elle signait du nom de son bénéfice, tantôt Adelaïs, Helis ou Hélie de Valle, de Val-Tuvâ, ou de son nom de famille Ventadour, les fouilleurs de grimoires, suivant qu'ils dépouillent un titre por-
— 510 —
tant l'un ou l'autre de ces noms, l'appellent tantôt Adelaïs, Helis ou Hélie de Vallée, du Val-Tuve, tantôt Adelaïs de Ventadour, et en font autant d'abbesses différentes.
. Nadaud estime que tous ces noms divers désignent la même personne, et il ne se trompe pas : c'est bien une et même Ventadour, mais peu connue. Son nom d'Adelaïs lui venait d'Adélaïde de Montpellier, épouse d'Ebles III en 1146. Volontiers elle renonçait à son nom de famille pour prendre celui de l'endroit qu'elle habitait. Nous verrons bientôt sa parente, Blanche de Ventadour, en faire autant et adopter celui de Dame Blanche de Podiomaris, Puymarais.
Parmi les dix enfants issus du mariage d'Ebles VII avec Blanche de Ghâteauneuf, je trouve une Hélie ; c'est apparemment notre abbesse qui est ici désignée. Dans ce cas, elle avait pour frères et soeurs :
1° Ebles VIII, qui continua la postérité des Ventadour ; 2° Ebles, seigneur de Donzenac, Boussac, Corrèze, époux de Gallienne de Malemort, dame de Donzenac; 3° Hélis, doyen de N.-D. du Puy et évêque de Tournay ; 4° Ramnulphe ou Raymond-Hélis, père de Blanche Ire, XVIIe abbesse de Bonnesaigne, et vicomte de Ventadour (V. Sigill., p. 408) ; 5° Ebles, chanoine de Reims ; 6° Guillaume, religieux en l'abbaye de Saint-Augustin de Limoges, doyen de Carennac, et, après son frère Hélis, évêque de Tournay; 7° Marguerite, épouse de Louis de Beaufort, seigneur de Montferrand, en 1290; 8° Dauphine, mariée à Guillaume de Mercoeur, seigneur de Gerzat; 9° Marie, veuve en 1298 de Jean Salin, seigneur de Châteauneuf.
— 511 —
C'est du temps de cette abbesse qu'on institua, dans l'abbaye, la confrérie de la Sainte Croix, pour promouvoir la piété des religieuses, preuve évidente de celle de leur supérieure.
En 1290, deux ans avant de laisser le pouvoir, Adelaïs eut la consolation de voir le mariage de son frère, Ebles VIII, avec Marguerite de Beaujeu, fille de Louis, seigneur de Montferrand, et de Marguerite de Beaujeu, dame de Bomès ou Beaumez, en Berry.
Le nom de notre abbesse, mais elle ne vivait plus alors, passa à une de ses petites nièces, fille de Bernard, premier comte de Ventadour, à Adélaïde qui, elle aussi, fut abbesse de Fontevrault en 1372.
Ebles VIII mourut jeune, sans enfant, et sa veuve, Marguerite de Beaujeu, épousa son beau-frère Ram-^ nulphe ou Raymond-Hélie de Ventadour, et fut mère de Blanche Ire, abbesse de Bonnesaigne en 1307.
Adelaïs de Val-Tuve se démit ou mourut en 1292, et Alix de Ventadour, sa tante, la remplaça comme abbesse de Bonnesaigne.
I XVI. — ALIX DE VENTADOUR (1292-1307)
Alix de Ventadour était fille du vicomte Ebles VI et de Dauphine de la Tour d'Auvergne, que nous avons dit avoir encore eu de leur mariage : Marie, morte jeune ; Isabeau, épouse d'abord de Faucon de Montgascon (1263), et ensuite de Robert de Montbrun (1276), tant loué par la chronique ae Saint-Martial à cause de sa grande charité pour les pauvres, et enfin Ebles VII, le héros de la huitième Croisade, qui épousa sa parente, Blanche de Châ-
— 512 —
teauneuf, la même année.que Faucon de Mont-gascon obtenait la main d'Isabeau de Ventadour (1263).
Elle était donc tante de la précédente abbesse et belle-soeur de la vicomtesse de Ventadour, Blanche de Ghâteauneuf.
Cette Alix, omise par Bonaventure de Saint-Amable et par M. l'abbé Poulbrière, nous est signalée par l'abbé Bazetou, par la Semaine religieuse et par le chanoine Flamary, de la Garnie, décédé à Tulle et enterré à Nonars sur la fin de décembre 1876 (Voir Sem. relig., lre ann., 5 août 1882, n° 32).
Quand elle arriva au pouvoir, son père était mort dépuis longtemps (1270), mais sa mère vivait encore en 1299, d'après un titre conservé aux archives de l'évêché de Limoges (Notes du chan. Flamary).
En 1307, l'abbesse Alix disparait et fait place à Blanche Irc de Ventadour, sa petite-nièce (M. Ghampeval dit nièce, et ajoute : Alix, -j- vers 1308. Double méprise).
g XVII. — BLANCHE lre DE VENTADOUR (1307-1326)
Blanche Ire était fille de Ramnulphe ou RaymondHélis, frère d'Ebles VIII, vicomte de Ventadour, et de Marguerite de Beaujeu, veuve dudit Ebles VIII (Voir Sigillog. du Bas-Lim., p. 410).
Elle avait pour frères et soeurs :
1° Ebles IX, émancipé par son père en 1312, et marié deux ans après avec Marthe de Comboru, fille de Guischard, seigneur de Treignac et de Chamberet, et de Marie de Ventadour ; leur contrat de mariage est du 20 novembre (1314) et le nom de notre abbesse y
— 513 -
est cité. Ce vicomte fait le pèlerinage de S'-Jacqnes, en Galicie, en 1325 ; en 1325 il vivait encore avec Marthe, son épouse, ainsi que Baluze déclare l'avoir trouvé marqué de la main d'André Duchêne ; mais il mourut avant 1329, ne laissant qu'une fille qui fut Blanche II, abbesse de Bonnesaigne ; et Marthe de Comborn se remaria avec Brun, seigneur de Claviers; 2° Bernard, qui fut vicomte de Ventadour après la mort d'Ebles IX, son frère, et épousa, le 17 mai 1338, Marguerite de Brienne, fille de Robert, vicomte de Beaumont-le-Vicomte, et de Marie de Craon. Nous le retrouverons plus tard fait comte de Ventadour, six ans- avant la bataille de Poitiers ; 3° Hélie, doyen de Notre-Dame du Puy, mort évêque de Castres en 1383 ; 4° Guy, évêque d'Avranches, de Vabres et de Cambrai, mort en 1347 ; 5° Guillaume, religieux à Saint-Martial de Limoges ; 6° autre Guillaume, également religieux à Saint-Martial en 1339 ; 7° Anne, qui venait immédiatement après notre abbesse ; 8" enfin un autre Guy, qui fut le successeur de son frère sur le siège de Cambrai en 1351.
M. Ghampeval nous dit que Blanche acquit quelques terres à Neuvic. Elle mourut le 5 juillet 1326, et sa filleule, Blanche II de Ventadour lui succéda.
§ XV11I. — BLANCHE II DE VENTADOUR (1326-1347)
Blanche II, nièce et filleule de l'abbesse qui précède, était l'unique enfant que le vicomte Ebles IX de Ventadour eut de son mariage, si vite brisé (1314-29), avec Marthe de Comborn, des seigneurs de Treignac.
Elle était par conséquent également nièce de
_. 514 «
Bernard, qui succéda à son frère Ebles IX comme vicomte de Ventadour. Elle prenait quelquefois le nom de Puymarais ou de Bonnesaigne : « De Podiomaris alias Bonnesanhioe ». [
Blanche II devait être bien jeune quand on lui mit en main les rênes du gouvernement, 12 ans au plus.
Sous son règne, les épreuves de toute sorte recommencèrent pour Bonnesaigne. Déjà même, avant son arrivée au pouvoir, il y avait rupture de bonne harmonie entre le roi de France et celui d'Angleterre.
Dès 1324, en effet, le roi de France avait envoyé son frère, Charles de Valois, en Gascogne, pour reconquérir la Guyenne, à la suite d'un méfait commis par les Anglais.
En 1329, ce fut avec restriction mentale qu'Edouard fit foi et hommage, à Philippe de Valois, du duché de Guyenne, Périgord, Limousin et autres terres, selon que le raconte Froissart au premier volume de sa Chronique.
Il y avait dans l'ombre des complots ourdis contre la couronne de France.
En 1340, Philippe fit mettre en mer quatre cents navires de guerre pour aller en Angleterre ; mais les Anglais, avertis à temps, les détruisirent dans le port de l'Ecluse.
Six ans après ce désastre maritime, arriva la défaite de Grécy (1346), et puis la prise de Calais :
« L'an mil trois cens quarante sept
« L'Anglais print Calais, comme on sçait ».
Pendant que nos barons étaient à la guerre, le Limousin était en proie à la peste et à la famine (1340).
— 515 —
Bonnesaigne surtout fut rudement éprouvé ; la misère y régnait.
De quarante-cinq qu'elles étaient sous l'abbesse de Châteauneuf, le nombre des religieuses descendit à quinze sous l'abbesse Blanche II de Ventadour.
Ce fut pour subvenir à leurs besoins que le vicomte Bernard fit, à la communauté, plusieurs donnations en 1338; et en 1345, entre autres privilèges, il permit à l'abbesse, sa nièce, de prendre dans la forêt de Ventadour jusqu'à deux cents charretées de bois.
Cette même abbesse, profitant de l'arrivée de son compatriote de Maumont au suprême pontificat, exposa à Clément VI que la communauté de Bonnesaigne était très pauvre en ce moment et ne se nourrissait que de pain de seigle et de vin excessivement mouillé (Lymphalissimo ou UsilalissimoJ, etc.
Le résultat final de tant de doléances fut que la cure de Darnets fut unie, pour la moitié de ses revenus, à l'abbaye criant misère, ainsi que trois villages de Soudeilles (1343-1345).
Nous dirons, dans un autre chapitre, ce qu'il en advint de cette union de la cure de Darnets; pour le moment, contentons-nous simplement de signaler au passage, à son rang de date, cet acte de la juridiction papale et le désarroi dans lequel se trouvaient les affaires de Bonnesaigne sous l'abbesse Blanche II de Ventadour, qui mourut le 17 avril 1347 (Bonaventure nous dit le septième juin).
Pour consoler un peu.les curés de Darnets de la perte de leur bénéfice, cette abbesse fit, avant de mourir, une fondation de cinq sols de rente annuelle, dans l'église de Darnets, pour l'entretien de la lampe
— 516 —
de la Sainte-Croix. On lit en effet, dans le terrier, que le curé Pierre Blancherie fit faire en latin, le 22 février 1385, ces paroles qui nous apprennent la piété et la dévotion de Mlle de Ventadour :
« Legavit Domina Blanchia de Podiomaris alias Bonnesaiihioe ad opus lampadis S. Crucis 5 sous renduales ».
Ils étaient percevables sur la moitié du manse de Chammas, près Montanias, dans la paroisse de Saint-Hippolyte : « Quos assignavil, in dimidio manso Chammas prope Montanias in parochia S' Ypoliti ».
La lettre de fondation de cette rente annuelle de cinq sous était entre les mains du curé Blancherie lorsqu'il fit faire le terrier de son église par Jean Pile-Roux, afin d'avoir sous la main une liste complète des revenus de sa cure qu'il n'entendait nullement partager avec l'abbesse de Bonnesaigne : De quibus jacet littera sigillata sigilli proedictoe abbatissoe Bonnesanhioe.
Blanche II de Ventadour obtint donc (1345) l'union de la cure de Darnets à son abbaye, mais n'en vit point la consommation ; ce fut Almodie de Saint-Jal, sa remplaçante, qui la vit se réaliser par l'autorité de l'évêque de Limoges. '
g XIX. — ALMODIE DE ROBERT DE SAINT-JAL (1347-49)
Aussi bien que les autres abbesses de ce nom, Almodie était sortie du château de Saint-Jal.
Petite-fille d'Aymard de Robert de Lignerac, seigneur de Saint-Jal et soeur du cardinal Aymard Robert de Saint-Jal, promu en 1342 et mort en 1363
— 517 —
(V. g IV, XII et XX). Notre abbesse était par conséquent nièce de la douzième supérieure de Bonnesaigne dont nous avons déjà parlé.
Quand elle arriva au pouvoir, la communauté de Bonnesaigne ne comptait que quinze religieuses professes. C'étaient :
Dame Almodie de Saint-Jal, abbesse ; dame Almodie d'Agneau (de Agno), et dame Clémentine de Repaire, prieures claustrales ; dame Léoterie de Léones, sacristaine; dame Gallianne de Meaumont; dame Blanche de Gimel ; dame Souveraine (Soberana) ; dame Delphine d'Anglars, future abbesse en 1365 ; dame Marguerite de Meymac ; dame Marguerite de Champieyx; dame Alayde d'Ayrains, future abbesse; dame Guillelme d'Arsala ; dame Marguerite de Confolent; dame Marguerite de Gourson (de Corso, Corso, Coursou, était un village de trente-deux âmes, paroisse de Treignac, siège d'un fief fort ancien à la famille de Coursou ; Bernard 1er, vicomte de Comborn, eut de Hermengarde de Coursou, Archambaud IV, vicomte en 1229) ; et enfin, dame Marguerite de Saint-Denis.
Toutes ces religieuses, éprouvées par la peste et la famine, toujours in exlremà necessitate aussi bien que cinq ans auparavant, convoquées au son de la cloche, se réunirent en chapitre le sept juillet 1348, un an après l'arrivée au pouvoir de la nouvelle abbesse, par devant maître Jean Belger, clerc public du diocèse, par autorité impériale notoire, limousin.
Pourquoi faire? Pour élire des procureurs qui iraient à Limoges solliciter, auprès de l'évèque Jean de Comborn, délégué à cet effet par le pape Clément VI, la fulmination de la Bulle d'union de la cure
T. XXIV. 4-5
— 518 —
de Darnets à l'abbaye de Bonnesaigne. Furent nommés procureurs de la communauté, le vénérable et scientifique personnage, maître Jean de Val, ou Devaux (de Valibus), jurisconsulte; les chéris dans le Christ : D. maître Pierre de Fait (de Failo); D. Pierre de Manaudès ; D. Bernard de Floret, tous prêtres ; et D. Jean Lajugie, damoiseau, de Maussac.
Etaient présents à cet acte, les chéris dans le Christ : D. Pierre de Peyre-Rohan ; D. Jean Dalhon, et D. Jean Dabris, tous prêtres.
Mais comme il n'était pas nécessaire que cette procession de procureurs, la plupart en bottines de bouleau, allât fouler les tapis du puissant évêque de Limoges, les cinq choisis, séance tenante, ainsi que leur en donnait le droit la procuration des religieuses, en subdéléguèrent un d'entre eux pour faire le voyage de la capitale du Limousin.
Ce fut le damoiseau de Maussac, Jean Lajugie, qui fut désigné par ses collègues.
Le jeune damoiseau, fier de la marque de confiance qu'on venait de lui témoigner, se lissa de son mieux et trois jours après sa subdélégation, 10 juillet, il était à Limoges (apud ortum nostroe Dioecesis).
De Maussac dut parler avec éloquence et persuasion, car à mesure qu'il avançait dans l'exposé des motifs qui l'avaient amené auprès de l'évêque, il voyait le prélat incliner vers la teneur de la supplique « inclinans ad sujjplicationem ».
Quand la lecture de la Bulle pontificale et celle de la procuration abbatiale furent terminées, Lajugie s'inclina à son tour, reçut la bénédiction épiscopale, baisa l'anneau, se releva, salua profondément et se
— 519 —
retira dans un coin pour essuyer la sueur qui perlait sur son front. Preuve de sa vaillance!
L'évêque, de son côté, se releva majestueusement de son siège, passa dans son cabinet de travail, et quelques instants après il faisait remettre, par son secrétaire particulier, au damoiseau de Maussac, un pli cacheté aux armes des Comborn, portant l'adresse du chapelain d'Ussel.
Le vénérable Hugues de Chalmels, en effet, était désigné par son évêque pour faire l'évaluation des revenus de l'église de Darnets, afin que le prélat pût, en connaissance de cause, fixer la portion congrue du curé et déterminer la part qui devait revenir aux bénédictines.
Un mois après, les parts de chacun étaient faites, par un arrêté épiscopal délivré au damoiseau de Maussac, à Nobiliac (Noblat, près Saint-Léonard), où le prélat était en tournée pastorale, le 10 août 1348, jour de Saint-Laurent.
Arrêtons-nous là, pour le moment; nous aurons occasion, dans le chapitre VII de cet ouvrage, de revenir avec plus de détails sur cette grave question de l'union de la cure de Saint-Maurice de Darnets à l'abbaye de Bonnesaigne.
Almodie de Saint-Jal ne jouit pas longtemps du fruit de sa victoire, comme abbesse de Bonnesaigne ; l'année d'après (1349), elle était remplacée par Gaillarde-Roberte de Ligneyrac, sa parente. Elle ne mourut pourtant que le 25 juillet 1361, deux ans avant son frère le cardinal Aymard, au moment où les malheurs qu'elle et Blanche II de Ventadour avaient pressentis éclatèrent sur nos montagnes.
— 520 —
g XX. — GAILLARDE ROBERT DE LIGNEYRAC (1349-50)
Elle portait : Ecu d'argent à trois pals d'azur.
Le château de Ligneyrac, entre Meyssac et Turenne, fut le berceau de la famille des Robert de Ligneyrac, ducs de Caylus, dont les armes sont gravées sur les portes des églises de Ligneyrac et de Sarazac, et au château de Noailles.
Cette famille a eu ses illustrations.
En 1249, Guillaume se croisa avec nos seigneurs montagnards : Ebles VI, Guillaume de Chassin seigneur de Fonmartin (?), André de Boisse, seigneur de la Farges, paroisse de Ghamberet, etc. (V. g XII).
En 1260, de concert avec ses frères Hugues et Pierre, il passe un compromis avec son oncle Aymard Robert, sous l'arbitrage d'Archambaud de Comborn, et en 1265, avec le consentement de son frère Hugues, il cède à Raymond de Turenne tout ce qui lui appartient en haute et basse justice à Montignac. C'est en retour de cette cession que les Robert reçoivent le château de Ligneyrac et plusieurs rentes dans les paroisses de Ligneyrac et de Noailhac.
Aymard Robert, dont nous venons de parler, était seigneur de Saint-Jal (entre Uzerche et Seilhac).
Sa fille Gaillarde fut XIIe abbesse de Bonnesaigne ; ses deux petits enfants furent l'un le cardinal Aymard et l'autre la XIXe abbesse de Bonnesaigne dont nous venons de nous occuper.
Jean Robert de Ligneyrac épousa, le 21 août 1377, Bertrande de Cosnac, nièce du cardinal Bertrand de Gosnac et soeur des deux évêques de Tulle, de ce nom.
Edme Robert, maréchal de camp en 1618, cheva-
— 521 —
lier de l'ordre du roi en 1650, était réputé l'un des seigneurs les plus braves de son temps.
Le comte Robert de Ligneyrac, marquis de Caylus, épousa la célèbre Marthe-Marguerite de Villette, née en 1673, cousine de Mme de Maintenon, élève de Saint-Cyr, et c'est pour elle que Racine composa le prologue à'Esther. Mariée à 13 ans, elle laisse des enfants et des Souvenirs, c'est-à-dire des confidences pleines de naïveté et de malice sur l'intérieur de la cour de Louis XIV. Elle mourut en 1729.
Son fils, Anne-Glaude-Philippe de Tubières, comte de Caylus, né à Paris en 1692 et mort en 1765, fut un célèbre archéologue, auteur d'ouvrages remarquables.
Joseph-Louis de Caylus était pair de France en 1814.
Le représentant actuel de cette illustre famille est François-Joseph Robert de Ligneyrac, duc de Caylus, grand d'Espagne de lre classe, né en 1820 et marié en 1851.
Au xvie siècle, François, baron de Ligneyrac, chevalier de l'ordre du roi, capitaine des gardes d'Isabeau d'Autriche femme de Charles IX, devint seigneur de Pleaux, gouverneur d'Aurillac et lieutenant royal de la Haute-Auvergne. Sa race, dès lors, ne cessa de grandir et de s'étendre. Nous la trouvons au château de la Prade, commune d'Arpajon (Cantal), d'où elle revint en Limousin au château de Bazaneix, près Ussel. C'est de là qu'en 1691, 16 mars, partait MarieRoberte de Ligneyrac, pour devenir l'épouse du marquis Louis-Marie de Soudeilles et donner le jour à l'aimable visitandine de Moulins, Louise-Françoise, petite-nièce de la célèbre supérieure Louise-Henriette de Soudeilles, amie intime de la bienheureuse Marie
— 522 —
Alacoque, et son bras droit dans la diffusion du culte au Sacré-Coeur (V. Trois Limousines à la Visitation de Moulins).
Notre abbesse de Bonnesaigne nous venait donc des environs de Meyssac ; elle était, pour le moins, grand'- tante de Jean Robert, époux, en 1377, de Bertrande de Cosnac.
Son séjour, dans nos marais, nous est signalé par les archives de M. Ambroise Tardieu, historiographe de l'Auvergne, qu'a dépouillées M. J.-B. Champeval, à la complaisance duquel nous devons le nom de cette abbesse.
Marguerite Judicis fut sa remplaçante en 1350.
g XXI. — MARGUERITE JUDICIS (1350-1361)
Cette abbesse, jusqu'ici ignorée des historiens de Bonnesaigne, nous est révélée par les recherches infatigables de M. J.-B. Champeval.
Du même nom que Marguerite de la Jugie, troisième abbesse de Bonnesaigne (1182), elle sort assurément de la même source qu'elle, c'est-à-dire des la Jugie d'Eyrein si répandus dans nos montagnes et dans tout le Bas-Limousin, à Brive, Perets, Maussac, Davignac, etc.
Mais descend-elle, comme la troisième abbesse, de Hugues Judicis, seigneur de Maussac et coseigneur de Soudeilles en 1206? Dans ce cas, elle serait soeur de Pierre de Maussac et tante du damoiseau Jean la Jugie, dont nous avons parlé à différentes reprises.
Si elle vient de la maison-mère, c'est-à-dire à'Eyrein, elle serait fille de Jacques la Jugie d'Eyrein
— 523 —
et de Guillaumette Roger, soeur du pape Clément VI (1342-1352), et aurait pour frères Guillaume, fait cardinal en 1342, et Pierre, qui fut archevêque de Sarragosse, de Narbonne et de Rouen en 1375.
M. Champeval la croit originaire de Vars, canton d'Ayen. Dans ce cas, on s'explique que les seigneurs de Vars soient compris au nombre des bienfaiteurs de Bonnesaigne sur la liste incomplète que nous avons déjà donnée (V. chap. III).
Je me demande si cette Marguerite de Juge ou de la Jugie, dont la famille sort d'Eyrein, ne serait pas la même que la religieuse Alayde d'Eyrains que nous venons de trouver à Bonnesaigne dans l'assemblée capitulaire où le damoiseau de Maussac, Jean la Jugie, fut nommé procureur de l'abbyaye pour plaider à Limoges l'union de la cure de Darnets à l'abbaye montagnarde, selon la teneur de la Bulle du pape Clément VI ?
Dans ce cas, nous comprendrions parfaitement pourquoi les procureurs choisis par les religieuses, d'une voix unanime, subdéléguèrent le petit damoiseau de Maussac, son parent, pour faire le voyage de Limoges !
Je me demande encore si notre supérieure ne serait pas la même que la religieuse Marguerite, en religion soeur Saint-Denis, que nous avons vue pareillement figurer dans cette importante réunion du 7 juillet 1348 (V. § XIX).
Quoiqu'il en soit, la famille La Jugie, d'où sortait notre abbesse, portait : « De sable à la bande d'or, accompagnée de six coquilles d'argent posées en orle » (Nobil. Lim., par de Bergues, p. 92).
— 524 —
Simple question : N'y aurait-il pas ici méprise de la part de cet employé des postes, écrivant toujours en courant, et les six coquilles dont il nous parle ne seraient-elles pas les six roses des Roger, comme les décrit le Dictionnaire sigillographique du BasLimousin, p. 674?
C'est sous le supériorat de Marguerite Judicis que les malheurs entrevus par ses trois devancières, Gaillarde Robert de Ligneyrac, Almodie de Saint-Jal et Blanche II de Ventadour fondirent sur nos contrées.
Après la déconfiture de Poitiers (1356), où périrent
glorieusement les chevaliers Guillaume de Bar, Jean
de Maumont, et les écuyers Bernard de Donzenac et
Guy de Bournay, et où se signalèrent Bernard de
Ventadour et Robert, son fils, resté un des derniers
sur le champ de bataille, entouré d'Anglais tombés
sous ses coups, et surtout après le traité de Brétigny
(1360), le Limousin devint, en effet, la proie de nos
perpétuels ennemis, dont :
« La rage inassouvie
« Qui des vaincus poursuit la vie,
« De leurs cités fait un vaste tombeau ».
Les Anglais sont doux dans l'adversité, mais très dangereux dans la prospérité : « Anglica gens est optima flens, sed pessima ridens ! » (V. Annales d'Aquit., par Jean Bouchet, p. 203).
Marguerite Judicis disparait juste au moment où ces insatiables écumeurs du reste du genre humain, semblables à des chacals affamés en recherche d'une proie bonne ou mauvaise à dévorer, parcouraient nos plateaux (1361).
— 525 —
Sa parente, Gaillarde-Roberte Ire La Jugie de Blauge, de Maussac, lui succéda.
g XXII. — GAILLARDE-ROBERTE Ire DE BLAUGE (1361-65)
Elle portait : De sable à la bande d'argent, à cinq étoiles d'or posées en orle.
Cette abbesse était la première fille de Pierre La Jugie, sieur de Blauge ou d'Ublange, seigneur de Maussac, et soeur du damoiseau Jean de La Jugie, que nous venons de voir si bien s'acquitter, auprès de l'évêque de Limoges, de la mission que lui avaient confiée les religieuses bénédictines de Bonnesaigne.
C'était une manière — un peu excessive — de témoigner leur reconnaissance, pour les bienfaits reçus, au petit damoiseau de Maussac, que de choisir cette enfant pour abbesse.
Elle devait être, en effet, bien jeune ; elle ne figuremême pas au nombre des quinze professes dont nous venons de donner les noms, sous la date de 1348.
Bonaventure de Saint-Amable semble nous dire qu'elle naquit en 1347. Elle n'aurait donc eu que quatorze ans lors de son arrivée au pouvoir, ce que nous avons déjà vu et verrons d'autres fois dans cette malheureuse abbaye, dévorée par tant d'intrigues.
Où étaient donc Bernard de Ventadour et Robert, son fils, quand ils abandonnaient ainsi l'antique abbaye à la merci du petit seigneur de Maussac?
Prisonniers en Angleterre, depuis la bataille de Poitiers !
C'est sans doute pour se faire pardonner la jeunesse et l'inexpérience de sa fille dans les affaires, que nous
— 526 —
verrons plus tard Pierre de La Jugie se montrer généreux, — aux dépens des curés de Maussac, — envers sa petite-fille devenue également abbesse de Bonnesaigne.
La jeune abbesse, Gaillarde-Roberte, ne resta que cinq ans au pouvoir.
Elle mourut le 2 juillet 1365 (21 juillet, M. J.-B. Champeval).
Là encore, qui oserait rendre les Ventadour responsables de la nomination de cette enfant comme abbesse de Bonnesaigne ?
Dauphine d'Anglars fut sa remplaçante.
g XXIII. — DELPHINE ou DAUPHINE D'ANGLARS(1365-80)
Les d'Anglars portaient : De sable au lion d'argent, armé, lampassé et couronné de gueules, accompagné de trois étoiles d'argent.
Le château d'Anglars est de la paroisse de SainteMarie-Lapanouse, doyenné de Neuvic, diocèse de Tulle.
Le premier d'Anglars fait son apparition en 1320, comme rendant hommage au vicomte Ebles IX de Ventadour, frère de Bernard, fait comte six ans avant la déconfiture de Poitiers (1356), où il se couvrit de gloire ainsi que son fils Robert, dont nous avons parlé et dont nous parlerons encore.
Le 7 juillet 1407, Astorg d'Anglars épousa Dauphine d'Ussel, et en 1408 Marguerite de Rochedagour.
Il en résulte trois branches :
1° Georges, resté au château familial, qui donna sa fille unique à Claude de Montfaucon, baron d'Alaisu
— 527 —
de Vezenobre. De cette union surgit Jeaulin de Montfaucon, dame d'Anglars et d'Ussel, qui transmit la succession à la famille de Lacroix de Castries, dont une descendante est devenue de nos jours l'épouse du maréchal de Mac-Mahon ; leur fils aîné, soldat d'avenir, a épousé Marguerite d'Orléans, fille du duc de Chartres, l'ancienne fiancée de Philippe d'Orléans, héritier de la couronne de France ; 2° Jean Ier, seigneur de Saint-Victour, qui disparait en 1576 dans la famille de Saint-Nectaire, aujourd'hui remplacée par la famille de Bargue, dont le fils aîné vient d'épouser une des filles du général de Mirihel encore pleuré de l'armée ; 3° Jean II, époux de Françoise de Bassignac, des environs de Mauriac (Cantal).
L'abbesse Delphine d'Anglars nous est déjà connue de nom ; elle était professe à Bonnesaigne lors de la procuration délivrée au damoiseau de Maussac, pour traiter les affaires de la communauté auprès de l'évêque de Limoges.
Elle était fille du châtelain d'Anglars, que nous avons dit avoir fait sa première apparition dans nos annales en 1320, pour hommage rendu au vicomte Ebles IX de Ventadour.
Le rapprochement de la date de la mort de cette abbesse avec celle du mariage d'Astorg, nous porte également à croire qu'elle était tante du châtelain d'Anglars, qui épousa Dauphine d'Ussel en 1407, et en 1408 Marguerite de Rochedagour.
Durant les quinze ans qu'elle passa à la tête de l'abbaye de Bonnesaigne, Delphine d'Anglars vit tour à tour les Anglais et les Français envahir et piller son monastère : « Elle fut malmenée parmi les guerres
— 528 —
des Français et des Anglais » (Bonav. Saint-Amable). C'est ce que nous dirons plus longuement, dans le chapitre des épreuves de Bonnesaigne.
C'est de son temps (1371) que le brave Duguesclin, l'épée de la France, parut sur nos plateaux pour donner la chasse aux forbans du Nord.
Delphine d'Anglars mourut neuf ans après, en 1380. Une autre fille du petit damoiseau de Maussac occupa sa place durant vingt ans : ce fut Gaillarde-Roberte II de Blauge.
g XXIV. — GAILLARDE-ROBERTE II DE BLAUGE (1380-1400)
Gaillarde-Roberte II, petite-fille de Pierre de La Jugie et nièce de Gaillarde-Roberte Ire, pénultième abbesse de Bonnesaigne, était fille du damoiseau Jean La Jugie, de Maussac, dont nous avons si souvent prononcé le nom.
Inutile de raconter ici les maux qui désolèrent sa communauté ; qu'il nous suffise de dire que la guerre était plus acharnée que jamais entre la France et l'Angleterre et que nos bénédictines étaient toujours dans les plus pressants besoins.
La communauté ne comptait plus que seize religieuses.
C'est cette abbesse qui, en 1385, eut de grandes contestations au sujet des revenus de la paroisse de Darnets avec le curé Pierre Blancherie.
Gaillarde-Rorberte II mourut en 1400 et fut remplacée par sa soeur Gaillarde-Roberte III.
— 529 —
- o
gXXV. — GAILLARDE-ROBERTE III DE BLAUGE (1400-34)
Gaillarde-Roberte III était soeur de la précédente abbesse et par conséquent fille du damoiseau Jean La Jugie de Maussac et petite-fille de Pierre, seigneur de Blauge ou d'Ublange, que nous allons retrouver.
Elle était prieure de Villechèze (Veyrières, Cantal), nous dit M. Champeval, quand elle fut choisie pour abbesse de Bonnesaigne.
L'abbaye dont on lui confiait la direction était, par suite de nos guerres interminables, dans le plus pitoyable état. Le nombre des religieuses était descendu de seize au chiffre dérisoire de neuf en 1407.
Gaillarde-Roberte III ne se découragea pas ; sa confiance en Dieu fut au niveau des épreuves terribles par lesquelles passait sa communauté.
Durant son long supériorat de trente-quatre ans, elle fut l'insigne bienfaitrice de son établissement ; et cette abbesse est une des grandes et belles figures qui ont illustré Bonnesaigne : « Elle fit au monastère des biens infinis ».
Son grand-père, Pierre de Maussac, jaloux sans doute de se faire pardonner le scandale qu'il avait donné en imposant à la communauté sa fille pour abbesse, à peine âgée de quatorze ans, se montra toujours, sous sa petite-fille, le grand bienfaiteur de la malheureuse abbaye.
Le prieuré de Maussac (saint Christophe, patron), appartenait déjà à Bonnesaigne, mais non l'église.
Le 10 avril 1402, Pierre de Maussac y fonda, en cette église paroissiale, une vicairie à l'autel de SainteCroix.
— 530' —
Puis, en 1406, il donna, aux dépens des curés de Maussac, cette même église, mais non la vicairie de Sainte-Croix, à sa petite-fille dont nous parlons, abbesse de Bonnesaigne depuis six ans.
Cette cure de Maussac avait 280 habitants et payait 30 livres. Les abbesses y nommèrent en 1506, 15, 16, 58, 71, 87, 1619, 70, 74 et 1713, comme prieures de Maussac. L'évêque de Limoges y nomma aussi en 1713, ce qui prouve qu'il y avait conflit entre les deux autorités, chose fréquente à cetle époque.
Pour la vicairie de Sainte-Croix, Pierre de Maussac, et plus tard ses successeurs, devait y nommer dans le mois de la vacance ; ce temps passé, le curé conférait.
Cette vicairie fut unie à la cure, le 5 février 1430, par noble Jeanne de Quintena, nièce du fondateur.
Noble Jean de La Jugie, sieur de Teilhac, paroisse de Pérets, damoiseau, y nomma à cette vicairie en 1454, 1474 et 1492.
Gaillarde-Roberte III, avons-nous dit, est comptée au nombre des très bonnes abbesses de Bonnesaigne ; elle releva son abbaye et fit refaire la tour du clocher ; c'est elle encore qui fit unir à sa communauté le manse et le prieuré de Menoire.
Durant les jours terribles de l'épreuve, GaillardeRoberte entendit gémir ses religieuses et vit couler leurs larmes amères, en apprenant Azincourt, où Jacques de Ventadour, fils du vaillant Robert, fut fait prisonnier; Verneuil, où périt glorieusement Guy de Ventadour, à côté de Louis de Soudeilles qui reçut son dernier soupir. Mais aussi, elle entendit éclater leurs chants de joie et vit couler leurs larmes de
— 531 —
bonheur quand elles apprirent que nos montagnes n'avaient plus à craindre d'être écumées par l'anglais rapace et que la France en était enfin purgée en majeure partie.
Gaillarde-Roberte III est, en effet, contemporaine de la glorieuse mission de la vénérable Jeanne d'Arc, que les chevaliers limousins secondèrent si bien, surtout Guillaume de Brosse, qui combattit constam-; ment aux côtés de la providentielle libératrice delà France.
Elle mourut le 4 août 1434, trois ans après notre grande héroïne, laissant le pouvoir à une Auvergnate, Dauphine de Chabannes.
g XXVI. — DAUPHINE DE CHABANNES (1434-1469)
Cette abbesse est de la même famille que Marthe et Etiennette que nous connaissons déjà (1263-1276), et que Catherine que nous trouverons plus tard à la tête de l'abbaye de Bonnesaigne (1556).
Dauphine était fille de Robert, seigneur de Charlus, tué à la funeste bataille d'Azincourt (1415), et d'Alix de Bort de Pierrefite (V. Dicl. des Paroisses : Combressol).
Elle avait cinq frères : 1° Etienne, capitaine d'une compagnie de gens d'armes, tué au combat de Crevant-l'an 1423 ; 2° Jacques, qui continua la famille de Chabannes. 11 fut sénéchal de Toulouse et prit part à toutes les grandes expéditions de son temps. Il se trouva au combat de Rouvray en 1429, à la- prise de Compiègne, 1430, etc. ; en 1440, lors de la Praguerie, il prit le parti du Dauphin, servit au siège de Gaeii en
— 532 —
1450, et quelques temps après il fut pourvu de la charge de Grand-Maître, traita de la capitulation de Blaye, contribua à la réduction de Bayonne, et ayant été blessé à la bataille de Castillon, le 17 juillet 1453, il mourut de sa blessure le 20 octobre suivant. Il avait été marié deux fois : la première fois avec Anne de Launay, morte sans enfants; et la seconde fois avec Anne de Lanjeu, dont il eut Geoffroy et Gilbert, sieur de Curton, qui fut gouverneur du Limousin ; 3° Antoine, le premier comte de Dammartin en 1411, fait prisonnier à la bataille de Verneuil (1424); 4° Jean, marquis de Curton et de la Palice, qui épousa Péronnelle de Ventadour, fille du vaillant Robert et de Isabeau de Vendat, issue d'Oudin et d'Alix du Breuil, de la maison de Courcelles (V. Moreri, t. II, Chabannes) ; 5° enfin, Jeanne, qui épousa Jean Balzac, seigneur d'Entragues.
On le voit, notre abbesse n'avait pas à rougir de ses frères ni de ses neveux. Elle était bien étayée pour relever sa communauté. Le lit-elle? L'histoire nous dira bientôt qu'elle ne put même guère y songer.
Elle fut bénite, comme abbesse, le 10 janvier 1434, et semble avoir aimé Bonnesaigne. L'année suivante, en effet, elle fut titrée du monastère de Fare-Moutier, en Brie, diocèse de Meaux, et renonça généreusement à ce titre pour garder celui de Bonnesaigne (1435). Plus tard, elle revint pourtant sur sa détermination et accepta d'être- nommée abbesse conjointement de Fare-Moutier et s'occupa de son gouvernement. Bien plus, d'après Nadaud, elle y alla comme abbesse, en 1454, mais non sans espoir de retour dans nos montagnes.
— 533 —
Nous connaissons, en partie du moins, les religieuses qui se sanctifièrent, à Bonnesaigne, sous l'administration de Dauphine de Chabannes. Voici quelques noms :
1° Jacquette et Florence de Valon de Champiers de Boscheyrono, c'est-à-dire du Boucheron de Davignac. Elles étaient filles de Guérin de Valon de Champiers et de Philippie Mourina (Mourin), mariés le 24 février 1399 (1).
Nos deux bénédictines avaient dix frères ou soeurs : Geneviève, qui épousa Jean Ier de Loubertès, seigneur de Lascaux (Meymac), fils de Guillaume et de Marie Malengua; Catherine, religieuse à l'abbaye de la Règle; Louis, religieux au monastère de Saint-Angel;
(1) La famille de Valon, d'ancienne chevalerie du Quercy où elle est connue dès le xc siècle, a possédé dans cette province les seigneuries de Lavergne-Valon, Thégra, Gigôuzac, Saint-Amaran, etc. Au xvc siècle, elle eut un accroissement en Limousin, où des donations et mariages lui portèrent les seigneuries du Boucheron, de Champiers, d'Ambrugeac et de Saint-Hippolyte, et pendant qu'elle s'est continuée d'une part en Quercy par la branche de Gigôuzac, Saint-Amaran, elle s'est établie d'autre part en Limousin par la branche dite de Boucheron, d'Ambrugeac et Saint-Hippolyte de la manière suivante :
Bernard Estienne de Valon, coseigneur de Gigôuzac, avait épousé, vers 1373, Florence de Neuvic de Champiers ; leur fils Guérin se maria en février 1399 (vieux style) avec Philippie Mourina, fille de feu Guillaume Mourini, et reçut à la même date de Maragde d'Ussel la donation du lieu del Boschayro avec charge de porter, lui et ses successeurs, les noms et armes des « hostels de Champiers et dal Boscheyro ». Vers la même époque, Guérin fut aussi héritier testamentaire de Guillaume de Neuvic, seigneur de Champiers, son grand-père, et se fixa dès lors en Limousin. — Rigon de Champiers, seigneur du Boucheron, mort sans postérité, avait fait héritier Maragde d'Ussel, sa femme ; et Rigon tenait lui-même la seigneurie du Boucheron de son aïeul, Hèble de Champiers, qui l'avait acquise en 1315 du vicomte de Ventadour.
T. XXIV. 4-6
— 534 —
Marguerite, Jeanne, Jean, Agnet et Jacques qui suit.
Jacques de Valon de Champiers épousa, le 3 avril 1453, Huguette de Beyneta, fille et héritière de Hugues de Beynette, seigneur d'Ambrugeac (près Meymac), et de Marguerite de Saint-Hippolyte, à la condition de prendre le nom et les armes d'Ambrugeac et Saint-Hippolyte. De ce mariage naquirent deux fils : Bertrand, auteur des Valon du Limousin, et Pierre, héritier universel de son père, auteur des Valon restés en Quercy (1).
Le 23 décembre 1441, Jacquetle reçut de sa mère un legs de dix septiers de vin, et Florence cinq sols, qui furent remplacés en 1445 par un legs de cinquante sols.
2° Philippie de Loubertès, qui prit l'habit à Bonnesaigne et fut abbesse de Fontgauffier en 1451. Elle avait pour frères Jean Ier, époux de Geneviève de Champiers dont nous venons de parler, et le premier des quatre Loubertès qui furent abbés de Meymac. Elle eut pour remplaçante à Fontgauffier (Sarlat) sa propre nièce, du nom d'Agnès, fille de Jean Ier et de Geneviève de Champiers. Cette dernière abbesse avait pour soeur Philippie, mariée à Jean d'Anglars, seigneur de Saint-Victour, et pour frère Jean II de Loubertès, qui épousa Gilberte de la la Roche-Aimon, morte en 1520, ne laissant qu'une fille d'abord religieuse à Bonnesaigne et ensuite mariée.
3° Anne-Catherine de Maumont, que nous allons
(1) Cette famille est encore représentée de nos jours par les Valon de la Corrèze et du Lot.
— 535 —
retrouver abbesse de Bonnesaigne pour quelques mois.
4° Dans une quittance de février 1454 (ancien style), délivrée par l'abbesse Dauphine de Chabannes à Bertrand de Bonnefond, curé de Darnets, à la suite d'un long procès que nous rapporterons au chapitre : Procès des abbesses avec les curés de Darnets, nous trouvons quelques autres noms de religieuses de Bonnesaigne ; ce sont :
Marie d'Ambrugeac ; Marguerite et Huguette de la Forssa ; Marie et Marguerite de Maumont, et Catherine de la Ghapoulie, formant la partie la plus considérable de la communauté, stipulant pour elles et pour celles qui viendront après elles, autant que cela pouvait les concerner.
Cet acte passé dans l'abbaye par Alpaix, notaire royal à Meymac, porte les signatures des témoins : messire Pierre de la Bardèche, de Darnets, et Jean de la Guinhari, prêtre, du lieu de Bonnesaigne. Il est contresigné aussi du seing manuel du notaire Dayrat (ou Cheyrat), clerc du diocèse de Limoges.
C'est à l'aimable complaisance de M. le baron Paul d'Ussel, commandant démissionnaire, le brillant correspondant des Bulletins de Brive et Tulle, que je dois la communication de cette pièce intéressante, et il la fait suivre des notes suivantes, que je suis heureux de reproduire ici :
« 1° Marie d'Ambrugeac doit être fille ou soeur de Hugues de Beynette, époux de Marguerite de Saint-Hippolyte seigneur d'Ambrugeac (Voir plus haut).
« 2° La famille de Forssa est une branche cadette
— 536 —
de la famille de Chabannes (Nadaud, Nobil. Lim., t. I, p. 645). La Force est un lieu près de SaintExupéry, qui du reste a disparu, tout au moins, de la carte de l'état-major. Le fondateur de cette branche est Ebles de Chabannes, damoiseau, seigneur de la Force, fils de Ebles II de Chabannes, coseigneur de Gharlus-le-Pailloux et seigneur de la Force, lequel vivait en 1215 et en 1255.
« Cet Ebles de Chabannes de la Force, damoiseau, eut pour fils Pierre de Chabannes de la Force, chevalier, lequel n'eut qu'une fille, Marguerite, qui épousa avant 1374 Georges de Sartiges, et cette branche de la Force s'éteignit ainsi. Ces renseignements de Nadaud ne sont pas exacts en ce dernier point, car dans une pièce du chartier de ma famille (cotée XIV-60) du 12 juillet 1391, j'ai trouvé un Ebles de Chabannes, alias de la Forssa, fils de feu Ebles de la Forssa qui vend tous ses biens à Aymon de Rochefort.
« 3° Le chroniqueur Geoffroy, prieur de Vigeois, prétend (p. 128 de la traduction de Bonnélye) que le fondateur de cette famille est un paysan du village de Maumont qui, par une gasconnade, sut flatter l'amour-propre de son seigneur Ebles de Ventadour, dont il attira l'attention. Ce paysan, ayant par la suite donné des preuves plus sérieuses de son mérite, devint chevalier. Le prieur de Vigeois plaisante un peu les prétentions nobiliaires exagérées qu'à son époque montrait cette famille. En réalité elle a rendu de grands et longs services, et la vanité d'un de ses premiers membres est un petit péché bien humain.
« 4° On ne trouve point dans Nadaud de notes sur la famille de la Chapoulie; dans la charte (XIV-56)
— 537 —
du 27 novembre 1359 du chartrier de ma famille, je trouve le renseignement suivant : Etienne de la Chapoulie épouse Marguerite de Bony. Ils sont morts tous les deux en 1356, laissant :
« 1° Guillemine de la Chapoulie, épouse de Bernard de Gimel ;
« 2° Etienne de la Chapoulie, qui épouse Claire de Champiers de Neuvic, laquelle, devenue veuve, épousa Géraud de Rochefort, seigneur de Saint-Martial-leVieux (paroisse du canton de la Courtine, Creuse) ».
Qu'il me soit permis d'ajouter à ces précieux renseignements deux mots seulement sur les Chapoulie :
1° Darnets avait sous cette date le fief noble de Chapoulier dont parle Nadaud (Nobil., I, 432). Sous la date du 26 février 1554, nous trouvons aux archives de Darnets nobles Mondon (Raymond) et Jean du Chapoulier (V. Trois Prieurés Limousins, Bulletin de Tulle, 4e liv., 1902);
2° A Cornil, il y avait le fief de la Chapoulie, dont Jacques de Bar était seigneur en 1685 (V. Dict. Sigill., p. 69).
Ce sont toutes ces saintes religieuses que nous verrons plus tard chassées plusieurs fois de leur communauté.
En 1450, Dauphine eut la consolation d'apprendre que la France était entièrement délivrée de ses terribles oppresseurs.
Trois ans après (1453), son abbaye fut rudement éprouvée par une bande de voleurs, marchant sous les ordres d'un insigne brigand, du nom de Rigaud, qui assaillit et pilla Bonnesaigne.
Dauphine de Chabannes, après un règne de trente-
— 538 —
cinq ans, mourut à Bonnesaigne le 29 mai 1469; la Semaine religieuse dit le 24 mars, et M. Champeval le 24 mai, d'après M. Longy.
A la mort de la vieille abbesse, le champ resta libre aux compétitions, et nos religieuses bénédictines, influencées par le dehors, furent loin de s'entendre pour élire une supérieure. Ce fut Anne-Catherine de Maumont, mais elle ne put prévaloir contre sa concurrente et l'obstination des soeurs que nous connaissons en partie.
THOMAS BOURNEIX. (A suivre).
(Suite)
§ XXVII. — ANNE-CATHERINE DE MAUMONT (1469-70)
Les Maumont portaient : « D'azur au sautoir d'or cantonné de 4 tours d'argent maçonnées de sable y ; et notre abbesse, d'après Bonaventure de SaintÀmable : « D'azur à la croix alaisée d'or ».
Voilà déjà cinq fois qu'au cours de cet ouvrage nous trouvons à Bonriesaigne des demoiselles de Maumont : Gallienne, en 1348; Marie et Marguerite, en 1454; Blanche, prieure de Villevaleix, en 1470, et Anne-Catherine., qui nous'occupe., en 1469.
D'où venait cette famille? De la terre de ce nom, paroisse de Rosiers-d'Egletons.
Au xne siècle, Maumont ou Malmont, nom qui signifie mauvaise montagne (malus monsj, était un fief de Ventadour. Le petit seigneur qui le tenait portait le nom de cette terre, qu'il jouissait moyennant la redevance à'une tonne de cire vierge, qu'il portait tous les ans à son puissant suzerain, le jour de la fête patronale du Moustier-Ventadour (29 juin).
Avant même l'aventure qui lui valut l'émancipation de sa terre et pour ses enfants le ceinturon de milice, le vassal des Ventadour s'était acquis une T. xxv. i — 2
— 22 —
réputation dans l'histoire et s'était élevé au-dessus de la plèbe.
Suivant la Chronique Normande, Guy de Maumont était contemporain de Philippe Ier, roi de France (1060-1108). (Bibliot. Niel, curé de Naves).
Son fils Jean donna le jour à un croisé, du nom de Hugues, qui à la voix d'Urbain II partit pour la Terre-Sainte (1096), à côté du vieux Raymond comte de Toulouse, de Golfier de Lastour, le héros de Marrah, de Jérusalem et d'Antioche, de Raymond Ier de Turenne, etc., tandis que les Ventadour brillaient, à cette première Croisade, par leur absence, Ebles Ie'' étant trop vieux (f 1096) et Ebles II, le futur chanteur, trop jeune pour s'armer ; ce dernier ne devait le faire qu'en 1145, avec son fils Ebles III.
Avant cette date avait eu lieu la curieuse aventure dont parle le prieur de Vigeois, aventure qui eut pour résultat d'anoblir le manant, le jiaysan de Maumont, d'élever ses enfants au rang de chevaliers, et leur valut le manse de Maumont affranchi de tout cens (1).
(1) Voici le récit de Geoffroy de Vigeois :
(i Ebles (II de Ventadour), frère de Pierre de Pierre-Buffière, par sa mère Almode, était renommé par ses gracieuses cantilènes, et ce talent lui valait la faveur de Guillaume IX (de Poitiers), fils de Guy. Toutefois ils étaient rivaux, et cherchaient à se surpasser en courtoisie.
« Un jour, Ebles de Ventadour vint à Poitiers et se présenta au château du comte Guillaume pendant que celui-ci était à table. Le comte de Poitiers fit servir à son hôte un repas somptueux, mais dont les apprêts furent lents. Lorsqu'il se leva de table, Ebles lui dit : ce n'est pas la peine qu'un comte comme vous fasse tant de dépenses pour recevoir un si petit vicomte que moi.
« Au bout de quelques jours, Ebles retourne dans ses terres ; le
— 23 —
Mais alors, comment appeler paysan, manant, vilain, un brave croisé qui a cent fois affronté la mort dans les champs de la Palestine? La réponse est facile : il est évident que tous ceux qui partirent pour les Croisades ne sortaient pas des premiers rangs de la société, pas plus que de nos jours tous les soldats qui ont combattu sur les bords du Rhin et sur les rives de la Loire, à Forbach, à Patay et au Mans, ne sortent de la noblesse. Les enfants de la bourgeoisie et du peuple accompagnèrent leurs seigneurs ou bien s'enrôlèrent sous les bannières d'autres barons de la contrée. Mais ils eurent beau trimer, s'élever audessus de la plèbe, tant qu'ils n'eurent point le ceinduc
ceinduc suit de près, accompagné de cent chevaliers, et arrive à l'improviste à Ventadour au moment où le vicomte était à table.
« Ebles, se voyant joué, fait promptement donner à laver. En attendant, ses serviteurs courent la châtellenie, enlèvent toutes les viandes qu'ils y trouvent et. les portent promptement à la cuisine. Heureuse- • ment c'était un jour de fête, les poules, les oies et la volaille abondaient à Ventadour. Ils préparent un dîner si splendidf, qu'on aurait dit les noces de quelque grand seigneur.
« Sur le soir, un paysan, à l'insu du vicomte, entre dans la cour du château, conduisant un char traîné par des boeufs : Serviteurs du comte de Poitiers, s'écria-t-il, approchez tous, et voyez comment se livre la cire à la cour du seigneur de "Ventadour. Puis, saisissant une doloire de charpentier, il brise les arceaux de sa voiture et d'une grande tonne défoncée s'échappent et tombent à terre d'innombrables gâteaux de la cire la plus pure.
« Le vilain les laisse négligemment à terre et s'en retourne avec son char au village de Maumont. Le comte de Poitiers, étonné de tant de profusion, fit en tout lieu l'éloge de la générosité et de l'adresse du vicomte de Ventadour.
« Ebles récompensa ce paysan et lui donna, ainsi qu'à ses enfants, le domaine de Maumont. 11 les éleva au rang de chevaliers, et aujourd'hui (vers 1183-85) ils se disent les neveux d'Archambaud de Solignac et d'Alboin, archidiacre de Limoges ».
(Traduction Bonnélye, p. 127-8. — Histoire littéraire de Finance T. XIV, p. 343).
— 24 — '
turon de milice, les usages du temps voulaient qu'ils sentissent toujours la vassalité et fussent réputés d'un rang inférieur.
Et puis, à cette époque, les expressions vilain, manant, paysan, n'avaient point le sens injurieux que nous leur attachons aujourd'hui. . Le nom de vilains (villani) désignait les hommes libres devenus tenants de fiefs, ou ceux qui étaient tombés en servage. Ils étaient toujours les serfs du seigneur ; mais cette servitude différait de la glèbe, et consistait uniquement à payer aux seigneurs certaines redevances annuelles et à fournir certaines corvées. (Marvaud, T. II, p. 167).
Pas plus que celle de vilain, l'expression manant n'avait rien d'injurieux ni de blessant pour la' classe d'hommes auxquels on l'appliquait. On trouve en effet, dit Combet, dans les ordonnances royales de ces temps et des temps subséquents, ces expressions : « Nos chers et bien aimés les Manans et habitants de notre ville d'Uzerche au Bas-Pays Limousin ». Et il continue : « L'acception moderne du mot manant s'explique par le discrédit où tombèrent les bourgeois qui transportèrent leur domicile à la campagne, et par le mépris avec lequel certains seigneurs affectèrent de les traiter. Manants, habitants, bourgeois, sont des termes dont la signification est à peu près la même ; la différence consiste en ce que les bourgeois étaient des hommes qui payaient une rente au seigneur pour avoir le droit de posséder un héritage dans l'intérieur d'une ville, tandis que le manant était celui qui habitait un village ou un bourg sous la même condition » (Hist. d'Uzerche, p. 129).
— 25 _
De même le mot Paysan; il voulait simplement dire en lui-même : habitant les collines ou le bord des eaux. C'est là sa vraie signification, soit qu'on le fasse dériver du latin pagus ou du grec Ttayo; ou Tr/m, colline, source, fontaine, habitant les hauteurs. L'habitude est, en effet, de fixer les habitations sur les hauteurs ou près des eaux. Le chroniqueur de Vigeois veut donc simplement dire habitant de la campagne.
Et puis, au Moyen-âge, Paysan voulait uniquement dire homme qui supporte des charges de l'Etat, qui paye certaine taille et fait quelque corvée ; ce nom n'avait nullement la signification désavantageuse qu'on veut bien lui assigner quelquefois de nos jours : « C'est un paysan. » (V. Bescherelle).
Nous le répétons : le vilain, le manant, le paysan de Maumont en était là. Il jouissait les terres de ce village moyennant une redevance au vicomte son voisin, et tout nous porte à croire que la cire répandue avec tant de profusion le long de la cour du château de Ventadour faisait partie de l'annuité que Maumont payait au suzerain de nos montagnes. Il paraît même, d'après certains auteurs, que c'était là toute sa redevance ; la cire vierge était alors d'une extrême rareté et d'un prix fort élevé. (Bibliothèque de l'abbé Niel).
Le paysan, devenu seigneur de Maumont, avait pour enfants se disant ce neveux d'Archambaud de Solignac, et d'Alboin, archidiacre de Limoges » : . 1° Hugues, qui entra en religion et remplaça même son oncle, Archambaud de Solignac. Il ne fut pourtant pas son successeur immédiat ; ce- ne fut que quinze ans après qu'il fut élevé à la dignité abba-
— 26 —
tiale, en 1194, et sept ans après il rendait son âme à Dieu (Abbé Niel).
2° Guillaume, qui en même temps que son frère Hugues gouvernait l'abbaye de Solignac, était chanoine de Limoges. Il se trouve à Grandmont, en 1221, le jour de la prise d'habit du vicomte Ebles V de Ventadour, et signe l'acte officiel avec Marie de Turenne, épouse du vicomte bénédictin, et avec Raymond et Ebles, leurs enfants, qui avaient voulu accompagner l'une son époux et les autres leur père jusqu'à l'autel du sacrifice des grandeurs de ce monde (Geoff. de Vig., p. 148; Marvaud, T. II, p. 95-97).
Ce Guillaume est compté au nombre des bienfaiteurs du monastère de Meymac.
3° Pierre Pr, chevalier, qui fait également des donations à Meymac, dans le xne siècle.
A partir de Pierre Ier de Maumont, nous avons la généalogie de sa famille. Voici comment l'établit M. l'ingénieur de Fontanges, dans sa Notice historique sur la seigneurie et le château de Maumont (1887):
1° Pierre Ier eut Guillaume de Maumont, qui fut curé de Rosiers et d'Egletons en 1273, et Pierre II qui suit ;
2° Pierre II, qualifié damoiseau en 1275, et en 1307 chevalier, seigneur de Maumont, épousa Marguerite de Gimel, qu'un titre de 1301 appelle Peyronne. Elle lui apporta la seigneurie du château supérieur de Gimel. Entre autres enfants, ils eurent Bertrand Ier qui suit;
3° Bertrand Ier, par son mariage avec Adélaïde de Châteauneuf, devint seigneur et baron de S1-Vit, près de la Croisille (Haute-Vienne), de Saint-Germain-
— 27 —
les-Belles-Filles, de Châteauneuf, tout en restant seigneur en partie du château supérieur de Gimel et de Maumont de Rosiers. Ils eurent : Gobert, non marié ; Isabeau, femme de Hugues de la Roche ; Dauphine, mariée à Pierre de Mallevai, et Pierre III, qui continua la famille.
4° Pierre III, seigneur en partie de Maumont, de Gimel, de Châteauneuf, de Saint-Vit, de TournoëL épousa Anne, fille de Renaud d'Aubusson, seigneur de la Borne, de Monteil-le-Vicomte, vicomte de la Feuillade. Ils eurent trois enfants : Bertrand II, auteur de la branche de Fromental, que nous allons retrouver à la tête de la famille de Maumont; Pierre IV, coseigneur de Maumont et de Gimel, qui prit le titre de damoiseau et se disait majeur de 14 ans et mineur de 25 dans le contrat de mariage de sa soeur avec Elie de Noailles, en 1349 ; il épousa Louise, fille de Robert Dauphin d'Auvergne, seigneur de Jaligny, et d'Isabeau de Chastel-Perron, dont il ne paraît pas avoir eu d'enfants; et, enfin, Jean Ier qui suit.
5° Jean Ier, aîné, seigneur en partie de Maumont et de Gimel, seigneur de Saint-Vit, épousa, le 6 juin 1345, Marie, fille de Faure {Fabri) d'Egletons. Ce mariage fut accordé par Guillaume II Roger, vicomte de Beaufort, frère du pape montagnard, Clément VI ; la dot de Marie Fabri était de mille florins d'or, assurée sur la seigneurie de Bellovidère. L'année suivante, Guillaume II Roger épousa Guérine de Canillac (Auvergne), fille unique de Marc de Ganillac, et se trouva par ce mariage seigneur de la baronnie de Canillac.
Du mariage de Jean Ier de Maumont avec l'Egleton-
— 28 —
naise naquit Bertrand' III qui suit. Jean Ier fut tué à la bataille de Poitiers (1356) et enterré dans l'église des Frères-Mineurs de cette ville (V. Annales d'Aquitaine).
6° Bertrand III épousa, le 4 septembre 1377,, Hélis, fille de Jean de Bonneval et d'Alix de Brème, et eut Antoine qui suit.
. 7° Antoine de Maumont n'eut que des filles de son mariage, et la seigneurie de Maumont échut à Bertrand II, auteur de la branche de Fromental, fils de Pierre III et d'Anne d'Aubusson.
8° Bertrand II de Fromental, coseigneur de Maumont, de Gimel et de la Roche (château du bourg de Saint-Vit), capitaine de Fleix, avait épousé une fille de Guy de Saint-Martial, soeur de Pierre, archevêque de Toulouse. De ce mariage naquirent : Bertrand, évèque de Mirepoix, présent en 1398 au contrat de mariage de sa nièce Catherine de Maulmont avec Jean de Monceaux, et Jean II qui suit.
9° Jean //épousa, en 1372, Hélène d'Aigrefeuille, fille d'Àymard et soeur de Guillaume II d'Aigrefeuille, cardinal de l'Eglise Romaine en 1366. De ce mariage naquirent : Bertrand, évêque de Tulle, mort en 1425 ; Hugues, qui fut abbé de la Chaise-Dieu ; Géraud, abbé de Saint-Pierre d'Uzerche ; Catherine, mariée en 1398 à Jean de Monceaux, seigneur d'Escorailles, dont le contrat de mariage fut passé en présence de l'évêque de Mirepoix, oncle de la mariée (V. ci-avant), et enfin, Nicolas qui suit.
10" Nicolas, seigneur de Maulmont, Saint-Quentin, Fromental, Saint-Léger, Saint-Martial de Gibanel, cité dans les hommages de 1414, 16, 19 et 1437,
— 29 —
épousa en 1415 Catherine, fille de Jean d'Aubusson, seigneur de la Borne et de Monteil-le-Vicomte, et de Guyonne de Monteruc. Ils eurent Pierre V qui suit.
11° Pierre V, seigneur de Maumont, Laterie, Chadeau, la Bastide, épousa en 1435 Catherine Joubert, fille du seigneur de la Bastide, et dès lors l'écusson des Maumont fut chargé des armes des Joubert : « D'azur fascé d'or à 3 fleurs de lys de même, 2 en chef et 1 en pointe ».
Ce sont les écussons qui dominaient, comme clefs de voûte, dans l'ancienne chapelle de Maumont, avec les armes de l'épouse de Charles de Maumont : « D'or à deux membres (ou pattes de griffon, d'autres disent de faucon,) arrachés de gueules surperposés et armés de sable (ou d'azur) », époux d'Anne de Bourdeilles, fille de François et d'Hilaire du Fou. Il était seigneur de Maumont, Fromental etVillars, baron de la RocheLimosy, et vicomte de Bridiers ; il mourut en 1526.
Pierre V eut de son mariage : Anne-Catherine qui nous occupe et Bertrand III. Tandis que ce dernier, seigneur de Maulmont, de Fromental, Saint-Quentin, Saint-Léger, Magnac et en partie de la vicomte de Bridiers, continua la famille de Maumont en épousant Jeanne, fille de Léger, baron de la Roche et de Magnac, qui lui donna Gilles, marié en 1492 à Françoise de Culant, fille de Louis, seigneur de Culant et de Saint-Désiré, conseiller, chambellan du roi, gouverneur du Berry, et de Michelle de Chauvigny, revenons à l'abbaye de Bonnesaigne, au moment du trépas de Dauphine de Chabannes.
A la mort de cette abbesse (29 mai 1469), les religieuses de l'abbaye montagnarde furent loin de s'en-
— 30 —
tendre pour lui donner une remplaçante. La majorité des suffrages se porta immédiatement sur Blanche de Gimel, religieuse à Notre-Dame de la Règle de Limoges, et la minorité sur Anne-Catherine de Maumont, et ce fut elle qui triompha pour quelques mois. Le pape Paul II, lui-même, pour des raisons que nous ne connaissons pas, fut du côté de la minorité, et par un bref du 29 janvier confirma l'élection d'AnneCatherine de Maumont.
De là les mésintelligences.
Finalement, après une année de lutte, Anne-Catherine de Maumont fit preuve d'intelligence et de vertu : elle céda son titre d'abbesse de Bonnesaigne moyennant 40 écus d'or de pension et l'obtention d'un bénéfice égal à celui qu'elle délaissait. Ces deux conditions furent acceptées : elle fut faite abbesse de la Règle d'où venait sa concurrente, et où elle eut pour remplaçante sa propre nièce, Catherine de Maumont, fille de Bertrand III et de Jeanne de Léger ; et le calme se rétablit, au moins en apparence pour un temps, dans la remuante abbaye de Bonnesaigne.
Encore une fois, pas plus dans ces compétitions abbatiales que dans les questions de pitance et de jeunesse qui agitèrent les têtes du couvent de Bonnesaigne, nous ne voyons les Ventadour impliqués. Le champ reste libre aux intrigues des familles secondaires de Chabannes, de Maussac, de Maumont et de Gimel, causes jusqu'ici des émotions plus ou moins répréhensibles qui faisaient vibrer les imaginations de nos bénédictines derrière leurs murailles austères. Nous allons établir bientôt que ce sont toujours ces mêmes familles unies par le sang, et jamais les
— 31 —
Ventadour, qui furent les promotrices des désordres plus graves encore que nous aurons à déplorer dans l'abbaye de Bonnesaigne : cuique suum !
Arrivons maintenant à l'heureuse concurrente d'Anne-Catherine de Maumont, et disons si Blanche de Gimel, qui fit pourtant du bien à son abbaye, futune abbesse politique.
§ XXVIII. — BLANCHE DE GIMEL (1470-1504)
Gimel porte : Bourrelé d'argent et d'azur à la bande de gueules brochant sur le tout.
Lorsque la majorité des suffrages exprimés par les Bénédictines de Bonnesaigne l'appela à régir cette abbaye, en 1469, Blanche de Gimel, âgée seulement de 26 ans, était déjà professe en l'abbaye de la Règle.
Et lorsque sa concurrente, Anne de Maumont, élue par la minorité et confirmée par bref du pape Paul II (29 janvier 1470), eut consenti à se désister moyennant les compensations que nous avons dites, Blanche de Gimel fut confirmée abbesse de Bonnesaigne.
Elle prit possession de son abbaye, en vertu d'un bref apostolique donné le 29 août 1470.
« Blanche fut élue, mais elle ne fut pas pacifique » (Bonaventure de Saint-Amable, T. III, p. 461).
« Blanche de Gimel fut installée, l'année suivante, par l'abbé de Bonnaigue, qui avait reçu les bulles apostoliques et qui lui tenait une main, et par Pierre de Ventadour qui lui tenait l'autre, en qualité de fondateur et de représentant du vicomte (lisez comte) son père » (Dict. des Paroisses, T. I, p. 370).
Les historiens nous disent communément que, ce
— 32 —•
jour-là, « l'autorité des Ventadour se montra surtout abusive, en prenant ainsi part à la nomination et à la mise en possession de l'abbesse Blanche de Gimel ».
Ici, avant d'aller plus loin, un mot d'explication devient nécessaire.
Pour ne pas remonter plus haut, Bernard de Ventadour, le glorieux prisonnier de Poitiers, et Robert, son fils, chassés l'un et l'autre de Ventadour par l'aventurier Geoffroy-Tête-Noire, dont nous parlerons en son lieu; Jacques, fils de Robert, époux deN. de Torsay, fait prisonnier à Azincourt, mort vers 1422, sans postérité, et Charles, son frère, époux de Roberte d'Auvergne, mort après 1445, me paraissent s'être passablement désintéressés des affaires de Bonnesaigne : ils avaient d'autres soucis en tête ; et nous avons vu les abus faire alors leur apparition sous les voûtes de l'abbaye.
Louis, fils de Charles, époux de Catherine de Beaufort dame de Char lus, fille de Pierre-Roger dernier rejeton mâle de^l'illustre famille des papes de Rosiers, voulut réagir contre ces abus et montrer, aux petits intrigants des environs qui en étaient les auteurs, qu'il était encore quelque chose dans cette abbaye que ses ancêtres avaient comblée de bienfaits et où ils avaient toujours maintenu l'ordre, la discipline et les vertus religieuses par les nombreuses abbesses sorties de leur illustre et vaillante race, par ailleurs si chrétienne.
Voilà pourquoi le 29 août 1470, ne pouvant assister lui-même à l'installation d'une fille des intrigants Gimel, Louis se fit représenter ce jour-là par son fils Pierre, qui, au nom de son père, devait conduire
— 33 —
Blanche de Gimel par la main. Le' comte entendait montrer par là, à la nombreuse assistance accompagnant la jeune abbesse de l'église au monastère, delà salle capitulaire au dortoir, de la salle à manger à la cuisine, de l'infirmerie aux cellules des religieuses, etc., que Ventadour aurait désormais, un peu mieux que par le passé, l'oeil ouvert sur Bonnesaigne.
Hélas ! le mal était fait ! La division était dans le couvent; les Ventadour furent impuissants à en détourner les fâcheuses conséquences et à y ramener la primitive obéissance.
Du reste, deux ans après l'installation dont nous parlons, la première race de nos vicomtes de Ventadour disparaissait de nos montagnes. En 1472, en effet, Blanche de Ventadour, unique héritière de Louis qui venait de faire cet acte d'autorité dans Bonnesaigne, donnait sa main en mariage à Louis de Lévy, seigneur de la Voulte, en Vivarais. Nous disons : « Unique héritière »., car son frère Pierre venait de mourir sans avoir contracté mariage, et son autre frère, Jean, déjà religieux, allait bientôt devenir abbé d'Obazine (1484-1517).
Les Gomborn avaient duré à Ventadour 434 ans, de 1059 à 1493, date de la mort de Louis dont nous nous occupons.
Est-ce grâce à la surveillance que le 'dernier comte, Comborn-Ventadour, exerça sur Bonnesaigne, ou à toute autre heureuse influence venue de je ne sais où,. que l'abbaye montagnarde fut calme, paisible et fervente, sous l'abbesse de Gimel ? Je l'ignore.
Toujours est-il que, durant les 34 ans de règne de cette abbesse, Bonnesaigne prospéra à vue d'oeil. Le
— 34 -
nombre des religieuses monta, un an après son élection, de neuf à dix-neuf, et s'y maintint.
Cette abbesse augmenta considérablement les revenus de son abbaye ; elle lui fit unir les prieurés de Veyrières (Vervilles), de Peychadoire et de Muratel, par un bref apostolique qu'elle obtint du pape Sixte IV.
Sur la fin de ses jours, pourtant, Blanche de Gimel commit une imprudence qui déteint sur toute sa longue administration ; elle ne fut pas politique, et fit la grosse faute de céder sa place, en 1504, à sa nièce, Marguerite de Gimel, ce qui fut la cause de bien des désordres dans son abbaye !
D'après M. Champeval (papiers de Lentillac), Blanche de Gimel vivait encore en décembre 1508.
§ XXIX. — MARGUERITE DE GIMEL (1504-1537)
Blanche de Gimel, venons-nous de dire, céda sa place, en 1504, à Marguerite de Gimel, sa nièce, qui, pendant quaranle-deux ans, fut la plus malheureuse des femmes. Ses malheurs commencèrent le jour même que sa tante démissionna en sa faveur.
Ce même jour, en effet, deux religieuses de la communauté de Bonnesaigne élurent, pour remplacer la tante au détriment de la nièce, Jeanne de Veyrac, dans la chapelle de Boschaud, dépendance de Saintr Angel.
Cette nouvelle concurrente était de la maison de ce nom, paroisse de Saint-Cirgues (Xaintrie), cohéritière de la maison de Merle et coseigneuresse de Saint-Cirgues, où le choeur de l'église de Saint-Jean avait à la
— 35 —
fois sa litre et sa sépulture ; famille qui associa tour à tour à son château local les seigneuries de Malesse, Gussac (Auvergne), Pouls, Sexcles, défendit vaillamment contre les Anglais la forteresse de Merle et disparut vers le milieu du xvie siècle (Dictionnaire des Paroisses).
Evidemment, l'élection de Jeanne de Veyrac, par deux voix, ne pouvait avoir aucun résultat, et n'en eut aucun, en effet; mais c'était une deuxième lutte dans le couvent, toujours en dehors des Ventadour.
Marguerite de Gimel, soutenue par le pape et le roi, triompha de Jeanne de Veyrac, sa rivale. Elle fut mise dans sa charge en juin 1505, par un bref de Jules II et un placet de Louis XII. Mais elle ne fut pas en repos à cause de l'élection de Jeanne de Veyrac, qu'elle eût toujours sur le coeur ; et puis, avec son caractère hautain, elle ne sut pas se plier sous le joug de l'humilité, se faisant toute à toutes, pour gagner l'affection de ses compagnes et les conquérir à NotreSeigneur Jésus-Christ.
Les têtes s'inclinèrent sous l'autorité de sa crosse, mais les esprits ne se soumirent jamais et les coeurs restèrent toujours vides d'affection pour elle. Néanmoins, malgré le vide que. l'on faisait autour d'elle, Marguerite de Gimel semble s'être occupée des intérêts de son abbaye; c'est ainsi qu'en 1515 nous la trouvons, tantôt à Bonnesaigne tantôt à Champagnac (Auvergne), traitant diverses affaires. Voici ce que M. l'abbé Poulbrière a découvert à ce sujet, dans les minutes de J. Dohet, notaire de Rilhac-Saintrie :
« 10 juillet 1515 —In aulà abbaliali monasterii Bonessaigne, noble et honorable dame Marguerite
— 36 —
de Gimel, abbesse de ce monastère, donne à Me Jean d'Escures not. royal du lieu même de Bonnesagne, investiture d'un pré par lui acheté et appelé de Lespinasse, situé au Mas del Feyt, confrontant avec le chemin allant du lieu de Lerm au lieu de Combressol et avec le pré appelé de Lespinasse de Jean-petit del Feyt. Prix 16 livres tournois. Vendeur Pierre dit lo moyne del Feyt. Témoins de l'investiture : Dno Helia Malortigue, pbro et Bertrando Lobas, servitoribus dicte domine, habitatoribus Bonessanhie:
« Même jour et lieu. — Investiture pour la Porte, hôte dud. Bonnesaigne, qui avait acquis lo prat Noalhac, aux appartenances de Combressol, confrontant avec pré d'Ant. Cauti et le pré del Veyrat; une terre appelée de la Cham Gaillard, confrontant avec chemin public de Combressol à Maussac et avec terre de Guillaume Cauti ; une pièce de terre... confrontant à terre de Bernard Delayre (Dreleyre? auj.) e( à terre de Pierre Cogusle ou Cogurle ; autre appelée à la Vernhe et Pauc avec un pastural, confrontant à terre de François Deleyre et d'Antoine Cauti ; enfin un autre pastural dit de las Noals, confrontant à pré des héritiers de feu Jean de las Borie et pastural de François Delayre ».
Un mois après ces arrangements, l'abbesse de Bonnesaigne se trouvait dans son prieuré de Champagnac pour visiter ses religieuses et passer les conventions suivantes :
« Le 6 août même année 1515, à Champagnac d'Auvergne, investiture donnée à Etienne Pigeyrol prêtre, curé ou vicaire perpétuel de ce lieu, par la même abbesse, prieure en même temps de Champa-
— 37 -
gnac et de Veyrière, membre dépendant de son abbaye ; témoins : Jean Chassée, prêtre de Bonnesaigne.
« Le 15 août. Investiture donnée par la même, en sa maison priorale de Champagnac, à un habitant de ce lieu.
« Le 27, elle nomme son procureur pour la perception de ses droits abbatiaux le prêtre Hélie Malortigue, du diocèse de Sarlat. Jacques La Porte, de Bonnesaigne, se porte caution dud. prêtre pour la moitié de la perception.
« Le 15 septembre, elle y donne une investiture à Antoine Ghanals du Mas de Ribeyrols, paroisse de Saint-Julien, prope Sarro (auj. près Bort), pour acquisition aux appartenances du Mas de la Grange, dite paroisse.
« Le 16, elle y fait des transactions avec des gens de Champagnac ».
Après cela, Marguerite de Gimel rentra à Bonnesaigne.
« Le 6 décembre, elle y donne investiture à des Delbos, du Mas del Bos, paroisse de Lamazière-Basse ; témoin, avec le prêtre Malortigue, noble et religieux homme Pierre-Claude de Gimel, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
« Le 7, elle investit encore Antoine Vieyres, prêtre du lieu de Maussac, acquéreur d'Antoine Delbos, dite paroisse, d'un pré appelé Longaygue, aux appartenances dud. Maussac, confrontant avec l'eau de Longaygue, le pré del Vieyres et le pré de François Delbos. Prix, 9 livres de monnaie courante. Acte d'achat reçu par Me Louis Planet.
T. XXV. 1 - 3
- 38 —
« Même jour, investiture de Catherine Delayre, veuve de Combressol, pour permutation de maison et jardin aud. lieu, confrontant, la maison avec maisons de deux Delayre, le jardin avec jardin d'Antoine Salesse et avec pré de la Borie.
« Item, acquisition par elle, de Jacques Laporte, de Bonnesaigne, du pré dit de Soubtz las eslras, dessous les fenêtres, au dit lieu, confrontant au pré de la Salle, de lad. dame, la pêcherie de la même et le pré de Jean Laporte. Prix : 8 livres de monnaie courante.
ce Puis, même jour, investiture de diverses gens, entre autres du prêtre Pierre de Lestangui, à Combressol, à Maussac, paroisses (pour la première, villages des Flottes, du Noudès, gens du même nom).
« Le 7 janvier 1516, elle investit Me Légier de Mari, baschelier en lois, notaire de la ville de Meymac, par achat à Pierre dit lo Gros, de Cros (Combressol), d'un pré appelé del Timble (!) aux appartenances du Mas del Monclouso, confrontant au bois du même nom (Del Monclouso) d'un côté et chemin de Combressol el navis sur deux côtés.
« Item le 15, Antoine Dupuy, marchand de Neuvic, par.acquisitions, à deux autres Dupuy, frères, du mas de Bezeaud, dite paroisse, et à deux autres en d'autres mas ».
Enfin, le 17 janvier 1516, l'abbesse Marguerite de Gimel termina à l'amiable une grande contestation qu'elle avait avec un de ses voisins, de Bonnesaigne même. L'acte qui en fait mention est le premier acte français du registre, avec titre latin, que nous venons d'analyser. Il débute par ces trois lignes latines :
— 39 —
Pro honorabili et religiosa Dna abbatissa Bonnessaigne, Guillelmo dicto Guillot, magistro Johanne et Johanne La Porta transaclio.
Voici ce dont il s'agissait ; laissons parler le notaire :
Comme « l'abbaye (de Bonnesaigne) est une belle abbaye, de noble et ancienne fondation, et laquelle a esté dotée de plusieurs beaux biens et villages, mouvens et tenus de l'abbesse, à cause "desquels luy sont dehus plusieurs cens, rentes, dixmes et aultres drocz et devoirs annuels », l'abbesse « pour recolliger et amasser les fruictz de son abbaye, a coustume de y tenir ung recepveur ».
Le receveur était tenu naturellement de rendre compte à la dame abbesse des cens, rentes et autres droits et devoirs de l'abbaye dont les intérêts lui étaient confiés, et cela annuellement.
Depuis trente ans c'était feu maître Pierre Laporte, de son vivant curé de Maussac, qui était chargé de cette délicate mission, commençant à la Saint-Michel et finissant à pareil jour de l'année suivante. Le curé de Maussac passa de vie à trépas avant d'avoir fini l'année 1514-1515, et ce furent ses héritiers, les Laporte, surtout Jean et Monsieur Jean qui, continuant la charge de leur oncle, s'emparèrent de la recelte déjà réalisée et perçurent les cens, rentes et autres devoirs qui étaient en retard ou non échus au moment de la mort de leur bienfaiteur.
Mais ils ne se pressaient pas, au gré de l'abbesse, de rendre leurs comptes de gestion.
L'abbesse réclamait non seulement les recettes de l'année 1514 à 1515, mais encore certains arrérages
— 40 —
dus par l'ancien curé de Maussac, arrérages qui, pendant sa longue gestion de trente ans, avaient fait la boule de neige et devaient s'élever à plus de dix mille livres tournois, à raison de cent livres tournois par an.
A ces réclamations de Marguerite de Gimel, les Laporte répondaient : Nous ne sommes tenus de rendre que les comptes d'une année, Pierre Laporte ayant toujours rendu compte des années précédentes à Madame de Gimel elle-même, et à sa précédente, Blanche de Gimel, dont il existe quittances générales et particulières.
Pour les comptes de l'année de leur gestion, ils étaient prêts à les rendre, et s'ils ne les ont .pas rendus plus tôt, « c'est à cause de certaines menaces proférées par l'abbesse et par ses serviteurs, menaces qui les avaient effrayés et à la suite desquelles ils n'avaient osé venir à l'abbaye, ni s'approcher de l'abbesse, pas même du lieu de Bonnesaigne ».
Ils ajoutaient que, lors même que leur oncle aurait été en retard de quelque petite somme, l'abbesse avait lieu d'être satisfaite, puisque, après la mort du dit Lapoite, curé, ils avaient eux-mêmes donné à MM. ses frères la somme de seize ou dix-sept cents livres tournois, soit aux MM. de Digmel [sic], soit à l'aumônier de Tulle, ses frères, dont ils avaient quittance, et de plusieurs autres choses qu'ils avaient données à Mme l'abbesse, etc.
Non satisfaite de toutes ces explications, MmD l'abbesse fit appointer les frères Laporte de la somme de cinquante écus d'or pour les préjudices que de tels retards avaient causés à son monastère. Enfin, de part et d'autre, effrayés de la tournure
— 41 —
que prenait cette affaire embrouillée, les belligérants furent d'avis d'en finir à l'amiable. C'est pourquoi le 17 janvier 1516 ils passèrent, au lieu de Bonnesaigne et en la salle abbatiale du monastère, la transaction suivante :
1° Les dits Laporte seront tenus de payer à Mme l'abbesse, tant pour raison de ce qu'ils pourraient avoir plus reçu que baillé durant le cours de l'année 1514, que pour les arrérages qui pouvaient être dus par leur oncle dont ils étaient les héritiers, depuis le premier jour de son entrée en fonction jusqu'au jour de son décès, la somme de huit-vingts livres tournois payables, quatre-vingts livres tournois le premier lundi de Karesme prochain venant, et autres quatrevingts livres tournois dans le jour de Noe prochain venant ; le tout payé et porté à Mrae l'abbesse, en sa maison abbatiale de Bonnesaigne.
2° De plus, les Laporte devaient payer toutes les charges ordinaires de l'abbaye dues depuis trente ans, pendant le temps de la recette, soit aux dames religieuses de l'abbaye, soit aux vicaires et autres, excepté ce qui pouvait être dû à Jacques Sanolhac, cordonnier de Saint-Angel, à cause des fournitures qu'il avait faites à l'abbaye, en ouvrage.
3° Les Laporte étaient enfin tenus de garder de dommage et de payer à maître Loys Planet, notaire à Meymac, vingt-quatre sétiers de seigle et cent qartes d'avoine, mesure de Bonnesaigne, si toutefois ils ne l'ont déjà soldé, et aussi le tenir quitte envers le curé de Meymac.
Moyennant quoi, les Laporte demeuraient quittes envers l'abbesse de toutes ses revendications.
— 42 -
L'abbesse, à son tour, levait la saisine et la mainmise et leur rendait leurs biens pris et saisis ; de part et d'autre on renonçait à tous procès ou procédures faites d'un côté et d'autre, etc. De part et d'autre on loua, approuva, etc., la transaction qui venait d'être passée, et que l'on promettait et jurait de tenir ; on hypothéquait ses biens et on se soumettait à la cohercion et compulsion de M. le Sénéchal du Limousin, officiai de Limoges, juge ou bailli de Ventadour, et juge ou bailli de Mme l'abbesse, etc., etc.
Fait double en présence de noble homme maître Antoine Andrieu, bachelier en décrets, sieur de Laguane (de Saint-Exupéry), et de Eme Bardin de Bellecroix, habitant du lieu d'Eyde, diocèse de Limoges et deGlermont, témoins, etc. (Minute sans signature).
L'année suivante (1517), douze ans après son installation, Marguerite de Gimel commit à peu près la même faute que sa tante : elle donna le prieuré de Champagnac (Auvergne) à sa nièce, Marie de SaintGhamant, qui n'avait que dix ans. Cette prieureenfant était fille de Pierre de Saint-Chamant, seigneur de Scorailles, et de Marguerite de Sainte-Aulaire.
Un an après (1518), la faute ou l'imprudence fut encore plus forte. Se trouvant malade, à toute extrémité, l'abbesse Marguerite de Gimel résigna, à la jeune prieure de Champagnac, l'abbaye de Bonnesaigne.
Cette petite abbesse de onze ans était assurément incapable de gouverner Bonnesaigne. Le pape Léon X, par un Bref, nomma alors deux ecclésiastiques pour administrer le temporel de la communauté.
Vaines précautions !
Bonnesaigne et Villevaleix refusèrent toujours de
— 43 —
reconnaître cette enfant pour abbesse, jusqu'à ce que leur opposition fût réduite à néant par le Parlement de Bordeaux, car les affaires en allèrent jusque-là.
Sur ces entrefaites, l'ancienne abbesse, Marguerite de Gimel, étant guérie, reprit, sans aucun droit, la direction de l'abbaye de Bonnesaigne, au grand mécontentement et des soeurs que froissait son caractère .altier, et de sa nièce Marie qui, arrivée à sa majorité de trente ans (1537), se hâta de prendre, à son tour, la direction de son abbaye ; on devine dans quel état et au milieu de combien de difficultés.
I XXX. — MARIE DE SAINT-CHAMANT (1537-1555)
Les armes des Saint-Chamant sont : De sinople à trois fasces danchées d'argent.
Marie de Saint-Chamant, nommée en 1518 par cession de sa tante, Marguerite de Gimel, et confirmée par bref de Léon X, ne put prendre les rênes du gouvernement de Bonnesaigne qu'en 1537, lorsqu'elle eut atteint ses trente ans. Elle fut bénite dans le château de Saint-Chamant le 12 juin 1541.
Pour se débarrasser de sa tante, elle lui donna le prieuré de Villevaleix, comme lieu de retraite, et la moitié des revenus de l'abbaye de Bonnesaigne.
Marguerite de Gimel partit donc de Bonnesaigne pour le prieuré de Villevaleix. Mais les guerres et d'autres difficultés intérieures la forcèrent à revenir à Bonnesaigne.
Ici, nous touchons au point le plus critique de l'histoire de notre abbaye montagnarde. Le fait que nous allons rapporter est tellement incroyable, qu'il faut
— 44 —
toute l'autorité d'un auteur sérieux, comme le R. P. Bonaventure de Saint-Amable qui le livre, pour qu'il ne nous paraisse pas inventé à plaisir, si non absolument impossible.
C'est ici que la règle de sage critique, posée par le païen Horace, doit nous guider dans nos appréciations et nous empêcher de les porter trop sévères : Ubi j)lura nittent... non ego paucis Offendar maculis, quas aut incuria fudit, Haut humana parum cavit natura.
Voici donc le fait que nous livre l'histoire, sur le compte de la tante et de la nièce se disputant le pouvoir abbatial :
Revenue à Bonnesaigne, l'ancienne et hautaine abbesse, la fière prieure de Villevaleix, Marguerite de Gimel, ne put se plier à la loi de l'obéissance sous l'autorité abbatiale de Marie de Saint-Chamant. La tante ne put se soumettre à la nièce, qu'elle s'était pourtant choisie pour remplaçante.
Le retour et la présence de Marguerite de Gimel à Bonnesaigne furent un vrai malheur pour l'abbaye et un grand scandale, non seulement pour la communauté, mais encore pour la postérité. Il est unique dans la longue existence de onze siècles de Bonnesaigne qui, par suite des malheurs du temps, était en pleine décadence ; circonstances qui, sans excuser la faute, en diminuent l'horreur et nous montrent que, lorsque nous ne sommes plus guidés que par l'esprit du monde et non par la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde, c'est-à-dire par Notre-Seigneur Jésus-Christ, notre pauvre nature déchue est capable de tout.
— 45 —
Voici donc ce que rapporte l'historien de SaintMartial en Aquitaine :
« Là (à Bonnesaigne), portant envie à sa nièce, elle (Marguerite de Gimel) souffrit d'icelle (de Marie de Saint-Chamant) beaucoup de peines presque jusqu'à l'extrémité, et enfin mourut presque de faim, de disette et de maladie, abandonnée de tout le monde.
ce Et lorsque l'heure dernière sonna pour elle, le 6 janvier 1547, les religieuses traînèrent son corps, à l'abbesse Marie, avec une corde, pour la faire ensevelir, et le clergé du voisinage dût l'ensevelir par charité, sans réfection ni honoraires ».
Etaient alors curés dans le voisinage de l'abbaye : Jacques de Montaignac, de Darnets ; Pierre Chanal, de Soudeilles ; François Granier, d'Ambrugeac, etc.
ce Exemple estrange, continue le pieux religieux, pour détourner les supérieurs et les supérieures de favoriser aux élections la chair et le sang. 11 eut bien mieux valu à cette pauvre religieuse de n'avoir pas de nièce, ou de ne luy donner pas sa charge, qui luy servit pour luy mettre le pied sur la gorge, et peut-être la perdre pour jamais ».
Ni la tante ni la nièce ne furent deux abbesses heureuses et édifiantes pour Bonnesaigne.
L'abbesse Marie ne fut pas plus heureuse après qu'avant la mort de sa tante, ce Dieu ne le permit pas. Occupée à thésauriser et vivant hors dû cloître, elle tomba malade entre les mains de personnes intéressées qui, pour mieux la voler, cachèrent son état et la laissèrent mourir à 48 ans, sans secours religieux, le 14 mars 1555. Bonaventure de Saint-Amable dit que
— 46 —
ce fut le 29 (Dict. des Paroisses, T. I, p. 371. — Bonavent., T. III, p. 460).
ce Ses actions, ajoute le Père Bonaventure, ne méritent pas qu'on en parle, sinon avec horreur ».
C'est une tache ; mais il y en a jusque dans le soleil. Elle est personnelle, car la famille de notre abbesse est une des plus anciennes et des plus honorables du Limousin ; Odon de Saint-Chamant, près d'Argentat, figure à la deuxième Croisade, et Gérald à la troisième. Treize ans après la mort de notre malheureuse abbesse, le sir de Saint-Chamant était nommé, dès la création de l'ordre, chevalier du Saint-Esprit (1578), par la volonté de Catherine de Médicis.
L'abbesse Marie, avons-nous dit, était fille de Pierre, seigneur de Scorailles, et de Marguerite de Saint-Aulaire.
Un François Murât de Beaupoil de Saint-Aulaire était curé de Darnets durant une bonne partie du temps (1482-1538) que ces sinistres événements se déroulèrent derrière les grandes murailles de Bonnesaigne ; c'était un parent maternel de l'abbesse, d'après M. Poulbrière.
Son frère aîné, Henri de Saint-Chamant, était déjà gouverneur de Thérouanne depuis deux ans (1553), quand arriva la triste mort de l'abbesse Marie dont nous parlons. Cette même année (1553), il défendit vaillamment la place qui lui avait été confiée, et, à partir de cet acte de courage, il mérita de porter une engrelure dans ses armes.
Quatre-vingt-douze ans plus tard, une autre fille de la maison de Saint-Chamant devint la XXXVIIme abbesse de Bonnesaigne, et, à l'exception de sa parente
— 47 —
et de quelques autres, devait tenir à rendre le dernier soupir dans son abbaye.
Marguerite de Livron succéda à Marie de SaintChamant pour quelques mois.
§ XXXI. — MARGUERITE (alias CATHERINE par Nadaud) DE LIVRON (1555, quelques mois)
Les Livron portaient : ce D'argent à trois fasces de gueules et un franc quartier d'argent, chargé d'un roc d'échiquier de gueules ». Sur un de ses écussons se trouve, en partition, le ce Vairé d'or et de gueules » des Beauffremont.
Cette famille, originaire de la Champagne, se fixa chez nous dès les premières années du xive siècle.
Elie de Livron portait le titre de seigneur d'Ayen etd'Objat en 1341..
Son fils épousa, en 1361, Marie, fille du seigneur de Saint-Exupéry, près Ussel.
Antoine de Livron hérita de Marie de Pompadour, sa mère, de la seigneurie de la Rivière, paroisse de Beyssac, et épousa Marie de Noailles vers l'an 1413.
En 1477, Bertrand de Livron, seigneur de Vars, la Rivière et Objat, écuyer d'écurie de Louis XI, capitaine de Coiffy, en Champagne, est époux de Françoise de Beauffremont, dame de Bourbonne en cette province, qui, portant sa seigneurie dans la famille de Livron, fut cause d'une expatriation. C'est ce Bertrand qui portait les armes que nous avons décrites plus haut.
Vers 1587, nous trouvons un autre Bertrand de Livron, seigneur d'Objat, neveu probablement de
— 48 —
notre abbesse d'un jour (V. Marvaud, T. II, p. 336. — Dict. des Paroisses : Objat.
Les Saint-Viance succédèrent par alliance aux Livron, à Objat.
Revenons à notre abbesse de Bonnesaigne.
Les vies agitées et les morts tragiques de Marguerite de Gimel (1547) et de Marie de Saint-Chamant (1555), ne servirent de rien aux gentilshommes de ces deux maisons unies par le sang. Elles auraient dû, ce semble, leur ouvrir les yeux et les corriger de leur malheureuse habitude de s'immiscer dans les affaires des communautés religieuses.
Il n'en fut rien.
Comme on était alors, — les faits que nous venons de citer ne le prouvent que trop, — en pleine décadence monastique, les Saint-Chamant, et les Gimel surtout, ne manquèrent pas d'intriguer pour l'élection d'une des leurs, afin de remplacer à Bonnesaigne l'abbesse défunte, Marie de Saint-Chamant.
Les intrigues combinées de ces deux familles aboutirent, en effet, à faire élire leur parente, Marguerite de Livron, peu après le 14 mars 1555.
L'élection fut faite, mais elle fut aussi cassé au bout de quelques mois de lutte. Marguerite de Livron ne put prévaloir contre sa concurrente, ce car l'ambition de commander s'était fourrée dans ce monastère » (Bonaventure).
Les de Chabannes aussi, alors tout puissants à la Cour, avaient pris part aux démêlés de Bonnesaigne, et ce fut une des leurs qui l'emporta et fit évincer l'abbesse Marguerite de Livron déjà nommée.
Devant tant d'intrigues, par ordre du pape et du
- 49 -
roi, Marguerite de Livron, imitant le bel exemple d'Anne de Maumont, se dépouilla d'un pouvoir éphémère qu'on lui avait tous les jours contesté et se retira cette fois moyennant cent livres de rente annuelle seulement.
L'Auvergne l'emportait sur le Limousin !
Arrivons à son heureuse rivale, Catherine de Chabannes-Gurton.
§ XXXII. — CATHERINE DE CHABANNES-CURTON (1555-1605)
Cette abbesse, dite Catherine par de Ribier, et Marguerite par Courcelles, issue d'une famille de l'Auvergne qui nous est parfaitement connue et que nous avons vue fournir d'autres abbesses à Bonnesaigne, était déjà religieuse de Prouille, dans le diocèse de Saint-Papoul, à 20 kilomètres de Carcassonne, quand un Bref du pape et du roi l'en tira pour la faire supérieure de notre abbaye, de préférence à Marguerite de Livron qui ne garda le pouvoir que quelques mois après son élection.
L'abbesse Catherine était fille de Joachim, seigneur de Gurton, sénéchal de Toulouse, chevalier d'honneur de la reine Catherine de Médicis, qui pourrait bien avoir donné son nom à la supérieure qui nous occupe, le jour de son baptême.
Joachim de Chabannes s'était marié quatre fois.
La première fois, il épousa, en 1527, Pétronnelle de Ventadour, fille de Gilbert Ier et de Jacqueline Dumay, veuve d'André de Crussol. Il en eut un fils
— 50 —
mort jeune, et Catherine, femme de François, baron d'Estaing et de Murol.
La seconde fois, il épousa Louise de Pompadour, dont il eut : Jean, mort sans lignée ; Isabeau, abbesse du Pont-aux-Dames ; Catherine, femme de François de Bar, baron de Baugi, et Hélène, abbesse de Vassy.
La troisième fois, il épousa. Claude de la Rochefoucaud, dont il eut : François, marquis de Curton, qui rendit de grands services au roi Henri IV, et épousa Renée du Prat, dont il eut : Christophe, Henri et Antoine, morts sans lignée, et Jean, héritier de ses frères ;
Joachim eut enfin, de ce troisième mariage, trois filles, parmi lesquelles l'abbesse Catherine, qui nous occupe.
La quatrième fois, Joachim de Ghabannes épousa Charlotte de Vienne, dont il eut : François, tige de la branche de Saignes; Gabriel, tige de la branche de Savigny-Piounzac, et Philiberte, mariée, l'an 1565, avec Jean de Mont-Boissier, dit de Beaufort, marquis de Canillac.
Le sénéchal de Toulouse, après avoir donné, de ses quatre mariages, de nombreux enfants à l'Église et à la Patrie, rendit son âme à Dieu, à Paris, en 1569.
Sa fille de Bonnesaigne est celle, de toutes les abbesses de cette communauté, qui a eu le plus long règne : cinquante ans !
Durant cette moitié-fin de siècle, Catherine de Ghabannes eut le temps de faire du bien à sa communauté. Bonaventure de Saint-Amable nous apprend, en effet, que cette abbesse « augmenta les prébendes de ses religieuses ».
— 51 —
Inutile d'ajouter que, sous l'abbesse Catherine, nous étions en pleines guerres religieuses. C'est peutêtre la raison pour laquelle nous devons nous montrer moins sévère envers sa mémoire, pour un acte de légitime défense dont on l'accuse pourtant do s'être rendue coupable en 1563 : nous voulons dire l'hécatombe d'une bande dé Calvinistes qui avait envahi son abbaye. Plus tard, en la racontant, nous discuterons cette grillade qui fut suivie, deux ans après, de terribles représailles.
Pour le moment, contentons-nous de dire que cet acte de légitime défense, en temps de guerre, est loin d'égaler en atrocités ceux dont les perfides Anglais, armés jusqu'aux dents, se sont rendus coupables envers les femmes et les enfants des malheureux Boërs qui étaient sans défense.
Des femmes désarmées, à plus forte raison, peuvent défendre leur honneur par toute sorte de moyens contre d'infâmes brigands nocturnes, seraient-ils revêtus de l'uniforme militaire.
La grillade du Montclauzoux, qui peut très bien s'expliquer sans être imputée à l'abbesse, est peut-être ce qui valut plus tard, à la famille de Chabannes, la gloire dû martyre (1).
(i) Marie-Henriette-Hyacinthe de Fournier de Quincy, épouse en 1766 de Claude-François de Chabannes du Verger, seigneur d'Argoulais, de Montbaron, de Montbois, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie au régiment de Broglie, fut en effet exécutée pendant la Révolution.
Receleuse de prêtres et de Mgr Louis-Jérôme de Suffren, évéque de Nevers, M"c veuve de Chabannes fut arrêtée un jour qu'elle venait d'entendre la messe dans une maison isolée de Clamecy, avec ses trois filles : Cécile, Marie-Henriette et Suzanne. Enfermée à Pressures,
— 52 —
Catherine de Chabannes est la dernière abbesse que cette famille ait donnée à notre abbaye.
Elle rendit hommage de Bonnesaigne au duc de Ventadour, le 4 novembre 1599 (Champeval).
Neuf mois avant de mourir, elle fit un acte d'autorité qui doit lui faire pardonner beaucoup :
Le 1er juillet 1604, elle prit pour coadjutrice sa nièce, Gabrielle de Beaufort de Canillac, qui devait être, dès l'année suivante, la plus illustre des abbesses de Bonnesaigne ; on ne peut, cette fois, reprocher à la vieille abbesse d'avoir trop écouté, comme certaines de ses devancières, la voix de la chair et du sang.
Catherine de Chabannes, après cinquante ans de règne abbatial, décéda le 2 avril 1605, écrit M. Poulbrière; le 8 avril, publie la Semaine religieuse; et Bonaventure de Saint-Amiable avait dit longtemps avant : ce Ce fut le 8 août de l'an 1605 que cette abbesse passa de vie à trépas ».
L'une ou l'autre des deux premières dates peut être admise ; mais celle du bon religieux est évidemment fautive, car, quelques lignes plus bas, il nous
elle comparut à Clamecy le 15 janvier 1794. Envoyée à Paris avec dixsept autres prisonniers, elle fut enfermée à la Conciergerie et exécutée le 15 mars 1794 (25 ventôse an II).
Après la tourmente, Jean-Frédéric de Chabannes, marquis de Curton, colonel de cavalerie, un des soldats de l'indépendance des EtatsUnis, émigré en 1789 dans l'armée des Princes et dans celle de Quiberon, rentré en France en 1802, racheta sa terre de Madic qui avait été vendue nationalement, la revendit et mourut en 1836, laissant trois filles. Il fut le dernier des de Chabannes possesseurs de Madic, aujourd'hui splendide propriété de M. Joseph Spinasse, d'Egietons (V. La Révolution en Auvergne, par M. Serre).
— 53 —
apprend que la remplaçante de Catherine de Chabannes fut nommée le 20 avril 1605. Ce fut Gabrielle de Beaufort-Canillac.
g XXXIII. — GABRIELLE DE BEAUFORT DE CANILLAC (1605-1651)
Beaufort porte : D'argent à la bande d'azur accompagnée de six roses de gueules.
Et Canillac : D'azur à un lévrier d'argent, accolé de gueules à la bordure componée d'argent.
Cette abbesse est de haute lignée. Elle descend en ligne directe de Guillaume Roger II, frère du pape de Rosiers, Clément VI.
Ce Guillaume Roger II, que nous avons vu accorder en 1344 le mariage de Jean de Maumont avec Marie Faure (Fabri), d'Egletons, devint, l'année même, vicomte de Beaufort, petite ville de l'Anjou, que Philippe de Valois lui avait donnée par lettres-patentes du 7 juin 1344. Dès lors, le nom primitif de Roger disparut insensiblement, pour ne laisser subsister que celui de Beaufort.
Ce premier vicomte de Beaufort (Guillaume II Roger) se maria trois fois.
Avant d'être vicomte, il avait épousé Marie du Chambon, dont il eut quatre enfants :
1° Pierre Roger, qui fut le pape Grégoire XI ;
2° Guillaume Roger III, mariée en 1349 à Eléonore de Gominges; acquéreur en 1350 de la vicomte de Turenne appartenant à sa belle-soeur, Cécile de Cominges, mariée à Louis de Poitiers, comte de Valentinois et de Diois. Il n'eut que deux filles, Eléonore,
T. xxv. - " 1-4
— 54 —
mariée à Edouard de Beaujeu, mort (1400) sans enfants, et Antoinette comtesse de Beaufort et vicomtesse de Turenne, mariée en 1393 à Jean Lemaingre, maréchal de Boucicaut II, créé chevalier la veille de la bataille de Rosebec (1382) par le roi Charles VI; fait prisonnier à Azincourt, où il conduisait l'avantgarde ; mort en Angleterre, des suites des blessures qu'il avait reçues (1421). Son épouse l'avait précédé de cinq ans dans l'éternité (1416), n'ayant eu de son mariage qu'un enfant du nom de Jean, mort presque au berceau ;
3° Nicolas, époux de Marguerite de Gallard (1370), fille unique de Jean, seigneur de Limeuil et d'Herment (Auvergne), et de Philippine de Lautrec, d'où Jean héritier, dès 1413, de sa tante de Turenne, et mis en possession de la vicomte après la mort de son oncle Boucicaut, qui en avait la jouissance depuis 1416, mais qui ne profita jamais des libéralités de son épouse, pour la raison que nous avons dite ;
4° Roger, seigneur de Rosiers,et du Ghambon, né en 1342, mort sans enfants.
En 1345, Guillaume II Roger, toujours simple vicomte de Beaufort, épousa, en secondes noces, Guérine de Canillac (Auvergne), fille unique de Marc, seigneur de Canillac, et d'Alixent de Poitiers. L'année d'après, par lettres-patentes, en date du mois d'avril 1346, la terre de Beaufort fut érigée en comté. C'était le cadeau de noces du roi de France.
De ce second mariage naquit Marques ou Marquis de Beaufort de Canillac, qui, en 1369, épousa Catherine-Dauphine, fille de Béraud, premier comte de Clermont, Dauphin d'Auvergne, et de Marie de Vie
— 55 —.
de Villemur. Ce Marqués de Beaufort de Canillac portait : ce Ecu droit, écartelé aux 1 et 4 de Beaufort » : d'argent à la bande d'azur accompagnée de six roses de gueules rangées en orles ; « aux 2 et 3 » ; d'azur au lévrier d'argent colleté de gueules, à la bardure componée d'argent, qui est de Canillac ».
Ce sont, on le voit, les armes de l'abbesse Gabrielle dont nous nous occupons, sauf qu'elles ne sont pas écartelées; elles n'en avaient pas besoin.
Du mariage de Marques naquit Louis Roger de Beaufort, vicomte de Canillac, qui se maria deux fois :
1° Avec Jeanne de Norri, fille d'Etienne, seigneur de Norri, et de Jeanne, dame de Passac;
2° Avec Jeanne, fille de Jean, baron de Montboisier, et de Catherine de Chalençon.
Ce Louis était aussi comte d'Alet, vicomte de la Mothe et de Valerne.
De son mariage avec Jeanne de Norri naquit Charles-Roger de Beaufort, marquis de Canillac. CharlesRoger épousa Jeanne de Chabannes, fille d'Antoine, grand-maître de France, et de Marguerite de Nanteuil, comtesse de Dammartin.
Sans nous attarder plus longtemps à établir une généalogie parfaitement inutile, disons tout de suite que Gabrielle de Beaufort de Canillac était issue de ce mariage et qu'elle eut pour soeur Marie, qui épousa Louis de Montmorin, dont nous allons trouver bientôt les deux filles : Anne et Marie-Françoise, à l'abbaye de Bonnesaigne, auprès de leur tante.
De grande et illustre lignée, notre abbesse se ressentit toujours, durant ses 46 ans de gouvernement,
. — 56 —
de la distinction de son origine. C'est, sans contredit, la plus éminente des supérieures de Bonnesaigne.
Coadjutrice de Catherine de Chabannes, sa tante, le 1er juillet 1604, elle fut nommée abbesse, par bref du pape, le 20 avril 1605.
Intelligente, active, pieuse et charitable, Gabrielle de Beaufort fit un bien infini au dedans et au dehors de sa communauté.
Elle releva son abbaye à tous les points de vue ; dès avant sa profession, ce elle avait mangé son patrimoine pour la rétablir », après les épreuves terribles des guerres de religion, dont nous parlerons dans un autre chapitre.
Au point de vue matériel, elle augmenta les bâtiments du monastère; en releva les ruines, entre autres celles du clocher qui, plus ou moins épargné par la guerre, venait d'être foudroyé pour la troisième ou quatrième fois (1400-1434-1597-1598). La dernière fois, surtout, le clocher fut abattu et la voûte écrasée. Mais rien ne fut au-dessus du courage de l'intrépide abbesse.
Pour ramener dans sa maison une modeste aisance, depuis longtemps disparue par suite des malheurs de la guerre ou de la mauvaise gestion de certaines abbesses, elle obtint que quelques prieurés fussent unis à la mense abbatiale : Villevaleix, Champagnacles-Mines (1605). (V. Chap. III, § II, n° 2).
Elle réussit aussi à relever son abbaye au point de vue moral et spirituel, et à rendre la clôture obligatoire. Pour ramener parmi ses soeurs l'esprit d'obéissance,
— 57 —
de soumission et de piété, pour les faire vivre, en un mot, dans l'esprit de leur vocation, elle leur fit donner de fréquentes retraites par les prédicateurs les plus en renom, par leur sainteté surtout plutôt que par leur éloquence. C'est ainsi que nous trouvons à Bonnesaigne, du temps de l'abbesse Gabrielle de Beaufort, le célèbre oratorien Jean Le Jeune, ou le Père aveugle, avant ou après ses inoubliables missions à Tulle et à Treignac. Nous raconterons, dans le chapitre des épreuves de Bonnesaigne, la curieuse aventure qui lui arriva un jour de cette retraite.
Nous l'avons déjà dit, en un autre endroit de cet ouvrage, jusqu'à cette abbesse les religieuses de Bonnesaigne faisaient bien voeu, le jour de leur profession, d'observer la règle de saint Benoît; mais, en réalité, c'était ordinairement la volonté, pour ne pas dire le caprice, des supérieures qui leur servait de règle. Pour couper court à ce grave abus, cause de tant de désordres dans l'abbaye, Gabrielle de Canillac fit dresser de nouvelles constitutions par quatre hommes éminents, du nombre desquels saint Vincent de Paul, et exigea que la clôture ne fût plus lettre morte, en donnant elle-même la première à ses filles l'exemple de la résidence la plus rigoureuse, derrière les hautes murailles et les grilles austères de son couvent (1645).
Elle vit aussi une cause d'abus qu'il fallait réformer à tout prix, dans l'influence que les seigneurs de Ventadour avaient exercée, de temps immémorial, sur les affaires intérieures de sa maison, en vertu de titres établis en 1280, 1338, 1341, 1444, 1599 et 1603, avons-nous dit ailleurs. Ce sont ces droits, ou pré-
— 58 —
tentions, que l'intrépide abbesse fit tomber (1627), par un arrêt du Parlement, qui laissa aux Ventadour pourtant le titre de bienfaiteurs de cette abbaye.
La victoire de l'abbesse ne dût pas lui être bien chaudement disputée, car le duc Henri et son épouse, Marie-Liesse de Luxembourg, sont bien les plus inoffensifs de tous les seigneurs de Ventadour. Le premier, après la bataille de Castelnaudary, se fit chanoine de Notre-Dame de Paris, et la seconde entra au Carmel de Chambéry qu'elle avait fondé, ainsi que la maison des Carmes de cette même ville, de concert avec son généreux époux (V. Trois Limousines à la Visitalion de Moulins).
Le pieux duc Henri dût se soumettre sans trop de peine à la sentence du Parlement. Mais il n'en fut pas ainsi de Charles, marquis d'Annonay, son frère et successeur au duché de Ventadour. Un titre de 1635 nous apprend, en effet, que, huit ans après la victoire de l'abbesse, Bonnesaigne relevait toujours de Ventadour. Bien plus, en 1647, le duc en réclama l'hommage à la triomphante abbesse elle-même (Papiers de M. Seurre-Bousquet ; lettre du 21 avril 1901).
En même temps qu'elle plaidait avec le puissant duc, Gabrielle de Beaufort avait deux autres affaires sur les bras, mais de nature différente : elle donnait procuration pour un procès contre Jean Dupuy, de Meymac, et réduisait au silence le seigneur de Pompadour.
Ce seigneur croyait encore être sous le régime absolu de la féodalité : il voulait continuer à opprimer Bonnesaigne, comme héritier des Comborn.
Voici ce qu'il avait imaginé :
— 59 —
Quand, après le passage de Goligny et de Lamaurie, à Bonnesaigne, l'intrépide abbesse de Beaufort eut relevé son monastère, Pompadour imagina de la dépouiller de son titre à'abbesse, titre dont avaient joui ses devancières depuis le xne siècle. Il voulait, à la faveur des troubles et de la confusion qui régnaient encore en France, et surtout en Limousin, à la suite des guerres de religion, faire reculer l'abbaye de cinq siècles et la remettre dans son berceau de prieuré. Il pensait, l'irréprochable gentilhomme ! qu'à l'exemple de certains hobereaux de l'époque, Bonnesaigne avait usurpé pour s'anoblir et se donner des bottes à talons rouges, un titre qui ne lui convenait pas.
Mme Gabrielle de Beaufort ne fut pas de cet avis. Elle soutint victorieusement ce nouveau genre d'épreuves pour son monastère et le titre à'abbesse lui resta après de longs et grands débats (1633). C'est ce qui a fait croire, à certains historiens, que ce n'était qu'au xvne siècle que Bonnesaigne avait été honoré de son titre abbatial (V. chapitre II, § III).
Gabrielle de Beaufort semble pourtant avoir été égarée, au moins une fois, par son zèle ardent de réformatrice de Bonnesaigne. Voici pourquoi :
Dès le principe, nous l'avons dit, Bonnesaigne ne relevait que du Pontife Romain et l'abbesse correspondait directement avec le Pape. A la longue, les évoques de Limoges s'introduisirent dans l'abbaye et finirent par y étendre leur juridiction. L'abbesse de Beaufort voyait là encore un abus qu'il fallait détruire pour, ramener son monastère aux privilèges de la règle primitive. Le débat s'envenima et les contestations allèrent au point qu'en août 1629 Mgr François de
— 60 —
la Fayette, en tournée pastorale dans nos montagnes, voulut visiter, comme supérieur, l'abbaye de Bonnesaigne, avant de se rendre à Soudeilles (23) et à Egletons, d'où il repartit le 28 ; Mme de Beaufort s'y opposa formellement, et comme l'évêque insistait elle lui ferma là porte au nez. L'intrépide abbesse entreprenait cette fois une lutte dont elle ne devait pas voir la fin, mais qui devait se terminer au détriment de son monastère, en 1657, après l'avoir soumis, en 1648, à la juridiction des abbés de Cluny pour le soustraire à celle des évoques de Limoges.
Si l'on devait encore reprocher autre chose à cette grande abbesse, ce serait peut-être l'acte de faiblesse dont elle se rendit blâmable en 1645, en donnant les prieurés de Villevaleix et de Champagnac-Muratel, unis à la mense abbatiale depuis 1605, à ses deux nièces : Anne et Marie-Françoise de Montmorin.
Dès 1636, elle s'était fait donner une pieuse coadjutrice, Charlotte de Planèze, sa nièce, originaire de Rouergue, qui malheureusement mourut le jour même de la réception de son brevet.
L'abbesse de Beaufort sentit si vivement la perte qu'elle et sa communauté venaient de faire, par la mort inopinée d'une personne si accomplie, qu'elle mit neuf ans à trouver une autre coadjutrice capable de continuer son oeuvre à Bonnesaigne. Mais le 17 juillet 1645 elle crut l'avoir devinée dans une autre de ses nièces, Anne de Montmorin, dont nous avons déjà prononcé le nom ; et elle vit juste.
La vieille abbesse eut encore six ans de bonne vie pour former sa remplaçante et en faire une digne continuatrice du bien qu'elle avait toujours poursuivi
— Ci —
pour sa communauté. Gabrielle de Beaufort de Canillac, après quarante-six ans de règne, mourut pleine de jours et de mérites devant Dieu et devanl les hommes, le 8 février 1651, ou le 18 du même mois et de la même année, d'après le R. P. Bonaventure de Saint-Amable.
C'était une très digne abbesse, dont on fit deux fois l'oraison funèbre.
Elle laissait bien à la communauté plus de 28,000 livres de dettes ; mais après le grand bien qu'elle avait fait à son abbaye et surtout les abondantes aumônes qu'elle avait versées dans le sein des pauvres, personne ne songea à reprocher de tels arrérages à la bienfaisante et glorieuse mémoire de la parente de nos papes de Rosiers.
En 1634, Pierre Dodet, consul d'Egletons, était juge de Bonnesaigne.
g XXXIV. — ANNE DE MONTMORIN (1651-1682)
Les Montmorin portaient : De gueules au lion d'argent armé et lampassé de sable, le champ semé de molettes de même.
ce La maison de Montmorin, dit Bouillet, est une des plus anciennes et des plus illustres de la province d'Auvergne; elle tirait son nom d'une terre considérable, près Billom ».
La Révolution la décima : cinq membres de cette famille en furent victimes.
Anne de Montmorin nous est déjà connue. Elle est fille de Louis et de Marie de Beaufort de Canillac,
— 62 —
soeur de la dernière abbesse de Bonnesaigne dont nous venons de parler.
Anne fit sa profession à Bonnesaigne même, le 20 octobre 1632.
En 1643, sa tante, Gabrielle de Beaufort, lui donna le prieuré de Villevaleix uni à Bonnesaigne depuis 1605.
Le 17 juillet 1645, elle la rappela de Villevaleix pour en faire sa coadjutrice, et Marie-Françoise de Montmorin, sa soeur, prieure de Champagnac, lui succéda à Villevaleix.
Et le 8 février 1651, date de la mort de sa tante, Anne de Montmorin devint abbesse de Bonnesaigne jusqu'en 1682 ; Deloche dit jusqu'en 1683. Elle ne fut bénite pourtant que le 31 janvier 1656 par l'évêque de Tulle, Louis de Rechigne-Voisin de Guron, au nom de son collègue de Limoges. Le R. P. Bonaventure de Saint-Amable dit que ce ne fut que le 8 septembre 1658 qu'eut lieu cette bénédiction.
C'est sous l'administration d'Anne de Montmorin, du temps de l'évêque Jean de Vaillac, qu'échoua définitivement la tentative d'établir à Tulle des bénédictines de Bonnesaigne.
Dès 1649, en effet, le pieux évêque en avait appelé quelques-unes dans sa ville épiscopale, déjà si bien pourvue d'ordres religieux. Anne de Montmorin, ellemême, alors coadjutrice de sa tante, s'offrit des premières ; et, en compagnie de Marie-Françoise de Montmorin, sa soeur, déjà prieure de Villevaleix, elle se rendit à l'appel de l'évêque pour essayer de planter sur les bords de la Corrèze un rameau bénédictin des rives de la Haute-Luzège.
— 63 —
La nouvelle fondation s'ouvrit le 25 janvier 1650; une prieure, deux religieuses et plus tard quelques demoiselles de la ville s'y établirent.; les revenus de Villevaleix et de Champagnac étaient affectés à l'oeuvre. La prieure de Villevaleix en fut supérieure lorsque sa soeur repartit pour Bonnesaigne comme abbesse en 1651.
En 1657, Marie-Françoise dé Montmorin, en résidence à Tulle, eut la consolation de recevoir à la prise d'habit une jeune montagnarde, Mlle Françoise de Fontanges, fille du haut et puissant Charles de Fontanges, seigneur, baron de Maumont, et de Hélène de Mirambel de la Nouailhe. Son contrat, passé par devant Etienne Bonnet, notaire royal, est du 22 septembre 1657 et porte la dot de deux mille livres tournois. Cet acte fut reçu par devant la grille du parloir, derrière laquelle se trouvait la majeure partie des religieuses dont les noms suivent :
Mraes Marie-Françoise de Montmorin-M ontars, prieure de Villevaleix et supérieure dudit monastère de Tulle ; Antoinette de la Pommérie, Suzanne de Bezug, Marie de Blot, Pascale Dupuy, Gabrielle de Gains de Montaignac et Isabeau de Jaucen, toutes religieuses professes.
Du côté de M. et de Mme de Fontanges se trouvaient : Bernard Gaye, docteur en théologie et curé d'Egletons, que nous rencontrons souvent mêlé aux affaires du prieuré de Bonneval et de l'abbaye de Bonnesaigne, Jean Braquilianges, conseiller du roi au siège de Tulle, Jean Dupuy, aussi conseiller et enquêteur en l'élection de la dite ville.
L'acte est signé : Maumont de Fontanges, Gaye,
— 64 -
Braquilianges, Dupuy, de Albier, Etienne Bonnet, nre, et l'expédition par Forzès et Desieyz, notaires.
Son contrat de profession est du 6 octobre 1658, et porte en plus des noms de religieuses que nous connaissons, ceux des soeurs Honorée de Fénis, et de Laporte. Il fut passé en présence de Jean Dupuy, conseiller du roi, élu et conseiller examinateur en l'élection de Tulle, et de Jean Melon, avocat, sieur du Pézarès, paroisse de Davignac. Le notaire était toujours Etienne Bonnet ; expédition en fut délivrée par Me Forzès, notaire.
Ce contrat de profession porte les signatures suivantes :
Sr de Montmorin Montaré prieure, sr de Maumon de Fontanges, srde la Pommérie, srde Laporte, du Bezut, sr M. de Blot, sr P. Dupuy, sr de Gains de Montagnac, sr I. de Jaucen, sr H. de Fenis. Maumon, H. de Mirambel de La Nouailhe, Dupuy, J. Melon et Forzès notaire royal. (Ex meisj.
L'oeuvre ne fut pourtant jamais florissante. Elle échoua même ; insuffisance de revenus, mauvaise administration, ou manque de sève religieuse, quel que fût le motif, après avoir compté jusqu'à treize soeurs.
Marie-Françoise de Montmorin repartit pour Bonnesaigne. Elle ne' laissait à Tulle que trois sujets qui en 1673, sur permission de l'évêque, qui était l'illustre Mascaron, gagnèrent d'autres couvents.
Alors, Mgr Mascaron, de concert avec les notables de la ville, acheta l'établissement des bénédictines pour y recevoir les infirmes et les pauvres de la ville. Il le bénit solennellement le 8.janvier 1674 et y
— 65 —
installa l'aumônier, les soeurs de la charité et douze pauvres. Ce fut l'Hôpital général de Tulle, et c'est aujourd'hui le Carmel (V. Dictionn. des Paroisses, T. Ier, p. 367).
Nous l'avons déjà dit, à différentes reprises, en 1648 le 13 août, l'abbesse Gabrielle de Beaufort de Canillac, pour, soustraire sa communauté à la juridiction des évoques de Limoges, l'avait soumise à celle de Cluny, dont elle reçut visites à partir de cette date.
Anne de Montmorin, au contraire, fit tous ses efforts pour l'arracher à la congrégation de Cluny et la soumettre à l'ordinaire ; ses efforts furent couronnés de succès ; et, à partir de 1657, Bonnesaigne releva directement de l'évêque de Limoges. C'est ce que veulent ces paroles de Gallia, que nous avons citées en un autre endroit de ce travail : ce Moniales abbatioe Bonnesanioe in traclatu superiore, paulo post ultro sese oblulère ut ab Francisco de la Fayette episcopo Lemovicensi visitationem et vitoe régulas acciperent » (T. II, p. 42).
Ce qui n'empêcha pas de nouvelles contestations sous l'évêque Durfé. Alors le roi intervint et par arrêt du 15 février 1691, neuf ans après la démission ou huit ans après la mort d'Anne de Montmorin, il soumit définitivement la remuante abbaye à la juridiction épiscopale.
En 1666, Anne de Montmorin avait dans sa communauté deux religieuses appartenant à une famille patriarcale des environs de Chamberet. C'étaient les demoiselles Louise et Marie-Françoise Hugon. Elles étaient filles d'Annet, écuyer, seigneur du Prat et de Magoutière, paroisse de Lavinadière, et de Peyronnelle
— 66 -
de Villelume. Leur frère cadet, Léonard, le troisième de huit enfants, avait épousé Anne du Teil, dame de Scoeux, village de Chamberet (1645). Dieu bénit ce mariage : huit enfants sortirent de cette union.
Le huitième, Léonard-François, né le 17 juin 1666, fut baptisé le 19 juillet par le vicaire de Laporte.
Ce fut une fête de famille !
Le parrain fut noble François Hugon, frère aîné du baptisé. La marraine devait être Dame Marie-Françoise Hugon, religieuse au couvent de Bonnesaigne. Mais, parce que les ordonnances et statuts de l'évêque de Limoges défendaient très expressément de recepvoir et admettre aulcun religieux ou religieuse, l'enfant fut tenu, au nom de nôtre bénédictine, par Claude de Forest, femme à Antoine HugonDuprat, du château de Magoutière.
Signé : Duprat, Fourest, de Hugon, de Hugon, Françoise de Hugon, marraine (V. Arch. de Chamberet et de la famille Hugon de Scoeux).
Après un règne de trente-et-un ans, Anne de Montmorin se décida à résigner son titre d'abbesse, purement et simplement es mains du roi. L'authentique de cet acte de résignation, dont la teneur se trouve dans la Semaine religieuse du 8 février 1896, nous a été gracieusement donné par M. J. Seurre-Bousquet, d'Egletons ; il a pour titre : ce Acte de démission faite par dame Anne de Montmorin, abbesse de Bonnesaigne, aux fins de la résignation de la dite abbaye, 1682 ».
Le voici :
« Au devant de la grille du parloir de l'abbaye de Bonnesaigne, fondation royalle de l'ordre de saint
— 67 -
Benoit au diosaize de Limoges, le trahtiesme jour du mois de may mil six cens quatre-vingt et deux avant midy par devant les notaires royaux soubsignés en présance des tesmoins bas-nommés, fust présante en sa personne dame Anne de Montmorin dame abbesse de la présante abbaye, laquelle vollontairement c'est desmise et ce démet es mains du roy notre sire de dicte abbaye de Bonnesaigne pour, par Sa Majesté y nommer, et faire pourvoir qui bon luy semblera, soubz la réserve néantmoins de la somme de douze cens livres de pansion viagère et annuelle quelle c'est réservée et réserve sur les fonds et revenus de ladite abbaye payables par chacune année à deux termes esgaux scavoir : aux festes de Noël et de Saint JeanBaptiste, franche et quite de toutes charges ordinaires et extraordinaires impozées et à impozer, prometant etc., juré etc., renoncé etc., compellé etc.
Faict en présance de M. Bernard Gaye prebstre, docteur en théologie curé de la ville de Gletton, y habitant, et Charles de Sartiges du Levandais, escuyer sieur de la Chaise habitant en son chasteau de Levandais paroisse de Champagnac en Auvergne et Me Jehan Colombin prestre docteur en théologie directeur des dames religieuses de ladicte abbaye tesmoingts.
A. M: MONTMORIN, abbesse de Bonnesaigne, résinante ;
GAYE, présent; 3. COLOMBIN, présent; DE LACHAIZE ;
FOULHIOUX, notre royal; CHAZAL, notaire royal,
reseveur.
Immédiatement après cet acte de résignation, Anne de Montmorin en passa un second, en présence des mêmes personnages, au-devant de la grille du parloir d'en haut, toujours avant midi. Elle donnait à ses
— 68 —
procureurs généraux et spéciaux, sans que la généralité déroge à la spécialité, pouvoir de résigner purement et simplement entre les mains de notre saint père le pape, monseigneur son vice-chancelier, ou autre ayant ce pouvoir, l'abbaye de Bonnesaigne, en faveur toutefois de Claude de Lévy-Charlus, religieuse, et à la réserve ci-devant indiquée de douze cents livres de pension viagère et annuelle, que ladite dame abbesse s'était réservée et réservait sur les fruits et revenus de l'abbaye, payable, par chacune année, en deux termes et paiements égaux, savoir aux fêtes de Noël et de Saint-Jean, francs et quittes de toutes décimes, rentes et charges ordinaires et extraordinaires imposées et à imposer ; et non autrement, ni d'autres paiements donnés même des parcelles.
L'abbesse affirmait sur son âme, devant les notaires, que pour ce présent acte n'était intervenu, ni n'interviendra aucuns dol, frande, tâche de symonie; ni aucuns autres faits vicieux et illicites; promettant avoir pour agréable tout ce qui par ses procureurs sur ce sera fait et de rembourser les frais qui seront faits.
Cet acte était fait en présence de Monsieur M. Bernard Gaye prestre, docteur en théologie et curé de la ville d'Esglaittons, Charles de Sartiges du Lavandes, escuyer, sieur de la Chaize, etc., et Jean Colombin, prestre, docteur en théologie, directeur des dames religieuses de l'abbaye de Bonnesaigne.
Signé : A. DE MONTMORIN, abbesse de Bonnesaigne, résinante ; GAVE ; J. COLOMBIN ; DE LACHAIZE ; FOULHIOUX, notre ; CHAZAL, notaire royal, reseveur.
— 69 —
Les voeux de la vieille abbesse, dont la main avait peine'à tenir la plume, furent exaucés : elle se retira des affaires ; la pension demandée fut accordée, et la religieuse qu'elle réclamait, pour la remplacer, lui fut donnée.
Mais Anne de Montmorin ne jouit pas longtemps du repos qu'elle convoitait, ni de la pension qui devait lui faire passer ses derniers jours dans une modeste aisance : l'espace d'un an.
Elle mourut l'année suivante, le 10 juillet 1683 (1).
(1) Un siècle plus tard, la famille de notre abbesse de Bonnesaigne disparut de l'Auvergne d'une manière bien tragique :
Louis-Victor, gouverneur du château de Fontainebleau, âgé de 30 ans, fut égorgé par les Sans-Culottes à la Conciergerie, après le 2 septembre, pendant que son cousin, le ministre, était massacré à l'Abbaye ;
Armand-Marc, ambassadeur en Espagne, fut empalé et porté ainsi jusqu'aux portes de l'Assemblée nationale qui applaudit;
Sa veuve, Françoise de Tanes, fut arrêtée à Passy, avec sa fille aînée, comtesse de Luzerne, et son fils Calixte-Hugues, et tous trois furent conduits à l'échafaud le 21 floréal an II (10 mai 1794).
Au pied de l'échafaud, en attendant son tour, le jeune CalixteHugues,'à chaque coup du fatal couteau, s'écriait : « Vive le roi! »
Cependant il pâlit quand vint le tour de sa mère, et il cria moins fort vive le roi ! Enfin, son tour était arrivé. Le jeune Calixte se rendit à l'échafaud sur la même charrette qui portait Elisabeth de France, soeur du roi. Cette dernière, avant d'aller rejoindre le jeune Calixte, reçut l'absolution de M. Claude de L'Hermite de Chambertrand, chanoine de Sens, qui était du nombre des condamnés.
Elisabeth de France avait trente ans ; Calixte en avait vingt, selon Boudet, ou vingt-deux, d'après Wallon. Le soir même, à onze heures, il fut enterré avec sa mère à Mousseaux.
En lui s'éteignit la famille des Montmorin de la Chassaigne.
(V. Révol. en Auvergne, p. 57).
T. XXV. 1 - 5
— 70 —
§ XXXV. — CLAUDE (GLAUDIE, CLAUDINE) DE LÉVYCHARLUS (de Ventadour) (1682-1701)
Les Lévy, continuateurs des Comborn au château de Ventadour dès 1472, portaient : Trois chevrons brisés de sable sur un champ d'or, deux épées croisées en cimier, avec cette devise : Duris dura frango.
Signalée à l'attention des chefs ecclésiastiques, le 30 mai 1682, par Anne de Montmorin résignante, la religieuse Claude de Lévy-Charlus fut, en effet, nommée abbesse de Bonnesaigne.
Selon quelques auteurs, les négociations de sa nomination, à la tète de l'abbaye de Bonnesaigne, durèrent depuis le 30 mai jusqu'à la fin de l'année 1682, et ce ne serait guère qu'en 1683 qu'elle aurait pris le gouvernement de sa communauté. D'autres disent que ce fut la même année.
Quelle était la famille de cette religieuse?
C'est par surprise que, dans l'ouvrage Trois Limousines à la Visitation de Moulins, p. 200, nous l'avons dite fille de Charles de Lévy-Ventadour et de Marie de la Guiche de Saint-Garon.
Elle est bien des Lévy de Ventadour, mais d'un cadet qui fut baron et comte de Charlus.
Elle descend en ligne directe de Jean de Lévy, second fils de Louis, baron de la Voûte, et de Blanche de Ventadour, fille unique de Louis-Charles et de Catherine de Beaufort, dame de Charlus, fille de Pierre Roger, comte de Beaufort, et vicomte de Turenne, et de Blanche de Gimel mariée en 1445. Notre abbesse Claude était fille .de Roger de Lévy,
— 71 —
comte de Charlus, marquis de Poligny, lieutenantgénéral des armées du roi, gouverneur du Bourbonnais, et de Jeanne de Montjauvent, fille de MarieFrançois, baron de Montjauvent, et d'Angélique de Vienne de Soligny, mariés en 1642.
Elle avait pour frères :
1° Charles-Antoine, seigneur de Charlus, qui épousa Marie-Françoise de Paule de Béthisy, fille aînée de Charles, seigneur de Mézières, et d'Anne Perdrier ;
2° Gilbert, prieur de Port-Dieu ;
3° Gaspard, chevalier de Malte, mort en 1675 ;
4° Madeleine, alliée à Louis de Foucquet, marquis de Belle-Isle.
Du second mariage de son père (1656) avec Louise de Beauxoncles, fille de Louis, seigneur d'Oucques, et d'Anne de l'Hopital-Sainte-Mesme, l'abbesse Claude avait pour frères :
1° Roger, mort jeune;
2° Elisabeth;
3° Catherine-Agnès de Lévy, dame de Remiremont.
Il paraît que le père de notre abbesse fut content de sa bru, Marie-Françoise de Paule de Béthisy, car il épousa, en troisièmes noces, la belle-mère de son fils aîné, Anne de Perdrier, veuve de Charles de Béthisy. Il y eut donc double mariage : le père et le fils épousèrent l'un la mère et l'autre la fille. Mais de ce troisième mariage il n'y eut pas de frères pour notre abbesse de Bonnesaigne.
Lorsque, le 30 mai 1682, Anne de Montmorin résigna en faveur de Mlle de Lévy-Gharlus, elle était religieuse à Belle-Chasse, Paris (V. Moréri, p. 759, lrecol.)
— 72 —
Les documents nous manquent sur son gouvernement de dix-huit ans à Bonnesaigne.
Aux archives départementales, nous trouvons simplement quelques procès qu'elle eut avec deux voisins de ses vastes propriétés. La première fois, elle obtint une condamnation par défaut contre les tenanciers de la Fage et ceux de Vialle Moury ; et la seconde fois, toujours à propos de rentes sur le tènement de la Fage, elle eut un procès avec Charles du Boucheron, sieur du Bugier, et Jean du Boucheron, sieur du Mas de Beyne, paroisse d'Ambrugeac.
C'est cette abbesse qui, malgré la soumission exemplaire d'Anne de Montmorin, eut la velléité de soustraire de nouveau son monastère à la juridiction de l'évêque de Limoges. Mais cette fois, avons-nous dit, le roi intervint et Bonnesaigne fut pour toujours soumis à l'autorité épiscopale (1691, 15 février).
C'est elle encore qui, de concert avec Louis-Charles de Lévy-Ventadour, l'archevêque d'Auch, et Charles de Rohan, prince de Soubise, duc de Ventadour, faisait de si vives instances auprès de sa parente, Marie-Henriette de Lévy-Ventadour, toute sa vie simple religieuse à la Visitation de Moulins, pour la décider à accepter des abbayes, malgré la promesse formelle qu'elle avait faite à sa tante mourante, l'incomparable Marie-Félicie des Ursins, veuve de l'infortuné duc Henri de Montmorency, de n'en jamais accepter (Voir Trois Limousines à la Visitation de Moulins, page 217).
Ceci se passait du temps de la Mère Louise-Henriette de Soudeilles, supérieure de Moulins pendant près de trente ans, morte en odeur de sainteté en
— 73 —
1714, et de Louise-Françoise de Soudeilles, sa petitenièce, morte également en odeur de sainteté, simple religieuse à Moulins, en 1759.
Malgré ces deux actes peu louables de la part de notre abbesse montagnarde, Claude de Lévy-CharlusVentadour fut une très bonne religieuse durant les dix-huit ans qu'elle passa à Bonnesaigne, ce où elle mourut saintement, nous dit Bonaventure de SaintAmable, en 1701 », l'année même que la duchesse de Ventadour, Marie de la Guiche de Saint-Géran, mère de la Visitandine, Marie-Henriette, rendait son âme à Dieu, le 23 juillet, à l'âge de 78 ans.
Les historiens de son temps nous disent :
ce La dernière abbesse (de Bonnesaigne) était la dame de Lévy de Charlus, qui a laissé cette abbaye assez bien accomodée, mais toujours très mal bâtie et encore plus mal située dans un pays le plus ingrat et un air plus sauvage qu'il y ayt dans le bas-Limousin, du côté des montagnes, dans l'archiprêtré de Gimel. Et par son déceds, le Roy y a nommé la dame de Beauverger de Nougon (pour Mongon) qui en jouit à présent » (Leduc, Etat du dioc. de Lim., Bull, de Lim., T. XLVI, p. 350).
Nous dirons au chapitre IXe, § III, ce qu'il faut penser de ce tableau lugubre de Bonnesaigne, que notre historien semble avoir tiré de sa propre imagination sans avoir jamais visité les lieux qu'il décrit sous de si sombres couleurs.
Claude de Lévy est l'avant-dernière abbesse de Bonnesaigne ayant dans les veines du sang des Ventadour, et la dernière qui en ait de la famille des papes de Rosiers, Clément VI et Grégoire XI.
— 74 —
g XXXVI. — CATHERINE DE BEAUVERGER-MONTGON (1701-1747)
Encore une fille de l'aristocratique Auvergne pour abbesse de Bonnesaigne ! C'est ce que nous affirme M. Serres, dans son intéressant ouvrage : ce La Révolution en Auvergne, T. III, p. 53 », en disant que la famille de Beauverger-Montgon est de la paroisse de Grenier, près Blesle.
Catherine était prieure de Villevaleix quand le roi la nomma abbesse.
Le 26 janvier 1706, cinq ans après sa prise de possession, toutes les religieuses de Bonnesaigne, au grand complet, étaient réunies au parloir de la communauté ; c'étaient :
Catherine de Beauverger-Montgon, abbesse ; Marguerite de la Brosse, prieure ; Peyronne de Barmontet ; Gabrielle Tineau de Vennac ; Jeanne de Saunade ; Peyronne Fraisse ; Gabrielle de la Mothe ; Marguerite de Lacour ; Françoise de Servientis ; Marguerite Duran ; Marie de Laprade ; Jeanne de Saint-Aubin ; Léonarde Lorte ; Marianne de Fayac, et Marguerite de Gibanel, toutes dames professes.
Pourquoi cette assemblée solennelle ?
Pour recevoir à la profession Mlle Françoise de Vénis, soeur des .Anges, novice dans l'abbaye depuis quinze mois, âgée de dix-huit ans ; fille de messire François de Vénis, chevalier, seigneur des Oussines, de Fernoël (Fournol?), baron de Peyrelevade et autres places, et de noble dame Marie-Henriette de SaintMartial de Conros, présents et résidant ordinairement en leur château des Oussines, paroisse de S'-Merd.
— 75 —
Le seigneur de Marsillac et la dame de Saint-Martial, père et mère de la Soeur des Anges, assuraient à leur fille, pour qu'elle fût nourrie et entretenue comme les autres dames de choeur, outre la dot et l'habit de profession, de leur bon gré et agréable volonté, une pension viagère, extinguible à son décès, de trente livres annuelles que devaient servir Jean Grandaud et François Mazaux, leurs fermiers du village de la Eondilière.
Etaient présents à cet acte, reçu par Laplène, notaire royal, messire Antoine Dupuy, sieur de S'-Pardoux, prêtre, docteur en théologie, curé de Meymac, messire Jean Dufaure, prêtre, curé de Perets, et signèrent à l'original seize religieuses, dont on trouvera les noms aux pièces justificatives, et MM. Marsillat de Vénis, de Gonros Marcilliac, Soudeilles, Fayat, du Faure, S*-Pardoux, prêtre, et Laplène, notaire royal.
Acte contrôlé à Meymac le 26 janvier 1706, fol. recto 24 n° 3, reçu onze sous. — LAPLÈNE.
(Communication de M. Champeval. — V. Sigillog., p. 418).
A part cette pièce importante, qui nous donne le
personnel de l'abbaye au commencement du xvme
. siècle, nous sommes sans archives sur le règne,
pourtant long de 45 ans, de l'abbesse de Beauverger.
La soeur de l'heureuse professe était Catherine de , Veinis, qui, le 9 mai 1702, avait épousé FrançoisAimé Joussineau de Fayat, écuyer, seigneur de Beffou et de La Valade, paroisse de Ghamberet, veuf de Françoise de Masvalier, dame de La Valade.
Voici les trois ou quatre faits que nous avons pu recueillir sur le compte de l'abbesse de Montgon :
— 76 —
En 1734, en sa qualité de prieure de Villevaleix, elle fait porter en hommage, par son frère, à l'évêque de Limoges, le susdit prieuré et les revenus y attachés (G. Préfect. de Limoges, T. Ier).
En 1740, audience à Uzerche, pour dame Catherine de Montgon, abbesse de Bonnesaigne (Sénéchaussée d'Uzerche, p. 17).
En 1741-42, nous trouvons également à la Sénéchaussée d'Uzerche : ce Rôle de dépenses de la même abbesse (S. B., p. 31).
En 1747, 15 juillet, deux mois avant sa mort, elle consentit une rente annuelle, au capital de 2,000 livres, à Mlle Marie-Victoire Laval, originaire de La Fage, paroisse de Saint-Pardoux-le-Vieux, rente qui fut fidèlement servie par l'abbaye jusqu'en 1790. Mais, sous cette date, s'en suivit une explication assez sérieuse dont nous parlerons en son lieu, sous l'abbesse Green de Saint-Marsault.
Catherine de Beauverger-Montgon mourut à Bonnesaigne, le 13 ou le 17 septembre 1747.
Juste quarante-sept ans après la mort de cette abbesse, la famille de Beauverger-Montgon fut rudement éprouvée par la Révolution.
Au moment où l'orage menaçait le plus, JacquesFrançois de Cordeboeuf-Beauverger, comte de Montgon, quitta l'Auvergne pour se rendie à Arras, dont il avait été nommé gouverneur militaire. Il emmenait avec lui sa famille et une servante dévouée, appelée Thérèse Chazelles, fille de son régisseur de Védrines.
L'orage venait d'éclater.
Deux fils du comte, Jacques-François-César et JeanAntoine, tous deux officiers au régiment de Cam-
— 77 —
braisis, furent arrêtés. Ils faisaient partie du fameux convoi de prisonniers qui furent massacrés sur la route de Paris à Orléans, le 9 septembre 1792. Grâce au dévouement d'un soldat de leur régiment, ils purent échapper à la boucherie.
Il n'en fut pas ainsi de leurs parents d'Arras. Le proconsul Joseph Lebon y arriva et terrorisa la ville.
On avait pressé le gouverneur d'émiger. Mais M. de Montgon avait noblement refusé, disant que, placé à son poste par le roi, il y resterait tant que le roi ne l'aurait pas relevé.
Mais bientôt il dût quitter forcément son poste de gouverneur de la citadelle d'Arras.
ce Pendant qu'il se cachait lui et les siens, dit Boudet, Thérèse les nourrissait en faisant de la dentelle. Quand ils furent incarcérés, elle se voua à l'adoucissement de leur captivité... Quand elle avait gagné quelque argent, elle achetait des provisions et les portait à la prison
ce Les femmes étaient surveillées plus rigoureusement que les hommes et Thérèse ne pouvait voir ces dames, Mme de Montgon et sa fille Delphine, dame de Saint-Cyr, mais elle obtenait sans difficulté de voir le prisonnier, son maître.
ce Un jour, M. de Montgon lui donna sa tabatière.
— Tiens, lui dit-il, sans aucune émotion apparente, tu donneras cela à ta maîtresse quand tu la verras ».
— ce Vous ne prisez donc plus? lui observa la jeune fille — Non, je ne priserai plus ! » répondit simplement M. de Montgon ; et en même temps il lui remit sa montie dont il avait arrêté le ressort, comme
— 78 —
pour mieux donner à ce souvenir suprême l'empreinte de la mort.
Il venait d'être condamné.
6. Thérèse ne connut l'exécution que par la rumeur publique ; elle apprit par hasard qu'elle venait d'avoir lieu; elle accourut et ne put voir que les ruisseaux de sang.
ce La date de la condamnation, ajoute Marcellin Boudet, n'a été précisée ni par les témoins, ni par M. d'Espinchal. Elle ne figure pas dans la liste officielle de celles qui sont attribuées à Lebon ».
Le commandant de la citadelle d'Arras avait, outre les deux fils mentionnés pins haut, un fils aîné, le marquis de Montgon, qui épousa, au retour de l'émigration, M1Ie de Baurron, et c'est dans le couvent de Baurron qu'il assura une retraite à Thérèse Chazelles, où ses descendants lui servirent jusqu'à sa mort une pension en reconnaissance de son dévouement dans les temps d'épreuves » (Tribunaux d'Auvergne, p. 68 et 284. — Hisl. de la Révol. en Auvergne, T. III, p. 53, par M. J.-B. Serres, 1895).
Après cette digression, revenons à Bonnesaigne, quarante-sept ans en arrière, c'est-à-dire au 17 septembre 1747, date de la mort de l'abbesse Catherine de Beauverger-Montgon, et parlons de Marie-Gabrielle de Saint-Chamant, qui lui succéda.
g XXXVII. — MARIE-GABRIELLE DE SAINT-CHAMANT (1747-1758)
De la même famille que Marie de Saint-Chamant, trentième abbesse de Bonnesaigne (1537-1555), Marie-
— 79 —
Gabrielle descendait en ligne directe de Henri, gouverneur de Thérouane, de Verdun et de Marienbourg, et frère de l'abbesse Marie.
Nous l'avons déjà dit, cet Henri de Saint-Chamant est le premier gentilhomme de sa famille qui porta, au haut de l'écu de ses armes, une engrelure qu'Henri III lui permit d'ajouter, comme marque d'honneur, pour avoir vaillamment défendu Thérouanne en 1553, deux ans avant la mort tragique de sa soeur, abbesse de Bonnesaigne.
Cette engrelure représente une palissade qu'il fit placer devant la brèche du rempart de la place assiégée, avec des gabions et des fascines, et d'où, par un feu continuel, il trouva le moyen d'empêcher l'escalade.
Les armes de la seconde abbesse de Saint-Chamant sont donc un peu différentes de celles de la première ; elles s'analysent ainsi : ce De sinople à trois faces d'argent ; une engrelure de même en chef ».
On les voit encore à la clé de voûte de l'église de Saint-Chamant, près Argentat, et à la clé de voûte de la tour, seul reste du vieux castel.
En 1750, Marie:Gabrielle s'ennuyait à Bonnesaigne; et, peu désireuse de continuer l'oeuvre de relèvement de son abbaye qu'avaient si bien prise à coeur les intrépides abbesses de Beaufort-Canillac, Anne de Montmorin et Claudine de Lévy-Charlus, elle présenta à l'évêque de Limoges, à la suite de l'audition de ses religieuses, un état détaillé du délabrement dans lequel se trouvait l'abbaye de Bonnesaigne. Cet état se trouve sur les registres du secrétariat de l'évêché de Limoges (V. Sénéch. de Tulle, p. 296).
— 80 —
C'est tout ce que nous avons trouvé, jusqu'ici, sur l'administration de onze ans de l'abbesse MarieGabrielle de Saint-Chamant.
A l'exception pourtant de certaines autres de ses devancières, et de sa parente surtout, elle tint à laisser ses cendres au sein de sa communauté, où elle mourut le 19 juin 1758.
Elle eut pour remplaçante Léonarde-Gabrielle d'Ussel de Châteauvert.
g XXXVIII. — LÉONARDE-GABRIELLE D'USSEL DE CHÂTEAUVERT (1758-1780)
Cette abbesse portait : ce D'azur à la porte d'or verrouillée de sable, accompagnée de 3 étoiles d'or 2 et I y. Ces armes sont les armes de la ville d'Ussel, dont la famille d'Ussel a tiré son nom.
Cette abbesse, toute montagnarde, est pur sang Ventadour-Gomborn, famille sur laquelle se greffa, en 1472, une branche de la maison de Lévis. La famille d'Ussel est en effet une branche de la famille de Ventadour : un cadet de Ventadour, du nom de Guillaume, fils puîné d'Ebles III et d'Agnès de Bourbon, recevant de son père une partie de la seigneurie d'Ussel, quitta le nom et les armes de son père pour prendre le nom et les armes d'Ussel, de même qu'un cadet de Comborn, recevant de son père la seigneurie de Ventadour, avait peu auparavant quitté le nom de son père pour prendre le nom et les armes de Ventadour. Ce fait était fréquent au Moyen-âge et s'est présenté souvent dans notre province.
Le premier acte public qui nous soit parvenu de
r- 81 —
ces cadets de Ventadour, qui portent dès lors le nom d'Ussel, est la fondation de l'abbaye de Bonnaygue (près d'Ussel), manifestation frappante de l'esprit chrétien qui a toujours animé cette famille et a assuré sans doute sa conservation jusqu'à nos jours. Guillaume et Pierre d'Ussel, son îrève(GalliaChristia?ia, 11-203), fondèrent en effet, antérieurement à 1157, l'abbaye de Bonnaygue, qu'ils soumirent à saint Etienne d'Obazine, qui y mourut en 1159. Leurs enfants y firent de nombreuses donations, dont la mention existe sur des extraits authentiques du Gartulaire de l'abbaye, qui ont été faits jusqu'en 1220.
Les d'Ussel restèrent coseigneurs d'Ussel avec les Ventadour, puis avec les Lévis-Ventadour jusqu'en 1612; à cette date, les Lévis-Ventadour leur achetèrent leur part de seigneurie ; en 1658, les Lévis-Ventadour achetèrent la dernière part qu'ils ne possédaient point, de la famille d'Anglars, qui est une branche de la famille d'Ussel.
A cette époque, d'ailleurs, les d'Ussel n'habitaient plus leur fief dans les environs d'Ussel : en 1522, le chef de la maison avait épousé Charlotte de Rochefort, en qui s'éteignit la puissante maison de RochefortChâteauvert ; elle lui porta l'importante baronnie de Châteauvert, où ses descendants habitèrent jusqu'à la Révolution. Nous donnons ce détail pour expliquer ce nom de Châteauvert ajouté par notre abbesse à son nom patronymique.
La famille d'Ussel existe encore. La branche aînée habite la Creuse ; la branche cadette habite depuis un siècle Neuvic d'Ussel et est fort connue en Corrèze. Le comte Jean-Hyacinthe, mort il y a dix ans, agro-
— 82 —
nome distingué et coeur bienfaisant, assisté d'une femme éminente, a propagé pendant cinquante ans les meilleures méthodes agricoles dans la ferme-école qu'il avait créée à Neuvic ; il a fondé l'hospice de la ville, et fait revivre l'ancien monastère de St-Projet, fondé en 1489 par Marquis, seigneur de Scorailles, et Louis de Ventadour. Il était beau-frère du poète Victor de Laprade, et de Félix de Parieu, président du Conseil d'Etat sous l'Empire, qui, étant ministre de l'instruction publique, avait présenté, défendu et fait promulguer devant la Chambre la célèbre loi Falloux. Il a laissé deux fils : le comte d'Ussel, inspecteur général des ponts et chaussées et écrivain distingué, qui lui a succédé à Neuvic et est fort connu en Corrèze, et le baron Paul d'Ussel, qui n'habite point le pays mais en conserve religieusement le souvenir.
Léonarde-Gabrielle était abbesse des Allois (HauteVienne), où elle fut remplacée par Marguerite d'Ussel, sa nièce, quand elle fut appelée à régir l'abbaye de Bonnesaigne. A son titre d'abbesse elle ajouta celui de prieure de Villevaleix, ce qu'avait fait avant elle Catherine de Beauverger de Montgon.
Notre abbesse appartenait à une famille vraiment patriarcale. Son père était l'aîné de six garçons, tous hommes d'église ou d'épée :
François, chevalier de Malte, commandeur de Maissonnice, mort en 1762;
Léonard, chevalier de Malte, commandeur de Tortebesse, mort en 1754 ;
Léonard, chevalier de Malte, grand bailli de la langue d'Auvergne, mort en 1761 ;
— 83 —
Guy, chanoine, comte de Brioude ;
Autre Léonard, oratorien sécularisé, qui vivait dans sa famille, accablé d'infirmités.
Quant à Léonarde-Gabrielle, l'abbesse de Bonnesaigne, elle était fille de Philibert, frère aîné des précédents, et de Jeanne de Joussineau de Tourdonnet. Ce Philibert avait été lui aussi reçu chevalier de Malte à 15 ans, en 1698, et s'était fait relever par le Souverain Pontife en 1706, et avait quitté l'ordre pour se marier la même année.
Les frères de notre abbesse étaient :
Guy, qui continua la famille;
Henri, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, qui prit du service dans l'armée française et fut tué à Fontenoy ;
François, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Saint-Georges, commanderie dont le siège était à Lyon ; il mourut à Malte.
Les neveux de notre abbesse étaient encore plus nombreux ; c'étaient :
Marc-Antoine, marquis d'Ussel et baron de Châteauvert et de Crocq, tige de la branche aînée de la maison d'Ussel aujourd'hui fixée dans la Creuse ;
Jean-Hyacinthe, comte d'Ussel et seigneur de Charlus-le-Pailloux, premier maire de la ville d'Ussel en 1789, tige de la branche cadette aujourd'hui fixée dans la Corrèze ;
Valérie, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ;
François, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Saint-Georges. Il présida à Lyon le dernier chapitre de la langue d'Auvergne le 2 juin 1792, et peu après fut tué à Malte ;
— 84 —
Marguerite, abbesse des Àllois, déjà nommée ;
Léonarde, religieuse au monastère de Saint-Genèsles-Monges (Puy-de-Dôme) ;
Marie, mariée au baron de Gain de Linars.
Notre abbesse, Léonarde-Gabrielle, était une personne très distinguée d'esprit, fort active, s'entendant bien aux affaires temporelles, et par suite aimant à s'en occuper, maintenant le bon ordre dans sa communauté et y dépensant le charme d'un esprit brillant et une grande affabilité de manières. Elle trouvait à Bonnesaigne une abbaye toute pleine des souvenirs de sa famille et à chaque instant les traces des munificences dont les Ventadour, ses ancêtres, avaient comblé l'antique abbaye montagnarde qu'elle gouvernait. Que n'eût-elle la vertu de s'y plaire ! Sans vouloir juger ici de l'opportunité de son départ pour Brive, car bien des éléments nous manquent pour pouvoir apprécier en pleine connaissance de cause, nous devons regretter qu'elle ne se soit pas donné la mission de relever les quelques ruines qu'avaient pu laisser par terre, en mourant, deux de ses parentes, toujours l'incomparable abbesse de Beaufort de Canillac et Claude de Lévy-Charlus. Bonnesaigne pourrait encore avoir son abbaye debout, quoique sans religieuses, comme Meymac, Valette, Saint-Angel et tant d'autres dans le diocèse.
Un an après son installation, en effet, nous trouvons l'abbesse de Châteauvert, non plus à Bonnesaigne, mais bien à Ussel même, avec ses religieuses. C'est ce qui résulte clairement d'une procuration qu'elle délivra le 11 février 1759. Elle avait obtenu d'un vieil oncle pieux et serviable, Léonard d'Ussel,
- 85 —
commandeur de Maissonnice, résidant à Bonnesaigne, qu'il gérerait, en son absence, les biens de l'abbaye. Nous voyons en effet que, sous la date indiquée, elle lui donne pouvoir de percevoir les revenus que maître Pigeyrol, curé de Darnets, devait sur son bénéfice aux religieuses de Bonnesaigne, en vertu de l'union de 1348. Nous lisons sur le double de cette procuration, que possède la cure de Darnets, ces paroles non équivoques, qu'on ne peut attribuer à un lajjsus plumas du notaire Despert :
ce Par devant les notaire et témoins soussignés, en la ville d'Ussel en Limousin, et en deçà de la grille du parloir des daines religieuses de cette ville, a été présente en sa personne, Révérende Dame, Madame Léonarde-Gabrielle d'Ussel de Châteauvert, abbesse de l'abbaye de Bonnesaigne et à'Ussel ».
Ussel n'était pour elle qu'une étape.
Pendant ce séjour momentané dans la capitale du duché, se poursuivaient activement les démarches qu'avait entreprises l'abbesse Marie-Gabrielle de SaintChamant, depuis dix ans, de faire transporter l'abbaye de Bonnesaigne sous un ciel plus clément.
Le 18 du mois de juin 1760, en effet, l'abbesse de Châteauvert, avec ses vingt-cinq religieuses, invoquant plusieurs raisons que nous donnerons dans un autre chapitre, prenait son vol de Bonnesaigne à Brive, où l'attendaient vingt-neuf cellules dans l'abbaye de Sainte-Glaire.
Nos bénédictines divorçaient avec des ruines pour épouser une masure, qu'elles ne purent relever pas plus que celle de Bonnesaigne.
Pendant son séjour de vingt ans sur les bords de la T. xxv. i - G
- 86 —
Corrèze, Léonarde-Gabrielle d'Ussel n'eut pas plus la tranquillité absolue qu'elle ne l'aurait trouvée sur les rives de la Haute-Luzège.
Sept ans après son exode, nous lisons : ce Serment décisoire sur le contenu d'une quittance égarée, entre messire Joseph de Plaignes, l'abbesse de Bonnesaigne, dame Gabrielle de Châteauvert, et une de ses religieuses, la dame de Saint-Félix de Meallet » (Arch. départementales).
Et l'année suivante : ce Requête de l'abbesse de Bonnesaigne concernant la réunion de son monastère de Sainte-Claire de Brive à ladite abbaye » (Sénéch. ? de Tulle, p. 296 et 297).
L'année d'avant (1766), elle avait eu aussi à plaider avec son parent, Charles de Rohan, prince de Soubise, duc de Ventadour, qui venait de lui enlever, depuis son départ de Bonnesaigne, le droit de chauffage que l'antique abbaye avait dans la forêt de Ventadour depuis le vicomte Bernard, neveu de l'abbesse Blanche II de Ventadour.
Enfin, sentant ses forces diminuer, notre abbesse, lasse de lutter, fut-elle prise de regret d'avoir quitté nos montagnes, ou bien de nostalgie loin de la terre natale? Je ne sais. Toujours est-il qu'elle ne voulut pas finir ses jours à Brive. La vénérable LéonardeGabrielle d'Ussel, pleine de jours et de mérites, se retira dans sa famille à Ussel, et c'est là qu'elle s'éteignit saintement, le 12 février 1780.
C'est la dernière abbesse de Bonnesaigne sortie du sang des Ventadour-Comborn.
Françoise-Gabrielle Green de Saint-Marsault lui succéda.
— 87 —
g XXXIX. — FRANÇOISE-GABRIELLE GREEN DE SAINT-MARSAULT (1780-1805)
Cette abbesse portait sur un cartouche, écusson en losange : De gueules, -à trois demi-vols d'argent ALIAS d'or, timbré d'une couronne de marquis et surmonté d'une crosse abbatiale (M. J.-B. Champeval).
Originaire d'Irlande, la famille Green se fixa au château du Verdier, paroisse d'Eyburie, près Uzerche.
Au xvie siècle, nous y trouvons Brandelis de Saint.Marsault, époux de Jeanne de Beaudeduit. Ils eurent Antoine, marié, par contrat du 15 mai 1571, à Catherine de Pierrebuffière^ fille de François, seigneur dudit lieu, et de Jeanne de Pierrebuffière, dame de Chamberet.
Notre abbesse avait trois frères et une soeur :
1° Le marquis du Verdier, seigneur deVernéjoux, — une des propriétés de la famille Green, située sur la paroisse de Gondat, — lieutenant des seigneurs les Maréchaux de France (V. à la note 7 sa conduite envers le curé de Tarnac, au sujet des dîmes des Franches).
2° Le vicomte du Verdier, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie.
Nous allons les trouver tous les deux à la prise de possession de l'abbesse de Saint-Marsault.
3° L'abbé Joseph Green de Saint-Marsault, né à Uzerche, vicaire-général de Meaux, premier aumônier de Mme Adélaïde de France, tante de Louis XVI ; nommé, par bulles du 16 janvier 1769, abbé d'Obazine; mis en possession le mars 1770; démissionnaire
— 88 —
vers la fin de décembre 1780 pour l'évêché de Pergame in partibus infdelium auquel on l'avait nommé la même année que sa soeur fut choisie pour abbesse de Bonnesaigne. Etait-il déjà sacré, quand peu de jours après sa démission d'abbé, sa soeur, Mme de Saint-Marsault, fut installée à Brive? Emigré en 1790, cet évêque de Pergame mourut à Rome en 1818, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans.
Le mémoire du curé de Tarnac, toujours au sujet des dîmes des Franches, nous donnera aussi, sur son compte, quelques détails piquants durant son administration de l'abbaye d'Obazine, qu'il semble n'avoir guère jamais habitée (Voir note 7).
4° Enfin, elle avait une soeur, religieuse à la Visitation de Tulle, sous la date du 13 juin 1787 (V. chapitre IV, g IX : Darnets, à la fin).
De nos jours, durant le second Empire, la famille de Saint-Marsault était représentée, dans la Corrèze, par deux frères, qui n'ont pas laissé de postérité mâle.
L'aîné, ancien préfet de Versailles, est mort sénateur, possédant la terre et le château du Verdier.
Le plus jeune habitait le Puy-Desjardelles, paroisse de Perpezac-le-Blanc ; sa veuve vit encore et nous répond qu'elle « possède toujours le bréviaire de l'abbesse de Bonnesaigne », et elle ajoute : ce Celui qui a été chargé de mettre en ordre tous les papiers de famille de la branche du Verdier est M. le vicomte Maurice de Saint-Marsault de Chatelaillon, à Le Roullet, par la Jarrie » (Charente-Inférieure).
Avis à ceux qui désireront compléter notre travail !
La dernière abbesse de Bonnesaigne est donc bien
— 89 —
du même coin de terre qui donna le jour au troubadour aventurier Gaucelme Faydit, d'Uzerche, et au moine antipape, Maurice Bourdin, le contemporain et l'émule du vicomte Ebles II, de Bernard de Ventadour et d'Agnès de Montluçon.
Françoise-Gabrielle Green de Saint-Marsault prit possession de son abbaye le 3 janvier 1781, avant midi.
Cette prise de possession, faite à Brive par devant notaire, fut très solennelle.
L'abbesse, nommée par le roi et instituée par le pape, tenant à la main les bulles de sa nomination fulminées par l'official général du diocèse de Limoges, sur les conclusions de M. le promoteur général, fut conduite à l'église de Sainte-Glaire, où se tenait le notaire, par messire Jean-Jacques Dubois, baron de Saint-Hilaire et de Chameyrat, ancien syndic du couvent et monastère de Sainte-Claire.
Elle était accompagnée de M. le marquis du Verdier de Vernéjoux, lieutenant des seigneurs les maréchaux de France (V. note 7 : Vernéjoux, terre de Condat) ;
De M. le vicomte du Verdier, chevalier de S'-Louis, ancien capitaine d'infanterie, ses frères, demeurant au château du Verdier, paroisse d'Eyburie ;
De M. le marquis de Lavaur, parent de la dame abbesse, demeurant au château de Balesme, paroisse d'Affieux ;
De M. le comte de la Renaudie, chevalier honoraire de l'ordre de Malte ;
De M. le commandeur de Félines de la Renaudie, son frère, commandeur de Bellecombe ;
De M. le chevalier de Laqueille de Ghâteau-Gay,
— 90 —
chevalier de Malte, officier dans le régiment des dragons de Monsieur ;
De M. Jean de Corn, seigneur du Peyroux;
De M. Dubois de Saint-Hilaire, baron de Favars, officier dans le régiment de Condé-dragons, ces deux derniers demeurant à Brive ainsi que les seigneurs de Félines de la Renaudie, et le seigneur de Laqueille de Château-Gay demeurant au château de Saint-Jal, paroisse du même nom ;
De messire Jean de Gilibert, écuyer, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie, seigneur de Merlhac et du Teinchurié, demeurant à Brive.
Toutes les cloches de la communauté sonnaient à grandes volées.
A la porte de l'église l'attendait messire Jean-Baptiste Serre, prieur de la Tour Saint-Austrille, chanoine du chapitre Saint-Martin de Brive, officiai du Bas-Limousin, fondé de la procuration de M. l'official de Limoges en date du douze décembre dernier, signée : Pétiniaud, vice-gérant l'officialité ; du bas-promoteur général, présents témoins, et plus bas Dubreuil, secrétaire ; scellé du sceau des armes de l'évêque de Limoges, pour installer ladite abbesse en vertu du brevet du roi, de la bulle du pape et de la fulminalion épiscopale.
M. l'official Serre, en habits sacerdotaux et en étole, avait à ses côtés :
Messire Dominique de Serres, prêtre, chanoine honoraire du chapitre de Saint-Martin, promoteur de l'officialité de Brive ;
Messire Antoine-Louis-Raymond de Salis, écuyer, prêtre subdélégué de l'intendant de Limoges ;
— 91 —
Messire Guillaume de Gilibert, prêtre, prieur commendataire ;
De Muzy, chanoine, ex-curé de Saint-Martin de Brive ;
Et M. François Gruveiller, prêtre-vicaire de la paroisse de Saint-Nicolas d'Uzerche, demeurant en la dite ville.
L'abbesse, devant cette brillante assemblée, requit M. l'official de vouloir bien l'installer dans l'église de l'abbaye.
Alors, l'official lui présenta le goupillon d'eau bénite et la conduisit dans le sanctuaire où elle fit sa prière au très saint sacrement, pendant que les dames religieuses de Bonnesaigne chantaient, dans le bas-choeur, l'hymne du Veni Creator.
Quand l'adoration de l'abbesse fut finie, M. l'official se présenta à la porte du bas-choeur, à côté du sanctuaire, et enjoignit aux dames religieuses d'ouvrir les portes et de recevoir leur nouvelle abbesse.
Ce qui fut exécuté à l'instant.
Alors l'abbesse, suivie de l'official, de toute la compagnie et du notaire, entra et monta au choeur par le grand escalier.
Après avoir fait sa prière à la sainte Vierge, patronne de l'abbaye, elle alla prendre place dans son siège abbatial.
Alors l'official lui présenta la crosse et l'aspersoir, qu'il lui mit en main ; et l'abbesse, ainsi armée du signe de son autorité, donna la bénédiction à ses religieuses, qui toutes en la recevant, une et chacune, reconnurent Mme de Saint-Marsault pour leur vraie et légitime abbesse.
— 92 —
Après la cérémonie du choeur, arrive celle de la salle de la communauté, puis celle du réfectoire et de l'infirmerie, où elle prit la première place en signe de possession.
De là, elle fut conduite dans la maison abbatiale, composée de cuisine, salons, parloirs et appartements, qu'elle parcourut et trouva en bon état et bien solide.
Après cette visite à travers les divers bâtiments de l'abbaye, dont nous dirons le délabrement dans un autre endroit de cet ouvrage, M. l'official reconduisit Mme l'abbesse au choeur des religieuses, où on entonna le Te Deum en actions de grâces.
Après avoir dit l'oraison, M. l'official déclara solennellement, à haute voix, aux religieuses de Bonnesaigne et à celles de l'ancien monastère de Sainte-Claire, qu'en vertu des bulles, fulmination et procuration de M. l'official général de Limoges, il installait et mettait la dame Françoise Green de Saint-Marsault en possession de l'abbaye de Notre-Dame de Bonnesaigne, ses annexes et dépendances, et par exprès des droits de collation et de nomination aux bénéfices du patronage de ladite abbaye, et nommément aux droits de présentation aux cures et vicairies perpétuelles de Villevaleix, de Darnets, de Combressol, de Maussac et Ménoire, diocèse de Limoges ; de Champagnac et Veyrières, au diocèse de Clermont, et de tous les autres bénéfices qui pourraient dépendre de l'abbaye de Bonnesaigne et prieurés y annexés pour, par ladite dame, jouir tant des droits que de tous les honneurs, fruits, profits, revenus et émoluments appartenant à l'abbaye ;
— 93 -
Commandait à tous vassaux, censitaires et sujets et officiers dépendant de l'abbaye de la reconnaître en la dite qualité d'abbesse de Bonnesaigne.
Entendirent ces déclarations de M. l'official les soeurs dont les noms suivent :
Mmes DE CHÈZES, prieure; DE LAPRADE, procureuse; D'ESCLAVAR, DUVERDIER, DE LAGRANGE, DE MEILHAC, DE GRANDSAGNE, DE MERRY, DE MONTLOUIS, DE CRAZAR et FABRE, toutes bénédictines.
Quand l'official eut fini, l'abbesse réitéra au SaintSiège le serment de fidélité qu'elle avait déjà prêté, et promit de donner toutes ses attentions à la célébration du service divin, dans son monastère.
Le procès-verbal de tout ce qui précède ayant été fait, et lu à haute voix, sans aucune opposition, la nouvelle abbesse en requit acte qui lui fut octroyé par le notaire et qu'elle signa avec toutes les religieuses, officiai, ecclésiastiques, seigneurs et notaire dont les noms suivent :
Soeur Green de Saint-Marsault, abbesse de l'abbaye royale de Bonnesaigne ;
Serre, officiai ;
Soeur de Chèzes, prieure ;
Soeur de Laprade, procureuse ;
Soeur Esclavar, soeur Duverdier, soeur de Lagrange, soeur Meilhac, soeur Mary, soeur Montlouis, soeur du Glaux-Crazar ;
Raymond de Salis ; Laval, chanoine, pro-notaire ; Dubois de Saint-Hilaire ; de Gilibert, chanoine, curé de Brive ; Duverdier ; Lachaux ; Cruveiller, prêtre ; Saint-Marsault ; le chevalier Armand de Laqueille, capitaine de dragons; Félines de la Renaudie; de
— 94 —
Gilibert ; de Corn du Peyroux ; baron de Saint-Hilaire, et Margûa, notaire apostolique.
Contrôlé à Brive, le même jour, par Dampière, qui reçut sept livres.
La teneur de la procuration, que nous reproduirons aux pièces justificatives, à la fin de l'ouvrage, nous apprend que M'ne de Saint-Marsault, née vers 1749, était déjà religieuse professe à Saint-Corentin, diocèse de Chartres, quand elle fut élue abbesse de Bonnesaigne (V. Sigillog., p. 561).
C'est en vertu du Concordat passé entre François Ier et le Saint-Siège, que le roi de France nommait à l'abbaye de Bonnesaigne.
Les lettres d'institution de Mme de Saint-Marsault sont datées de Rome le 6 d'avril 1780, dûment certifiées et contrôlées à Paris le 27 du même mois par MM. de Cressac et le sieur des Brières, notaires royaux de la Curie Romaine.
Cette cérémonie nous fixe sur celles qui eurent lieu antérieurement, en pareilles circonstances, à Bonnesaigne.
Ainsi solennellement installée, Mme de S'-Marsault se mit résolument à l'oeuvre, dès les premiers jours de son arrivée au pouvoir.
Ainsi que nous l'avons dit, l'année même de son installation, elle fit renouveler, par devant notaires, tous les baux des fermiers des différentes terres relevant de la seigneurie abbatiale de Bonnesaigne (1781). C'est elle qui lança, aux trousses de l'un d'eux, les huissiers de Meymac qui, à sa requête, pratiquèrent des saisies sur l'avoir de messire J.-François Sourzat, seigneur du Monteil (V. ci-avant chap. II, § Ve) (1783).
— 95 —
Huit ans plus tard (1791), elle eut une autre affaire avec l'archiprêtre de Gimel.
On se souvient que Mme l'abbesse de Beauverger avait consenti (15 juillet 1747) une rente annuelle, au capital de 2,000 livres, à MUe Marie-Victoire Laval, originaire du lieu de la Fage, paroisse de S'-Pardouxle-Vieux.
Cette demoiselle, devenue infirme et malade, se retira auprès de son neveu, Guillaume Lalaye, archiprêtre de Gimel, et par un testament du 13 avril 1783 le fit son héritier général. Elle ne mourut pourtant que le 20 août 1790 et fut inhumée le lendemain, à Gimel, en présence de M. Soumailles, curé de Vitrac, du sieur Laval, vicaire de la paroisse, assurément son parent, et du sieur Démichel, vicaire.
L'abbaye de Bonnesaigne tint ponctuellement les conventions et paya exactement le revenu de cette rente jusqu'en juillet 1790, ainsi que l'établit la déclaration que Mroe de Saint-Marsault envoya le 27 août 1791 à MM. les administrateurs du district d'Ussel :
ce Je soussignée, abbesse de Bonnesaigne, déclare et certifie avoir toujours payé, à Mademoiselle Laval, le revenu de la rente constituée, à elle due par l'abbaye de Bonnesaigne, jusqu'au mois de juillet 1790 qui lui est due au capital de 2,000 livres, en foi de quoi j'ai signé
GRAIN DE SAINT-MARSAUD,
Abbesse de Bonnesaigne ».
Sur ces entrefaites, la nation s'étant emparée de l'administration des biens du clergé et des communautés religieuses, le receveur du district d'Ussel eut
— 96 —
ordre de payer, à qui de droit, le revenu de la dite créance ; c'est ce qu'il fit pour l'année de juillet 1789 à juillet 1790. Mais l'année suivante surgirent certaines difficultés.
C'est alors que l'archiprêtre de Gimel adressa la note suivante aux administrateurs du district d'Ussel :
« A MM. LES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT D'USSEL,
« Le 27 août 1791, M. Guillaume Lalaye arcbiprêce
arcbiprêce de Gimel est déclaré en qualité d'héritier de la
ce demoiselle Laval sa tante, par les membres de
ce l'administration du district d'Ussel, créancier de la
ce Nation, d'une somme de 2000 livres en capital,
ce dérivant d'une rente constituée le 15 juillet 1747
« par Madame de Beauverger alors abbesse de Bon»
Bon» Cette rente avait été servie jusqu'au mois
ce de juillet 1789 par la ci-devant abbesse de Brive.
ce Le receveur du district avait payé cette même rente
ce pour l'échéance de l'année 1790, mais il lui est
ce encore dû celle échue le 15 juillet dernier. Le rece
rece de cette rente, distraction faite des dixièmes
ce et vingtièmes, s'élève à la somme de quatre-vingtce
quatre-vingtce livres que l'exposant vous prie de faire payer
ce par le receveur de votre district.
ce LALAYE ».
Cette note était accompagnée de la déclaration de l'abbesse que nous venons de reproduire.
Malgré toutes ces précautions, le paiement du revenu de cette créance ne se faisait pas ; c'est ce que nous apprend une lettre de l'abbesse.
Sous la date du 21 octobre 1791, Mme Green de Saint-Marsault écrivait de Brive, à M. l'archiprêtre
— 97 —
de Gimel qui l'avait prévenue de ce retard, en lui annonçant la mort de sa tante en même temps :
ce Je partage vos regrets, Monsieur, sur la perte de ce M1Ie votre tante que j'ai recommandée aux prières de ce la communauté.
ce II m'aurait été difficile, Monsieur, d'acquitter les ce charges de l'abbaye de Bonnesaigne,. les fermiers ce ne m'ayant pas payé. Si je suis payé des arrérages « je ferai honneur. Si au contraire, le district s'en ce empare, il faudra que ce soit à lui qu'il faut vous ce adresser. Voilà, Monsieur, tous les renseignements ce que je peux vous donner, n'étant pas plus au fait ce que les autres du nouveau régime.
ce J'ai l'honneur d'être avec une parfaite considé« ration, Monsieur, votre très-humble et très-obéisce santé servante.
ce GRAIN DE SAINT-MARSAUD,
« Abbesse de Bonnesaigne ».
Deux ans plus tard, la Révolution se chargeait de les mettre, l'un et l'autre, « au fait du nouveau régime ».
Nous ignorons ce qu'il advint de l'archiprêtre de Gimel et de sa créance. Mais pour l'abbesse de Bonnesaigne nous dirons, dans un autre chapitre, avec quel sang-froid elle soutint, avec ses religieuses, l'ouragan furieux, garda fidèlement ses voeux, et regarda les menaces de la mort'avec la sérénité du courage chrétien.
Mme de Saint-Marsault est la dernière abbesse de Bonnesaigne.
— 98 —
L'Histoire'conservé le souvenir des actes de générosité de ces trente-neuf abbesses connues, mais aussi celui de leurs querelles et de leurs caprices (Voir Semaine religieuse, 21 avril et 12 mai 1883).
THOMAS BOURNEIX. ÇA suivre).
(Suite)
CHAPITRE VII
Les Abbesses de Bonnesaigne et les Curés de Darnets
§ Ier. — UNION DE LA CURE Toutes ces abbesses, dont nous venons de crayonner la physionomie, sont assurément la gloire de Bonnesaigne par la noblesse de leur origine et par l'éclat des vertus qu'elles jetèrent sur nos montagnes. Mais il faut bien le dire, elles furent aussi le grand tourment des pauvres curés de Darnets !..., depuis 1348 jusqu'à la grande Révolution. J'aime à croire qu'il en fut autrement des titulaires de Maussac, de Combressol, de Sainte-Anne de Villevaleix, de Ménoire, de Champagnac et de Veyrières dont elles détenaient également les modestes bénéfices, sans quoi nous aurions un chapitre trop intéressant sur l'esprit processif qui aurait animé nos bénédictines montagnardes.
Voici donc la vie de procès que menèrent, durant trois siècles et demi, abbesses de Bonnesaigne et curés de Darnets.
Nous en avons déjà dit un mot, dans le cours de notre récit. Le xme et le xive siècles furent féconds en malheurs pour la France. Nos guerres interminables avec nos aimables voisins d'Outre-Manche,, surtout celles de Philippe VI et d'Edouard III, nous attirèrent des désastres incalculables. La guerre faisait de nombreuses victimes, les maladies en faisaient encore davantage.
— 196 —
Une épidémie terrible, connue sous le nom de Peste noire, ravagea des provinces entières. Les Aquitains, et surtout les Limousins, en eurent grandement à souffrir. Ce fut pour se délivrer de ce fléau dévastateur qu'en 1340 la ville de Tulle fit le voeu de la Lunada, en l'honneur du grand saint JeanBaptiste.
Aux horreurs de la guerre et de la peste, ajoutons celle non moins horrible de la famine, et nous aurons une idée du lamentable tableau que présentaient nos provinces et notre abbaye en particulier.
« On ne croira pas, dit Pétrarque, qu'il y ait eu un temps où l'univers a été presque entièrement dépeuplé, où les maisons sont demeurées sans familles, les villes sans citoyens, les campagnes incultes et toutes couvertes de cadavres. Comment la postérité le croirait-elle? Nous avons peine à le croire nous-mêmes, et cependant nous le voyons de nos yeux. Sortis de nos maisons, nous parcourons la ville que nous trouvons pleine de morts et de mourants. Nous rentrons chez nous, et nous n'y rencontrons plus nos proches; tout a péri pendant ce peu de moment d'absence. Heureuses les races futures qui ne verront point ces calamités et qui regarderont peut-être la description que nous en faisons comme un tissu de fables » (Ep. famil. L. VIII ép. VII).
L'abbaye des bénédictines de Bonnesaigne, habituée du reste, de longue date, à voir s'abattre sur elle tous les fléaux qui passaient sur la France, eut sa large part des souffrances générales de cette époque calamiteuse. Plus d'une fois, ainsi que nous le dirons dans le chapitre suivant, elle fut mise à contribution par
— 197 —
les belligérants et obligée de laisser aller les religieuses qu'elle abritait chercher un refuge sous les toits hospitaliers et mieux défendus des seigneurs des environs.
En 1345, elles étaient dans une extrême nécessité, ne vivant que de pain de seigle et n'ayant pour leur boisson qu'un peu de vin très clair, le tout assurément insuffisant, même pour une décente sustentation : In extrema necessitate... pane siliginis... vino lymphatissimo (ou usitatissimo) non quidem ad decenlem veslram sustentationem (Bulle du pape).
C'est alors que, poussée par les malheurs du temps et par les besoins de sa communauté, l'abbesse Blanche II de Ventadour (1326-1347) s'adressa, sans détour, directement au pape Clément VI, son compatriote, le suppliant très humblement de vouloir bien prendre en commisération son abbaye et subvenir à ses besoins les plus urgents, en unissant à l'abbaye de Bonnesaigne la cure paroissiale de Darnets.
Notre Pape limousin ne pouvait rester sourd au cri de détresse que poussait une abbaye qu'il avait assurément visitée bien des fois lorsqu'il habitait le manoir de Rosiers, ou était simple moine dans l'abbaye voisine, à La Chaise-Dieu. Du reste, il avait à Bonnesaigne des parentes : Marguerite Judicis, Gallianne de Maumont, et d'autres devaient y aller plus tard, telles qu'Anne de Maumont, Gabrielle de Beaufort de Canillac, Claudine de Lévy, etc., pour y exercer les fonctions d'abbesses.
Clément VI ne pouvait oublier qu'il était, avant d'être pape, Pierre Roger de Maumont, simple vassal
T. XXV. 2-2
— 198 —
de Ventadour. Il écouta donc d'une oreille favorable la demande d'une abbesse partie de l'opulent château voisin, auquel Maumont devait l'origine de sa gloire.
Par bulle datée d'Avignon, le 23 mai 1345, il chargea l'évêque de Limoges d'opérer l'union demandée et de fixer, après mûr examen des rentes du bénéfice de Darnets, la part qui devait rester au curé ou vicaire perpétuel de la paroisse pour se suffire honnêtement, et celle qui devait aller à l'abbaye voisine.
Mais, soit commisération de la part de l'abbesse, ce qui n'est pas vraisemblable, ou plutôt résistance, ce qui est probable, de la part des curés, l'union sollicitée et obtenue tarda encore trois ans à s'effectuer.
Blanche II de Ventadour n'était plus alors ; c'était Almodie de Saint-Jal (1337-1349) qui devait voir consommer cette union.
Almodie de Saint-Jal fut moins clémente, envers les curés de Darnets, que ne l'avait été Blanche II de Ventadour.
Le 7 juillet 1348, de concert avec ses quinze religieuses professes dont nous avons déjà donné les noms, elle fonda de procurations divers hobereaux que nous connaissons également qui, à leur tour, subdéléguèrent le damoiseau de Maussac pour aller à Limoges prier l'évêque de vouloir bien fulminer la bulle du pape et prononcer l'union définitive de la cure de Darnets à l'abbaye de Bonnesaigne.
Jean Lajugie, trois jours après (10 juillet), était auprès de l'évêque Jean de Comborn, de la branche de Treignac, pour lui exposer le but de son voyage.
Les affaires cette fois marchèrent rondement.
Séance tenante, l'évêque désigna le vénérable cha-
— 199 —
pelain de l'église d'Ussel, messire Hugues de Chalmels, pour rechercher la vérité relativement à la valeur annuelle des fruits et des émoluments de l'église de Darnets, afin de pouvoir ensuite, selon la teneur de la bulle pontificale, fixer la part du curé et la part de l'abbesse.
Le chapelain d'Ussel n'y mit pas de retard non plus. Sitôt avisé par l'évêque, il se rendit à Darnets et durant plusieurs jours compulsa les terriers de la cure et rédigea son rapport. Les archives paroissiales ne disent pas si, pendant qu'il instrumentait, le curé, dont nous n'avons malheureusement pas le nom-, lui offrit le lit, le pain et le sel.
Quoiqu'il en soit de cette question piquante pourtant, mais de simple curiosité, un mois après l'évêque était en état de rendre sa sentence.
Le même damoiseau de Maussac lui avait apporté le rapport du curé d'Ussel à Noblat (Saint-Léonard), où il était en tournée pastorale, et le 10 août 1348, jour de la fête de Saint-Laurent, de Noblat même, il rendit sa sentence, un peu grillante pour les curés de Darnets.
§ IL — PART DU CURÉ ET PART DE L'ABBESSE
Les parts étaient ainsi faites entre le curé et l'abbesse : le curé avait pour sa part exclusive la caminade ou chaminade de l'église, c'est-à-dire le presbytère, le jardin contigu à la chaminade, le pré de cette même église et tous les émoluments du verrou ou del verront. Par ces dernières expressions, il faut entendre toutes les oblations et émoluments qui arrivaient dans l'église et dans le cimetière, et
— 200 —
toutes les autres occurrences qui arrivaient à la dite église ou qui sont censées appartenir au verrou, pour baptêmes, mariages, enterrements, offrandes, services ou messes qui étaient aussi exclus du partage et revenaient au curé seul.
Cependant, sur ces divers produits du verrou de son église, que nous appelons aujourd'hui casuel, le curé était obligé de payer annuellement, à l'abbesse, huit livres, monnaie courante dans le pays.
Les autres fruits et émoluments en blé, deniers, décimes, cens, rentes et autres intérêts de la paroisse, se partageaient à égale portion entre le curé et l'abbesse, sous cette clause spéciale cependant que la moitié de l'abbesse était nette de toutes charges, tandis que sur la moitié du curé devaient peser les droits, décimes et autres charges qui pouvaient atteindre la cure de Darnets, soit de la part du Saint-Siège, de l'évêque de Limoges, soit d'ailleurs, le curé seul devait les supporter sur sa portion.
Tel est le résumé de ce fameux décret qui portait un si rude coup aux modiques ressources des curés de Darnets, et qui devait engendrer une si longue série de procès, durant plus de trois siècles, entre les curés de Darnets et les abbesses de Bonnesaigne.
A la fin de ce livre nous insérerons, aux pièces justificatives, la Bulle du pape, la Procuration du damoiseau de Maussac et le décret de Fulminalion de l'évêque de Limoges, avec quelques autres documents fort intéressants et inédits.
— 201 —
§ III. — MÉCONTENTEMENT DES CURÉS DE DARNETS
Telle était la décision formelle de l'évêque de Limoges. On le comprend sans peine, elle n'était pas de nature à faire deux heureux à la fois.
Les Bénédictines durent l'être. Mais les curés furent loin de s'associer à un tel contentement. Ils virent toujours, eux et leurs successeurs, avec grande peine, la part la plus nette de leurs revenus passer entre des mains étrangères, à des religieuses qui, comme eux, ne portaient point le p>oids du jour et de la chaleur pour remplir les fonctions du saint ministère et arpenter les champs de la paroisse, afin de porter la parole de consolation et les derniers sacrements aux malades.
Ils furent obligés de se soumettre parfois, mais ne se résignèrent jamais au sort qui leur était fait.
La jurisprudence de l'époque laissait aux curés de Darnets une porte ouverte pour s'échapper et éviter, du moins en partie, la rigueur du décret de l'évêque de Limoges. Ils eurent soin d'y passer pour aller trouver qui de droit.
D'après l'usage admis dans l'église des Gaules, il fallait la sanction royale pour que les écrits émanés de l'autorité pontificale, ou épiscopale, eussent force de loi.
En conséquence, ce n'était ni la bulle pontificale, ni le décret épiscopal qui avaient, aux yeux des curés et de ceux qui les conseillaient, la vertu d'unir la cure à l'abbaye, mais bien le concours de la puissance royale et un jugement rendu en règle, après les formalités observées.
Or, ce jugement ne fut jamais rendu ; les religieu-
— 202 —
ses négligèrent de le solliciter, ou ne se crurent pas obligées d'y avoir recours.
Preuve qu'il y avait à cette époque, aussi bien qu'aujourd'hui, du tirage entre la puissance temporelle et la puissance spirituelle.
Bien que les documents que nous avons fouillés n'en disent rien, il est donc plus que probable que, dès la fulmination de la bulle de Clément VI, les curés de Darnets en appelèrent au roi.
Dès 1348, en effet, nous voyons les titulaires de l'endroit exclure du partage avec l'abbaye trois choses, malgré la décision formelle de l'évêque diocésain :
1° Les rentes foncières et directes dues par les habitants du bourg ;
2° Les dîmes abonnées, connues sous le nom de proférents ;
3° Les huit livres sur le casuel annuel de leur église.
Le roi, ainsi que s'en expriment les jurisconsultes du temps de l'abbé Pigeyrol, aurait retranché, dès l'apparition de la bulle d'union, une partie des revenus qui revenaient à l'abbesse en faveur de celui qui portait « Pondus diei et oesiùs », le poids du jour et de la chaleur.
De telle sorte qu'il n'entrait en partage, avec les Bénédictines, que les dîmes ordinaires, pures et simples, soient prédiales, personnelles ou navales, prélevées annuellement sur la paroisse.
Quant aux huit livres sur le casuel de l'église, nous verrons dans la suite que différentes sentences judiciaires contraignirent les curés à observer le sens littéral de l'ordonnance épiscopale : mais ils n'en firent
— 203 —
rien. Les choses se passèrent ainsi pendant trente-sept ans, durant l'administration des abbesses : Almodie de Saint-Jal, Gaillarde-Roberte de Ligneyrac, Marguerite de Judicis, Gaillarde-Roberte Irc de Blauge et Dauphine d'Anglars.
Mais en 1385, de grandes contestations surgirent entre le curé Pierre Blanchier et l'abbesse GaillardeRoberte II de Blauge.
L'affaire monta jusqu'au roi Charles VII, qui de nouveau confirma les privilèges que ses devanciers avaient accordés aux malheureux curés de Darnets, envers et contre la sentence pontificale et épiscopale qui favorisait un peu trop l'abbaye.
Pour en finir, Pierre Blanchier, avec l'assentiment au moins tacite du roi, fit dresser, le 22 février 1385, un terrier des rentes de son église sur lequel figurent seulement les rentes qu'il entendait mettre hors de partage avec les religieuses de Bonnesaigne : « Hoec sunt reddilus ecclesioe de Darneto proeter Decimam », tel est le titre de cette feuille de rentes que nous reproduirons in extenso dans notre Notice sur Darnets.
De sorte que ce terrier n'est pas le mémorial exact et fidèle de tous les revenus de l'église, mais bien celui seulement des rentes foncières, directes, et des dîmes abonnées que les curés entendirent toujours soustraire du partage avec les abbesses.
Gaillarde-Roberte II de Blauge dut en passer par là.
Quoiqu'il en soit de la victoire que l'abbé Blanchier venait de remporter sur les bénédictines, on ne voit pas qu'elle ait eu rien de définitif.
Bientôt surgirent de nouveaux démêlés et les trois
— 204 —
points, sur lesquels on croyait avoir pour toujours battu' les religieuses, furent de nouveau vigoureusement remis sur le tapis de Thémis.
§ IV. — PROCÈS AVEC BERTRAND DE BONNEFOND (1444-1482)
Comme bien on le pense, le feu allumé entre la cure et l'abbaye depuis 1348 n'était pas éteint par l'avantage que Pierre Blanchier venait d'obtenir sur l'abbesse; il couvait seulement sous la cendre et le moindre souffle de discorde pouvait le faire éclater et amener un vaste incendie. C'est ce qui arriva en 1444, environ cent ans après la bulle d'union, sous Mme Dauphine de Chabannes, XXVIe abbesse de Bonnesaigne. Il paraît que ce sont les différends les plus sérieux qui se fussent élevés jusqu'à ce jour entre l'abbaye et le curé.
L'abbé Bertrand de Bonnefond se crut de force à pouvoir lutter contre la puissante abbesse Dauphine de Chabannes. Il appartenait en effet à une famille bien apparentée. Il était fils de Rigald de Bonnefond et de Bertrande Aramide. Son nom figure, sous la date du 30 avril 1449, dans le testament de son père, dont l'authentique est dans le chartrier de la famille d'Ussel de Neuvic, dans laquelle la famille de Bonnefond se perdit, vers 1500, par le mariage de son unique fille avec le chef de la maison d'Ussel.
Dès son arrivée à la cure de Darnets (1444), Bertrand de Bonnefond, marchant sur les traces de ses devanciers, refusa purement et simplement de payer la rente à Bonnesaigne telle que l'évêque de Limoges
— 205 —
avait permis de la prélever sur les émoluments du verrou de l'église de Darnets.
C'était pour les huit livres à prendre sur le casuel du curé que la bourrée allait commencer.
Le curé se disait, aussi, fondé à ne pas payer la moitié de toutes les dîmes, telle que l'abbaye les revendiquait.
Le procès fut porté au parlement de Paris, qui renvoya l'affaire au sénéchal de Brive et Uzerche.
On fit des enquêtes et des contre-enquêtes, et finalement on rendit une sentence qui, cette fois, ne fut pas favorable au curé.
Bertrand de Bonnefond était condamné à payer à l'abbesse la somme en litige, à savoir : huit livres sur son casuel.
Le curé ne voulut pas s'avouer battu pour si peu. Sur l'avis conforme de MM. de son conseil, il fit appel de la sentence du sénéchal de Brive par devant nos seigneurs du parlement de Paris.
Cependant, après réflexion, la peur prit un peu le curé. Il comprit toute la gravité que sa démarche pouvait avoir, et, après mûr examen du pour et du contre de son acte, il se décida à ne pas poursuivre son procès en Cour d'appel, préférant acquiescer à la sentence qui le condamnait à Brive et payer certaines dépenses avec restitution des frais. A son avis, cette conduite valait encore mieux que de s'exposer à subir une nouvelle condamnation.
De la sentence définitive du tribunal de Brive et Uzerche, et du manque de poursuite du second appel, s'en suivit une transaction, convention, engagement, contrat, — tout ce qu'on voudra, mais rien
— 206 —
de bon, — entre le curé et l'abbesse, en date du 31 janvier 1448, par devant Me Àlpaix, de Meymac.
Cette transaction, signée Lageneste-le-Jeune, par commission délégué du couvent, spécifiait que le curé reconnaissait avoir eu un grand procès avec l'abbesse Dauphine de Chabannes, pendant au sénéchal de Brive et Uzerche ; qu'il s'en était suivi sentence définitive donnée en faveur de l'abbesse, au détriment du sieur Bonnefond, vicaire perpétuel; qu'il avait été mal fondé en son appel et s'en départait, etc.
Le pauvre curé reconnaissait en outre, conformément à la sentence rendue par le sénéchal de Brive et Uzerche, tant pour lui que pour les siens, être légitimement due et appartenir à l'abbesse et à sa communauté, la somme de huit livres de rente annuelle et perpétuelle qu'il promettait de payer annuellement, en deux termes égaux, savoir : « La moitié à la SaintMichel et l'autre moitié au premier jour de mai, à chaque année et à perpétuité, et ce, à cause du délaissement et abando'n de maison et jardin y attenant, à'un pré et émolument du cimetière et verrou de l'église ». — Toutes choses pourtant qui lui étaient exclusivement réservées par le décret de l'évêque de Limoges. Mais ce n'est pas tout.
« De plus reconnaissait, M. le vicaire de Darnets, appartenir légitimement à l'abbese la moitié de tous les fruits aimables de la paroisse, sans aucune réserve ;
« Pour le paiement de laquelle rente, le sieur Bonnefond, vicaire perpétuel, obligeait tant pour lui que pour ses successeurs, tous ses biens présents et avenir ».
— 207 —
Evidemment, cette transaction allait tout à fait contre le décret d'union et enlevait absolument au curé tout ce que l'évêque lui réservait exclusivement, ainsi que le roi.
Cet arrangement abusif, comme bien on peut se le figurer, fut loin de rétablir la bonne harmonie, depuis si longtemps brisée, entre la cure et la communauté.
Cette fois la victoire était honteuse, mais complète contre le curé, au profit de l'abbesse.
Ainsi enchaîné, l'abbé de Bonnefond n'eut qu'à faire face à son engagement. Après la sentence de Brive et Uzerche, et sa ratification par la transaction de 1448, le curé de Darnets donna annuellement huit livres sur son casuel et partagea avec l'abbesse tous les fruits décimables de son bénéfice, sa vie durant (1482). C'était un acte de faiblesse qui devait avoir les plus fâcheuses conséquences pour ses successeurs.
Ce ne fut qu'en février 1454 (ancien style), que le curé de Darnets se libéra complètement envers l'abbesse Dauphine de Chabannes. Voici la traduction sommaire de la quittance qu'il en retira, quittance à moitié dévorée par les rats, que nous a communiquée M. le baron Paul d'Ussel :
« Au nom de Dieu, amen. Le .... février 1454, en présence du notaire et des témoins soussignés, ont comparu : Dauphine de Chabanne, abbesse du monastère de Bonnesaigne, de l'ordre de saint Benoît, au diocèse de Limoges ; Marie d'Ambrugeac, Marguerite et Huguette de la Forsa, Marie et Margueritte de Maumont, Catherine de la Chapoulie, religieuses de Bonnesaigne, formant la partie la plus considéra ble, stipulant pour elles et pour celles qui viendront après elles, autant que cela pourroit les concerner d'une part, —
« Et le très cher en Jésus-Christ, messire Bertrand de
— 208 —
Bonnefond, chapelain, de l'église paroissiale de Darnets, au diocèse de Limoges, pour lui et ses successeurs, d'autre part, —
« L'abbesse et les religieuses reconnaissent avoir reçu de messire Bertrand de Bonnefond la somme de 22 réaulx d'or et 15 sous au coin du roi, notre sire, que Bertrand avait reconnu leur devoir par acte reçu par Alpeis, notaire royal, et cela à la suite d'un accord survenu entre les parties, et à cause de certains frais faits par elles en différentes cours, et notamment au parlement de Paris relativement à la moitié... que chacune des 2 parties prétendait lui appartenir ».
L'acte est passé dans l'abbaye de Bonnesaigne, l'an, mois et jour que dessus. Les témoins sont messires Pierre de la Bardêche, de Darnets, et Jean de la Guinhari, de Bonnesaigne, prêtres.
Le notaire qui a signé de son seing nominal se nomme Jean Deyiat, ou Ceyrat.
Le réal d'or, sous Charles VII, valait 25 sous, bien entendu valeur du temps.
Mais heureusement cet état de choses ne pouvait ni ne devait durer que le temps du pastorat de celui qui l'avait consenti, sans savoir se défendre.
Après lui, ses successeurs devaient au moins protester et essayer de nouveau de secouer le joug, chaque jour plus lourd, que Bonnesaigne faisait peser sur leur modeste bénéfice.
Ainsi faisaient les vieux Romains !
Au dire de Montesquieu, en effet, « on pensait alors, dans les républiques d'Italie, que les traités qu'elles avaient faits avec un roi ne les obligeaient point envers son successeur. C'était pour elles une espèce de droit des gens (cela paraît par toute l'histoire des rois de Rome).
— 209 —
Ainsi, tout ce qui avait été soumis par un roi de Rome, se prétendait libre sous un autre, et les guerres naissaient toujours des guerres » {Grand, et Décad. des Romains).
Hélas ! que d'autres gouvernants leur ressemblent sans être Romains !
Ainsi faisaient les titulaires de Darnets et de Bonnesaigne, à l'arrivée d'une nouvelle abbesse ou d'un nouveau curé.
§ V. — PROCÈS AVEC FRANÇOIS MURÂT DE BEAUPOILSAINT-AULAIRE (1482-1538)
L'arrangement dontnous venons de parler, arraché à la poltronnerie du curé de Darnets, avait été passé par devant Me Alpaix, notaire à Meymac, le dernier jour de janvier 1448 ; il dura jusqu'en 1482.
François Murât de Beaupoil signala son arrivée à la cure de Darnets par un refus formel d'obéissance à la transaction étrange que l'abbesse avait arrachée à son prédécesseur.
Il déclara hautement ne pas reconnaître les droits de l'abbaye sur les huit livres de son casuel.
Alors l'abbesse Blanche de Gimel (1470-1504), de concert avec ses religieuses, fit appel de ce refus au sénéchal de Limoges.
Le sénéchal rendit une sentence de réintégrande contre le curé de Darnets, dans le cours de l'année 1483.
L'abbé Murât de Beaupoil ne se regarda pas comme battu pour cela. Il fit appel de cette sentence au parlement de Bordeaux et le maintint, malgré les avis
— 210 —
contraires qu'on pouvait lui donner. Il eut du moins le courage dont avait manqué son prédécesseur.
Le résultat fut le même.
N'ayant point voulu relever son appel, le roi Charles VIII donna des patentes aux religieuses de Bonnesaigne, en la ville de Tours, le 24 janvier 1483, adressées au parlement de Bordeaux, portant que si l'appel à la Cour de ladite sentence du sénéchal de Limoges n'était pas par le curé relevée dans le temps de l'ordonnance, la Cour aurait à mettre la sentence à exécution et à faire jouir les religieuses de huit livres, nonobstant les appels du curé, sans préjudice d'iscelui, par manière de provision.
Malgré ces deux sentences successives obtenues par les religieuses contre les curés de Darnets, il ne paraît pourtant pas que ces derniers se soient jamais exécutés pour cela.
Rien, dans la suite des temps, ne nous indique qu'ils aient payé à l'abbaye cette somme de huit livres.
Au contraire, quand, longtemps après, les curés, pour mettre fin à ces débats ruineux, sans cesse renaissants, se décidèrent à affermer la part des revenus revenant aux religieuses, nous voyons que toujours dans les baux ils ont soin d'insérer une clause spéciale concernant ces huit livres, qu'ils revendiquèrent constamment, d'une manière exclusive, pour eux seuls.
Dans les procès qui surgiront encore, sur ce même point, nous verrons également que ce défaut de paiement fut toujours invoqué comme une preuve de rente non due.
— 211 —
Il est donc à présumer que ces huit livres ne furent guère payées que par le malheureux Bertrand de Bonnefond, faute de savoir se défendre contre l'abbesse.
§ VI. — DÉSAPPOINTEMENT DES CURÉS ET DES ABBESSES (1544)
Six ans après l'arrivée de messire Jacques de Montaignac à la cure de Darnets, survint un événement qui, pour plus d'un siècle, mit d'accord les curés ?et les abbesses.
Ils furent battus de la même verge.
Pour se reconnaître des services que les Soudeilles lui avaient rendus duiant ses guerres d'Italie et pour refaire un peu leur fortune, François Ier confisqua, à leur profit, les bénéfices de Soudeilles et de Darnets; c'est ce qu'on appelle la confidence.
En 1543 il confisqua les biens de la cure de Soudeilles au profit de Jean II de Soudeilles, seigneur de Soudeilles, futur héritier de Lieuteret; et l'année suivante (1544), en vertu d'un décret royal, ce fut le tour du bénéfice de Darnets au profit de Loys de Soudeilles, seigneur du Lieuteret, oncle de Jean II de Soudeilles. A partir de ces deux dates jusqu'en 1631 pour Darnets, et 1666 pour Soudeilles, les titulaires de ces deux églises ne furent que de maigres congruistes.
Clément VII eut beau protester, le Concile de Cologne lancer des anathèmes, il fallut en passer par là.
C'était du reste la plaie générale de l'époque.
C'était aussi un remède radical pour guérir les curés de Darnets et les abbesses de Bonnesaigne de leur
212
maladie processive, sans cesse renaissante, au moins à chaque changement de titulaire. Ils purent méditer à'avoine, de seigle et de revenus du verront...
Inutile de dire ici les abus criants qui se glissèrent, durant cette longue période, dans l'administration temporelle des bénéfices ecclésiastiques. Nous les énumérons longuement dans notre travail sur Soudeilles et sur Darnets. Arrivons de nouveau à l'ère des procès retentissants entre curés et abbesses.
Nous voilà en plein xvir 5 siècle, le grand siècle de la France, où tant d'abus furent corrigés.
L'orgueil de la noblesse fut humilié par Richelieu... mais beaucoup trop. Après une sorte d'idolâtrie pour l'oeuvre politique de ce grand ministre, on reconnaît en effet aujourd'hui que si elle a été la gloire de la France dans sa partie extérieure, elle est aussi sa ruine à l'intérieur. Les sinistres événements dont la France a été la victime depuis cette époque et dont nous sommes encore les témoins attristés, éclairent sur le passé et le font juger ; et tous les auteurs réfléchis de nos jours sont obligés d'avouer que la chute de l'aristocratie a produit le manque d'équilibre dont la France ne peut plus se remettre, oscillant fatalement entre la démocratie extrême et l'absolutisme sans contrepoids. Il faut, comme dans le corps humain, considérer les éléments vitaux de leur constitution et les pondérer (V. à ce sujet l'abbé Fliche, Vie de Mme de Montmorency).
Mais passons ; ce n'est pas le sujet que nous avons à traiter.
L'abus des confidences eut un terme, par suite des améliorations introduites dans le gouvernement ecclé-
— 213 —
siastique des bénéfices, et grâce surtout au glorieux saint Vincent de Paul, qui travailla tant pour dégager les bénéfices des griffes des seigneurs qui s'en étaient emparés par suite des malheurs qui précédèrent ce siècle réparateur.
L'Eglise respira enfin !
Il n'y eut pas jusqu'à la modeste église de Darnets qui ne se ressentît de l'heureuse influence qu'apportait l'ère nouvelle dès son aurore.
En 1631, l'heure de la délivrance sonna pour elle ; François de Soudeilles, oncle de Louise-Henriette, la future visitandine de Moulins et la confidente de la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque, lâcha sa proie, et Antoine Chanal qui devait, quelques années plus tard (1645), faire si bien les honneurs de son église à la dépouille mortelle de l'infortuné Henri II de Montmorency, fut réintégré dans les droits de son modeste bénéfice.
L'abbesse l'avait su ; les procès ne vont pas tarder à recommencer.
§ VI. — MENACES DE PROCÈS AVEC JEAN CHANAL,
NEVEU DU PRÉCÉDENT CURÉ' (1664-1708)
Quelque temps avant sa démission de la cure de Darnets (29 mai 1708), messire Jean Chanal eut une grande contestation avec l'abbesse Catherine de Beauverger Montgon (1701-1747). C'est pour tirer au clair cette question, sans cesse renaissante de l'union de la cure à l'abbaye, que le curé fit faire, sur les titres authentiques, toutes les copies de rentes, ou d'autres titres, qui composent actuellement les archives préT.
préT. 2-5
— 214 —
cieuses de l'église de Darnets, comme : 1° liste des rentes que l'église percevait en dehors des décimes ; 2° bulle d'union de Clément VI ; 3° procuration du damoiseau de Maussac ; 4° fulmination de l'évêque de Limoges ; 5° notes marginales, insérées dans le Missel en lettres gothiques, qu'avait composé le frère Chadenier, religieux bénédictin de l'abbaye de Meymac, etc.
C'était la préparation des armes avant le combat ! ou, si l'on aime mieux, la préparation des pièces nécessaires au procès que Jean Chanal prévoyait dans un avenir prochain.
g VIL — PROCÈS AVEC JEAN CHANAL ET FRANÇOIS MAGIMEL (1708-1746)
Durant la confidence, les filles de saint Benoît firent les mortes, et pour cause.
Leurs droits, aussi bien que ceux des curés, étaient logés à la même enseigne, c'est-à-dire méconnus, sauf pour la congrue des curés.
Mais sitôt qu'elles apprirent que la confidence avait bel et bien cessé, sitôt qu'elles surent qu'Antoine et Jean Chanal, réintégrés dans leurs droits, avaient eu le temps de refaire les revenus du bénéfice de Darnets, oh ! alors Catherine de Beauverger, leur abbesse, se hâta de retirer de la poussière de son monastère la vieille bulle de 1348 ; et, en vertu de cette pièce, elle demandait à être remise en possession de la moitié des dîmes et des huit livres prises sur le casuel ou émolumenis du verront de l'église.
Sa réclamation avait aussi bien sa raison d'être à
— 215 —
cette époque qu'en 1345; son monastère n'était pas riche depuis la fin des guerres de religion.
Dans l'impossibilité de réclamer les arrérages depuis 1631 qu'avait cessé la confidence, elle retenait seulement 29 ans, c'est-à-dire depuis 1679 ; c'était encore adroit pour empêcher la prescription de 30 ans.
Donc, le 6 août 1708, elle fit demander, soit à Jean Chanal retiré de la cure, soit à Magimel, son successeur depuis le 29 mai 1708 par résignation en forme, la redevance des huit livres et les arrérages de 29 ans avant l'action.
Sur leur refus formel de paiement, vu que depuis 1631, date de la cessation de la confidence, aucune demande de ce genre ne leur était arrivée des prieures de Bonnesaigne, l'abbesse fit contrôler sa cédule, contenant présentation le 29 novembre 1708, et les assigna tous les deux par devant le sénéchal de Tulle.
Chanal et Magimel dressèrent à l'instant un Mémoire sur l'état de la question et l'envoyèrent au Conseil de Bordeaux. Dans ce mémoire on parlait :
1° De l'union de la cure à l'abbaye par la bulle de Clément VI ;
2° De la fulmination de cette bulle par l'évêque de Limoges ; • 3° De la part qu'il assignait au vicaire, ou curé perpétuel ;
4° Du procès de 1448, porté au parlement de Paris, renvoyé à Brive et Uzerche, où fut rendue sentence en faveur de l'abbesse ;
5° De l'appel du curé et de la transaction qui s'en suivit ;
6° Du procès de 1482 et de la sentence du tribunal de Limoges en faveur de l'abbesse ;
7° De l'appel fait au parlement de Bordeaux ;
8° Des patentes que le roi rendit en sa ville de Tours pour
— 216 —
condamner le curé s'il ne relevait pas son appel dans le temps de l'ordonnance, avec ordre de faire jouir les religieuses nonobstant l'appel et sans préjudice, par manière de provision ».
Dans ce mémoire nos deux prêtres suivaient ainsi, l'un après l'autre, en s'efforçant de les réfuter, les titres sur lesquels s'appuyait l'abbesse pour formuler sa demande auprès du Parlement de Tulle.
Le Conseil de Bordeaux répondit que, vu le mémoire, vu les pièces énoncées, il était d'avis :
« Que Madame l'abbesse était bien fondée à demander les huit livres de pension, ou redevance annuelle, au curé de Darnets, aux termes de ses titres ;
« Que toute la difficulté était réduite à la prescription, attendu que les paiements ne pouvaient s'établir que par des quittances d'écriture privée, parce que pour des sommes modiques on ne fait guère des quittances par main publique. Ces quittances ne peuvent être qu'entre les mains du curé. Comme il y a plus de 200 ans entre le dernier paiementquittance et la réclamation de l'abbesse, il y a un temps plus que suffisant pour acquérir la prescription, si toutefois elle pouvait avoir lieu dans le cas proposé ».
Mais, ajoute le Conseil :
« La prescription ne peut avoir lieu dans ce cas pour trois raisons :
« 1° Le titre d'union, portant création de la vicairie perpétuelle, si l'abbesse le conserve en bonne forme, s'y oppose, parce que ce titre étant commun aux deux parties, aucune d'elles ne peut prescrire contre son propre titre, suivant qu'on a perpétuellement jugé encore tout récemment dans une semblable cause ;
« 2° Parce que les redevances annuelles sont imprescriptibles, l'obligation renaissant tous les ans suivant différentes lois du Code, titre De annuis legatis ;
— 217 —
« 3° Parce que les redevances qu'une église fait à une autre in signum superioritatis sont imprescriptibles et présumées telles, suivant un grand nombre d'arrêts rendus tant au parlement de Guyenne qu'en d'autres, et encore tout récemment où un Prieur de Saint-Privat fut condamné à payer diverses redevances autrefois dues à un monastère de Saint-Benoît depuis un siècle sécularisé, quoiqu'il n'y eût aucune preuve que ces redevances eussent été payées depuis plus de trois cents ans ;
« Ensuite parce que cette redevance de huit livres étant établie par le titre commun, confirmée par un jugement, acquiescée par transaction, le curé paraît mal fondé à la contester ».
Finalement le Conseil ajoutait :
« Il est vrai que la déclaration du 29 janvier 1686 et par celle de 1690, les oblations et casuel des églises sont adjugés aux curés ou vicaires perpétuels nonobstant toutes transactions, arrêts et prescriptions ; mais ce n'est que dans le cas de l'option et réduction des curés et vicaires perpétuels à la congrue ; el si le curé de Darnets se réduisait à la congrue, il serait dans le cas des déclarations, et non autrement, suivant des arrêts rapportés par Duperrain, dans son traité des portions congrues.
« Délibéré à Bordeaux le 29 mars 1709. — CAMBOUX ».
On le voit, l'acte de faiblesse qu'avait commis l'abbé Bertrand de Bonnefond, en signant la transaction du dernier jour de janvier 1448, avait produit ses fruits désastreux contre les curés de Darnets ; c'était une arme terrible entre les mains des abbesses, qui eurent garde de la laisser se rouiller et de la mettre au repos chaque fois que surgirent de nouvelles difficultés avec les curés de Darnets.
Aussi voyons-nous, dans l'avis de Bordeaux, maître
— 218 —
Camboux dire, aux deux curés de Darnets, qu'ils ont contre eux un jugement acquiescé par transaction dont il ne leur sera pas facile d'éluder la rigueur, etc. Honneur au courage malheureux !
Malgré l'avis contraire qui leur arrivait de Bordeaux, Chanal et Magimel voulurent plaider. L'affaire fut portée au sénéchal de Tulle, qui ne leur fut guère plus favorable que la consultation de maître Camboux. La sentence qu'il porta, après un an d'attente, condamnait les infortunés curés à payer à l'abbesse les huit livres, avec arrérages de 29 ans. Cette sentence fut rendue le 26 février 1710, un an avant la mort prématurée (49 ans) du marquis Louis-Marie de Soudeilles, époux de Marie Roberte de Lignerac, dame du Bazaneix, neveu de la mère Louise-Henriette, supérieure de Moulins, et père de l'aimable visitandine Louise-Françoise de Soudeilles.
Pendant cette année d'attente, il y eut des attaques et des répliques, des accusations et des défenses, un tas d'incidents dans lesquels nous ne pouvons suivre les parties belligérantes et leurs défenseurs. La reproduction de pareilles pièces nous entraînerait trop loin ; nous nous contentons de reproduire la sentence rendue par le sénéchal de Tulle, avec son préambule, portant indication des pièces authentiques sur lesquelles il étayait son jugement. Nous verrons que l'abbé de Bonnefond avait fourni une pierre pour battre ses successeurs.
En tête de cette sentence nous lisons :
« Entre révérende dame Catherine de Beauverger, abbesse de l'abbaye royale de Bonnesaigne, demanderesse, d'une part, ... ...
— 219 —
« Entre maître Jean Chanal, vicaire perpétuel de la paroisse de Darnets, défendeur, d'autre part,
« Et maître... Magimel, à présent vicaire perpétuel de la même paroisse, appelé au procès.
« Veu l'expédition en forme du procès-verbal de fulmination fait par l'Evesque de Limoges, commissaire député par le Saint-Siège, daté du 10 juillet 1348 ;
« De la Bulle d'union, faite par le pape Clément, de la cure de Darnets à l'abbaye de Bonnesaigne dans lequel ladite bulle est transcrite au long, donnée à Avignon le dixième des calendes de juin et le troisième de son pontificat, ledit acte expédié par Berger notaire royal de Limoges et scellé ;
« Transaction passée entre le curé de Darnets, l'abbesse et religieuses de Bonnesaigne le dernier janvier 1448, par devant Alpaix notaire royal portant confirmation du contenu en ladite Bulle d'union ;
« Commission du roy Charles, donnée à Tours le 24 janvier 1483, signée, libellée du 6 août 1708, contenant les conclusions de ladite dame, controllée à Meymac le 7 dudit mois par Sauzer, cédule contenant la présentation de la demanderesse du 29' novembre 1708 ;
. « Autre cédule contenant la présentation du défendeur du 26 août audit an, même défaut levé par ladite dame contre ledit sieur Chanal faute d'avoir fourni défense, daté du 29 novembre audit an, signifié le même jour ;
« Défenses fournies par le curé défendeur le 4 décembre de la même année ;
« Acte de déclaration d'audience signifié de la part de la dame abbesse du même jour et an, appointement portant règlement à mettre, pièces du onze dudit mois et an ;
« Avis du Conseil produit par le défenseur du quinze du même mois et an, signé Dudon, y ayant au bas vingt et une lignes et demie raturées d'une manière à ne pouvoir lire, sans aucune approbation ;
« Acle signifié requérant ladite Dame, contenant l'indication de la distribution et remise de la production du 15 février 1709;
— 220 —
« Répliques de l'abbesse aux défenses du défendeur, signifiées le 17 avril même an ;
« Acte à droit requérant l'abbesse du 22 mois et an que dessus ;
« Deux requêtes comminatoires présentées par la dame abbesse pour la remise du procès des 4 et 15 mai audit an ;
« Dire du défendeur contenant ses plus amples défenses signifiées le 28 du même mois et an ;
« Factum et avis du sieur Camboux justificatif du dire de l'abbesse ;
« Autre dire du défendeur signifié le 16 juin, même an ;
« Autre dire de la dame abbesse signifié le 18 du même mois et an ;
« Acte d'affirmation fait au greffe par le receveur de l'abbesse le 2 juillet, avec la procuration de l'abbesse du 4 juillet 1709 ;
« Exploit d'assignation donné, requérant l'abbesse à Magimel à présent vicaire perpétuel de Darnets, pour assister au procès et voir déclarer la sentence qui interviendra exécutoire contre luy du 26 juillet 1709, contrôlé le 27 au bureau de Meymac par Chauzex ;
« Cédule contenant la présentation de la dame abbesse sur ledit exploit du 20 août, même an ;
« Autre défense de Magimel du 22, même mois et an ;
« Appointement d'audience contenant jonctions des instances du 27 du même mois et an ;
« Autre acte et droit signifié de la part de l'abbesse le 29 novembre audit an, et les conclusions du Procureur du roi signées Melon avocat du roi,
« Nous, faisant droit aux parties sans avoir égard à la fin de non recevoir, ni autre chose dite ou alléguée par lesdits Chanal et Magimel, les avons condamnés et condamnons de payer à l'abbesse les arrérages de la redevance annuelle de huit livres dont au procès est question, des 29 années précédentes à la demande,
« Savoir : « Ledit Chanal jusqu'à la prise de possession dudit Magi-
— 221 —
mel son résignataire, et ledit Magimel depuis sa prise de possession et ceux qui ont couru de depuis, et de continuer à l'avenir tant et si longtemps qu'il sera possesseur de ladite vicairie perpétuelle, aux profits y attribués par ladite Bulle d'union ;
« Déclarons néanmoins les fruits de ladite vicairie perpétuelle sujets aux arrérages faits par ledit Chanal, dont ledit Chanal sera obligé de garantir ledit Magimel ;
« Condamnons lesdits Chanal et Magimel aux dépens envers ladite dame, chacun le concernant.
« Fait à Tulle, dans la Cambre du Conseil le 26 février 1710.
« Ainsi signé : JARRIGE DU BOURNAZEL, lieutenant particulier, particulier rapporteur; RITIÈRE, conseiller doyen; Du MIRÂT, conseiller; MELON, conseiller-clerc, et DARLUC ; DELPY, conseiller.
La sentence de Tulle fut loin de décourager notre jeune et intrépide curé; M. François Magimel, enfant du plateau de Millevaches, habitué dès son enfance aux orages et aux tempêtes de l'ordre physique, voulut braver ceux de l'ordre moral ou judiciaire.
Magimel, au nom du vieux Chanal, fit un nouveau mémoire qu'il adressa à son conseil pour savoir s'il était prudent de faire appel de la sentence onéreuse qui venait de l'atteindre.
La copie, que conservent les archives paroissiales, porte : Mémoire au Conseil pour M. Chanal.
Le curé prétendait éluder la sentence par la prescription, « parce que, disait-il, la dame abbesse n'était « pas en droit de prouver que les curés de Darnets « eussent jamais payé les huit livres aux abbesses de « Bonnesaigne depuis fort longtemps ; tout au plus « si l'abbesse était en droit de jouir la moitié des « dîmes et autres revenus de la cure ».
— 222 —
La question était donc de savoir si ce droit de huit livres était bien fondé, et s'il était prescriptible ou non comme Mme l'abbesse le prétendait.
« Le proposant, disait-il, a pour lui une double fin de non recevoir :
« 1° La première est prise de ce que cette redevance de huit livres, ayant été uniquement établie pour les émoluments du verrouil de l'église de Darnets et n'étant pas imposée Propter traditiones fundi, se trouvait évidemment prescrite par le laps de temps, attendu qu'il n'y avait aucune trace de paiement depuis la transaction de M. Bertrand de Bonnefond (1448) qui demeura sans exécution ;
« Que cette prétendue redevance ne peut pas être regardée comme une charge imposée in signum superioritalis, comme le prétendait l'abbesse qui se disait le curé primitif de Darnets, depuis la Bulle d'union, et par conséquent imprescriptible, puisqu'il paraît par ladite bulle que tous les fruits et revenus de la paroisse de Darnets appartenaient au vicaire perpétuel ;
« Que l'abbesse et les religieuses ont supplié sa Sainteté de vouloir bien unir à l'abbaye une partie des fruits et revenus de lad. vicairie, pour donner quelques ressources aux religieuses afin de pouvoir subsister, et que bien loin qu'il y ait en quelque tradition de fonds du côté de l'abbaye, en faveur de l'Eglise, qui puisse servir de prétexte à ce signe de supériorité, au contraire les revenus de la paroisse de Darnets ont été démembrés pour secouvrir la pauvreté de l'abbaye.
« 2° La seconde fin de non recevoir se prend de . ce que par les déclarations du roi, des années 1686
— 223 —
et 1690, le verrouil de l'église est adjugé au vicaire perpétuel, outre la portion congrue, nonobstant toutes coutumes, usages et transactions contraires ; et comme la bulle porte que la redevance de huit livres dont, il est question sera payée pour émoluments du verrouil de l'église, les susdites déclarations ont dérogé à la teneur de cette Bulle pour raison de cet article ».
• La transaction de 1448 n'augmente pas le droit de Mmc l'abbesse, parce que le vicaire n'a pas pu obliger ses successeurs à cette transaction, suivant le chapitre Veniens extra de transactionibus ; cette transaction encore n'ayant jamais été suivie d'exécution, se trouve prescrite par le laps de plus de deux siècles, et la déclaration du roi ayant dérogé à toutes sortes de transactions, doivent effacer le concordat du vicaire quand il aurait été exécuté et suivi des paiements contenus.
Le mémoire continue en suivant pas à pas les débats qui amenèrent la sentence du 26 février 1710 :
« La dame abbesse a répondu que la Bulle étant un titre commun pour elle et le vicaire perpétuel de Darnets, le proposant ni ses prédécesseurs n'ont pas pu prescrire ladite redevance par cette maxime que nul ne peut prescrire contre son propre titre; cela est décidé dans le chapitre : Vigilans extra de Prescriptionibus et dans Dumoulin en son conseil 10e. D'ailleurs que les dites redevances annuelles renaissant tous les ans ont un caractère d'imprescriptibilité aux termes de la loi : Censibus quodice de Episcopis et Clericis, et que une redevance qu'une église fait à une autre est regardée comme un signe de
— 224 —
supériorité qui est imprescriptible. Ladite abbesse ajoute que la déclaration du roi concernant le verrouil de l'église n'a son application que lorsque les vicaires perpétuels se réduisent à la portion congrue et au verrouil de leur église, ce qui n'est pas applicable au sieur proposant qui, en exécution de ladite bulle, est gros décimateur dans sa paroisse et perçoit la moitié des fruits, rentes et revenus.
« A ces allégations de l'abbesse le proposant a répliqué que la maxime que personne ne peut prescrire contre son Titre ne s'applique pas dans toutes sortes de matières, puisqu'on prescrit contre un arrêt qui est le titre commun des parties, et qu'un cohéritier institué peut prescrire contre l'autre cohéritier institué dans le même testament, quoique l'institution dérive d'un titre commun ; que cette redevance annuelle de huit livres ne portant ni obit ni fondation, il n'est pas vrai, sauf respect, qu'elle renaisse tous les ans. D'ailleurs les protestations annuelles, qui ne sont pas des rentes foncières, sont prescriptibles suivant la loi : Si certissim codice de pactis et Mornac sur cette loi ;
« Que cette redevance de huit livres n'ayant pas été reconnue en faveur d'une église cathédrale par une église in feriori, ni pour cause de tradition de fonds, elle ne peut pas être regardée comme un signe de supériorité ; d'autant mieux que le délaissement que le pape a fait à l'abbaye de la moitié des fruits et revenus de la paroisse, n'a eu pour objet et pour fin que le soulagement de l'abbesse et des religieuses qui étaient réduites, d'après leur supplique, à une" extrême nécessité ».
— 225 -
Après l'exposé de toutes ces raisons qui, d'après lui du moins, auraient dû lui donner gain de cause à Tulle, l'abbé Magimel continue :
« Il est arrivé ceci que, pour éviter la sentence du sénéchal de Tulle, l'abbesse a fait valoir que j'avais échoué dans cette cause. Et voilà que depuis peu de jours j'ai été condamné au paiement de cette redevance de huit livres par sentence rendue au sénéchal ».
En cet état, le proposant demande au conseil la décision de deux questions :
ce La première est de savoir si cette redevance est prescrite par l'exécution de -ladite transaction et par le défaut de paiement depuis près de trois siècles, et s'il sera bien fondé à faire appel à la Cour de ladite sentence du sénéchal de Tulle qui vient de le condamner ;
ce La seconde est de savoir si cette union faite par la bulle du pape et la fulmination de l'évêque n'est pas abusive, et si le proposant sera recevable d'en faire appel comme d'abus, attendu que l'abus in p>erpetuo et continuo gravât ne peut être couvert ni par prescription ni par fin de non recevoir ;
ce Pour cela le conseil lira, s'il lui plaît, avec attention, les titres dont on lui envoie une copie tout au long;
ce On attache à ce mémoire les avis de M. Dudon et Camboux sur la question dont il s'agit, avec une copie du contrat énoncé dans le mémoire » (Transaction de 1448).
Sur ces entrefaites, M. l'abbé Chanal, démissionnaire de son bénéfice en faveur de M. Magimel depuis le 29 mai 1708, vint à passer de vie à trépas le 4 avril 1710, âgé de 85 ans.
— 226 —.
Qu'advint-il alors? Magimel envoya-t-il même à Bordeaux le mémoire que nous venons de rapporter?
Le Conseil lui envoya-t-il une réponse défavorable? Les documents que j'ai eus entre mes mains sont muets sur toutes ces questions. Mais tout nous porte à croire, qu'après la mort de Chanal, l'abbé Magimel ne fut pas encouragé à faire appel de la sentence rendue par le sénéchal de Tulle. En effet, nous voyons que, trois ans après, le 12 août 1713, la sentence du 26 février 1710 lui fut signifiée par le ministère de l'huissier.
Huit ans après la signification, 28 mars 1721, nous voyons la même abbesse du procès, dame Catherine deBeauverger, donner quittance à Barthélémy Chirac, époux d'Aline Chanal, du contenu en la sentence pour la part des dépenses que MM. Chanal et Magimel devaient payer, chacun leur part, aux termes de la dite sentence rendue contre eux au sénéchal de Tulle, le 26 février 1710.
ce Le reste des dépenses, porte la quittance, est de l'autre part, nous l'en tenons quitte sans aucune garantie de notre part ».
Pour toute garantie, en effet, on délivra à l'héritier de l'ancien curé de Darnets l'expédition de la sentence rendue, à la requête de la dame abbesse, contre Jean Chanal, vicaire perpétuel de Darnets et les pièces visées à Tulle.
Une autre preuve encore que Magimel ne fit pas appel, est que, l'année suivante (1711), il devint fermier de la part des dîmes que la dame abbesse prélevait sur la paroisse de Darnets.
— 227 —
§ VIII. — M. MAGIMEL FERMIER DE L'ABBESSE (1711)
Las, sans doute, de toutes ces chicanes chaque jour de plus en plus ruineuses pour son modeste bénéfice, Magimel, après la sentence de Tulle qui lui était défavorable et son refus d'interjeter appel de cette condamnation qui lui était commune avec son devancier, prit un parti extrême qui dût grandement coûter à son amour-propre de curé de Darnets : celui de devenir fermier de la même abbesse avec laquelle il venait d'avoir un procès de si longue haleine. -
Il espérait sans doute, par là, fermer l'ère des procès entre les religieuses de Bonnesaigne et les curés de Darnets.
Voici la copie de ce premier bail à ferme consenti par les titulaires de l'église Saint-Maurice de Darnets :
« Fait à la grille du parloir d'en haut de l'abbaye royalle de Bonnesaigne en Limousin, le second jour du mois de juillet mil sept cent onze, avant midi, par devant le notaire royal soubsigné, présents les témoins bas-nommés,
« A été personnellement constituée Haute et puissante dame Catherine deBeauverger, dame abbesse de la présente abbaye et prieuré de la paroisse de Darneyx ; laquelle de gré et volonté a baillé et délaissé à titre d'affermé, à M. Maître Magimel, docteur en théologie, et curé de ladite paroisse de Darneyx ici présent et acceptant,
« Scavoir est,
« La moitié des dîmes de blé, seigle appartenant à ladite dame dans ladite paroisse de Darneyx en quoi qu'ils puissent consister, et sous aucune réserve et tous ainsi et de même qu'ils ont été jouis par les précédents fermiers de la dame abbesse,
« La présente ferme ainsi faite par ladite dame audit sieur
— 228 -
curé pour le temps et espace de cinq années consécutives qui ont commencé à courir le jour de Notre-Dame de Mars passé et finiront à pareil et semblable jour, moyennant pour chacune année de la quantité de quatre-vingts sétiers blé, seigle de cette maisure de Bonnesaigne, payable et portable pour ledit sieur Magimel dans les greniers de la dame chaque jour de Saint-Michel de chaque année ; et de plus le sieur curé a renoncé pendant le cours de ladite présente afferme à tous cas fortuits prévus et à prévoir ; pacte pour tout accord entre lesdites parties que au cas où s'il vient à arriver pendant le cours de la présente ferme que le blé viendrait à se vendre sur un grand pied, et de même qu'il se vendrait les dernières années, audit cas et non autrement, il sera loisible audit sieur curé d'en payer quarante sétiers à ladite dame à raison de six livres le sétier, et les autres quarante sétiers en espèce.
« Il a aussi été convenu entre lesdites parties que au cas où l'une ou l'autre d'icelles viendrait à permuter de bénéfice ou viendrait à décéder pendant le cours de la présente afferme, audit cas aussi et non autrement elle demeurera recindée et de nulle valeur sans qu'il soit besoin pour raison due de faire aucun acte,
« Et pour l'entière exécution desdites présentes, lesdites parties ont obligé,
« Scavoir,
« Ladite dame tous les revenus dudit prieuré de Darneyx et de faire jouir ledit sieur curé de ladite afferme envers et contre tous, appuyer; et ledit sieur curé tous et chacun ses biens présents et advenir et sur exprès les revenus de son bénéfice.
« Présents Gérai Dapeyrou, curé de Saint-Fréjou-le-pauvre y habitant et Me Pierre Despert bourgeois dudit lieu, lesquels et parties ont signé.
« Ainsi signé à l'original : Dame Catherine du Beauverger abbesse de Bonnesaigne, Magimel curé de Darneyx, Dapeyrou curé, Despert présent. L'original est contrôlé à Meymac par Laplène. « DESPERT, not™ royal ».
— 229 —
En 1716, le 28 juin, la même ferme fut renouvelée pour cinq ans, à la grille du même parloir et aux mêmes conditions, sauf que le prix n'était que de soixante-quinze sétiers. Dans les cas prévus plus haut, le curé en payait trente-cinq à raison de cinq livres dix sous, et les autres en espèces.
En 1721, le 16 juillet, la ferme fut reportée à quatrevingts sétiers, et dans les cas prévus le curé en payait quarante à raison de cinq livres dix sous, et les autres en espèces.
Ainsi furent calmés, pour un temps, les longs démêlés que nous venons de rapporter. Le presbytère de Darnets ne fut guère plus troublé que par le bruit de quelques arrangements judiciaires en fait de rentes et d'arrérages, dont nous trouvons la mention, par cinq fois, aux archives imprimées du département de la Corrèze.
François Magimel et Catherine de Beauverger vécurent donc de longues années en bonne intelligence.
En 1740, Magimel, déjà courbé sous le poids des fatigues du ministère et des années, s'adjoignit un sien neveu pour vicaire; et, en 1745, il résignait en sa faveur la cure de Darnets.
Deux ans plus tard, l'abbesse disparaissait à son tour de la scène de ce monde (1747).
§ IX. — J.-B. PIGEYROL ET L'ABBESSE GABRIELLE DE SAINT-CHAMANT (1747-58)
Voici apparaître un terrible jouteur qui fera reculer l'abbesse de Bonnesaigne.
C'était encore un montagnard à la trempe énergiT.
énergiT. . 2-4
— 230 —
que, né également sur le plateau de Millevaches, au village du Magimel ; sa mère était soeur du précédent curé.
Petit, trapu, d'une grande énergie, très bon, mais en même temps très digne; ses confrères le redoutaient un peu à cause du titre de visiteur, dont l'avait revêtu la confiance de son évêque.
C'est sans contredit le prêtre le plus distingué qu'ait eu le bonheur de posséder l'église de Darnets, si on en excepte, peut-être, l'abbé Thomas, qui fut député du clergé durant la tourmente révolutionnaire.
Avant de se lancer dans la lutte contre les abbesses de Bonnesaigne, il marcha quelques temps sur les traces de son oncle en affermant les dîmes de l'abbaye.
Le 13 juillet 1748, il consentit une ferme avec l'abbesse Gabrielle de Saint-Chamant sur le pied de quatre-vingt-dix sétiers, mesure de Bonnesaigne.
Douze ans plus tard, il renouvela ce même bail (10 avril 1760), de concert avec le chevalier Léonard d'Ussel de Châteauvert, fondé de pouvoir de sa nièce, l'abbesse, dont nous avons déjà eu occasion de prononcer le nom.
Ce bail, cette fois, s'élevait en argent au prix fabuleux de quatre cent soixante-douze livres treize sous, y. compris les huit livres du verrou.
Fait et passé à Darnets, par devant .Despert, notaire, en présence de François Audouze, praticien ; Etienne Servarie, célibataire ; contrôlé au bureau de Meymac le 16 avril 1760, par Mary, qui reçut sept livres.
Le chevalier d'Ussel agissait en vertu de la procuration que sa nièce, abbesse, lui avait faite à la grille de la communauté d'Ussel le 11 février 1759, en
— 231 —
présence d'Antoine Chastagnier Duteil, étudiant en théologie ; de Jean Cayre, praticien ; de Montlouis, notaire; contrôlé à Ussel, le onze février 1759, par Demichel, qui reçut douze sols pour façon d'expédition.
Après avoir réglé certaines affaires avec les châtelains de Fonmartin, et passé une police avec les habitants de Darnets les ramenant à la dîme pure et simple en abolissant les proférents ou dîmes abonnées (27 janvier 1760), M. Pigeyrol se disposa à résister aux prétentions de l'abbesse d'Ussel de Châteauvert.
§ X. — PRÉTENTIONS DE L'ABBESSE DE CHÂTEAUVERT ENVERS M. PIGEYROL (1769)
Il paraît que Mn,e de Châteauvert, installée à Brive depuis une dizaine d'années, ne trouvait guère plus d'aisance à Sainte-Claire qu'elle n'en avait eue dans les marais de Bonnesaigne.
Quoique établie cette fois dans une plaine opulente, sur les hors de la Corrèze, elle avait constamment les yeux tournés vers la montagne d'où lui arrivait le secours.
Vers la fin du bail du 10 avril 1760, elle se plaignit amèrement de ce que M. Pigeyrol ne lui donnait rien :
1° Sur une donation que noble Delphine de PeyreFaure (Petri-Fabri) avait faite à Pierre Blanchier, quelque temps après les embarras que lui avait suscités l'abbesse Gaillarde Roberte II de Blauge dont nous avons déjà parlé; cette donation portait expressément qu'elle était faite à l'exclusion des religieuses
— 232 —
de Bonnesaigne ; — 2° Sur les rentes du bourg payées jusque là au curé seul ; — 3° Sur les rentes ou proférents fonciers portés dans le terrier du 22 février 1385, que les curés percevaient et entendaient percevoir seuls, à l'exclusion de l'abbaye depuis l'union de la cure (1348) et la donation du 28 juin 1393 de Mme de Peyrefaure.
C'était une bonne affaire pour la besogneuse abbaye, si le curé pouvait se montrer de bonne composition, comme il l'avait fait dans les fermes qu'il avait consenties depuis qu'il était au pouvoir !
A l'expiration du bail de 1760, elle fit entendre ses réclamations, se plaignant de ce qu'on n'avait pas compris, dans la dernière ferme, tout ce qu'elle avait droit d'y faire insérer relativement à la donation de Delphine de Peyrefaure, etc., etc.
M. Pigeyrol lui répondit noblement que pour avoir la paix avec l'abbaye et ne pas ouvrir de nouveau«l'ère des procès, il consentirait à donner 500 livr. de ferme, c'est-à-dire 28 livres de plus que dans le dernier bail, bien qu'il sût positivement, après examen des titres de la communauté, que la première fois il donnait même trop.
Après plusieurs et inutiles lettres échangées, ne pouvant tomber d'accord, curé et abbesse choisirent pour arbitre, afin de vider le différend, M. Laval, prieur et promoteur de l'officialité, chanoine de Brive.
M. Pigeyrol se trouvait alors à Brive (2 juin 1760).
Quelque temps après, M. Laval écrivit à M. Pigeyrol qui, pour éclairer sa religion sur la question en litige, lui envoya un mémoire et une lettre pour l'entre-
— 233 —
mise de M. Verniaud. économe du grand séminaire de Tulle. Voici ces intéressants documents :
« Monsieur,
« J'ai été plus sensible que je ne saurais vous l'exprimer, à toutes les bontés et attentions gracieuses dont il vous a plu, et à mademoiselle de la Valette, de me combler et de m'honorer ; agréez, Monsieur, que je vous en réitère mes empressés remercîments, et que je l'assure de mon très-humble respect, ainsi que MelIe Pasché votre soeur.
« Suivant la permission que vous avez bien voulu m'en donner, Monsieur, je prends la liberté de vous adresser mon Mémoire ci-joint avec plusieurs autres pièces, concernant .mes différends avec Mme L'abbesse ; vous y verrez ma sincérité dans l'aveu des revenus de mon bénéfice, et je vous proteste que dans les huit ans y désignés, il n'y a que trois sacs de blé de plus sur le total des huit années, qui fait un sétier, une coupe de plus par an, et vous jugerez quel est mon profit, affermant à 90 sétiers, mesure de Bonnesaigne. C'estf-à-dire 360 quartes, et que ce n'est que par les motifs y insérés que je suis bien aise d'avoir la totalité, quoique les frais de levée me soient coûteux ; ils le seront bien plus à un fermier qui ne trouvera plus les gens à sa disposition, ni au même prix que moi. Quand il faudra garder 2 ou 3 vaneurs à la journée, 1, 2, quelques fois 3 jours à attendre et épier le moment du vent ou la cessation de la pluie, user draps el sacs, les envîeux en sentiront mieux la conséquence ; au lieu que je fais ramasser mon grain chaque jour et que je le garde dans sa hâle où il se conserve sans danger jusqu'au besoin.
« Je joins ici, outre mon Mémoire :
« 1° Copie en forme de la pieuse donation de noble Delphine de Peyrefaure, tirée mot pour mot de l'expédition originale en velin, sur laquelle on peut compter comme si on la voyait ;
« 2° Une cotisation ou liève, de l'an 1666, de mes profé-
— 234 —
rents, avec une feuille de même écriture, et même portant la totalité de ce que les curés ont toujours possédé et sont en droit de posséder eux-seuls, cela ayant été sans doute abonné en vertu delà susdite donation. Mais cent ans de confidence et le long laps de temps ont préjudicié à bien des choses et fait perdre bien des titres ;
« 3° Une cotisation, deux sentences et une saisie rendue sur quelques villages particuliers, à la requête des curés seuls, ce qui prouve irrévocablement leurs droits ; j'ai plusieurs autres pièces de cette nature...
« 4° L'expédition de mon dernier bail, avec un petit mémoire spécifiant chaque article et le prix de chaque chose faisant la totalité dudit bail. Madame a la Bulle d'Union et la Fulmination ; ainsi je ne l'ajoute pas ici ; c'est son titre fondamental et dépourvu du concours de la puissance temporelle ; Vous sentez, Monsieur, combien il est peu solide, et propre à lui donner de l'inquiétude ; ce que je n'entreprendrai qu'autant qu'elle m'y forcera en me disputant mes reprises et un titre de fondation imprescriptible, que je me sens obligé en conscience de soutenir comme d'en acquitter les charges ;
« 5° Un Avis de Conseil de M. Rabanide, un des meilleurs avocats de Tulle ;
« 6° Je prends la liberté de vous adresser ma procuration pour le passement d'un bail, s'il y a lieu, osant me flatter, Monsieur, que vous voudrez bien me pardonner et faire pour moi ce que je voudrais être e'n même de faire pour vous.
« Quoique mon Mémoire soil absolu pour les clauses, je vous laisse entièrement le maître de tout ; quoiqu'il me fût essentiel qu'il y fût stipulé comme il est porlé par mon Mémoire que je n'entends me préjudicier en rien au montant de mes lièves ni à mes novales, dont il s'est fait confusion par la jouissance ; du tout vous réglerez, s'il vous plaît, comme bon il vous semblera ; mais du moins, qu'il y soit dit seulement, comme dans le précédent, la part et portion des dîmes tant en seigle qu'en agneaux, en quoi qu'elles consistent et non la moitié, puisque cela est faux selon le titre de
— 235 —
fondation. Il faut, s'il vous plaît, que Madame commence par me donner quittance du pacte avenir de la S'-Jean-Baptiste et de 4 livres, 13 sols, 6 deniers dont je la surpayai en étourdi; et qui seront autant de payé.sur la redevance de 8 livres pour le verrouil de l'église. Je vous prie, Monsieur, de faire en sorte que le premier pacte ne soit qu'à la Noël et le second à la St-Jean-Baptiste, comme ci-devant, étant hors d'état d'en faire un autre à la S1-Jean prochain.
« Je vous supplie aussi d'offrir mes respects à Mme l'abbesse si elle veut bien les agréer, et à dom Col de qui je fis tenir la lettre par un bourgeois d'Aubusson.
« Il pourra bien se faire que Mme demande des épingles ; mais je crois de lui en avoir donné d'honnêtes depuis mon règne et les neuf ans de mon bail où elle en aurait été de plus de 20 livres par an pour les réparations de la sacristie et du sanctuaire que j'ai faites et je continuerai les mêmes épingles pendant le bail suivant.
« S'il faut quelque écu de 6 livres pour la femme de chambre, ou ce que vous jugerez convenable, je vous prie, Monsieur, d'avoir la bonté d'en faire l'avance, ainsi que des frais du bail, que je serai exact à vous faire passer, quoique je n'ai pas tiré un obole des droits de lods qui ne sont que sur deux petits ténements, pendant mon dernier bail, il est juste, ce semble, que s'il y a quelque chose, cela me revienne.
« Vous pourrez, Monsieur, faire repasser le paquet entre les mains de M. l'Econome du grand Séminaire, ou du sieur Piquar Crignon, maître-faiseur de bas.
« Agréez que M. l'official et M. Lajugie trouvent ici l'assurance de mes respects. J'aurais fort voulu voir Mr,Rivet et Mr Le Mas, mais j'étais isolé dans votre ville à ne savoir aucune maison et tout le monde était en dévotion. Il y a apparence que Mme les fera appeler, je vous prie de leur faire mes très-humbles compliments.
« J'ai l'honneur etc. PIGEYROL, curé de Darnets.
« J'ai un procès à Tulle pour ces proférents où j'ai plusieurs autres lièves. « A Darnets le 11 juin 1769 ».
— 236 —
Sept jours après l'expédition des documents dont nous venons de parler, à l'adresse de M. Laval, le curé de Darnets lui écrivit de nouveau :
« Je ne sais si vous avez reçu le paquet que vous m'avez bien voulu permettre de vous adresser concernant mes intérêts avec Mme L'abbesse. Il vint cependant ici, avant hier, un marchand de Meymac en mon absence disant n'avoir point la ferme, mais cependant qu'il avait commission de venir dîmer les agneaux lundi prochain. Connaissant ses bonnes dispositions je pense qu'il a affermé ; vous vous rappelez, Monsieur, que j'eus l'honneur de vous rendre mot pour mot ma conférence avec Mms et que vous n'y trouvâtes rien de trop. Cependant elle en a fait des plaintes amères jusqu'à dire, au rapport de son commissaire, que je m'étais emporté. Ma conscience m'est témoin du contraire et du calme aveclequeil je déduisais mes raisons. C'est ici le renovato de Vareix, pour parler honnêtement il faut donc être du même sentiment oubliant tout intérêt
« Quoiqu'il en soit, Monsieur, vous verrez si Madame veut me continuer la ferme, oui ou non... Si le Parlement de Bordeaux a aboli les Novales comme les autres, ce que vous savez sans doute, quoiqu'on m'ait assuré le contraire, je n'aurais plus de reprise à cet égard selon mon Mémoire joint au paquet ; et ce serait pour Mme 10 sétiers seigle de plus à 3 livres, 14 sols le sétier comme l'autre. Je cherche bien plus ma tranquilleté qu'un gain sordide de fermier, et Me n'en trouvera pas de si désintéressé que moi. Je lui avais promis de lui rendre compte fidèle de sa part de dîme d'agneaux. Mais elle ne s'est pas fiée à moi. Je ne puis avoir le don de lui plaire. Je vous prie, Monsieur, de me faire réponse par le présent porteur, s'il vous est possible, ayant à faire mes diligences pour mon sixième en reprise sur la totalité de la dîme des agneaux en conséquence du contrat de fondation, sans y perdre de temps et peut-être pour d'autres objets.
« J'ai l'honneur... PIGEYROL, C. de Darnets.
« Mes très-humbles respects à MeIIe de la Valette.
« A Darnets le 18 juin 1769 ».
— 237 —
Dans le paquet adressé à M. Laval se trouvait le suivant énoncé des rentes de l'église de Darnets restées indivises :
« Le sieur curé, de Darnets, en vertu de la donation faite par forme et manière de fondation à l'église de Darnets par noble Delphine de Peyrefaure du 23 juin 1393, à charge de prières et services divins et conformément à toutes ses lièves, doit percevoir en seul et à l'exclusion des dîmes de Bonnesaigne, comme lui et ses prédécesseurs en ont toujours eu le droit en seuls et sur les villages et ténements énoncés audit contrat de fondation,
« Savoir est en proférents ou en dîmes :
« Quatre-vingt-dix sétiers, un quarton seigle ;
« Quarante-sept sétiers, un quarton froment ;
« Trois-cent-vingt-six quartes, deux ras d'avoine ;
« Cinquante-huit gélines.
« Le susdit froment en seigle a un tiers en sus, faisant en seigle, pour tenir lieu de froment, soixante-dix sétiers, trois quartons qui avec les quatre-vingt-dix sétiers, un quarton seigle font cent-soixante-un sétiers, laquelle quantité de seigle prenable sur la totalité de la dîme ou sur les champs désignés pour ledit profèrent. Lesdits grains mesure d'Egletons moitié de celle de Bonnesaigne un 20" en sus.
« Ledit sieur curé a à prélever en outre les Novales qui monteront au moins à quarante sétiers eu égard aux paroisses voisines et à la situation de ladite paroisse où il se fait annuellement des défrichements dans les bois ou broussiers ; total mesure d'Egletons deux-cent-un sétiers, et mesure de Bonnesaigne cent-six.
« Or, selon le compte exact qu'a fait ledit sieur curé de huit années consécutives, pendant son dernier bail selon les Mémoires qu'il s'est trouvé avoir conservés, la totalité des grains en seigle n'est montée, une année portant l'autre, qu'à cinq-cent-soixante-dix sétiers mesure d'Egletons, ce qui en fait, mesure de Bonnesaigne, trois-cent-treize sétiers, un quarton ; et déduction faite des cent-six à prélever, reste à
— 238 —
partager deux-cent-huit sétiers, une quarte ; c'est cent-quatre sétiers un quarton pour chacun. C'est donc quatorze sétiers un quarton que ledit sieur curé paraît avoir de bon dans la ferme à quatre-vingt-dix sétiers.
« Mais combien d'accidents ladite paroisse a essuyés, pendant le règne dudit sieur curé ; trois années de gelée et quatre années là grêle...
« En outre il faut vingt-cinq jours à quatre batteurs et un tourneur pour battre lesdits grains à douze sous par jour pour chacun pour journée et nourriture, quoique prise bien modique, cela monte soixante-quinze livres, nouveaux frais pour des vaneurs, souvent vaquants à défaut de vent, et qu'il faut également nourrir et payer ; enfin frais pour le transport desdits grains qui ne sont cependant qu'en nourriture pour led. curé.
« Il est facile de conclure de ce fidèle exposé quel est son gain, et si ce n'est pas plutôt pour éviter tout démêlé pour qu'on dîme plus équitablement dans les granges, ce qui arrive en effet quand un curé perçoit la dîme et enfin pour être plus libre de faire battre et vaner son grain à sa volonté, que pour le profit qu'il en fait.
« C'est dans le même esprit que ledit sieur curé a affermé lesdits grains trois livres 14 sous le sélier susdite mesure de Bonnesaigne, prix plus haut au moins de 8 à 9 sous par sétier qu'aucun autre fermier ne l'ait élevé.
« Il a affermé sur le même pied, les petites rentes que Madame a dans ladite paroisse, et l'avoine à 6 sous, à quoi elle ne s'est jamais affermée de cette petite mesure ;
« Rente : seigle 36 quartes
avoine 55 quartes 2 coupes argent 6 livres 17 sous.
« Il a affermé les agneaux soixante-quinze livres quoiqu'il ait un sixième à prélever sur la totalité ; il y fait le même gain que sur le reste, et le total en argent monte : quatrecent-soixante-douze livres, 13 sous.
« Ledit sieur curé a offert bonnement et à l'aveugle, sans avoir bien examiné ses droits, comme il vient de le faire, à
— 239 —
Madame l'abesse de faire le compte rond à cinq-cents livres, et il continue son offre pour ne pas manquer à sa parole ; et s'il ne l'avait avancé il ne le ferait pas, voyant que c'est à sa pure et évidente perte. Mais il aime mieux en être de sa perte que de passer pour un homme sans parole.
« Ainsi, si Madame l'abbesse veut lui consentir un bail pour neuf ans, elle en est la maîtresse ; mais il ne sera accepté qu'autant qu'il y sera stipulé que ledit sieur curé ne prétend se préjudiciel' en rien au montant de ses lièves proférentales, qu'il prélèvera sur la totalité des grains, en cas qu'il vienne à n'avoir plus ladite ferme, en, par lui, faisant dîmer de tous les champs et pièces ensemencées de seigle, ni au sixième de la dîme d'agneaux portée par la fondation de la pieuse Delphine de Peyrefaure, ni à ses Novales.
« Il sera aussi stipulé que ladite dame tient quitte ledit sieur curé du pacte de S'-Jean-Baptiste prochain qui est de deux-cent-trente-six livres, 6 sous, 6 deniers, comme l'ayant reçu d'avance, si mieux elle n'aime lui donner quittance préalable et séparée de sa main et de quatre livres treize sols six deniers de plus qu'elle a reçus au moyen de dix Louis d'or qu'elle a reçus à son parloir dudit sieur curé le 2 juin (1769).
« Enfin que ladite dame s'oblige de fournir des reconnaissances audit sieur curé pour la levée des rentes tant pour le passé que pour l'avenir, lui ayant été fait pour quarante-huit livres d'arrérages de son dernier bail.
« Que si Madame veut critiquer la pieuse donation de la noble Delphine ledit sieur curé se mettra en devoir de la faire valoir, comme il le doit en honneur et en conscience.
« Au reste ledit sieur curé y allait si bonnement et à l'aveugle qu'il croyait devoir, comme il en fit l'aveu, le pacte de Noël prochain ; mais cela est faux, ayant toujours payé exactement son 1er pacte à la Noël et le 2e à la St-J.-B., de sorte que celui de S'-Jean prochain est le dernier comme il apparaît par ses quittances ».
— 240 —
§ XI. — ENTREVUE DU CURÉ ET DE L'ABBESSE (1769)
Que faire devant tant de revendications exprimées de part et d'autre? Car, si M. Pigeyrol était verbeux, Mme d'Ussel-Châteauvert ne devait pas non plus être, courte de paroles et de revendications.
Gomment se reconnaître au milieu de tant de paperasses? Le plus simple était de ménager une entrevue aux deux champions pour leur fournir l'occasion de s'entendre sur leurs droits respectifs et leurs devoirs réciproques.
C'est ce que fit M. Laval.
Ainsi éclairé, ou plutôt ainsi aveuglé sur le débat par tant de petits bouts de papier, il pensa que le plus sage était pour lui de remplir le rôle de conciliateur entre l'abbesse et le curé. Il s'entendit avec eux et arrêta le jour où ils pourraient l'un et l'autre débattre, tout à leur aise, longuement et vigoureusement leurs intérêts mutuels.
L'entrevue eut lieu dans les derniers mois de l'année 1769. Le premier choc fut violent de part et d'autre ; mais après avoir rompu plusieurs lances verbales à travers les barreaux de la grille, les esprits se calmèrent petit à petit et curé et abbesse finirent par s'entendre et convinrent de passer sans tarder un bail à ferme.
C'était trop bien pour que ça durât.
§ XII. — L'ABBESSE REMET TOUT EN CAUSE (1770)
A peine l'abbé Pigeyrol était-il rentré à Darnets, que Mme de Châteauvert conçut en son esprit des soup-
— 241 —
çons sur la sincérité de la déclaration des dîmes de la paroisse de Darnets, et sur la valeur des titres allégués par le curé pour mettre hors de partage les proférents en question.
Elle fît, ou plutôt elle fit faire un mémoire pour mettre plus en évidence ses droits et ses titres et l'envoya au curé de Darnets.
M. Pigeyrol connaissait trop bien les variations dont peut être le siège le cerveau d'une femme, pour être étonné ou surpris d'un changement si subit de la part de l'abbesse de Bonnesaigne. Il lui fit tranquillement repasser son Mémoire à Brive, sans un mot de réponse, et, au retour du nouvel an (1770), il écrivit simplement, comme à l'ordinaire, ses voeux et ses politesses à la versatile abbesse; il ne soufflait mot, dans sa lettre du premier de l'an, sur ce qui venait de se passer depuis leur dernière entrevue.
L'abbesse fut outrée de dépit du silence, assurément calculé, du petit curé montagnard.
Ce ne fut que le 7 février 1770 qu'elle répondit aux voeux que M. Pigeyrol lui avait adressés au commencement de l'année. Après les compliments d'usage en pareille occasion, l'abbesse demandait au curé des explications sur le sujet qui les divisait. Elle insistait surtout pour avoir une réponse au Mémoire qu'elle lui avait adressé et qu'il avait repassé à Brive sans le moindre mot ou pour ou contre.
Cette lettre abbatiale, sans un mot d'orthographe, est sur un ton fort dégagé.
Elle se terminait par cette phrase :
« J'ai grande impatience de savoir à quoi m'en tenir avec
— 242 —
vous ; je n'aime point les procès, mais j'aime l'ordre dans mes affaires ».
I XII. — RÉPONSE DU CURÉ (1770)
Mme Léonarde-Gabrielle d'Ussel de Châteauvert ne savait pas, paraît-il, à qui elle avait à faire quand elle se permettait d'écrire avec une telle désinvolture de langage au petit curé, au collet bas, de Darnets.
M. Pigeyrol n'était pas homme à avoir l'onglée, même au plus fort de l'hiver, pour répondre avec de la bonne encre quand on l'avait blessé dans la noblesse de ses sentiments et la délicatesse de ses intentions. Il était petit, mais de taille à ne pas se laisser toiser par le premier venu, par même par une haute et puissante abbesse.
Quatre jours après, c'est-à-dire le 11 février 1770, M. Pigeyrol répondit à l'abbesse de Châteauvert :
« Je vous supplie, Madame, de vouloir bien vous rappeler ce que j'eus l'honneur de vous dire la dernière fois que j'eus celui de vous voir, que je ne désirais rien tant que de bien vivre avec vous, et de pouvoir mériter l'honneur de votre bienveillance ; que je tâcherais de ne rien faire pour la démériter ; que je n'avais pas plus de goût ni d'intérêt pour le procès que vous.
« C'est dans toute la sincérité, Madame, que j'ai voulu vous donner ces assurances ; et partant je n'ai pas cru nécessaire de vous faire passer une réponse à votre Mémoire ; je l'avais faite avant de le voir.
« Mr du B. notre Médiateur l'a lu attentivement d'un bout à l'autre, et je suis persuadé qu'il l'a encore présent. Je me suis soumis à sa décision favorable pour vous, Madame, dans notre bail à ferme au sujet de la fondation de noble Delphine de Peyrefaure, me bornant à mes proférenls qu'il
— 243 —
trouva solidement et invinciblement établis à prélever sur la totalité de la dîme. Mais comme vous n'êtes pas obligée de m'en croire, l'intérêt ne faisant que trop souvent passer à côté de la vérité, vous avez, Madame, des gens de confiance et d'intelligence sur les lieux pour faire l'examen et me convaincre du faux allégué. Si j'ai été assez malhonnête homme pour vous en imposer, quand vous aurez cette connaissance telle que vous la désirez et qu'il convient que vous l'ayez, nous passerons transaction ensemble, comme Mr notre Médiateur nous le conseille à l'un et à l'autre, ou pour notre vie ou encore pour nos successeurs, s'il le juge convenable. Jugez par là, Madame, s'il vous plaît, si je suis homme à vouloir plaider el vous inquietler, et, preuve de ma sincérité, vous pouvez, Madame, garder ma lettre; elle est assez claire et explicite pour vous convaincre qu'il n'y a en moi ni replis ni détours, et que je me soutiens toujours dans ce que j'eus l'honneur de vous dire dans votre parloir, en vous priant de m'accorder l'honneur de votre bienveillance ; c'est dans dans ces sentiments que j'ai aussi celui d'être avec un respect infini, etc ».
Cette lettre si pleine de dignité, de franchise et en même temps de politesse, contrastant si bien avec celle de l'abbesse, était une réponse bien de nature à dissiper les sentiments de méfiance que Mme de Châteauvert avait éprouvés à l'endroit du curé de Darnets en lui écrivant sur le ton que nous avons dit. Il n'en fut rien.
Mme l'abbesse refusa encore de se rendre à l'évidence; elle avait envie de plaider; il fallait bien que M. Pigeyrol lui passât ce petit caprice de femme.
Les démêlés qui renaissaient entre eux ne devaient pas finir de sitôt. Durant près de quatre ans, cette affaire resta pendante devant les tribunaux, ou entre les mains des médiateurs choisis, et de part et d'autre acceptés.
— 244 —
§ XIV. — RÉPONSE DE M. JUGE AVIS DE LIMOGES
(1774)
Enfin, désireux d'en finir une bonne fois pour toutes, M. Pigeyrol écrivit à M. Juge Avis de Limoges l'objet de son différend avec Mmc de Bonnesaigne, et sous la date du 3 juin 1774, il en recevait la réponse suivante :
« Vu les Mémoires de M. le curé de Darnets et consultation y jointe, le soussigné estime que le proposant est en droit de retenir hors de partage et exclusivement à l'abbaye de Bonnesaigne :
« La Rente foncière et directe due par les habitants du Bourg de Darnets, et les dîmes abonnées connues sous le nom de Proférents en vertu de la possession immémoriale dans laquelle il est à la suite de ses prédécesseurs ».
Après avoir réfuté l'objection que personne ne peut prescrire contre son droit, vu que l'abbaye possède un droit général depuis l'union, et certaines raisons alléguées par le curé disant que son clocher était un titre suffisant pour jouir de toutes les dîmes de sa paroisse, vu que la Bulle avait réduit les curés à la moitié des dîmes et autres revenus de leur bénéfice en unissant l'autre moitié à l'abbaye, M. Juge Avis continue :
« Nonobstant les raisons qu'on peut alléguer, la prescription du sieur curé paraît être en sa faveur une barrière insurmontable ; elle est évidemment établie par tous les actes cités par le Mémoire, et l'on doit présumer que :
« 1° Son fondement est plutôt légitime que vicieux. La Bulle du pape n'est pas ce qui a confirmé l'union de la cure à l'abbaye ; il fallait le concours de la puissance royale et un jugement rendu après les formalités observées. Le jugement n'est point rapporté ; il est à présumer qu'il a retranché à
— 245 —
l'abbaye une partie des revenus qui lui avaient été accordés en faveur de celui qui devait soutenir Pondus diei et oestus, et Prescripiioni standum donec probetur contrarium.
« Ce qui rend cette présomption très forte c'est que la possession des sieurs curés remonte à peu près à l'époque de l'Union et a toujours continué sans aucun trouble ni empêchement de la part de l'abbaye qui n'a pas pu l'ignorer ; parce que les actes de cette possession étaient publics et notoires. Le terrier de 1380 n'a pas pu se faire clandestinement, ni les proférents, substitués à la dîme, payés au curé seul à l'insu de l'abbaye qui partageait tous les autres dîmes de la paroisse, et qui n'aurait pas laissé les tenanciers qui avaient fait l'abonnement jouir à titre d'exemption du privilège de ne pas payer la dîme si elle n'avait eu connaissance qu'elle était abonnée et servie au sieur curé seul.
« Il en est de même des rentes du Bourg qui non seulement ont été perçues par les sieurs curés pour le total, mais encore dont lesdits sieurs curés ont rendu hommage aux Seigneurs de Ventadour sans aucun concours de l'abbaye. Celle-ci se serait certainement opposée auxdits hommages ; le Seigneur aurait même exigé qu'elle les rendit conjointement avec le sieur curé, si elle en avait eu sa part et portion dans lesdites rentes.
« 2° L'on peut très bien prescrire contre un titre commun et changer l'état de la possession, ex causa nova superveniente. Et cette nouvelle cause se trouve dans l'hypothèse présente au moyen de la donation qui fut faite en 1393 par la dame de Peyrefaure aux sieurs curés de Darnets, d'obits et fondations de la quatrième et sixième partie de la dîme qu'elle percevait sur les fonds dépendants de la cure. Il est sensible que l'abbaye n'aurait rien à prétendre dans cette donation; l'antiquité de l'acte fait présumer que la donation avait effectivement une portion des dîmes de la paroisse de Darnets, quânam invidiâ, que pour éviter toute discussion sur la distraction des dîmes en faveur du sieur curé, l'abbaye lui avait délaissé la moitié qu'elle avait dans les dîmes abonnées, et peut-être celles du Bourg; l'on dit peut-être
T. XXV. 2-5
— 246 —
quant à ce dernier objet, parce qu'il se pourrait fort bien que lesdites rentes eussent aussi été délaissées par la maison de Ventadour pour raison de quelque fondation sous la rétention de l'hommage.
« 3° Il est décidé par l'apostillateur de la Peyrère et les autorités qu'il rapporte (Lect. 8 n° 67 verba : on peut) qu'à supposer que tous les revenus de la cure de Darnets eussent demeuré en commun entre l'abbaye et le sieur curé, celui-ci aurait pu prendre les proférents et les rentes, parce que la règle Socius rem communem contra Socium prescribit ; et qu'elle cesse d'abord que Socius possidet nomine proprio. Tel est le cas présent.
« Les parties ont toujours possédé en commun les dîmes ordinaires qui ont demeuré indivisées ; mais en outre les sieurs curés ont joui en seuls et en leur propre nom les proférents el les rentes du Bourg ; la preuve en est consignée dans le nombre prodigieux d'actes authentiques publiés et non contredits. Le titre de cette possession des sieurs curés qu'ils ont eu nomine proprio pendant l'espace de plus de trois siècles postérieurement à la Bulle de 1348 de certains revenus particuliers, n'est point rapporté, mais il est nécessairement présumé surtout après le concours des autres circonstances ci-dessus rappelées ; parce que optima rerum interpres consuetudo ; et la seule possession continuée pendant si longtemps a par elle-même suivant la doctrine de Dumoulin Vim tiluli ac conslituti.
« Si elle se bornait aux temps des deux derniers titulaires de la cure qui ont été fermiers de l'abbaye, elle serait regardée comme précaire et par conséquent inutile, pour la prescription ; mais elle remonte à plus de deux siècles avant les fermes qui n'y ont aucunement dérogé.
« En ce qui concerne les Novales que le proposant voudrait se retenir des pays nouvellement défrichés dans les 40 ans antérieurs à l'édit de 1768, il est question de savoir si avant les baux à ferme acceptés par les sieurs curés, ils prélevaient les Novales lors du partage des dîmes ordinaires, ou si au contraire lesd. Novales étaient partagés avec les autres dîmes ;
— 247 -
« Au 1er cas le proposant est fondé à se retenir, d'abord puisqu'il n'opte pas la pension réglée par cet acte, sa disposition lui est favorable ;
« Mais au 2e cas il n'est pas fondé dans sa prétention parce que lui et son prédécesseur n'ont pu acquérir aucun nouveau droit pendant leurs termes : Non sibi sed domino possidebant.
« Enfin le changement que l'on a fait par rapport aux proférents en faisant assujélir les abonnateurs à payer la dîme ordinaire, causera des distinctions qu'il est impossible d'éviter pour distinguer lesd. dîmes des autres. Mais si l'on a les titres qui faisaient avant cette conversion la Cotité de chacun desd. abonnements, l'expédient proposé par M. Demanoux de demander à prélever le montant desd. abonnements et de partager tout le surplus, semble préférable à tous autres : à défaut de titres il faudra en venir à des enquêtes qui sont toujours fort coûteuses et fort incertaines.
« Signé Juge Avis ». (Délibéré à Limoges le 3 juin 1774 pour honor. 6 livres).
§ XV. — RECULADE DE L'ABBESSE (1774)
La réceplion d'une consultation si claire, si précise, si bien motivée, eut un double résultat :
Plus que jamais l'abbé Pigeyrol se sentit fort de son droit, et l'abbesse de Châteauvert sentit quo le terrain lui manquait sous les pieds.
Cette réponse, favorable au curé sur toute la ligne, produisit sur l'abbesse l'effet d'un seau d'eau jeté en pleine figure d'une personne enfiévrée. Elle qui avait tant envie de plaider, comprit tout d'un coup que les affaires prenaient une mauvaise tournure pour la cause qu'elle contestait. Autant elle s'était montrée exigeante dans ses actes et dans ses lettres, avant
— 248 —
que M. Pigeyrol eût pris la mouche, autant elle se montra douce et traitable après avoir flairé l'air des bureaux judiciaires.
Mmc de Châteauvert reconnut, avec beaucoup d'humilité, la fausseté de la chicane qu'elle cherchait au pauvre curé de Darnets, regretta l'opiniâtreté qu'elle y avait mise et sollicita un accommodement à l'amiable, offrant même au curé de Darnets la ferme de la portion des revenus qui pouvaient lui revenir sur cette cure, le priant de descendre à Brive, disant que cette fois ils s'entendraient.
M. Pigeyrol ne pouvant, pour cause de maladie, se rendre à l'invitation de l'abbesse, fonda de procuration M. Laval pour traiter avec Mme de Châteauvert, et adressa à l'abbesse une copie des proférents qu'il entendait, avec plus de raison que jamais, exclure du partage des dîmes avec l'abbaye de Bonnesaigne.
Avec la peur, la sagesse était venue à l'abbesse ; elle fut facile, douce comme un gant, envers le procureur de M. Pigeyrol. Ils tombèrent d'accord en un clin d'oeil; et le 29 septembre 1774, M. Laval, se trouvant à sa maison de campagne du Clou, paroisse d'Ussac, écrivait au curé de Darnets :
« Le matin du jour de mon départ pour cette campagne, je reçus votie procuration pour traiter en votre nom avec Madame l'abbesse de Bonnesaigne. L'après midi du même jour, le contrat de ferme pour neuf ans fut passé ; je vous en envoie l'expédition, avec celle du précédent bail que vous m'avez fait passer, sans doute, pour s'y conformer dans ce dernier. Celui-ci n'a commencé à courir que du 25 mars, parce que le premier ne finissait qu'à celle époque. Il n'y a pas eu d'épingle pour Mme l'abbesse, peut-être sur ce que je lui ai dit de vos pertes sur l'année courante. Cependant elle
— 249 —
vous demande du beurre et je lui ai promis de vous écrire pour vous y solliciter, au moins pour une fois fait. Du reste vous êtes fort maître de faire ce que vous jugerez à propos...
« J'ai demandé plusieurs fois à la dame la copie de vos proférents que vous lui aviez adressée en particulier, avant hier par mon domestique que je lui envoyai. Elle m'a répondu qu'elle l'avait cherchée et qu'elle ne l'avait pas trouvée, mais qu'elle la chercherait de nouveau et que dès qu'elle l'aurait trouvée, elle me la remettrait ; je soupçonne qu'elle l'a confiée à son avocat et qu'elle l'a oubliée, je lui communiquerai mon soupçon
« Quant aux titres de rentes non servies que vous réclamez, ladite abbesse m'a dit qu'elle vous priait de lui faire passer un état de ces rentes, afin qu'elle en pût chercher les titres, et vous en envoyer une expédition.
« Il ne me reste, Monsieur, qu'à vous souhaiter une meilleure santé ; la mienne commence à se rétablir, et je reprends des forces.
« J'ai l'honneur etc. LAVAL, ch"c.
« M. de la Valette qui est ici vous prie d'agréer l'assurance de ses respects ».
La famille de la Valette (originaire de Bretagne), établie à Brive, habitait le presbytère actuel de SaintMartin.
A partir de cette date (1774) jusqu'à la Révolution, qui se chargeait de les mettre d'accord d'une belle manière, il n'y eut plus de contestations sérieuses entre les curés de Darnets et les abbesses de Bonnesaigne.
La ferme de 1774 fut renouvelée en 1781 pour neuf ans, et cette fois sans difficulté de la part de la nouvelle abbesse, Mme Françoise-Gabrielle Green de SaintMarsault (1780-1805). Le prix était de six cents livres
— 250 —
annuellement et les termes de cette ferme, passée le 17 mai par devant Lascaux, notaire à Uzerche, portaient cette clause dont nous comprenons maintenant la signification qui a pu échapper au lecteur à prime abord, lorsque nous avons donné au chapitre IV, § IX, les fermes que fit renouveler l'abbesse Gabrielle de Saint-Marsault à son arrivée au pouvoir : ce Sans néanmoins que la présente stipulation puisse préjudiciel' à
l'abbesse Il ne sera préjudicié en rien aux droits
de proférents prétendus par ledit sieur curé, sur diverses possessions de la paroisse, n'entendant ladite abbesse reconnaître lesdits droits, à l'égard desquels les exceptions de toutes parties demeurent respectivement réservées ».
C'est-à-dire qu'on enterrait les matières à contestations, sauf le droit de les faire sortir du tombeau lorsque bon semblerait à l'un ou à l'autre de faire revivre les procès.
M. Pigeyrol ne vit point la fin de ce bail. Il paya ponctuellement les pactes convenus jusqu'au 5 janvier 1785 ; le lendemain il était mort, et la ferme se trouvait résiliée par le fait même; ce qui prouve que M. Pigeyrol n'avait nullement entendu lier ses successeurs.
Par contrat du 15 mars 1785, le successeur de M. Pigeyrol, l'abbé Martin Thomas, traita pour cinq ans avec Mme de Saint-Marsault, au même prix de six cents livres.
Quoiqu'il ne soit resté qu'un an à la cure de Darnets, Martin Thomas, devenu curé de Meymac, continua à payer l'abbesse jusqu'au 15 juillet 1790, que M. Antoine Lauly, son successeur et son neveu versa
— 251 —
le pacte, mais au nom de son oncle. Ce n'est que le 28 août 1790 que l'abbè Lauly retira le reçu de l'abbesse à son propre nom.
Ce dût être le dernier; la Révolution était déjà en train de faire son oeuvre délétère.
On le voit, de 1348 à 1790, les abbesses de Bonnesaigne et les curés de Darnets ne péchèrent pas par trop d'intimité ; ils tombèrent dans l'excès contraire.
Ils ne surent pas garder la juste mesure si nécessaire en toutes choses dans ce bas-monde !
CHAPITRE VIII
Épreuves de Bonnesaigne
§ I. — EPREUVES INTÉRIEURES
Placée loin du tumulte des villes, au sein d'une campagne paisible, peuplée de religieuses sorties des familles les plus aristocratiques, les plus aisées et les plus chrétiennes de plusieurs provinces à la ronde, il semblerait, au premier abord, que l'abbaye de Bonnesaigne avait tout ce qu'il fallait pour mener une vie calme, recueillie derrière les robustes murailles que les grands de l'époque avaient élevées pour abriter la vertu et la piété de leurs filles appelées à servir Dieu plus parfaitement qu'elles n'auraient pu le faire derrière les remparts de leurs châteaux-forts.
Par suite d'une série de circonstances malheureuses, amenées par les événements sinistres qui se déroulèrent autour de l'abbaye, ce fut presque le contraire qui arriva. Ce ne fut que rarement que Bonnesaigne jouit d'une manière absolue de la paix intérieure si nécessaire à la vie religieuse. Les divisions, les cabales, les mesquines ambitions, les intrigues en un mot que nous avons déjà vues régner derrière des murailles qui, selon l'esprit de l'ordre bénédictin, n'auraient dû résonner que des mélodies de la prière, des suavités de la contemplation et des ardeurs du travail auraient été pourtant évitées, en partie, malgré les influences du dehors, si la malheureuse abbaye avait eu trois choses que nous semblent lui avoir souvent manqué :
— 254 —
La liberté pour élire ses supérieures ;
Une règle stable pour diriger sa conduite,
Etla,haine des procès qui est soeur du désintéressement.
Ce sont là trois vers qui la rongèrent constamment à l'intérieur. Tant que la première dignité de l'abbaye fut élective, c'est-à-dire jusqu'au Concordat de 1516 passé entre François Ier et le pape Léon X, les religieuses n'eurent que rarement la liberté d'élire leur abbesse. Souvent, pour ne pas dire toujours, elles furent influencées dans leur choix par les grandes familles du voisinage qui voulaient faire des abbesses de leurs filles.
ce Les Ventadour, dit-on, disposèrent à leur gré, durant plusieurs siècles, des dignités de ce monastère.» Ça doit être puisque les historiens anciens et nouveaux l'affirment, sauf cette réserve à leur louange qu'aucun d'eux n'a faite et qui nous paraît pourtant bien justifiée : nos vicomtes, jaloux de la gloire, de la prospérité et de l'édification d'une maison dont ils se disaient et se croyaient les fondateurs, et sûrement les restaurateurs ne lui donnèrent toujours que des abbesses exemplaires issues de leur sang généreux et foncièrement chrétien.
Malheureusement, il n'en fut pas ainsi des Gimel, des Saint-Chamant, des Chabannes, voire même du damoiseau de Maussac, Lajugie, sieur d'Ublange ou de Blange. Tantôt ils imposèrent à l'abbaye des abbesses qui ne résidaient pas ; tantôt elles étaient incapables de conduire une maison, ne sachant même pas se conduire elles-mêmes ; d'autrefois enfin c'étaient des enfants de onze ou quatorze ans qu'on affublait du
— 255 —
titre pompeux à'abbesses-seigneuresses de Bonnesaigne, comme Marie de Saint-Chamant et Gabrielle Roberte I de Blange. L'intérêt sordide des parents les hissait au pouvoir et une fois revêtues de l'autorité, ces abbesses poussaient la ladrerie, pour accroître leurs revenus, jusqu'à spéculer sur l'estomac de leurs compagnes. Une fois, ce fut au point, nous l'avons dit, que l'évêque de Limoges fut obligé d'intervenir pour régler la pitance et la quantité de pain que l'abbesse devait fournir chaque jour à ses religieuses.
Durant la période élective les abbesses se ressentirent souvent de leur vice d'origine, et trop souvent elles furent le jouet des passions du dehors.
Et quand d'élective la nomination des abbesses passa à la puissance royale, les abus furent moins apparents mais aussi réels que durant le règne de la féodalité. Toutes ces grandes familles, fixées à la Cour, pour la plupart, approchaient la royauté de trop près pour ne pas peser d'un grand poids sur la détermination du monarque. Et de fait, après comme avant le Concordat, nous retrouvons, à la tête de l'abbaye, toujours les filles de ces mêmes grandes familles du Limousin ou de l'Auvergne, toujours les mêmes abus criants. Ainsi, sous la période élective, à la mort de Dauphine de Chabannes, les intrigues des Gimel firent élire une des leurs, Blanche de Gimel ; cette élection parut si peu libre que le pape Paul II, de sa pleine autorité, sauf à être obligé de reculer ensuite, confirma l'élection d'Anne de Maumont choisie par la minorité des soeurs de Bonnesaigne. Sous la période concordataire, nous trouvons un fait semblable. Après les morts tragiques de Marguerite de Gimel et de Marie de Saint-
— 256 —
Chamant, les seigneurs de ces deux familles unies par le sang, non corrigés par les terribles leçons du passé, intriguèrent encore pour faire élire une des leurs ; et, de fait, Marguerite de Livron, leur parente, fut proclamée abbesse de Bonnesaigne. Mais les Chabannes, alors tout puissants à la Cour, attaquèrent cette élection, et la fille du chevalier d'honneur de Catherine de Médicis, Catherine de Chabannes, par ordre du pape et du roi prit la place de Marguerite de Livron.
Nous n'en finirions pas si nous voulions énumérer ici toutes les intrigues mises en avant chaque fois qu'il fut question de donner une abbesse à Bonnesaigne.
Encore si ces abbesses une fois nommées, quoique leur élection fût entachée, avaient été tenues par une règle douce et ferme à la fois, comme celle que saint François de Sales venait de donner aux Filles de la Visitation, tout serait rentré insensiblement dans l'ordre au sein de leur communauté. Mais nous avons entendu la grande abbesse Gabrielle de Beaufort nous dire que jusqu'en 1645, les religieuses de sa communauté n'avaient guère eu pour tout règlement que la volonté de leur supérieure, malgré la promesse qu'elles faisaient, le jour de leur profession, de suivre la Règle de saint Benoit, le glorieux fondateur de leur ordre.
Et lorsque la plus illustre des abbesses de Bonnesaigne voulut en 1627 et en 1645, réagir contre les deux abus que nous venons de signaler, le mal était trop enraciné. Par le déboutemenl des Ventadour, et les constitutions, avec obligation formelle de garder la clôture, qu'elle fit donner à ses religieuses, bien des abus purent être corrigés ; bien des ruines furent relevées au point de vue physique, moral et religieux.
— 257 —
Mais quand sonna son heure dernière, après 46 ans de supériorat durant lequel elle avait essayé de relever toutes les ruines de Bonnesaigne, bien des choses restaient encore à faire. Bien plus elle léguait à sa remplaçante la lourde charge de couvrir 28,000 livres de dettes qu'elle laissait, avec les modiques économies d'une maison dont elle avait sensiblement réduit les revenus en enlevant à la mense abbatiale Villevaleix et Champagnac pour les donner à ses deux nièces de Montmorin.
De là, le malaise, la parcimonie, les tiraillements intérieurs de cette malheureuse maison, et Y esprit 2irocessifàe plusieurs de ses abbesses pour faire rentrer rigoureusement dans la caisse de l'économe les revenus des nombreux bénéfices que détenait Bonnesaigne.
Ce manque de liberté, cette privation de Règle et cette maladie d'esprit pour les procès furent cause que l'abbaye fut quelquefois plus turbulente qu'il ne convenait. 11 y eut dans l'intérieur de ses murs des divisions, des jalousies, des cabales vraiment peu édifiantes. Trop souvent ces jeunes abbesses recherchèrent trop ardemment, sous des habits de pénitence, les jouissances du monde en négligeant les pratiques essentielles de la vie religieuse.
Mais, en bonne conscience, est-il juste de faire retomber uniquement sur ces pauvres recluses tout l'odieux des abus que nous avons eu à déplorer, tout le long des siècles, dans l'intérieur des murs de leur abbaye? Si telle abbesse nommée ne put prévaloir contre sa rivale et fut obligée de partir pour la Règle, Villevaleix ou ailleurs, est-ce bien la faute des religieuses qui l'avaient choisie ?
— 258 —
Accusons plutôt l'influence de certains seigneurs que nous connaissons déjà. Pour échapper aux bandes armées qui durant des siècles sillonnèrent notre Limousin, les malheureuses communautés se placèrent sous l'égide du bras séculier. Mais l'institution catholique des abbés laïques dégénéra bientôt en oppression. Nos grands seigneurs consentirent bien à défendre les abbayes contre d'injustes agresseurs, mais à la condition de les tenir eux-mêmes en tutelle et de les opprimer au besoin.
Les voilà les vrais coupables, ceux qui sont vraiment responsables des abus que l'on trouve non seulement dans Bonnesaigne, mais encore dans presque toutes les communautés religieuses, durant cette époque de décadence.
Mais, après tout, pourquoi tant crier contre cette ingérence du dehors? La noblesse poussait alors ses créatures au pouvoir ; aujourd'hui, c'est la démocratie gouvernementale qui pousse les siennes. Alors, il y avait des abus à déplorer ; aujourd'hui, n'y aurait-il pas à craindre des scandales d'autant plus déplorables qu'une publicité des plus étendues les guette à toute heure pour les jeter à tous les vents? Que le laïcisme aristocratique ou gouvernemental laisse à l'Eglise la liberté de choisir ses pasteurs et nous aurons des chefs aptes à conduire les âmes vers les rives de l'éternité.
De même pour Bonnesaigne. Chaque fois que le laïcisme se mêla de ses affaires intérieures, il y eut des abus dans la communauté, et quand les influences du dehors s'arrêteront à la porte, les religieuses élurent de bonnes et saintes abbesses.
Il en est ainsi de Y esprit processif qu'on leur
— 259 —
reproche. Jamais il n'aurait existé à ce point, sans les pressants besoins que les seigneurs avaient créés autour de l'abbaye, par leurs querelles, leurs dissensions et leurs guerres incessantes. Par suite des événements sinistres qui se déroulèrent autour de Bonnesaigne, nous allons le dire tout à l'heure, les religieuses se trouvèrent dans la pénible obligation d'exiger rigoureusement les moindres recettes pour équilibrer plus ou moins bien le chapitre des dépenses. Et nous avons déjà entendu Madame de Saint-Marsault nous faire l'aveu qu'après avoir payé les frais obligatoires et extérieurs de sa communauté, il ne lui restait que 3,837 livres, 6 sous et 8 deniers pour couvrir les dépenses de l'intérieur de son abbaye.
Finalement, que sont quatre ou cinq méfaits que certains historiens, plus ou moins de l'école huguenotte de de Thou, aiment tant à relever durant les 625 ans d'existence connue de cette abbaye ? Si l'homme ennemi y a jeté quelques grains d'ivraie, le bon froment a poussé aussi en abondance dans ce champ bénédictin ; et nous voyons les chroniqueurs de ces temps reculés, comme les RR. PP. Estiennot et Bonaventure de Saint-A mable nous dire dans leurs naïfs récits : ce telle religieuse fut une bonne abbesse ; telle autre a été une bénédiction pour Bonnesaigne ; telle autre enfin y a fait une sainte mort après 18 ans de supériorat, » etc. Mais Marvaud, aussi bien que certains autres historiens de ce cru, se garde bien de mentionner de tels actes de vertu. Ils préfèrent, les uns et les autres, grossir, exagérer les légendes, parler de scandales. Les vertus modestes et cachées qui brillèrent derrière ces murailles antiques et parfumèrent
— 260 —
les marais de l'abbaye, ou les champs de Fleuret, sont pour eux quantité négligeable.
Pour nous, après avoir dépouillé consciencieusement les archives de Bonnesaigne, une seule chose nous étonne, et nous osons espérer qu'il en sera de même de nos lecteurs après avoir parcouru le paragraphe de ses épreuves extérieures : c'est que dans cette malheureuse abbaye, il y ait eu si peu de mal et tant de bien.
Disons pour en finir sur ce point des épreuves intérieures de Bonnesaigne : Si l'abbaye villageoise eut quelques torts à se reprocher, —• et quel gouvernement n'en a pas dans une existence dix fois moins longue que celle de notre monastère? —il faut avouer que la divine Providence lui fournit, dix fois pour une, l'occasion d'en faire une rude pénitence par les épreuves terribles qu'elle lui envoya du dehors.
Vraiment, après avoir entendu le récit de ses malheurs extérieurs on est obligé de se demander si ce sont bien ses discordes intérieures qui lui attirèrent de tels châtiments ; ou bien, si ce ne sont pas plutôt les calamités qui fondirent sur elle du dehors qui furent cause des dissensions et des cabales que l'on a à déplorer dans l'intérieur de ses murs.
g II. — ÉPREUVES EXTÉRIEURES
Trois choses semblent être la cause des malheurs extérieurs qui fondirent sur notre abbaye : Y isolement, la noblesse des religieuses et le voisinage de Ventadour.
Son isolement au fond d'un bois, dans une campagne
— 261 —
déserte, loin de tout grand centre qui pût la protéger, la laissa à la merci de tous les maraudeurs d'Ussel, de Meymac, d'Egletons et de Neuvic qui venaient s'approvisionner dans la forêt ducale.
La noblesse de ses religieuses excita la convoitise des bandes affamées, comme il y en avait tant à ces époques nécessiteuses de notre histoire, roulant sur la voie romaine de Tintignac à Ussel et Clermont et leur laissait croire que les filles de nos grands seigneurs, cousues d'or et d'argent, avaient tout à satiété derrière leurs épaisses murailles.
Et le voisinage de Ventadour lui fît recevoir les contre-coups des assauts acharnés que le fier colosse eut à repousser durant plusieurs siècles, tantôt de la part des Anglais, tantôt de la part des Protestants.
Aussi, maraudeurs, bandes affamées, Anglais et Huguenots allèrent à tour de rôle se ruer contre l'abbaye villageoise dont ils firent une ruine à différentes reprises.
La fière devise nationale : ce Haine à l'Anglais ! — Sus aux Huguenots ! » fut toujours le noble cri de guerre des Ventadour. Il était gravé dans leur coeur en caractères indélébiles. C'était comme un précieux héritage que les pères léguaient à leurs enfants. Aussi les avait-on dénommés : Les dénicheurs des Anglais et des Huguenots ! C'est pourquoi, durant les troubles qui ensanglantèrent l'Aquitaine, depuis le mariage de Y Idole de nos Troubadours, épouse divorcée de Louis VII, avec Henri II, roi d'Angleterre, jusqu'à l'arrivée de la vénérable Jeanne d'Arc ; et depuis Lutlier jusqu'à la fin des guerres de religion, c'est-àdire du xiie au xvne siècle, Ventadour fut le point de
T. XXV 2—6
— 262 —
mire des Anglais voraces et des sectaires sacrilèges du moine défroqué, ravisseur de religieuses, si bien faits les uns et les autres pour s'entendre dans la haine de la France et de l'Église.
Mais il n'entre pas dans notre plan de faire le procès des Anglais ou des Protestants, ni même de retracer toutes les atrocités qu'ils commirent en Limousin. Nous ne voulons en retenir que celles qui se rapportent à la partie montagneuse du diocèse, surtout à Bonnesaigne. Nous ne reviendrons pas non plus sur ce que nous avons dit des fléaux qui ravagèrent notre abbaye, tandis que les Routiers de Ventadour donnaient la chasse aux Normands et aux bandes qu'Henri II et son fils Richard avaient lancées dans nos bruyères pour s'emparer du château vicomtal.
Arrivons d'un coup à la seconde période des guerres Anglo-Françaises, c'est-à-dire au xive siècle, et voyons quel fut le sort de l'abbaye de Bonnesaigne, durant cette terrible levée de boucliers.
Guerres avec les Anglais LEBRET (1371-1390)
« L'an mil-trois-cens-cinquante et six, « Le Roy Jean, après mainte taille « Fut prins, et maints princes occis « Par les Anglais en dure bataille. »
(Annales d'Aquit., p. 202.)
Après la défaite de Crécy (1346) et le désastre de Poitiers (1356), et surtout après le traité de Brétigny (1360) la Croix blanche de France céda le pas, en Limousin, à la Croix rouge d'Angleterre, avons-nous déjà dit.
— 263 —
Nos montagnes surtout eurent à souffrir de la fureur anglaise. Des bandes armées, formées du rebut des deux partis belligérants, s'abattirent^sur le Limousin, comme des forbans affamés. Limoges fut pris, perdu et repris par les Anglais.
Le château de Ghamberet fut pris aussi et gardé jusqu'à l'arrivée du brave Duguesclin qui en débusqua les Anglais avec l'aide de Louis de Sancerre et les secours en hommes, vivres et munitions que Limoges lui envoya (1383).
Tandis que Chamberet succombait avec Bar et Saint-Jal, et que Tulle résistait au vainqueur de Poitiers, un brigand, Pierre Foucaut, surnommé le Bourreau, s'empara du château de Saint-Chamant et en fit longtemps sa place forte.
En même temps (1378) une compagnie de stipendiés, formée des déserteurs des deux pays, d'aventuriers dénués de tout, ou poursuivis pour leurs crimes, ayant à leur tête un chef vaillant et expérimenté, Geoffroi, surnommé Tête-Noire, breton d'origine, grand partisan des Anglais, marchait contre l'antique manoir de Ventadour où s'était retiré, depuis son retour d'Angleterre, le vieux Bernard avec Robert, son fils, compagnon de ses exploits à la lamentable Journée de Poitiers où avait péri l'élite de la noblesse Limousine, sans parler de celle des autres provinces de France. (V. Annal. d'Aquit., p. 202-205.)
Le guerrier que la vieillesse, les infirmités contractées sur les champs de bataille et les douleurs de la patrie éloignaient des combats ce ne s'armait plus et se tenait coi en son castel ». (Froissart, t. I, ch. 47.) Il s'y croyait en sûreté. Mais la trahison allait opérer
— 264 —
ce que la bravoure d'Henri II et le courage bouillant de Richard, son fils, n'avaient pu faire.
Le siège fut terrible ; il dura une année entière. Désespérant de le réduire par les armes et la faim, Geoffroi eut recours à un moyen ignoble. Il soudoya, à prix d'argent, l'écuyer du comte. Ce traitre, du nom de Pons du Bois ce qui trop petit avait profité en son service » (Froissart), livra le château pour six mille francs, à la condition pourtant — il eut au moins ce reste de pudeur — que l'on respecterait son ancien maître et les gens qui se trouvaient dans la place(1379). Bernard sortit alors de la demeure de ses ancêtres, la laissant au pouvoir d'un soldat aventurier, et se retira, les yeux mouillés de larmes, suivi de Marguerite de Beaumont sa femme, et du reste de sa famille au château de Miramont, bâti sur la rive gauche de la Dordogne, en face du village de Mauzenac, paroisse de Soursac; et de là, au château de Montpensier, en Auvergne, où, un siècle et demi auparavant, était mort Louis VIII, le Lion, et qui par alliance avait passé dans la maison de Ventadour.
Avant même que Tête-Noire s'installât pompeusement dans la vieille forteresse de Ventadour dont il se disait duc, et comte du Limousin, d'autres aventuriers de la même trempe avaient déjà paru, depuis plusieurs années, sur nos plateaux.
Dès 1350, l'église et le prieuré de Saint-Angel avaient été incendiés. En 1371, ce fut le tour d'Ussel. La ville fut livrée quatre fois au pillage et à l'incendie, et finalement le farouche Lebret s'emparait du château où il entassa son butin et ses prisonniers.
De là, les bandes de Lebret se présentèrent devant
— 265 —
Bonnesaigne; pénétrèrent dans l'abbaye, la pillèrent et mirent en fuite les religieuses avec leur abbesse Dauphine d'Anglars (1371).
Ce fut vers cette époqe de malheurs (1383) pour nos montagnes que Charles V, dit le Sage, pour réparer les maux qui désolaient nos contrées, envoya une armée en Limousin, sous les ordres du duc de Berry et du brave Duguesclin, Vépée de la France, qui dans nos bruyères vengea souvent les défaites de Crécy et de Poitiers. Nos montagnes, longtemps après son départ, retentirent de son noble cri de guerre : ce Notre-Dame, Duguesclin ! Mont-Joie et Saint-Denis! »
Après un combat acharné et un premier assaut infructueux livré à la citadelle d'Ussel, Duguesclin se retira pour voler au secours de Montpensier.
Un de ses compagnons d'armes, Geoffroi Budes, brave chevalier, blessé dans l'attaque livrée à la ville d'Ussel et qui avait roulé dans les retranchements d'où les siens le sortirent pour le porter dans une cabane voisine, guéri presque miraculeusement par un voeu qu'il fit à Charles de Blois, continua chez nous, plus terrible que jamais, la guerre contre les Anglais jusqu'au jour où le duc de Berry, le comte d'Armagnac et d'autres seigneurs eurent ordre de délibérer entre eux sur les moyens à prendre pour délivrer les châteaux-forts occupés par les Anglais en Limousin (1387).
Dans ce conseil, les hommes de guerre comprirent aisément que le coeur de la résistance se trouvait à Ventadour. Du reste, les habitants du Bas-Limousin sollicités de s'imposer de nouveaux sacrifices pour continuer la guerre, avaient unanimement répondu
— 266 —
qu'ils ne donneraient plus d'argent avant que le château de Ventadour fût rendu.
Alors le prince de Berry, qui avait dans ses rangs d'Armagnac, Guillaume de Lignac, Jean de BonneLance, Guillaume-le-Boutiller et autres nobles chevaliers de l'Auvergne et du Limousin, vint investir le château (1387).
ce Or, dit Froissart, advint qu'à une escarmouche qui y fut Geoffroi Tête-Noire s'avança si avant que du trait d'une arbalète, tout outre le bassinet et la coëffe lui furent percés, et fut navré d'un carrel en la teste, tant qu'il lui en convint gésir au lit, dont tous les compagnons en furent courroucés ».
Tête-Noire avait vécu sans gloire, il voulut mourir dans la honte. Avant de rendre le dernier soupir, il désigna pour le remplacer dans le commandement, ses cousins, les deux frères Alain et Pierre Roux.
Après cela il fit diverses dispositions en faveur de ses compagnons d'armes, de sa Mie qui Vavait loyalement servi, de son clerc, ainsi que de la chapelle Saint-Georges du château de Ventadour où il demanda à être enterré.
Puis, montrant son coffre-fort aux assistants : ce Si départez-vous entre vous trente le surplus bellement ; et si ne pouvez être d'accord, et que le diable setouaille entre vous, véez là une bâche bonne et forte, et bien taillant et rompez l'arche; ne ait qui avoir ne pourra».
La chapelle, où avaient prié les Ventadour, eût une tombe pour le soldat aventurier, et le château retentit encore, longtemps après, du bruit des armes et des chants de l'orgie des vieilles bandes dévastatrices de l'Angleterre.
— 267 —
Ce ne fut qu'après un siège rigoureux de trois ans (1390) que les deux bandits> Alain et Pierre Roux, furent pris dans les filets qu'ils avaient tendus aux chefs des assiégeants.
Guillaume-le-Boutiller s'empara des deux brigands et des hommes cachés dans la grosse tour. Leurs membres écartelés, suspendus à des gibets, dressés pour épouvanter les bandits d'alentour, flottèrent le lendemain sur les remparts du château.
Alain et Pierre eurent la vie sauve ; mais ils furent conduits à Paris sous bonne escorte et livrés à la justice royale. On leur trancha la tête après les avoir mis au pilori sur la place des Halles, et leurs cadavres écartelés furent exposés aux principales portes de la capitale (1390). (V. les détails de ce siège mémorable dans notre Notice sur Ventadour).
Et nos montagnards purent ensemencer plus tranquillement leurs champs, du moins pour un temps, sans crainte de les voir ravager, au retour des moissons, par les pillards de Ventadour qui portaient l'épouvante et la dévastation jusqu'aux portes d'Uzerche, de Tulle et de Brive, et même au coeur du Périgord et de l'Auvergne.
Tous ces sinistres événements eurent lieu sous le pontificat de notre compatriote Grégoire XI et Urbain II son successeur ; Pierre Blanchier étant curé de Darnets, Dauphine d'Anglars et Gaillarde Roberte II de Blauge abbesses de Bonnesaigne (1365-1400).
Inutile d'allonger notre récit; disons simplement que, durant ces trente-cinq ans, Anglais et Français trépignèrent four à tour le sol détrempé des larmes et des prières de la malheureuse abbaye. Les armées du
— 268 —
duc de Berry que nous voyons courir d'Ussel à Ventadour, de Ventadour à Montpensier, et de Montpensier à Riom pour revenir ensuite sur nos plateaux, aussi bien que celles de Lebret et de Geoffroi Tête-Noire, se disputèrent à l'envi ce lieu de passage d'Ussel à Egletons, capitale du comté, et lui firent subir les pertes les plus considérables. Tout cela n'était point fait pour entretenir, dans le monastère, l'esprit de saint Benoit; et du sein du trouble dans lequel il fut oblige de vivre, durant cette période de notre histoire, nous voyons surgir une raison plus que suffisante pour expliquer les désordres que nous avons eu à déplorer dans les' murs de cette abbaye.
Ce fut durant ces sinistres événements (1385), qu'éclatèrent les premières contestations entre l'abbesse Gaillarde Robertell de Blauge et Pierre Blanchier curé de Darnets, au sujet de la part qui revenait à chacun d'eux des dîmes paroissiales, de par l'évêque de Limoges, d'après la Bulle d'union fulminé en 1348. La communauté était dans les plus pressants besoins et par suite des malheurs du temps elle ne comptait plus que seize religieuses (1399).
L'abbesse d'Anglars et les deux de Maussac, Roberte II et Roberte III, eurent à coeur de relever leur abbaye qui en 1407 ne comptait plus que neuf religieuses. Roberte III surtout fit à son monastère « des biens infinis». Elle augmenta considérablement ses revenus, fit refaire la tour du clocher emportée par l'ouragan de la guerre et fut la contemporaine de la glorieuse mission de Jeanne d'Arc.
Ces trois abbesses furent admirablement secondées dans leur oeuvre de relèvement de Bonnesaigne par
— 269 —
leurs familles. Et c'est alors que les d'Anglars et les damoiseaux de Maussac prirent rang parmi les insignes bienfaiteurs de la malheureuse abbaye.
Et Bonnesaigne reprit le cours de ses destinées jusqu'au milieu du xv° siècle (1453). Mais, sous cette date, de nouvelles épreuves l'atteignirent encore et la mirent de nouveau à deux doigts de sa perte. Du reste, ses malheurs extérieurs ne faisaient que commencer et les plus rudes étaient pour la fin.
LE BRIGAND RIGAUD (1453)
Vingt-deux ans après le drame de Rouen où périt la grande et sainte libératrice de la patrie française, tandis que Bonnesaigne, grâce à l'intrépidité de ses abbesses, aux largesses de plusieurs familles seigneuriales des environs et aux appoints que lui apportaient les bénéfices de Darnets, de Maussac et de Ménoire nouvellement unis à l'abbaye, avait réparé les dégâts de la guerre Anglo-Française, relevé ses murs éventrés, refait, à force d'économies, la grande tour carrée de son église, de nouveaux malheurs fondirent sur notre VAL-TUVE.
Sous l'administration de l'abbesse Dauphine de Chabannes, remplaçante immédiate de GaillardeRoberte III de Blauge (1434-1469), une bande de malfaiteurs se forma dans nos montagnes. Elle avait pour chef un insigne brigand du nom de Rigaud et se composait de tous les pillards qui avaient combattu naguère dans les armées de Lebret, de Geoffroi-Tête-Noire et de Foucaut, sans parler de ceux qui avaient échappés à l'épée vengeresse de Jeanne d'Arc ou qui avaient été
— 270 —
recrutés dans les rangs des fuyards des armées françaises. Ils étaient la terreur du pays à plusieurs lieues à la ronde. Le jour ils se cachaient dans l'impénétrable forêt de Ventadour, sans avoir peur des spectres, des fantômes et des revenants qui la peuplaient, selon les contes des anciens Troubadours ; et la nuit ils dévastaient les villages et dépeuplaient les étables des paroisses environnantes.
Une nuit de l'année 1453, le sinistre Rigaud vint, avec sa bande, surprendre l'abbaye. M. Ghampeval croit que ce fut en 1450, l'année même que les Anglais furent définitivement chassés de France, ce L'abbaye fut pillée et mise à sac, » nous disent les anciens historiens ; et les religieuses, affolées de cette attaque soudaine et imprévue, se dispersèrent dans les villages voisins et couchèrent sous des toits étrangers. (Bonaventure de Saint-Amable).
Bertrand de Bonnefond, curé de Darnets, fut tenté de voir dans le grand malheur qui venait d'arriver si à l'improviste à l'abbesse Dauphine de Chabannes la juste punition de l'arrangement néfaste qu'elle venait de lui arracher depuis cinq ans seulement (31 janvier 1448), après un procès ruineux de quatre ans, au sujet des revenus de sa cure. (V. ci-avant chap. VII.)
C'est le dernier contre-coup que reçut Bonnesaigne de nos guerres interminables avec l'Angleterre. Mais d'autres épreuves l'attendaient, à un siècle de distance.
Remettre l'abbaye montagnarde sur pied, réparer les dégâts matériels que lui avait causés la bande du voleur Rigaud, remplacer les meubles emportés ou brisés par ces scélérats fut le travail persévérant de sept abbesses durant cent ans. Nous y voyons constam-
— 271 —
ment appliquées, malgré leurs dissensions, Dauphine de Chabannes, durant les seize ans qui lui restaient à vivre (1469) ; Anne de Maumont, pendant quelques mois; Blanche Ire de Gimel, durant trente-quatre ans ; Marguerite de Gimel, l'espace de trente-trois ans; Marie de Saint-Chamant, pendant dix-huit ans ; Marguerite de Livron, abbesse de quelques mois, et surtout Catherine de Chabannes-Gurton (1555-1605) qui eut à coeur de relever les ruines accumulées autour de l'abbaye sous l'administration de sa parente, Dauphine de Chabannes, dont nous parlons. Durant son supériorat de cinquante ans, on effet, l'abbaye prospéra et le nombre des religieuses s'éleva sensiblement. Mais son oeuvre était à peine fini, qu'elle aussi fut visitée par le malheur et autrement éprouvée qu'aucune de ses devancières,'dans la charge d'abbesse de Bonnesaigne.
Nous voici en pleines guerres de religion, sous la date de 1567.
Guerres de religion
HÉCATOMBE DE HUGUENOTS (1567)
Ce fut en 1563, sous l'administration de Louis de Genouillac, évêque de Tulle (1553-1583), qu'éclatèrent ces troubles hideux, ces luttes fratricides qu'on appelle guerres de religion. Elles eurent la religion pour prétexte et pour résultats les plus épouvantables catastrophes qui aient jamais souillé les annales d'un peuple.
Catherine de Chabannes-Curton était abbesse de
— 272 —
Bonnesaigne ; Etienne Massonie curé de Darnets ; Gilbert de Soudeilles, de Soudeilles ; Jean II de Soudeilles venait d'hériter du Lieuteret de son oncle Loys, et Gilbert III était comte de Ventadour en attendant qu'il en devînt duc (1578), quand la France entière se transforma en un immense champ de bataille.
Ces troubles furent autrement lugubres que nos longs démêlés avec les Anglais. Entre Anglais et Français, en effet, tandis que Philippe VI et Edouard III promenaient leurs hommes à travers les champs désolés delà France, les guerriers qui allaient mourir, auraient pu s'écrier avant le choc, comme ils le firent plus tard à Fontenoy : ce Messieurs les Anglais », ou ce Messieurs les Français, tirez les premiers ! » Mais la guerre entre Catholiques et Protestants fut sans merci. De part et d'autre on ne procéda que par la démolition ou l'incendie. De là la plupart des ruines qui jonchent le sol Limousin.
Après que Henri-de La Tour d'Auvergne, père du Grand Turenne, rompant avec les traditions chrétiennes que lui avait léguées la famille de nos papes de Rosiers, eût tacitement fait cause commune avec les partisans de la Réforme, en attendant qu'il le fit ouvertement (1573), des bandes de Huguenots, espèce de crocquants anticipés, pénétrèrent de partout dans nos montagnes, et surtout dans le Bas-Limousin. (MarvaudYX, 319 — de Larouverade).
Une d'elles, en 1567, sous l'administration de Catherine de Chabannes, envahit le cloître de Bonnesaigne qu'elle venait de relever. L'abbesse cherchait à raisonner les envahisseurs : peine perdue ! ce J'espère, du moins, dit-elle alors, que si vous en voulez à nos
- 273 —
biens, vous saurez respecter l'honneur des filles nobles qui se sont consacrées à Dieu. Il est nuit : impossible à nous d'aller à travers la campagne ! Laissez-nous notre demeure pour quelques heures seulement et prenez nos granges où je vais vous faire servir. » La bande accepte et boit jusqu'à l'ivresse. Or les granges (on dit que c'étaient celles de Montclauzoux) étaient couvertes en chaume, comme en général dans nos montagnes, et plus ou moins remplies de pailles. Tandis que les Huguenots cuvent leur vin, le feu y prend par trente endroits à la fois. En un instant, tout fut réduit en cendres, hommes et bâtiments... » (Dict. des Paroisses, t. Ier, p. 367).
Pour bien juger cet acte, d'ailleurs peu ordinaire, qui fit à notre abbesse une terrible réputation, il ne faut pas oublier que nous étions en pleines guerres religieuses. Avec l'expérience du passé, surtout depuis l'aventure de Rigaud, l'abbesse et ses religieuses ne pouvaient-elles pas s'attendre à toute sorte d'infamies de la part de pareils visiteurs nocturnes, si elles n'avaient pas recours à ce procédé radical pour s'en débarrasser ? En temps de guerre et en cas de légitime défense, chacun, surtout une femme, se défend comme il peut. Tant pis pour les naïfs qui se laissent prendre à des ruses et à des paroles fallacieuses ! Rappelonsnous l'exemple de Judith et d'Holopherne.
Que cet acte, qui après tout pourrait fort bien n'être imputable qu'à l'initiative des fermiers et des habitants du village, soit licite ou non, il fut l'occasion, si non la cause de terribles représailles, deux ans après, envers l'abbesse Catherine de Chabannes et l'abbaye de Bonnesaigne.
- 274 -
L'AMIRAL COLIGNY (1569)
Les événements se précipitent en France.
Deux ans après l'hécatombe de Montclauzoux, les Religionnaires éprouvent deux sanglantes défaites successives à Jarnac (13 mars 1569) et à Moncontour (30 octobre 1569).
Tandis que le jeune Béarnais — depuis notre immortel Henri IV — conduisait les débris de ses Huguenots vaincus dans les villes de Saint-Yrieix, Lubersac, .luillac et dans les bourgs de Saint-BonnetLa-Rivière, Objat et le Saillant, son compagnon d'infortune, l'amiral Coligny, prenait une autre direction,
vers le Nord, avec ses bandes en guenilles grossies de celles du prince de Condé.
Quelques jours après sa dernière défaite, Coligny vint camper sur les terres de Combressol, au village de Feyt, surnommé la Vinouse, au fond des prairies de Bonnesaigne, sur la rive gauche de laHaute-Luzège, ayant pour protéger les derrières de son armée la rivière d'abord, et, ensuite par delà, la noire forêt de Ventadour.
De là, semblable au taureau qui s'étant laissé battre par plus fort que lui, se retourne traîtreusement contre une génisse inoffensive paissant paisiblement dans la prairie et lui enfonce la corne au flanc, Coligny bondit furieux contre l'abbaye ce pour venger la mort de ses sectaires », grillés deux ans auparavant dans les granges de Monclauzoux.
L'abbaye fut pillée, saccagée et livrée aux flammes ; et les religieuses, le soir de cette lugubre journée,
— 275 —
couchèrent à la belle étoile, peut-être dans les bois du Deveix.
Le lendemain de cette longue nuit sans sommeil du mois de novembre, Catherine de Chabannes et ses filles purent contempler en pleurant le tableau lamentable que présentait leur abbaye après le départ du furibond amiral.
Que nous dit l'histoire à ce sujet? ce Les troupes du détestable Gaspard de Coligny, amiral de France, (c'est Nadaud qui parle,) pillèrent et détruisirent complètement le monastère de Bonnesaigne vers l'an 1565 (lisez 1569) ; il n'y restait ni cloître, ni réfectoire, dortoirs, offices ni bâtiments ; les meubles et ornements furent entièrement enlevés ; l'église qui restait seule fut considérablement endommagée parle feu du ciel vers 1597 », surtout en 1598.
Mais Bonnesaigne n'en a pas encore fini avec le sinistre Coligny ! Catherine de Chabannes devait en recevoir une seconde visite et sans bien tarder.
De Bonnesaigne le sectaire calviniste se porta en toute hâte, avec d'autres bandes venues le rejoindre, à Beaulieu, au sein de la vicomte de Turenne dont les portes lui étaient larges ouvertes par l'infâme Henri de Latour. Il y passa et logea l'espace de huit jours, «huit jours de dévastation, de pillage et de meurtres», nous dit l'abbé Poulbrière.
ce Pendant ce temps, les soudards de Coligny allaient écumer et ensanglanter les villages voisins. Un sieur Clare, bourgeois de la ville qui s'était marié à Sennac, dans la paroisse de Queyssac, vit venir dans sa maison des capitaines de la suite de l'amiral dont un (de Colombières, croit-on) l'emmena prisonnier à Beaulieu
— 276 —
et ne le lâcha que sur une rançon de 1,600 livres ». (Hist. du Diocèse, p. 253).
De Beaulieu, remontant sur Argentat, le long de la Dordogne, les Religionnaires détruisirent également l'abbaye de Valette, Muratel, en Auvergne, et son pont des Monges, et montèrent jusqu'à Bort qui dut leur payer 2,000 écus, nous apprend de Thou. Le P. Bonaventure dit davantage : ce Les Calvinistes, selon lui, démolirent le couvent; les moines furent dissipez, les revenus aliénez, et ce monastère devint un bénéfice simple ».
Suivant d'Aubigné, le détachement envoyé sur Bort, commandé par la Loue, renforcé de Chouppes, après avoir pris ce par étonnement » cette ce petite villette... qui a un pont de pierre » et logé à Saint-Thomas, (petite métairie, où Marmontel lisait Virgile à l'ombre des arbres fleuris qui entouraient ses ruches d'abeilles et où il faisait de leur miel des goûters si délicieux), battit Saint-Géran à la Saigne (Saignes).
Après cette victoire, les séides de Coligny eurent l'attention de revenir voir si Bonnesaigne respirait encore, ou si elle avait râlé son dernier soupir.
Cette fois, Catherine de Chabannes et ses religieuses, revenues dans les ruines encore fumantes de leur abbaye, furent forcées de se retirer à Saint-Angel.
ce L'hospitalité que leur donna le châtelain du lieu, quoique protestant, fut une bénédiction pour sa famille; au siècle suivant, le baron de Saint-Angel (de Rochefort de Théobon) fut converti par une abbesse de Bonnesaigne, Gabrielle de Beaufort-Canillac », (Dicl. des Paroisses, p. 367).
Et cette fois, l'hécatombe de Monclauzoux est-elle
— 277 —
assez chèrement rachetée ? Hélas ! Mais Catherine de Chabannes le croyait du moins. C'est pourquoi, durant dix-sept ans, avec une ténacité admirable, elle s'acharna, de concert avec ses religieuses, à relever les ruines de son abbaye.
Elle y était à peu près parvenue, et les exercices religieux de la communauté avaient repris tant bien que mal, lorsqu'en 1586 une troisième visite protestante vint brusquement en interrompre le cours.
LAMAURIE (1586)
C'est un enfant de Darnets, Martial Chassaing, sieur de Fontmartin, qui fut la cause involontaire de cette troisième visite protestante à l'abbesse Catherine de Chabannes et attira tant de malheurs sur ma paroisse natale.
Voici pourquoi :
Ce vaillant compatriote et loyal serviteur du roi, frère d'un aumônier d'Henri III, chanoine d'Agen, venait d'être élu par le roi au siège de Tulle, quand cette ville fut prise, en novembre 1585, par le vicomte de Turenne qui y laissa le capitaine Lamaurie, assisté de 8 à 900 hommes de guerre. Lamaurie en décembre enjoignit aux élus : Pierre Lafargerdie, Guillaume Maruc et Martial Chassaing de faire, sur les paroisses de l'élection, le département des 15,000 écus de taille dus au roi du quartier de janvier pour qu'il les prît. Ils refusèrent, quoique menacés d'être étranglés et pendus, leurs maisons rasées et leurs boriages détruits
T. XXV. 2 — 7
— 278 —
et s'enfuirent, le premier au château de Sédières, le second à celui de Gimel et le troisième à Fontmartin. Les troupes de Lamaurie l'y suivirent de près pour l'assiéger.
Tandis qu'un détachement de 300 hommes, (M. J.-B. Ghampeval dit 500,) entouraient Fontmartin, défendu par son seigneur en personne et par les montagnards que l'âge ou les infirmités empêchaient de courir sur d'autres champs de batailles, des bandes de vauriens, toujours au service du plus fort, se formèrent autour de Lamaurie et, avec son consentement, se mirent à écumer la paroisse entière de Darnets. Les châteaux secondaires de la Barge, de la Bardêche, du Bourneix, du Ghapoulier, des Horteix, du Montusclat et les trois du bourg (du Léry, d'Andral et de la Bourre), furent ou brûlés, ou rasés ou fortement endommagés, après avoir été pillés. Celui du Lieuteret fut heureusement préservé de la dévastation par la vaillance retrouvée de son vieux seigneur Jean II de Soudeilles, que l'âge et les infirmités retenaient loin des grands combats.
Ces lugubres événements se passaient sous le pastorat de messire François Verdier, curé de Darnets, dont le presbytère et l'église furent fortement endommagés. Le presbytère, relevé plus ou moins bien, ne fut complètement refait qu'en 1677 par le curé Jean Chanal. L'église, dont les voûtes avaient cédé sous l'action des flammes, attendit longtemps aussi son entière restauration. Ce ne fut guère que sous Anne II, marquis de Soudeilles, frère aîné de la mère LouiseHenriette de Soudeilles, supérieure de la Visitation
— 279 —
de Moulins, que ses voûtes, avec dix écussons cette fois, lui furent définitivement rendues (1).
Tandis qu'église, presbytère et châtelets de Darnets flambaient que devenait notre abbaye? Échapperat-elle cette fois à la dévastation et au pillage? Non.
Elle était trop dans le voisinage ; l'épaisseur seule de la forêt de Ventadour la séparait des horreurs de la guerre dont les terres de Saint-Maurice et Saint-Martin étaient le sanglant théâtre.
De leurs croisées, de derrière leurs hautes murailles
(1) Sur ces dix écussons nous lisons les principales alliances des Soudeilles, depuis leur arrivée au Lieuteret (1520) et une d'avant, tandis qu'ils habitaient encore Soudeilles.
Les six à partitions chargées de trois poissons contreposés, nous apprennent qu'Antoine de Soudeilles (1498) et Jean IL son petit-fils, (avant 155G) avaient éppusé deux demoiselles de Malengue de Lespinasse, du château de Latourette, près Ussel, dont les armes étaient « Trois poissons d'argent sur champ d'azur ».
La partition, dans la chapelle du château, aux armes parlantes « Deux mains apaumées de gueules » nous dit probablement le mariage de Loys de Soudeilles, fils d'Antoine, avec Poulmarde ou Palmarde de Lieuteret (1520), l'unique fille et héritière de la famille de ce nom.
Les trois écussons de la nef, du transept à la porte du fond, sont chargés de croix ; le premier l'a à senestre et les deux autres à dexlre. Ils dénotent trois brillants mariages des enfants de Soudeilles avec deux demoiselles de la Marche et une de la vallée du Tarn :
Le premier, en entrant dans l'église, nous dit qu'en 1543, Jean Ier de Soudeilles, frère de Loys, entré au Lieuteret en 1520, devenu veuf de Catherine de Beaufort, épousa en secondes noces Jeanne de SaineGeorges dont la famille portait « d'argent à la croix de gueules ».
Le second, dont la croix paraît ancrée, nous apprend que Gabriel, fils de Jean II, tombé glorieusement le 21 mars 1591 au village de La Béchadie, non loin de Saint-Yrieix-La-Perche, avait épousé en 15S7 la parente du célèbre Pierre d'Aubusson, trente-neuvième grand-maître de Malte, Madeleine d'Aubusson, fille du seigneur de Montel-Le-Vicomte, qui portait « d'or à la croix ancrée de gueules ».
Le troisième, près du transept, nous dit qu'en 1626, Anne I", le bouillant commandant de place à la mémorable Journée de Castelnau-
— 280 —
de clôture, encore mieux des allées de leur jardin les religieuses pouvaient entendre le cri strident du clairon qui excitait à ces démolitions. Elles pouvaient voir briller, par dessus la forêt noire, le nimbe ardent qui auréolait le ciel du côté du midi ; des colonnes de fumée épaisse, portées sur les ailes des vents, passaient même par dessus les grands arbres de la forêt; s'engouffraient dans la vallée de Bonnesaigne et pénétraient dans le couvent, avec un tourbillon de cendres ardentes, capables d'enflammer des toits en
dary (1632), avait reçu en mariage la main de la vertueuse languedocienne, Antoinette de Luzançon, qui fut l'heureuse mère de LouiseHenriette dont nous avons si souvent prononcé le nom béni. Sa famille habitait le château de Saint-Georges situé sur les bords du Cernon, avant de s'installer sur le promontoire de Luzançon (1575) qui domine et la vallée du Cernon et celle du Tarn « comme Turenne domine la voie ferrée de Saint-Denis à Brive ». {Trois Limousines, p. 25-29.)
Enfin, l'écusson du transept, entre les deux chapelles, est sujet à contestation jusqu'à plus sérieuse étude. Si, selon le sentiment de M. le Supérieur de Servières, la partition de la droite est un demisautoir entre trois molettes, nous sommes en présence de l'alliance d'un Soudeilles avec une Montaignac dont la famille portait un « Sautour entouré d'éperons » ; alliance dont je ne trouve pourtant aucune trace dans ma généalogie des Soudeilles. Si, au contraire, ce demisautoir est un chevron mal pointé, soit maladresse de l'ouvrier, soit difficulté de le ciseler sur cette moitié étroite de pierre dure, cette partition dénoncerait le mariage (29 janvier 1663) d'Anne II avec Philiberte de Sédières, vicomtesse de Saint-Yrieix-Le-Déjalat, veuve de François de Lentillac et dont les armes étaient « d'azur à un chevron d'or ».
Sur neuf partitions de ces dix écussons ressort le « damier d'azur et d'argent », sinon « de gueules et d'or » de la famille de Soudeilles. (Sigillog. du B.-L., pp. 396-397.)
L'écusson de la chapelle seigneuriale est uniquement consacré (à dextre) à la mémoire de Palmarde de Lieuteret, et (à senestre) à celle de la première de Malengue entrée au Lieuteret par son mariage avec Jean II, son cousin germain, héritier de son oncle Loys en 1545.
— 281 —
bardeaux mal assujettis depuis les visites du farouche Coligny.
Les cris des victimes et des sauveteurs semblent se rapprocher. Les crépitations de l'incendie deviennent plus distinctes ; à chaque instant, les clartés sont plus sinistres, et les hourras des pillards plus frénétiques, sauvages et menaçants.
Plus d'illusion possible! Les ennemis sont là! Bonnesaigne est entouré pour la quatrième fois, depuis les guerres de religion, par une bande de scélérats qui lui enlèvent en un instant ce que dix-sept ans d'économies et de transes lui avaient permis de ramasser depuis les visites du terrible Gaspard Coligny.
Et la bande, après avoir plus ou moins ébranlé des murs à peine affermis depuis leur récent relèvement, se retira emportant son maigre butin, et se replia sur Fontmartin. Fontmartin venait de se défendre vaillamment et de forcer ses assaillants à battre en retraite sur Tulle où ils saccagèrent les maisons de Lafagerdie et Maruc et les boriages du S'' Fagerdie. Il y avait aussi le capitaine Fogerolles et le capitaine Gascon. Le fait est certifié par l'official et trésorier de Tulle, François Borie. (Chartrierde M. le comte de Sainte-Fortunade. V. M. Champeval, Bulletin, Tulle, 2e livraison, avriljuin, 1902, p. 287.)
Et le triomphant et gracieux château de Fontmartin qui avait déjà son cimetière Gallo-Romain, au flanc des Rebières où, en traçant le chemin gledzier, (de l'église), on a trouvé plusieurs urnes cinéraires, avec broche et chevalière en ma possession, eut désormais une fosse de Huguenots dans ses champs, du côté d'Egletons,
— 282 —
Après la descendance du victorieux Martial Chassaing, nous trouvons, à Fontmartin, les Geoffre de Chabrignac ; viennent ensuite les de Lavaur de SainteFortunade; et, finalement, depuis la Révolution, les Maisonneuve-Lacoste dont la progéniture s'est alliée, de nos jours, aux de La Salvanie et aux de Fauconval.
Et l'abbesse Catherine de Chabannes eut le temps de méditer jusqu'en 1605, derrière les ruines de son monastère, sur les terribles représailles que lui avaient attirées la ce grillade » de Montclauzoux ! (V. Dict. des Paroisses, t. Ier, p. 433. — Archives paroissiales.)
Que faisaient nos seigneurs, grands ou petits, défenseurs naturels des communautés et des églises, pendant que ces lugubres événements se déroulaient sur nos plateaux et sur le reste du sol limousin ?
Ne les accusons pas tous. Tandis que Coligny et Lamaurie désolaient nos campagnes, ils étaient, nos seigneurs, là où le devoir le plus pressant les appelait. Les uns étaient dans le voisinage de Brive, sur les confins du Périgord avec le vainqueur de Moncontour pour barrer le passage au Béarnais. Les autres, comme Gilbert III de Ventadour et Gabriel de Soudeilles, tandis que le duc d'Anjou surveillait les mouvements des rebelles au Midi, avaient ouvert une campagne, au Nord de la province, et assiégeaient Saint-Léonard dont ils s'emparaient. D'autres avaient assez à faire pour eux afin de défendre leurs demeures, comme Martial Chassaing, Jean II de Soudeilles, (Antoine) de la Barge, Mondon et Jean Chapoulier et Martin Crespel, etc. D'autres enfin, oubliant malheureusement
— 283 —
que cinq siècles auparavant leurs ancêtres avaient pris la croix se traînaient à la suite de Lamaurie, de Coligny, du pélican de Turenne et du Béarnais, comme les de Martret seigneurs du château qui sert aujourd'hui de presbytère aux curés de Nonars, et tant d'autres dont le nom est cloué au pilori de l'histoire.
Sont-ce là toutes les épreuves qu'eut à subir l'abbaye de Bonnesaigne sous la longue administration d'un demi siècle de Catherine de Chabannes? Il s'en faut de beaucoup ! Il faut que la vieille abbesse, avant de mourir, boive le calice du malheur jusqu'à la lie.
Voici qu'aux horreurs de la guerre viennent se joindre les fléaux encore plus terribles des éléments pour renverser ce que les boulets du canon avaient respecté de son abbaye.
La Foudre (1570, 1597, 1598)
Nous l'avons dit ; après les deux visites de Coligny, l'abbaye n'était'qu'une ruine : cloître, réfectoire, dortoirs, offices, bâtiments, meubles et ornements avaient disparu. Il ne restait debout que la tour de pierre de la communauté et l'église abbatiale avec sa grande tour carrée. Les flammes allumées par la fureur calviniste les avaient respectées ; la colère des éléments devait les secouer rudement.
Le 25 février de l'année qui suivit les deux visites de Coligny, pendant une épouvantable bourrasque « au moment où l'hiver et le printemps se trient », comme disent nos montagnards, la foudre éclata sur
— 284 —
la tour ronde de la communauté et ce la mit à bas », nous apprend le P. Bonaventure (1570).
Vingt-sept ans plus tard (1597), c'est-à-dire onze ans après la visite de Lamaurie, toujours sous l'abbesse Catherine de Chabannes, ce fut le tour de celle du clocher qu'avait relevée avec tant de peine Gaillarde Roberte III de Blauge," après le passage des Anglais. La décharge électrique fut terrible, mais la robuste tour carrée ne bougea pas.
L'année suivante (1598), cette nouvelle ennemie de Bonnesaigne, en cela semblable à l'armée de Coligny, revint visiter sa victime ; et cette fois ce le clocher fut abbattu et la voûte écrasée », nous dit M. Poulbrière. (Dict. des Paroisses).
Est-ce sa dernière visite? Oui, pour l'abbesse de Chabannes mais non pour sa communauté. Nous la retrouverons plus tard cette alerte messagère des colères du ciel, en train de lézarder à nouveau, comme à plaisir, ce clocher à peine restauré.
Cette fois la mesure est pleine; Catherine de Chabannes peut aller dormir le grand sommeil de l'éternité où elle entra le 2 avril 1605.
Le Démon (1605-1651)
À la mort de Catherine de Chabannes, l'abbaye de Bonnesaigne avait l'aspect d'un vaste et lugubre tombeau, où faisaient entendre des cris plaintifs les mânes de huit siècles d'abbesses et de religieuses.
L'heure dernière a donc sonné pour l'antique fondation du pieux duc d'Aquitaine? Pas encore ! Elle est bien malade, semblable au voyageur laissé à demi-
— 285 —
mort sur le chemin de Jérusalem à Jéricho, après avoir été meurtri et dépouillé par une bande d'assassins ; mais il lui reste encore un souffle de vie et le coeur bat toujours. Une bonne Samaritaine, cette fois, aura pitié de son malheureux sort. D'une main délicate, elle soignera ses blessures béantes, y versera le vin et l'huile pour les cautériser et en adoucir les brûlantes douleurs. Elle veut la sauver à tout prix. Pour la ramener à la vie, elle dépensera généreusement tous les deniers de sa bourse et, à son départ pour l'éternité, elle la confiera à un coeur ami qui saura aussi continuer son oeuvre de miséricorde.
Qui donc opérera ce miracle de résurrection pour Bonnesaigne ? Ce fut, pendant plus de cinquante ans, la plus illustre des abbesses de Bonnesaigne, Gabrielle de Beaufort de Canillac.
Nièce de Catherine de Chabannes, dès son arrivée au monastère de Bonnesaigne elle seconda admirablement sa tante dans l'oeuvre de relèvement de l'abbaye, qu'elle avait entreprise après le passage de l'amiral de Coligny et du farouche Lamaurie.
Avant même d'être professe, nous apprend Nadaud, Gabrielle de Beaufort avait mangé son patrimoine pour rétablir le cloître, le réfectoire, les dortoirs, les offices et les bâtiments, qui avaient été emportés par la tourmente qui s'était abattue sur Bonnesaigne.
Devenue sa coadjutrice (1604) et sa remplaçante (1605), elle releva, pendant les quarante-six ans que dura son supériorat, tout ce que la guerre, le pillage, l'incendie et la foudre avaient dévasté dans son abbaye. Les bâtiments de la communauté furent non seulement refaits mais encore agrandis. Le clocher et
— 286 —
les voûtes de l'église, « écrasés » par la foudre, furent de nouveau lancés dans les airs.
Comment put-elle pourvoir à de si pressants besoins, faire face à tant de dépenses ? car Nadaud nous apprend que ce les rentes du monastère suffisaient à peine pour nourrir les 15 religieuses qui y servaient Dieu nuit et jour ». C'est là le secret de son grand amour pour Dieu, de son inépuisable charité envers les pauvres et de son zèle ardent pour la sanctification des âmes qui lui étaient confiées. En elle se sont réalisées ces paroles de nos saints Livres : Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum.
Malgré l'assistance du ciel et les secours qui lui arrivaient du côté de la terre, Nadaud nous dit que ce les besoins (de l'abbaye) étaient considérables et la pauvreté de la maison ne lui permettaient pas de fournir tout le nécessaire ».
Ce fut dans ce pressant besoin que, dès son arrivée au pouvoir, elle fit unir à son monastère les prieurés de Villevaleix et de Champagnac, par bulle obtenue le 22 décembre 1605 et fulminée le 15 décembre de l'année suivante.
Malgré les torts qu'elle se donna dans la suite (1643) de distraire du bénéfice abbatial ces deux prieurés en faveur de ses nièces de Montmorin, Gabrielle de Beaufort put remettre complètement Bonnesaigne sur un bon pied.
Ce fut après avoir relevé tant de ruines, meublé de nouveau les cellules de ses religieuses, rendu à l'église et à la sacristie les ornements que Coligny et Lamaurie lui avaient volés, arraché sa communauté à la juridiction des Ventadour (1627) et l'avoir dotée des
— 287 —
nouvelles constitutions dont nous avons parlé à différents endroits de cet ouvrage, que pour affermir ses filles dans l'esprit de leur ordre, cette intrépide et admirable abbesse leur fit donner une fructueuse mission par le P. Jean Lejeune, dit le Père aveugle.
C'est à ce moment, lorsque l'abbaye semblait revivre ses jours les plus prospères, que Dieu fit passer notre abbesse par une terrible transe qui sembla lui dire que le ciel, toujours en courroux contre Bonnesaigne, ne voulait plus des sacrifices qu'on pouvait lui offrir derrière des murs si souvent ébranlés par le malheur.
Le célèbre oratorien arriva à Bonnesaigne avant ou après —je ne puis préciser davantage — les missions qu'il avait données avec tant de fruit à Tulle et à Treignac, précédé de la renommée que lui avaient acquise en France sa vibrante parole et ses vertus éminentes.
Or, au cours de cette retraite se produisit un fait étrange, qui glaça d'épouvante et les religieuses qui en furent témoins et les habitants du village qui suivaient les pieux exercices. •
Le démon en personne avait juré, à son tour, la ruine d'une abbaye qui avait résisté à la guerre, à l'incendie, au pillage et aux éléments déchaînés par les Anglais, les protestants, les brigands et la foudre.
Ecoutons le panégyriste du saint missionnaire, nous rapportant le fait en question :
ce Les. puissances des ténèbres ont échoué et se ce sont vues briser aux pieds de cet homme apostoli« que dans la mission de Bonne-Saigne. Il fut jeté ce par les démons avec son guide du haut d'une tour
— 288 —
« et roula sur tous les degrés de cet édifice. Quicon« que l'aura vu comme moy jugera facilement qu'ils ce devaient tous les deux périr, si Dieu ne les eut « préservés par un miracle et une protection si visicc ble qu'ils se trouvèrent au bas des degrés sans ce avoir reçu le moindre mal ny la moindre appaee rence de blessure, quoy qu'il se fût fait un fracas ce si étrange qu'il fit accourir tout le monde. L'on fut ce bien surpris d'entendre ce saint homme, qu'on ce croyait écrasé, dire à son guide en se relevant :
ce Mon frère, nos bons anges ont empêché l'effet de ce la malice du démon ; nous n'avons point de mal, ce allons prescher et continuer notre mission ».
Celui qui s'exprime ainsi, il nous le dit lui-même, a été témoin du fait, et c'est messire Gabriel Ruben, docteur en théologie, curé et chanoine de l'église collégiale d'Eymoutiers, qui le rappelle du haut de la chaire de Bonnesaigne aux religieuses qui l'auraient perdu de mémoire.
La signature de ce prêtre éminent se trouve sur les registres de Chamberet sous la date du 11 janvier 1649. Un siècle plus tard, Léonard Ruben, prêtre de la même ville, décéda au château de Chaverivière, auprès des de Lapomélie, ses parents, et.fut enterré dans l'église de Chamberet, en présence de Léonard Poumier, curé de Saint-Priest, et de Jean Ruben, curé de Sainte-Anne, où se trouvait le prieuré de Villevaleix, et frère du défunt.
Le Discours funèbre sur la vie et la mort du R. P. Lejeune est aujourd'hui chose rare à trouver.
Gabrielle de Beaufort, qu'avait si fortement impressionnée ce fait étrange, n'entendit point le curé
— 289 —
d'Eymoutiers le rappeler à ses religieuses : elle était morte depuis vingt-et-un ans; ce fut sa nièce et remplaçante, Anne de Montmorin, qui fut terrifiée de se l'entendre redire en 1672 par le grand admirateur de la sainteté de l'illustre missionnaire.
Après l'action lugubre de l'affreux père du mensonge dans les murs de Bonnesaigne, la série des visites terrifiantes est bien épuisée à jamais pour notre abbaye ? Pas encore ! En voici une autre, et ce sera fini, cette fois, jusqu'à la plus grande de toutes qui, pour toujours, enterrera Bonnesaigne sous un monceau de ruines pulvérisées, sur lesquelles se promènera la charrue et fleurira le blé noir.
La Foudre encore (1664)
Chose étonnante, bien digne de remarque ! A 94 ans d'intervalle et treize ans après le décès de la grande abbesse de Beaufort, sous le supériorat d'Anne de Montmorin, ce fut encore le 25 février que les terribles éléments se déchargèrent de nouveau sur le clocher de l'église abbatiale à peine restauré depuis quelques années. Les dégâts furent considérables, mais non de nature à décourager nos intrépides religieuses qui s'obstinaient à ne pas déserter des lieux qui semblaient maudits de Dieu et des hommes, mais qui leur rappelaient les joies de leur profession.
Les ravages de la foudre furent reparés par la pieuse abbesse et par sa digne remplaçante Claude de LévyGharlus qui en mourant (1701), ce laissa son abbaye assez bien accommodée, lisons-nous au Rulletin de Limoges, mais toujours très mal bâtie et un air plus
— 290 —
sauvage qu'il y ait dans le Bas-Limousin, du côté des montagnes, dans l'archiprêtre de Gimel ». (T. XLVI, p. 350.) Nous dirons plus tard ce qu'il y a d'exagéré dans ce tableau lugubre de Bonnesaigne que Leduc semble n'avoir jamais visité.
Quoi qu'il en soit, pour une raison ou pour une autre, jusqu'en 1760, sous les abbesses Catherine de Beauverger et Marie-Gabriellede Saint-Chamant, l'abbaye ne reprit guère plus ses grands airs de fête d'autrefois. Par suite de l'ennui que les grandes familles du xvine siècle éprouvaient de vivre à la campagne, loin des plaisirs délirants des villes, notre communauté champêtre eut désormais l'aspect d'une noble ruinée, d'une masure branlante ou d'une malade sentant déjà l'odeur du tombeau, malgré sa restauration complète sous le règne bienfaisant de Louis XIV. C'est du moins ce qui ressort du rapport adressé à Louis XV pour lui demander le transfert de nos Bénédictines dans l'abbaye des Clarisses de Brive (1759).
A bientôt nos réserves.
Après ce tableau, certes bien incomplet, des épreuves extérieures de Bonnesaige, peut-il paraître étonnant, à tout lecteur sérieux, que dans l'intérieur des murs de cette abbaye, nous ayons eu à déplorer parfois, le long de notre récit, des dissensions, des cabales, des exigences jusqu'à des scandales blâmables, à la rigueur, mais toujours compréhensibles et excusables jusqu'à un certain point?
Répétons-le une dernière fois : ce Une seule chose nous étonne, c'est que dans cette abbaye, nous trouvions si peu de mal et tant de bien ! »
Hélas ! à Brive encore, elle n'aura guère mieux la
— 291 —
paix intérieure et extérieure si nécessaire à la vie religieuse ! Là aussi nous la verrons aux prises avec toute sorte de malheurs.
Tant il est vrai de dire que les Bénédictines de Bonnesaigne devaient constamment habiter le Calvaire pour imiter la vie souffrante de l'Homme-Dieu afin de parachever, selon le langage de saint Paul, ce qui manque à la Passion de Jésus-Christ !
(A suivre).
(Suite)
CHAPITRE IX . ;' ;.
\ --. '
Bonnesaigne émigré à Brive (1651-1759) \y'",
"H
§ I. — RÊVE D'ÉMIGRATION
Décidément le séjour de Bonnesaigne devenait, si non intenable,, du moins effrayant... Toutes ces visites sinistres, sans cesse renouvelées, n'étaient-elles pas un pronostic de mauvais augure pour les Filles de Saint-Benoît si elles s'obstinaient encore à habiter plus longtemps ces lieux maudits ? N'étaient-elles pas des signes manifestes de la volonté de Dieu de voir transférer l'abbaye sous d'autres climats?
C'est la raison, sans doute, pour laquelle, sur la fin de son règne, l'imperturbable, l'intrépide abbesse, Gabrielle de Beaufort, elle-même effrayée, essaya d'une fondation à Tulle dont nous avons parlé, mais qui n'eut pas le succès attendu, pour y faire plus tard le tranfert de sa communauté.
Durant un siècle encore (1651-1758), les quatre abbesses qui lui succédèrent : Anne de Montmorin, Claude de Lévy-Charlus de Ventadour, Catherine de Reauverger-Montyon et Marie-Gabrielle de Saint-Chamant, se résignèrent bien à habiter derrière des murailles réparées et sous des toits restaurés qui, d'après les rapports fournis au roi., ee à la moindre secousse atmosphérique pouvaient tomber sur elles ! » (Encore une fois, à bientôt nos réserves.)
T. XXVI 3-1
- 350 —
Mais la cinquième, Léonarde-Gabrielle d'Ussel de Châteauvert, ne s'y résigna pas du tout.
Un an après sa nomination (1758)., nous la trouvons installée à Ussel, le 11 février 1759, tandis que son oncle, plus brave qu'elle devant le danger, habite toujours Bonnesaigne. Ce jour-là, elle lui donne procuration, à la grille de son parloir d'Ussel, pour traiter avec l'abbé Pigeyrol les affaires de la cure de Darnets dont nous avons déjà eu occasion de parler. Pour elle, elle rêvait d'émigrer sous un ciel plus clément, et avait besoin de toute sa liberté d'esprit, sans préoccupation d'intérêts matériels de dîmes, de rentes, de proférents et de revenus du verrou de Féglise, pour réaliser son rêve.
§ II. — PROJET DE FUSION. — ARRÊT
D'Ussel, Gabrielle de Châteauvert négociait avec l'official de Limoges qui, de concert avec le roi, préparait une fusion, des bénédictines de Bonnesaigne avec les urbanistes de Sainte-Claire de Brive. Ces dernières aussi ne pouvaient ni se recruter, ni se suffire.
Après s'être fait rendre un compte exact de l'état des deux communautés, le roi, par arrêt du conseil du 1er mai 1759, ordonna la suppression des clarisses de Brive, en vue de leur remplacement dans leur cloître de cette ville, par les bénédictines de Bonnesaigne.
Les réparations à faire à Bonnesaigne étaient évaluées à 40,000 livres et l'abbaye avait 9,000 livres de
— 351 -
revenus pour faire face à 5,995 livres de charges ordinaires, et à 4.,000 livres de charges extérieures de la maison.
§ III. — EXPOSÉ DES MOTIFS
Sitôt qu'il eut reçu cet arrêt du conseil, l'official de Limoges le porta à la connaissance de l'évêque. Écoutons Nadaud :
« Le promoteur du diocèse exposa à l'évêque que le roi s'étant fait rendre compte de l'état et situation de Bonnesaigne avait ordonné par arrêt du conseil, le 1er mai 1759, quil serait incessamment procédé à l'extinction et suppression des religieuses de Sainte-Claire de Brive, et que les biens, titres et religieuses de ce couvent seraient transférés et unis à l'abbaye de Bonnesaigne.
ce Outre les raisons générales qui faisaient désirer la translation des religieuses des campagnes dans les villes, Sa Majesté trouvait qu'il y en avait de particulières pour Bonnesaigne qui se trouvait situé dans un pays froid, isolé., désert, où la neige était si abondante en hiver que les communications n'étaient pas libres; si un aumônier venaità tomber malade dans ce temps, les religieuses étaient privées de tous secours spirituels ; Féloignement des villes, de cette abbaye, rendait aussi très difficiles les secours temporels en hiver.
ce Le sol des bâtiments étant dans un marais, ces bâtiments menaçaient ruine prochaine. Dans cette situation les religieuses ne pouvaient que respirer un air malfaisant, en danger continuel de maladies comme
- 352 -
aussi d'être écrasées par les murs de clôture en très pitoyable état.
ee Aussi, loin de trouver aucun inconvénient à la translation requise, Sa Majesté était convaincue que le bien des religieuses des deux maisons et l'avantage du public demandaient que l'on transférât l'abbaye de Bonnesaigne dans le monastère de Sainte-Glaire de Brive. »
Voici maintenant mes réserves, depuis si longtemps promises :
Pour quiconque connaît Bonnesaigne et ses environs le tableau des motifs est un peu chargé de non valeurs. A trois kilomètres, au plus, du bourg de Combressol, les religieuses ne risquaient nullement de manquer de secours spirituels, lors même que leur cher aumônier serait tombé malade, pendant la saison des neiges. Les malades de Lerme, village bien plus éloigné, n'en manquent pas; sans quoi il faudrait dire que les curés de la montagne, qui ont des villages à 15 kilomètres du clocher, comme Chamberet, Peyrelevade, Meymac, Neuvic, etc., laissent mourir tout leur monde sans sacrements et qu'alors il faut bâtir des églises, établir des curés dans tous ces villages éloignés.
Le froid n'y est pas si intense qu'on veut le dire ; Bonnesaigne n'est pas sur un mamelon comme Egletons, Saint-Angel, ou sur un plateau comme Ussel, mais bien sur un ressaut de la montagne de Fleuret, s'enfonçant comme un coin dans le flanc gauche des prairies qui descendent de la Chapelle et vont mourir au Feyt (La Yinouse) sur la rive gauche de la HauteLuzège, là où Coligny avait établi son camp pour
— 353 —
incendier l'abbaye. Les rayons du midi et du couchant touchent parfaitement et le village et le monastère de Bonnesaigne très écarquillés l'un et l'autre, comme ils nous ont paru sur la fin de septembre dernier, gardés qu'ils sont par les deux collines parallèles chargées de maisons, de champs, de bois, de châtaigners et même de noyers qui, avons-nous dit, encadrent la verte vallée de Bonnesaigne.
Non, ainsi déroulée du nord-ouest au midi sur un tapis de verdure, la vallée ne doit pas garder la neige longtemps, et le courrier qui la traverse aujourd'hui doit trouver du changement, quand il la quitte, pour faire l'ascension du plateau de Palisse avant d'arriver de Meymac à Neuvic.
D'ailleurs si Bonnesaigne est si insalubre, si froid, si dépourvu de secours en hiver, ee comment, aurait pu répondre le roi à Mme l'abbesse d'Ussel, comment vos devancières ont-elles pu s'y maintenir Fespace de mille hivers et tenir à la main la crosse du commandement durant des 46 et même des 50 ans comme Gabrielle de Beaufort et Catherine de Chabannes? Où est donc le temps où l'une d'elles aimait tant à se dire : Abbesse de la Vallée Chaude, de la ValléeÉtuve ou du Val-Tuve ? Les saisons et les climats ont donc bien changé !... Ne serait-ce pas plutôt les hommes et les goûts, Ma Soeur?... »
Les murailles de clôture qu'avait relevées MmB de Beaufort étaient si peu en pitoyable état qu'elles subsistent encore, après un siècle et demi d'abandon ; toutcomme, sans les ravages de la Révolution, seraient encore debout les murailles d'une abbaye ce qu'avait relevée l'abbesse de Beaufort et qu'avait laissée assez
— 354 —
bien accommodée Mme Claude de Lévy-Charlus », morte en 1701.
Mais assez chicané de pauvres filles qui, en allant à Brive, divorçaient, si l'on veut, avec une masure qu'elles n'eurent pas le courage d'entretenir, pour épouser une ruine qu'elles n'eurent pas l'amour propre de relever, ainsi que nous l'établirons bientôt.
La vraie raison de cette émigration est que les dernières abbesses de Bonnesaigne, -à l'instar des nobles de l'époque, n'aimaient pas la campagne ; elles faisaient mentir ceux qui avaient écrit : ee 0 fortunatos nimium sua si bona, norint agricolas ! »
Ou qui disent encore : ee Ne fuyons pas les campagnes ! A la campagne on voit l'intelligence de Dieu, et à la ville l'intelligence de Fhomme ! » (Paul Auvard.)
Elles avaientoublié ces paroles de nos Saints Livres : ee Ducam eam in solitudinem et ibi loquar ad cor ejus. »
Les ruines des villes avaient pour elles plus d'attraits que celles des champs. Mme de Châteauvert était de ces dernières abbesses fin de siècle.
Mais passons : Le roi trouva bonnes des raisons qui ne valaient rien, et l'évêque en fit autant. C'était leur affaire ; ça doit nous suffire !...
Sitôt que Louis-Charles du Plessis d'Argentré, évoque de Limoges, eut dit oui, le promoteur le notifia au souverain. Et Sardanapale, qui avait d'autres Nymphes en tête, se hâta de donner congé aux dames de Bonnesaigne.
Par décretdu5 juin 1759 il transféra les bénédictines montagnardes dans l'abbaye de Sainte-Glaire de Brive.
— 355 — l IV. — DÉLIBÉRATION DES CLARISSES
Sitôt que la sentence du pouvoir royal fut connue à Limoges, le promoteur requit les clarisses de Brive d'avoir à s'y conformer, par lettre du 24 juin 1759, signifiée par le ministère de l'huissier.
Le lendemain, les religieuses de Sainte-Claire, réunies au son de la cloche en assemblée capitulaire, prirent la délibération suivante :
« Aujourd'hui, vingt-cinquième jour du mois de juin milsept-cent-cinquante-neuf, Nous Supérieures et religieuses de la communauté de Sainte-Claire de Brive, capitulairement assemblées pour délibérer en conséquence de l'assignation qui nous a été donnée à la requête de M. le Promoteur général du diocèse de Limoges, en date de hier, signée : Marsin, huissier, contrôlée par Desilles, après avoir mûrement réfléchi sur le contenu du réquisitoire de M. le Promoteur duquel nous a été donné copie en tête dudit exploit, avons d'un commun accord consenty et consentons à l'extinction et suppression de notre communauté et à la réunion de tous les biens meubles et immeubles d'icelle, de notre maison et jardin à l'abbaye de Bonnesaigne et à tout ce qui est contenu au dit réquisitoire, à nous notifié le vingt-quatre du courant aux conditions suivantes :
« 1° Que chacune de nous pourra demeurer, jusqu'à la fin de ses jours, dans la présente communauté, pour y recevoir les secours spirituels et temporels en santé et en maladie, et après notre mort la sépulture monastique ; que pour notre vestiaire et autre linge de table et de lit qui nous sera fourni, il nous sera donné annuellement à chacune de nous la somme de vingt livres, outre le produit de notre travail qui nous appartiendra, et les pensions viagères que chacune de nous a droit de recevoir de sa famille.
« 2° Que toutes les fondations dans notre église, continueront d'être acquittées, attendu que les fonds d'icelle ont été employés dans et pour l'utilité de la maison.
— 356 —
« 3° Qu'en cas de mécontentement, il nous sera loisible de nous retirer dans quelqu'autre communauté religieuse, et qu'il sera fourni à chacune de nous par la dame abbesse de Bonnesaigne, la somme de deux-cent-cinquante livres annuellement, autre et pardessus nos pensions viagères qui nous ont été constituées par nos parents.
« Au surplus, avons nommé soeur de la Nativité de Parry, vicaire dudit couvent, soeur de la Trinité, discrète, pour comparaître en notre nom, devant M. l'abbé Serre, commissaire délégué par Mgr l'Evêque de Limoges, et assister à toutes les opérations de la procédure, comme inventaires de meubles, papiers usités, de bâtiments et autres, approuvant dès à présent tout ce qui sera fait par lui fait et de même de présenter et lui remettre copie en forme de la présente délibération, et avons toutes signées, à la réserve de la soeur de Saint-François de Lajoanie, laquelle à cause de son grand âge de plus de cent ans et de ses infirmités n'a pu signer.
« La lecture de ce présent délibératoire a été faite devant nous soussignées et la soeur Marie de Laporte, converse, qui n'a pas signé pour ne savoir. « Ont signé :
« Sr DE LALVAINE ;
« Sr CATHERINE DE MAIGNE, supérieure ;
« Sr DE LA NATIVITÉ DE PARRY, vicaire;
« Sr DE SAINT AUGUSTIN DE RORNE ;
« Sr DE SAINTE ELIZABETH DE LA SERRE ;
« Sr DES ANGES DE GAUTIER ;
« Sr DE SAINTE COLOMBE DE COURS ;
« Sr DE LA TRINITÉ DE LENTILLIAC ;
« Sr DE SAINT BENOIT DU PRAT.
En tout, onze religieuses pour trente-neuf cellules qui attendaient les 21 bénédictines et trois converses de Bonnesaigne, outre l'abbesse.
Ainsi disparut l'abbaye de Brive où, sous la date du 24 mars 1702, nous trouvons M,1,c Brachet de Maslaurent.
— 357 —
g Y. — DÉPART DE BONNESAIGNE — CHARGES (1760)
D'après M. Ghampeval, ce fut le 18 juin 1760 que l'abbesse Léonarde d'Ussel de Châteauvert émigra, avant l'arrivée des frimas, avec ses vingt-et-une religieuses et trois converses, sous le ciel plus clair de Brive où trente-neuf cellules l'attendaient dans une abbaye éteinte par décret.
Y trouva-t-elle Yotium cum dignitate, tant envié des anciens et qu'elle n'avait pas l'air de dédaigner. C'est fort douteux.
Le premier résultat négatif de cette émigration fut, en effet, que l'abbaye de Bonnesaigne perdit, sur le champ, le privilège de prendre annuellement jusqu'à deux-cents charretées de bois dans la forêt de Ventadour pour le chauffage de la maison.
Jusqu'à cette date, la forêt ducale avait été un lieu fermé au vulgaire; seules la famille do Soudeilles et la communauté de Bonnesaigne avaient le droit d'y couper leur bois de chauffage. Après la fuite des bénédictines, elle fut ouverte au public, mais pour les deux-cents charretées seulement que les religieuses y prenaient. C'est ce qui résulte d'une supplique que M. Dambert, juge d'Egletons (1763-1772), adressa au duc Charles de Rohan (f 1787) vers 1760, c'est-à-dire sitôt que nos bénédictines furent parties, pour le prier de livrer désormais sa forêt à l'exploitation des marchands de bois. Du compte rendu de sa démarche, qui se trouve aux riches archives de M. J. SeurreBousquet, nous extrayons ces deux phrases :
ce Les religieuses de l'abbaye de Bonnesaigne jouissaient d'un droit de chauffage dans la dite forêt (de
— 358 —
Ventadour) qui était de deux cents charretées chaque année ; elles furent transférées à Brive et perdirent leur droit ; avant cette époque on ne vendait pas de bois
ee M. Desprès (homme d'affaires du seigneur de Ventadour) fit répondre que le conseil du prince avait décidé de vendre jusqu'à concurrence de 200 charretées qu'en prenaient les religieuses de Bonnesaigne ; alors il se présenta des acquéreurs ; le garde fut chargé de vendre ce bois qu'on fixa à 15 sols la charretée »
Dans la confiscation de ce droit de chauffage que le comte Bernard avait accordé à sa nièce Blanche II de Ventadour (1326-1347), nous avons peut-être la raison du procès qu'en 1766 l'abbesse Gabrielle d'Ussel de Châteauvert intenta, pour son monastère, à Charles de Rohan, prince de Soubise, duc de Ventadour, son parent, mort en 1787, n'ayant eu que deux filles : Charlotte-Godefride et Yictoire-Armande. (Y. Trois Limousines, p. 228.)
Mais ce n'est pas tout ; bien d'autres embarras encore attendaient nos Bénédictines à Brive : Leurs propres dettes les y suivirent; et, de plus, elles y trouvèrent celles que les Glarisses y laissaient en partant.
Nous avons déjà'vu, en effet, que l'argent des fondations pieuses avait été employé, par les Urbanistes, dans elpour futilité de la maison. Or, les charges des fondations existaient et elles furent imposées à Mrae l'abbesse de Bonnesaigne par la supérieure des Glarisses le 25 juin, quand elle consentit à mourir par décret (1759). En voici le tableau détaillé que nous trouvons dans la Semaine religieuse :
— 359 —
« Messes de fondation que les religieuses de Sainte-Claire de Brive sont obligées d'acquitter annuellement :
« 1° Pour la famille de Sallis, trois messes chantées de la fête du jour, la lre le 17 janvier, jour de Saint Antoine abbé ; une le jour de Sainte Catherine de Sienne, 30 avril ; une le jour de Saint Jérôme, 30 septembre.
« La fondation est de cent pistoles.
« 2° Pour les MM. de Lagrange, trois messes chantées, une le jour de Saint Louis, roi de France ; une autre le jour de Saint Charles-Borromée ; une autre de Requiem dans l'octave des morts, celle-là pour un prêtre. « La fondation est de 500 livres.
3° « Pour chez M. Vieilbans de Bassaler, pour leurs ancêtres, deux messes chantées :
« La lre le jour de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge. Après la messe on devra chanter le Salve Regina et VInviolata, et à la messe on veut qu'il y ait diacre et sous-diacre.
« La fondation de cette messe est de 50 livres.
« La seconde messe est des Morts, le jour de sainte Monique, le 4 mai.
« La fondation de cette messe payée, on fit faire les vitres de l'église et de la tribune, et les bancs dossiers de l'église.
« 4° Pour chez M. Négrerie, marchand dans la rue des Frères, une messe chantée des morts, le 2 septembre, fête de Saint Nicolas de Tolentino.
« 5° Pour MelIe Jacqueline de Seneterre de Saint-Viclorin, une messe basse toutes les semaines.
« La fondation est de 1000 livres. « G° Pour MelIe Brunerie, cinquante messes basses.
« La fondation est de 500 livres. « 7° Une messe basse du jour pour chez M. de Neuville, le onzième d.u mois d'août.
« La fondation est de 10 livres.
— 360 —
« Toutes les fondations ont été payées, et ont été employées à la communauté. « Ont signé : « Sr DE LA NATIVITÉ, supérieure ; « Sr DES ANGES DE FAUCONIE ; « Sr DE LA TRINITÉ DE LENTILLAC ; « Sr DE SAINT BENOÎT DU PRAT.
« (S. R. N° 15, 14 avril 1883). »
Et l'abbaye de Sainte-Claire était-elle dans un meilleur état de conservation que celle de Bonnesaigne ? Y avait-il là-bas, comme là-haut, danger de voir, à chaque instant, les religieuses périr sous des décombres? Les réparations à faire à Sainte-Claire étaientelles moins onéreuses que celles que demandait Bonnesaigne ?
Écoutez ce que nous trouvons, 22 ans plus tard, dans le procès-verbal d'installation de l'abbesse Françoise Green de Saint-Marsault, le 3 janvier 1781.
Ce que l'abbaye était ce jour-là, elle l'était le jour de l'arrivée de Mme de Châteauvert (1760).
1° Église. —Tandis que l'official installait au choeur la nouvelle abbesse, le notaire apostolique Margûa, dont nous avons déjà écrit le nom, légèrement distrait par devoir, jetait un coup d'oeil d'ensemble dans l'intérieur de l'église et il écrivait :
ee Tandis que les dames religieuses de Bonnesaigne chantaient, dans le bas-choeur, l'hymne du Veni Creator, nous avons observé que tous les murs de ladite église sont d'une extrême vétusté, bossues et en décadence, les poutres soutenant un très vieux lambris surbaissées et suspendues par de minces boulons de fer. »
— 361 —
2° Choeur. — La porte grillée du choeur s'ouvre ; et, à la suite du cortège, le notaire y pénètre par le grand escalier ; il jette un second coup d'oeil autour de lui, et il continue à écrire :
ee Ce grand escalier nous a paru, ainsi que les murs d'icelui, extrêmement usé, décharné, comme ceux du vestibule avant le choeur et ledit choeur et stalles le sont en vétusté et ruinés. »
3° Salle de communauté. — Les voilà hors de l'église, dans la salle de communauté; notre notaire regarde une troisième fois autour de lui, et il écrit encore :
ee La salle de communauté n'est autre chose qu'un très large dortoir, ayant six cellules de chaque côté, formées par des cloisons de torchis, qui étant d'un poids énorme avaient fait fléchir anciennement de plus de quatre pouces les poutres qui les supportaient et qui sont dans l'église, lesquelles mêmes s'étant retirées par le surbaissement d'environ quatre pouces, il fut mis au bout un S en fer ; mais le secours étant insuffisant, on a jugé à propos de suspendre lesdites poutres par des tringles de fer qui soutiennent les boulons que nous avons remarqués au lambris de l'église et vont s'attacher dans la charpente.
ee Dans laquelle charpente étant montés, nous avons remarqué que depuis cette opération, le tour (ou la tour) avait encore baissé de quatre pouces, que ladite charpente ne valant rien, lesdites cellules et l'église au dessous menacent une ruine imminente et font craindre les funestes événements tant pour les religieuses que pour le public-qui vient entendre la messe dans ladite église. »
— 362 —
4° Réfectoire. — C'est bien le moins du monde qu'on puisse prendre ses repas sans se sentir menacé de recevoir, à chaque instant, un carreau ou une poutre sur la tête ; ou de voir soupières, verres, assiettes et bouteilles voler en éclats, avec les ragoûts qui vous sautent à la figure et vous maculent la guimpe, n'est-ce pas ?
Écoutons encore notre cher notaire :
ee Étant descendus au réfectoire à travers plusieurs petits dortoirs et bâtiments dans la plus grande ruine, et qui ne sont qu'un assemblage de vieilles petites maisons toutes de niveaux différents sur des charpentes en ruines, nous avons trouvé que tout avait besoin'de reconstruction et menace ruine imminente tant au dedans qu'au dehors. »
5° Infirmerie. — Du moins, les pauvres soeurs malades, si la souffrance, les empêchant de dormir, leur fait trouver la nuit interminable :
« Oh ! que la nuit est longue à la douleur qui veille ».
peuvent veiller sans crainte à l'infirmerie, et attendre paisiblement l'arrivée de la mort lente qui les enlève? Que nous dit finalement notre tabellion : ee De même pour l'infirmerie qui est au dessus du réfectoire ; le tout menace ruine. Il n'y a que la maison abbatiale, composée de cuisine, salons, parloirs et appartements que ladite abbesse a parcourus et trouvés en bon état, et bien solides.
ee Tout le reste, comme il a été dit, a besoin de reconstruction el menace ruine imminente tant au dedans qu'au dehors, dont les réparations et
— 363 —
reconstructions doivent être examinées et les devis être faits par les ingénieurs et gens experts. »
Ici, tout naturellement, si nous en avions le temps, nous poserions plusieurs questions à nos amis lecteurs, leur laissant le soin de répondre, convaincu d'avance qu'ils le feraient dans le sens que nous répondrions si nous étions interrogé nous-même :
Laquelle des deux abbayes vous paraît la plus délabrée, d'après les deux rapports que nous venons de reproduire ?
Est-ce bien, sous cet aspect de délabrement, qu'on représenta l'abbaye de Brive au roi, pour lui faire croire que les soeurs de Bonnesaigne y seraient moins en danger que dans l'abbaye montagnarde?
N'a-t-on pas, au contraire, forcé un peu la note, en faisant à la puissance royale, le tableau lugubre des ruines de l'antique abbaye d'Eudes, duc d'Aquitaine?
Nous verrons en effet, dans la suite, que Bonnesaigne tenait encore debout au moment de la Révolution. Pour réparer cette abbaye on disait au roi qu'il fallait 40,000 francs; mais après ce que vient de nous dire M. Margùa, tout en admettant qu'il a chanté un peu trop haut les ruines de Sainte-Glaire afin de se faire entendre au loin et d'obtenir un secours de l'Etat ou de la charité publique, combien pensez-vous qu'il faudrait de moins qu'à Bonnesaigne, pour releverY église, le choeur, la salle de communauté, le réfectoire, Yinfirmerie, la charpente de l'abbaye de Sainte-Claire et mettre à l'unisson ee tout cet assemblage de vieilles petites maisons toutes de niveaux différents sur des charpentes en ruines ? »
— 364 —
Non ; MmD de Châteauvert n'a su, ni voulu sauver Bonnesaigne qui, sans elle, pourrait être encore parfaitement debout. Que n'eût-elle la ténacité de ses devancières !
Il est vrai qu'à Brive elle possédait une maison abbatiale en bon état et bien solide, et ses religieuses avaientle droit de lui dire, comme Lo Sor Cotorino :
«" Lo tsambro que vous avez, nou pore-i bélo è Sano, « Din las pledzas d'iver, setso coumo uno o oulano, « Belo visto pertou, bien virado e-i boun ven, e( Lo pu dzolio, o cop sûr, de tou nostre couven. « Poudez plo vou vonta d'esse lo miel loudzado
« De tou nostre couven, oma-i lo miel plossado
« Bien eoumodo per vou, bien virado ei-soulel « Nou vou tso-ouro l'estie ou, tsondialo, ni tsolel ».
(Les Ursulines de Tulle, p. l'abbé Sage. V. Dicl. patois, p. 356.)
Ça lui suffisait, et elle laissait dire. Mais eùt-elle le souci de relever la masure de Brive? Non, pas plus que celle de Bonnesaigne, puisqu'elle la légua dans son pitoyable état, vingt ans plus tard, à Mmc de SaintMarsault, ainsi que nous venons de le dire.
L'abbesse de Châteauvert, malgré ses belles qualités, semble avoir eu trop au coeur trois uniques préoccupations, durant son séjour sur les bords de la Corrèze :
Faire descendre l'argent de la montagne ; surveiller de trop près le curé de Darnets, qui lui répondit si noblement et lui fit passer l'envie de plaider ; et disparaître au plus tôt pour aller mourir à Ussel, le 12 février 1780.
CHAPITRE X
Bonnesaigne de Brive et la Révolution (1789-1805)
§ I. — PERSONNEL
Quand éclata la Révolution, l'abbaye bénédictine de Brive avait toujours sa même physionomie de tristesse qu'en 1781.
Bien plus, son personnel avait diminué de moitié. Au lieu de vingt-et-une religieuses, trois converses et l'abbesse qu'elles étaient en partant de Bonnesaigne en 1760, elles n'étaient plus que onze religieuses et trois converses.
C'étaient :
Françoise-Gabrielle Green de S'-Marsaud, abbesse, et les religieuses :
Anne Desclavar ; Marie La Chataigner de la Prade ; Louise Lagrange Feygnac ; Marguerite Montlouis ; Jeanne Grozac Duclaux ; Françoise Monamy-Mirambel ; Marie-Jeanne Sclafer-Jugeal ; Antoinette André ; Louise Hngon Duprat, fille de Jean-Jacques Hugon, écuyer, seigneur de Magoutière, et deN. deYignane, mort en 1746 ; en lui s'éteignit la branche aînée de Magoutière ; nous avons trouvé la branche cadette à Scoeux, de Chamberet ; Catherine Bourguet ;
Et trois converses : Marthe Laroche ; Marie-Thérèse Ribadaud ; Françoise-Marie Lafond.
Nous allons les voir aux prises avec la Révolution. Toutes résisteront vaillamment.
T. XXV. 3-2
- 366 —
§ II. ?— REVENUS DE L'ABRAYE (17 janvier 1790)
D'abord cauteleuse, comme de nos jours, sauf à devenir violente plus tard et à étouffer sa victime une fois qu'elle l'a enlacée dans ses réseaux, la Révolution ordonna que tous les possesseurs de bénéfices ecclésiastiques, religieux ou autres, seraient tenus de déclarer, devant les officiers royaux de la ville où ils se trouveraient, le nombre, le titre des bénéfices qu'ils possédaientet le lieu de leur situation, etc. (13 novembre 1789). Le décret portait la signature de e.. Louis par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Elat, roi des Français » (18 novembre 1789).
Il n'y avait qu'à s'y conformer.
En conséquence, la supérieure de Bonnesaigne fit la déclaration suivante à M. de la Bastille, le 17 janvier 1790 :
Etat des biens mobiliers et immobiliers dépendans de l'abbayë roïale de Bonnesaigne, ordre de S. Benoit, diocèse de Limoges, la dite abbaye transférée à Brive, Bas-Limousin, dans l'année 1159.
PAROISSE DE BRIVE
1° L'abbayë de Bonnesaigne jouit par elle-même et fait valloir un domaine au labourage de quatre boeufs, et quelques vignes y attenantes, le tout situé paroisse S. Martin de Brive et produisant, années communes, trois cents livres, cy 300
Un jardin situé hors la ville de Brive, produisant années communes, cent livres, cy 100
L'abbaye de Bonnesaigne a affermé les biens fonds, cens, rentes, dixmes cy après nommés :
- 367 -
PAROISSES DE BONNESAIGNE ET DE COMBRESSOLES
2° Les biens situés dans la paroisse de Bonnesaigne et Combressoles, consistant en quarante-cinq septiers de rente en froment, deux-cent-trente septiers de rente en seigle, sept-cent-trente-cinq quartes de rentes en froment, deuxcent-quarante livres en argent, vinades, menus cens, etc., toutes les dîmes que la dite abbaye a droit de percevoir, menues et vertes dîxmes, quelques terres et prés, bienfonds, quatre étangs, le tout sans garantir le plus ou le moins, affermé au sr Ninaux par contrat passé devant M. Lascaux notaire roïal au bourg de Condat en Limousin, le dit acte en date du dix-sept juillet mil-sept-cent-quatre-vingt-deux, moyennant le prix et somme de cinq-mille livres, cy : 5,000
PAROISSES DE COMBRESSOLES ET DE DARNETS
3° Un pré et deux pièces de terre situés paroisse de Combressoles et affermés au curé du dit lieu suivant bail à ferme qui lui en a été fait en date du 17 mai 1781, moyennant le prix de cinquante-quatre livres par an, le dit acte reçu par Lascaux, notaire susnommé, cy 54
4° Les dîmes en seigle, agneaux à percevoir sur la paroisse de Darnets, ensemble trente-huit quartes de bled, seigle ; cinquante-six quartes d'avoine ; sept livres un sol d'argent, ou suite de rente à percevoir sur les villages du Mas et du Fouilloux et autres situés dans ladite paroisse, le tout affermé au curé de Darnets, pour la somme de six-cents livres, suivant le bail à ferme passé à Brive devant Massénat, notaire roïal, le 17 juin 1785, cy 600
PAROISSE DE MAUSSAC
.5° Les dixmes, cens et rentes, droits en résultant, à prendre et percevoir sur la paroisse de Maussac, le tout affermé sans autre détail au curé dudit lieu pour le prix de 1200 livres, suivant acte passé devant Margûa, notaire roïal à Brive, le 17 janvier 1781, cy 1200
— 368 —
PAROISSES D'AMBRUGEAC ET DE DAVIGNAC
6° Les dixmes, cens et rentes et autres droits à prendre sur les paroisses d'Ambrugeac et de Davignac, affermés au sieur Joseph Périer par contrat passé devant Me Lascaux, notaire roïal, le 16 mai 1781, moyennant la somme de 1000 livres, cy 1000
PAROISSE DE CHAVEROCHE
7° Les dîxmes, cens et rentes et autres devoirs seigneuriaux à prendre sur la paroisse de Chaveroche, le tout affermé au curé de ladite paroisse par acte passé devant Lascaux, notaire, le 17 mai 1781, moyennant 120 livres, cy .' 120
PRIEURÉ DE VILLEVALEIX, PAROISSES DE NEUVIC, PALISSE, LA MAZIÈRE, SÉRANDON
8° Le prieuré de Villevaleix, dépendant de ladite abbaye, situé près Eymoutiers, consistant en cens, rentes, prés, terres, étangs, deux moulins ;
Les cens et dixmes dépendants de ladite abbaye à percevoir sur les paroisses de Neuvic, Palisse, la Mazière, Sérandon, le tout affermé au sieur Meilhards, d'Eymoutiers, par acte reçu devant Massénat, notaire roïal, à Brive. savoir, le prieuré cy-dessus énoncé, moyennant 918 livres, cy,.. 918
Et les cens et rentes sur les trois paroisses cy-dessus, pour le prix de 1200 livres, cy 1200
PRIEURÉ DE MENOIRE
9° Le prieuré de Menoire dépendant de ladite abbaye, consistant en cens, rentes, dîxmes, autres droits seigneuriaux en dépendants, à percevoir tant sur la paroisse de Menoire que sur celles où s'étendent lesdits droits, affermé au sieur Bourdet, paroisse d'Albussac, par acte passé devant Me Guittard, notaire roïal à Brive, pour le prix de 930 livr., ledit acte en date du 9 may 1781, cy 930
— 369 —
PAROISSE DE MENOIRE
10° Contrat d'arrentement passé devant Me Margûa, notaire roïal à Brive, au profit de Roumignac, habitant du bourg de Menoire, pour le prix de vingt-six livres, d'un pré dépendant dudit prieuré de Menoire, comme il paroit par ledit acte en date du deux mars mil-sept-cent-quatre-vingt-un, cy 26
DIOCÈSE DE CLERMONT. — PRIEURÉ DE CHAMPAGNAC
11° Le prieuré de Champagnac, dépendant de ladite abbaye, consistant en dîxmes de froment, bled, seigle, agneaux, dîxmes abonnées, novales, cens, rentes, droits de lods ; le pré appelé de Madame, près et dans les appartenances du bourg de Champagnac, généralement tous les droits résultant dudit prieuré, assis sur la paroisse de Saint-Julien et autres tènements, le tout affermé aux sieurs Juny et Pezières, marchands de la ville de Bards? (Bort), par acte passé devant Treille, notaire roïal en la ville de Bards (Bort), pour le prix et somme de seize-cent-vingt livres, cy.. 1620
Et les prés ci-dessus mentionnés sont affermés cent-quarante-quatre livres, cy 144
RENTES DÉTACHÉES DE LADITE ABBAYE
12° L'abbaye jouit et perçoit annuellement différentes rentes qui lui sont dues, tant par le roi que par plusieurs personnes ; le revenu annuel des dites rentes monte à la somme de douze-cent-soixante-quatre livres, cy 1264
Total général des revenus immobiliers : 14,516 livres.
BIENS MOBILIERS
L'état des biens mobiliers consiste en ce qui est strictement nécessaire à ladite abbaye, composée de seize religieuses, il n'y a n'y logement en dehors pour les étrangers, n'y autres meubles en dedans que ceux à l'usage commun. Le linge est proportionné aux besoins de ladite abbaye, — tam pour la sacristie que pour le service de la table, les ornements et linges d'églises sont analogues à sa fortune.
— 370 —
L'abbaye n'a dans ses archives que les titres nécessaires pour assurer la possession de ses biens.
g III. — CHARGES DE L'ABBAYE (17 janvier 1790) L'Assemblée nationale exigeait non seulement la déclaration des revenus exacts des bénéfices ecclésiastiques, mais encore celle des charges qui pesaient sur eux. C'est pourquoi la déclaration de Mmc de Saint-Marsault à M. Malden de la Bastille, conseiller du roi, lieutenant-général civil et de police, le 17 janvier 1790, après avoir mis au jour le bilan des recettes de son abbaye, y étale aussi celui de ses dépenses.
CHARGES QUE SUPPORTE LADITE ABBAYE
Pour la portion congrue des curés 4,200 1.
Réparations des sanctuaires des églises et entretien des sacristies, tant en
ville qu'en campagne 1,000 1.
Réparation des bâtiments et étangs.... 1,200 1.
Les décimes et abonnements 780 1.
Rentes constituées à différents particuliers 705 1.
Droits de régale 69 1. 6 s. 8 d.
Pension viagère 200 1.
Redevance en grains pour la vicairie de
Sainte-Catherine 200 1.
Pension de l'aumônier et du confesseur. 200 1.
Fondation de messes 150 1.
Impositions seigneuriales 130 1.
Pour médecins, chirurgiens, médicaments, etc 400 1.
Gages de six domestiques, leur nourriture, etc 1,400 1.
Total des charges connues 10,679 1. 6 s. 8 d.
Total général du revenu 14,516 1.
Reste net pour faire la dépense de l'intérieur de l'abbaye 3,837 1. 6 s. 8 d.
— 371 —
§ IV. — L'ABBESSE ET LE LIEUTENANT GÉNÉRAL (17 et 21 janvier 1790)
L'abbesse, qui ne savait pas trop pourquoi on demandait ces détails intimes aux maisons religieuses, puisque l'année suivante elle avouait à l'archiprêtre de Gimel qu'elle ee n'était pas plus au fait que les autres du nouveau régime » (Lettre citée 21 octobre 1791), écrivit au bas de cette déclaration financière :
« Nous, soussignée Françoise Green de Saint-Marsault, abbesse de l'abbaye roïale de Bonnesaigne, transférée à Brive, pour nous conformer au décret rendu par l'assemblée nationale, en date du 13 novembre dernier, sanctionné par le roi le 18 du même mois, portant que tous supérieurs de maisons religieuses sont tenus de faire dans les deux mois de la publication dudit décret, une déclaration des biens mobiliers, immobiliers, revenus et charges, qui en dépendent, AFFIRMONS, pour suivre le texte de la loi, que nous possédons les objets ci-dessus mentionnés, que tout ce que renferme celte déclaration cotée et paraphée par première et dernière page, et signée de Nous, est sincère et véritable ; que nous n'avons rien soustrait, et que nous avons fait avec la plus scrupuleuse exactitude le détail de nos biens, de quelque nature qu'ils soient, et charges suivant la connaissance que nous en avons, n'entendant pas cependant que le plus ou moins dans le revenu, ou les charges puisse nous préjudiciel' ; en conséquence, nous avons remis la présente délibération entre les mains de M. de la Bastille, Lieutenantgénéral de Brive, pour en faire l'usage requis par l'assemblée nationale.
« Fait à l'abbaye roïale de Bonnesaigne à Brive, le 17 janvier 1790.
« Signée : FRANÇOISE GREEN DE SAINT-MARSAULT, (( Abbesse de Bonnesaigne ».
— 372 —
Mmc l'abbesse ne tardera pas à apprendre, à ses dépens, l'usage que l'Assemblée fera de la permission qu'elle lui donne de faire de sa déclaration Yusage requis qu'elle voudra.
Il est vrai que l'Assemblée nationale n'avait que faire de cette permission.
En attendant que le bandeau tombât des yeux de l'abbesse, M. de la Bastille écrivit, à la suite de Mme de Saint-Marsault :
« Nous soussigné, conseiller du Roy, Lieutenant-général civil et de police es sièges royaux de la présente ville, certifions que le présent cahier contenant six feuillets côtés et paraphés par nous contient la déclaration des biens meubles et immeubles, revenus et charges de l'abbaye roïale de Bonnesaigne, que nous à faite Mme l'abbesse de Bonnesaigne et qu'elle est conforme à celle qui nous a été faite le 18 du présent mois.
« A Brive le 21 janvier 1790.
« Signé : MALDEN DE LA BASTILLE. « Paraphé : MALDEN DE LA BASTILLE ».
§ Y. — REQUÊTE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE (1790)
Il n'entre nullement dans notre plan d'allonger outre mesure notre récit, en racontant en détail les agissements de la Révolution envers ces pauvres religieuses bénédictines, avant de les jeter dans les rues de Brive.
Seulement, nous tenons à reproduire ici deux requêtes inédites jusqu'à ce jour, et sans date, que les religieuses de Bonnesaigne se virent dans la nécessité d'adresser à l'Assemblée nationale peu de jours
— 373 —
après la déclaration de l'abbesse à M. de la Bastille (Y. Rulletin,. Brive, janvier-mars 1901, p. 155, T. XXIII.)
Nous devons ces deux pièces intéressantes à l'inépuisable obligeance de M. l'abbé Poulbrière, qui a bien voulu en enrichir notre travail au détriment des Bulletins scientifiques du département auxquels il les destinait.
Pour bien saisir la raison d'être de la première requête et la classer à son rang dans l'ordre des événements qui se précipitaient en France, il faut nous rappeler que le dépouillement du clergé battait déjà son plein. Les fameux décrets deY abolition des dîmes de toute nature (du 4 au 11 août 1789) ; de la suppression d'une maison religieuse dans toute municipalité où il en existerait deux (12 février 1790), et de la suppression des voeux monastiques solennels et des maisons où ils se prononçaient, avaient déjà leur entière application (19 février 1790).
ART. 2. — Tous les individus de l'un et de l'autre sexe, existants dans les monastères et maisons religieuses, pouvaient y rester ou en sortir, en faisant toutefois leur déclaration d'option devant la municipalité du lieu. S'ils sortaient, il devait être pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable ; il devait aussi être assigné des maisons spéciales où se retireraient les religieux qui ne voudraient pas forfaire à leurs engagements.
Naturellement, moyennant la pension qu'on allait leur assigner, sauf à ne pas la leur payer, les biens de ces communautés religieuses étaient et demeuraient confisqués au profit de la nation.
— 374 —
Enfin, le 26 février 1790 avait paru le décret en question, réglant la pension de chacun de ces pauvres spoliés.
Les religieuses de Bonnesaigne étaient atteintes par tous ces décrets ; elles se trouvaient pensionnées.
Elles vont maintenant nous dire ce qui leur arriva. Leur PREMIÈRE REQUÊTE à l'Assemblée nationale doit se placer après le 13 mai 1790.
Requête des Bénédictines de Bonnesaigne (Brive) à l'Assemblée nationale, pour se faire payer par le district le traitement à elles alloué (et dont leur fermeté religieuse leur valait le refus) :
A Messieurs les Représentants de la Nation MESSIEURS,
Les religieuses de la communauté de Bonnesaigne, de la ville de Brive, district de Brive, département de la Corrèze, ont l'honneur de supplier l'Assemblée nationale de vouloir bien prendre en considération la triste situation où elles se trouvent, et de donner des ordres pour qu'on leur rende la justice qu'elles réclament ; elles vont exposer avec la franchise et la simplicité que leur prescrit leur état et la conduite qu'elles ont tenue, et les prétextes dont on se sert pour leur refuser le traitement que les lois leur assignent, afin que les Représentants d'une Nation sensible, loyale et généreuse, à laquelle elles se font gloire d'appartenir, puissent juger avec connaissance de cause si leurs plaintes et leurs réclamations sont fondées.
Le 9 avril dernier, Messieurs les commissaires de la municipalité de Brive se sont rendus à la communauté de Bonnesaigne pour y assister à l'élection d'une supérieure et d'une économe, et y recevoir la déclaration des religieuses sur l'intention où elles étaient de vivre dans leur communauté ou de se séparer et de quitter leur couvent.
Toutes ont répondu unanimement qu'elles confirmaient,
— 375 —
en tant que de besoin, Mme Green de Saint-Marsault pour leur supérieure ;
Qu'elles étaient résolues de pratiquer jusqu'au dernier moment de leur vie la règle qu'elles ont librement embrassée lors de l'émission de leurs voeux et de vivre et mourir dans leur cloître, ainsi qu'elles y sont autorisées par les décrets de l'Assemblée nationale.
Elles ont ensuite adressé une pétition à Messieurs les administrateurs du département de la Corrèze pour obtenir la fixation de leur traitement.
Dans sa séance du 8 du mois de mai dernier, le département a fixé le traitement :
Pour Mme de Saint-Marsault à la somme de 7991. 11 s. 11 d. Pour chaque religieuse de choeur à celle de 5421. 40 s. 6 d. Et pour chaque soeur converse à celle de 271 1. 20 s. 5 d.
Ensuite le département déclare comme non avenu tout ce qui a été fait, à raison de la nomination d'une supérieure et d'une économe ;
Arrête qu'avant d'être payées des sommes ci-dessus à elles allouées, elles nommeront de nouveau en se conformant aux décrets et suivant les formes prescriptes, en présence du Maire et d'un officier municipal de Brive, une supérieure et une économe qui accepteront la commission, si mieux n'aiment abandonner la vie commune.
Le 13 du même mois de mai, Monsieur le,Maire de la ville de Brive, sur une déclaration de Monsieur le Procureur syndic du district de Brive, s'est présenté à la dite communauté de Bonnesaigne ;
A notifié à Madame Green de St-Marsault l'arrêté du Département ; l'a priée de faire rassembler toutes les religieuses de choeur et les soeurs converses qui composent la dite communauté, pour leur faire lecture dudit arrêté du département et les interpeller de s'y conformer en nommant une supérieure, ou de se séparer et de quitter le couvent pour recevoir chacune individuellement leur pension :
A quoi ladite dame de S'-Marsault a répondu qu'elle était
— 376 —
dans la résolution de remplir les obligations qu'elle a contractées par ses voeux ;
De vivre et de mourir dans l'état qu'elle a embrassé ;
Qu'elle ferait comparaître toutes les religieuses de la communauté, excepté celles qui sont détenues dans leur lit, pour cause de maladie ;
Qu'à l'égard de l'élection d'une supérieure, elle était légalement, canoniquement nommée abbesse perpétuelle ; qu'elle ne croyait pas que sa conscience lui permît de renoncer à une juridiction toute spirituelle qu'elle tient de l'Eglise, et dont elle ne peut être déchargée que par l'Eglise ; qu'en conséquence, elle ne participera en rien à l'élection à laquelle il va être procédé ; qu'elle regarde cette élection comme contraire à ses voeux et aux règles de son ordre.
Elle a de plus déclaré vouloir rester dans la maison ;
Et de suite sont entrées dans la salle du parloir toutes les religieuses, excepté deux religieuses de choeur et une soeur converse qui étaient détenues dans leur lit. Il leur a été fait lecture de l'arrêté du département. Elles ont répondu d'une voix unanime qu'elles persévéraient dans la déclaration qu'elles avaient déjà faite, le 9 avril dernier, de ne reconnaître pour leur supérieure que Madame de S'-Marsault leur abbesse, qu'elles avaient nommée conformément aux décrets du 25 février dernier ; qu'elles faisaient la même déclaration pour Madame Duprat qu'elles avaient nommée en même temps leur économe ; qu'elles ne voulaient point procéder à d'autre nomination.
On leur a répondu que la nomination devenait nulle par défaut d'acceptation.
Elles ont persisté à déclarer qu'elles ne pouvaient pas en faire d'autre.
Quant à Madame Duprat, elle a déclaré accepter comme elle a déjà fait sa nomination.
Toutes les religieuses ont de plus déclaré de nouveau qu'elles entendaient vivre et mourir dans la maison où elles avaient fait leurs voeux.
Voici l'exposé' exact et sincère de tous les faits. Les reli-
— 377 —
gieuses de la communauté de Bonnesaigne ne conçoivent pas comment on peut leur refuser le traitement qui leur a été alloué, sous prétexte qu'elles n'ont pas voulu se conformer aux lois; elles s'y sont conformées autant qu'il a été en leur pouvoir.
Le but que s'est proposé l'Assemblée Nationale, en ordonnant que toutes les communautés religieuses, sans exception, éliraient une supérieure en présence du Commissaire de la Municipalité du lieu où elles sont situées, a été, sans doute, d'assurer leur liberté.
En ordonnant une supérieure de leur choix, les religieuses de Bonnesaigne se sont conformées à la lettre de la loi, puisqu'elles ont élu une supérieure ; elles en ont rempli l'esprit, puisqu'elles ont fait librement et volontairement le choix de Madame de Saint-Marsault, pour continuer de les gouverner.
Elles déclarent de nouveau ne vouloir point reconnaître d'autre supérieure qu'elle.
Elles sont très persuadées que les Représentants de la nation ne souffriront pas que, privées des biens qui leur avaient été donnés par les pieux fondateurs de leur maison, ou qui leur avaient été acquis du produit de leur dot, de celles des religieuses qui les ont précédées, et de leurs économies, elles soient réduites à la dure alternative de périr de faim et de misère ou de violer les engagements sacrés qu'elles ont contractés au pied des autels, en sortant de leur cloître.
Elles espèrent qu'ils voudront bien donner des ordres pour que le district de Brive leur paie, sans aucun délai, le traitement qui leur a été assigné ; elles ne cesseront d'adresser des voeux au ciel pour la prospérité de leur patrie et le succès des travaux de leurs Législateurs.
— 378 -
§ VI. — ADRESSE DES RELIGIEUSES DE BONNESAIGNE
(A BRIVE) A L'ASSEMBLÉE NATIONALE (1791)
Cette SECONDE REQUÊTE, également sans date, n'a pu partir de Brive qu'après le mois de mars 1791.
Il y est en effet question de la constitution civile du clergé et de l'évêque constitutionnel de Tulle.
Or, le décret de la constitution civile du clergé, voté par l'Assemblée constituante le 12 juillet 1790, sanctionné, à regret, par Louis XVI, le 26 décembre
1790, ne fut mis-à exécution que dès janvier 1791 ;
Et Brival, curé de Lapleau, nommé évèque par le corps électoral de la Corrèze, le 20 février 1791, après que Mgr de Rafelis eût refusé la prestation du serment, ne fut installé que le 17 mars 1791. Et après avoir fait du palais épiscopal un club où se tinrent désormais les réunions des Amis de la Constitution, et supprimé les paroisses de Saint-Julien et de Saint-Pierre, il partit pour Paris afin de se pourvoir, auprès de Talleyrand, évêque d'Autun, de la confirmation et de l'institution canonique pour procéder à l'ordination, ou plutôt au massacre de six prêtres.
Pour ces deux raisons, les religieuses bénédictines n'ont pu écrire qu'après les premiers trimestres de
1791. Bien plus, d'après le contexte même, elles n'ont écrit qu'en octobre 1791.
Pour bien comprendre les motifs de leur requête, il faut nous rappeler deux choses :
1° La publication de la constitution civile du clergé fit grand bruit, jusque dans les chaires catholiques;
— 379 —
2° La loi spoliatrice qui atteignait les maisons de femmes laissait encore à ces dernières, jusqu'à nouvel ordre, la jouissance du cloître, d'un jardin et de l'église de leur communauté.
C'était encore beaucoup trop.
Il fallait à tout prix trouver un prétexte pour les en déloger. Ecoutons celui qui fut cause des déboires qui atteignirent encore nos pauvres religieuses déjà si réduites. L'adresse, qu'elles se crurent obligées d'adresser à l'Assemblée, nous dira tout ce qui se passa dans leur pauvre église, à l'instigation surtout du curé intrus de Saint-Martin de Brive et du Massacreur de la Solane.
« adresse à l'Assemblée Nationale
« Messieurs,
« Les religieuses de la communauté de Bonnesaigne de la ville de Brive pénétrées de la plus grande douleur, osent réclamer la justice de l'Assemblée Nationale relativement à une circonstance peut-être unique dans le royaume, et qui les prive des seules consolations que puissent recevoir des filles dévouées aux divins exercices de la religion.
« Depuis plus d'un mois on ne célèbre plus la messe chez elles ;
« La porte extérieure de leur chapelle est murée sans qu'aucun prêtre puisse y pénétrer ;
« Le S* Sacrement enfermé dans cette église ne reçoit point d'hommages ;
« Les soins de simple propreté sont refusés au respectable objet de notre culte et de nos adorations ;
« Les espèces sont exposées à se corrompre par le laps du temps, le S' Ciboire dans le tabernacle de leur église en est entièrement garni ; peut-être même va-t-il devenir impossible d'en faire la consommation, vu le danger que le métal
— 380 —
qui les renferme n'ait eu sur elles quelque influence ; peutêtre même que les espèces venant par un trop long espace de temps à tourner en une corruption totale, les religieuses de Bonnesaigne seraient exposées à perdre le précieux dépôt qui fait en ce moment l'objet de leurs larmes et de leurs sollicitudes, autant que celui de leurs adorations.
« Depuis la même époque, elles n'ont aucune communication avec leurs confesseurs, par la crainte où elles seraient de s'exposer et de les exposer eux-mêmes.
« Voilà donc une maison religieuse entière, à qui les secours de la religion sont enlevés : ils sont trop précieux pour les religieuses de Bonnesaigne. et trop respectés par l'Assemblée Nationale, pour qu'elles puissent craindre de ne pas rentrer incessamment dans le libre exercice de leur religion, et de l'état qu'elles ont embrassé ; objets pour lesquels leur premier sacrifice serait trop peu de chose, si celui de leur vie même n'était pas tous les jours offert à l'Eternel.
« Fortifiées par la confiance que leur donne une si belle cause, elles supplient l'Assemblée Nationale de vouloir bien entendre la simple exposition des faits :
« Vous avez décrété, Messieurs, le treiz mai dernier, que les églises appartenant à des sociétés ou congrégations particulières seraient fermées, ou plutôt qu'on y aurait prêché contre la constitution civile du clergé ; ce qui veut dire que celles où on n'aurait pas prêché resteraient ouvertes.
« Il est notoire qu'on n'a pas prêché dans celle des religieuses de Bonnesaigne. Elles devaient donc être exemptées aux termes du décret du 13 mai de la loi portée par ce décret contre les églises où l'on aurait prêché contre la constitution civile du clergé.
« Cependant l'arrêté du directoire du département de la Corrèze, en date du trois juin, qui ordonnait aux municipalités de faire fermer les portes des chapelles des communautés, afin que l'office divin n'y fût plus célébré publicniement, s'étendit jusqu'à elles et leur fut signifié.
« Elles crurent devoir obéir à l'ordre qui leur parut ne devoir être que momentané, puisque le décret du 13 mai leur
- 381 —
était favorable, dès que l'on n'avait pas prêché chez elles ; elles se soumirent cependant et firent, ainsi que la communauté de Ste-Ursule qui est à Brive, fermer leur église qui est restée constamment fermée à la clef jusqu'au dix août ; et tous les jours, et à chaque messe le sacristain ouvrait la porte au prêtre qui venait y célébrer l'office, et la refermait exactement ; cela est si vrai que quelques proches voisins, très âgés ou infirmes, avaient obtenu de la municipalité la permission d'entrer; en conséquence de cette permission, le sacristain reçut ordre des religieuses de ne laisser entrer que des personnes désignées par la municipalité.
« Les choses restèrent dans cet état jusqu'au dix août que les habitants de la ville et sans doute ceux du quartier, fatigués d'aller chercher loin la messe qu'ils étaient accoutumés d'avoir tous les jours, à la même heure, dans cette église, s'attroupèrent à la porte et forcèrent le sacristain à les laisser entrer.
« Les religieuses de Bonnesaigne firent avertir la municipalité de ce qui venait de se passer ; la firent inviter même à mettre des gardes à la porte de leur église, ne voulant en rien être responsables des événements ; la municipalité n'y mit aucune force, et leur fit répondre qu'elles fussent tranquilles.
« Le lendemain, onze, le même événement eut lieu, ainsi que le douze, jour de Sl6-Gaire qui est une fête de leur maison. Il ne se passa rien à l'office du matin de ce jour-là, où le S' Sacrement est exposé à la messe.
« Il est d'usage que l'on donne la bénédiction, le jour de Sainte Glaire à l'issue des Vêpres.
« Les religieuses, au moment du Magnificat, furent interrompues par un bruit horrible dans l'église. Elles avaient vu venir un prêtre autre que leur aumônier, ainsi que c'est l'usage, dans presque toutes les maisons religieuses, d'inviter des prêtres étrangers les jours de solennité.
« A ce bruit effroyable, les religieuses cessèrent Vêpres ; la peur s'empara de toutes les têtes ; nombre de religieuses coururent à la sacristie et apprirent que ce bruit était oc<;aT.
oc<;aT. 3-3
— 382 —
sionné par l'apparition subite de Ursidon, curé constitutionnel de Brive, qui, d'abord, paru seul dans l'église, était ressorti, et rentré l'instant d'après suivi de deux officiers municipaux ; que tous ceux qui étaient dans l'église, et même dans la rue, criaient, les uns effrayés, les autres choqués du scandale que Ursidon avait occasionné.
« Le bruit et cet effroi s'étant communiqués dans la maison, les uns criaient, d'aulres pleuraient, d'autres se trouvaient mal. On criait du dehors que l'on avait été chercher la garde. C'était enfin un trouble affreux.
« Pendant tout ce vacarme, les officiers municipaux dressèrent un procès-verbal, dans la sacristie, dont les religieuses n'ont eu aucune communication et, le procès-verbal achevé, tout le monde de se retirer.
« Leur aumônier continua, les jours suivants, de leur dire la messe, et le public continua d'entrer dans leur église, le sacristain n'ayant pas une force suffisante pour l'empêcher.
« Le 14 cependant la municipalité de Brive rendit une ordonnance qu'elle fit afficher el publier dans sa forme, portant une amende de 10 francs à chaque particulier qui forcerait les portes des dites églises el une de 50 francs aux religieuses si elles laissaient entrer toute autre personne que leur aumônier. Copie de cette pièce est jointe ici et numérotée n° 1.
« Elle leur fut signifiée le 16 août, ayant précédemment fait avertir la municipalité de ce qui s'était passé, et lui ayant fait connaître l'impossibilité où elles étaient de repousser les forces du dehors ; elles avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir.
« Mais après cette signification, elles écrivirent sur le champ à la municipalité pour lui faire sentir de nouveau l'impossibilité où elles étaient de tenir leur porte fermée, si de son côté elle n'empêchait pas le public de la faire ouvrir. Dans cette même lettre, elles demandaient justice de la vérité déplacée, vu que le curé constitutionnel de Brive avait fait dans leur église, le 12, le scandale qui avait occasionné l'effroi et le vacarme pendant l'office.
— 383 —
« Le 17, au lieu de recevoir justice, elles apprennent que le département vient de publier une délibération qui ordonne, non seulement que la porte extérieure sera fermée, mais même qu'elle sera murée, et en conséquence de cette délibération, on place des ouvriers, sans leur aveu et sans les avoir prévenues, et la porte fut murée.
« Depuis cette époque, elles sont dans les larmes par la privation des exercices religieux pour la pratique desquels elles ont fait le sacrifice de leur vie entière.
« Cette pièce est jointe ici sous le n° 2, et attendu qu'elle renferme plus d'une inculpation contre les religieuses de Bonnesaigne, elle exige ici quelques explications.
« Observent-qu'elles,
« 1° Les religieuses de Bonnesaigne ne devaient point être soumises à l'exécution de l'arrêté du département, puisqu'il est notsire que l'on n'a pas prêché dans leur église, depuis un très long temps, et que les ternies du décret du 13 mai ne prononçaient la fermeture des portes qu'à l'égard des églises où l'on aurait prêché contre la constitution civile du clergé.
« 2° Que s'étant, nonobstant celte loi du 13 mai, soumises aux délibérations de la municipalité el du département, puisqu'il est de notoriété publique que leur église a constamment été fermée, tant que le public ne s'est point porté à en forcer l'ouverture, c'est donc très faussement qu'on leur suppose le motif d'avoir voulu troubler l'ordre public, puisqu'au contraire c'est pour contribuer à le maintenir qu'elles se sont soumises aux délibérations de la municipalité et du département qu'elles auraient pu éluder d'après les termes du décret du 13 mai ; que c'est tout aussi faussement qu'elles sont accusées d'avoir permis l'entrée de leur église puisqu'elles n'avaient aucun moyen de l'empêcher.
« 3° Que c'est encore très faussement que l'on voudrait donner le titre de fonctionnaire public au prêtre qui leur a donné la bénédiction le jour de Sainte-Claire. Les décrets ayant suffisamment fait connaître ce qu'ils entendaient par cette qualification, on ne peut l'appliquer à un particulier qui vient, un jour dans la semaine, donner la bénédiction
— 384 —
dans une chapelle religieuse, surtout un jour où il n'est que fêle pour elles.
« 4° A l'égard du renvoi à la municipalité pour prononcer sommairement sur les propos injurieux qui peuvent avoir élé tenus par les pensionnaires de ladite maison de Bonnesaigne, je dirai que cet arrêté, lui-même, prouve tout seul la futilité de cette accusation.
« Les religieuses, en effet, dans le moment d'un pareil vacarme ont entendu des cris au dehors de leur maison et au dedans il est vrai ; mais elles attestent que dans un bruit aussi tumultueux, il était impossible de distinguer ni les voix, ni les expressions des personnes qui criaient. Elles sont loin de croire que leurs pensionnaires ont tenu des propos injurieux el déplacés ; les dites pensionnaires en ont fait la dénégation la plus formelle.
« Mais dans la supposition même que quelques enfants, dans le moment d'un semblable désordre eussent tenu quelque propos que les religieuses désapprouveraientinfiniment, serait-il juste, raisonnable et légal de les en rendre responsables, et pour les en punir de les priver de satisfaire à leur devoir le plus cher el le plus sacré, celui d'entendre la messe les jours prescrits par l'Église ?
« Mais, leur dit-on, vous pouvez faire entrer votre aumôrnier par les portes intérieures par où il se rendrait à l'église pour y dire la messe. — Mais ce moyen est absolument opposé à leurs statuts, à l'usage constant de toutes les communautés religieuses ; il serait de la plus grande indécence, comme de la plus grande importunitô, et finirait par dégénérer en abus. D'ailleurs la messe n'est pas le seul objet pour lequel une maison religieuse ait besoin d'une communication extérieure avec leur aumônier ; ne leur serait-ce point une dérision de leur proposer de faire entrer leur aumônier pour leur facilité et à leurs pensionnaires le recours au tribunal de la pénitence ? Mais lors même que le moyen serait regardé comme praticable, ce qui est impossible, il deviendrait dangereux d'après les menaces faites par t/rsido??,curé constitutionnel de Brive, dans la lettre qu'il
— 385 —
écrit, aux religieuses de Bonnesaigne, le 19 août, pour leur donner communication d'une ordonnance de M. l'évêque constitutionnel de la Corrèze.
« Les décrets de l'Assemblée Nationale devaient laisser aux religieuses de Bonnesaigne le libre exercice de leurs devoirs religieux ; mais elles ont trop appris combien les interprétations mensongères ont d'effet sur les hommes méchants ou peu éclairés pour s'exposer à donner la moindre prise à sa malignité.
ee Elles joignent ici l'ordonnance de l'évêque constitutionnel du département, côté n° 3, ainsi que la lettre menaçante du curé constitutionnel de Brive, cotée n° 4.
« Les religieuses de Bonnesaigne espèrent que l'Assemblée Nationale voudra bien prendre en considération l'objet de leur réclamation ; et ordonner l'ouverture de la porte de leur église, soit par un décret qui supprimerait la délibération rendue le 16 août par le département. — Elles ne peuvent s'adresser ni à la municipalité, ni au district, ni au département qui tous seraient juges et participants, ayant tous trois contribué à la délibération qui fait l'objet de leur peine. Elles s'étaient adressées à M. Delepart, Ministre de l'Intérieur; il a, dit-on, demandé au département, le motif qui a fait murer les portes de cette église, mais il n'a donné aucun ordre qui révoque celui du département, ni aucun conseil aux religieuses de Bonnesaigne. Le temps s'écoule cependant et les choses restent dans le même état.
« Mais ne connaissant point de tribunal où elles puissent s'adresser pour obtenir justice, elles espèrent que l'Assemblée Nationale voudra bien la leur rendre, et ne point douter de leur soumission à la loi qui n'est point incompatible avec la liberté de conscience et d'opinion que l'Assemblée Nationale a également décrétée.
« Si le décret qu'elles sollicitent ordonnait que l'office se fit chez elles, portes closes, elles s'y soumettraient comme elles l'ont fait à la délibération du département. Mais la municipalité seule pourrait le faire exécuter ; elles n'ont, elles le répètent, aucun moyen d'empêcher le public de forcer
— 386 —
la porte de leur église. Mais elles déclarent aussi que n'ayant aucune raison pour désirer que leur office soit public, elles n'ont et n'auront jamais la volonté de faciliter l'entrée de leur église aux personnes du dehors ; l'Assemblée Nationale seule, peut apprécier les inconvénients, ou la nécessité, de permettre ou de défendre l'entrée des églises particulières. »
l VU. — FIN DE LA COMÉDIE
Sans nous attarder plus longtemps sur les misères qu'eurent encore à subir nos pauvres bénédictines, durant la période révolutionnaire, disons tout de suite la fin prévue de cette macabre comédie.
Une fois qu'elle les eût fermées entre quatre murailles, sans aucune communication avec les personnes de la ville qui auraient pu leur apporter du dehors une parole de consolation et d'encouragement, la Révolution eut l'amabilité d'envoyer ses séides visiter nos malheureuses recluses dans l'intérieur de leur couvent. C'est ce qui résulte d'un billet, également sans date, publié au Bulletin de Brive, que l'abbesse de Bonnesaigne adressait au chanoine Etienne-Jean Sapientis, de Brive :
« Que M. l'abbé Sapientis soit bien tranquille sur les belles figures qui ont paru ce soir au parloir de Me l'abbesse. Quoiques redoutables, ils ne lui ont point fait sentir leurs rigueurs. Leur démarche était pour poser les scellés sur les archives. Après avoir rempli leur objet, ils ont tiré leur chapeau et .ont laissé bien contente Me l'abbesse qui prie M. l'abbé de venir la voir ce soir ou demain, à l'heure qui -lui sera la plus commode. Me l'abbesse présente à M. l'abbé le bonsoir.
DE BONNE SAIGNE. »
— 387 —
Et M. le supérieur de Servières ajoute :
ee C'est l'abbesse, Mme de Saint-Marsault, qui signe ainsi du nom de son bénéfice, comme elle appelle ailleurs son èvêque : ee M. de Limoges ». Le billet est de sa main, bien qu'elle s'y mette- à la troisième personne, ainsi qu'on fait aujourd'hui dans une carte. » (Y. T. XXIII, lrc livr. 1901.) Nous avons vu que deux de ses devancières, Adelaïs et Blanche II de Ventadour, en faisaient autant et signaient des divers noms de Bonnesaigne : du Val-Tuve, de Podiomaris.
Durant ces odieuses tracasseries et ces sinistres visites, toutes ces saintes filles, dont nous venons de transcrire les noms avec une respectueuse émotion, furent immuables comme des rochers au milieu de la tourmente. Résistant d'abord aux séductions de la liberté, du bien-être, elles opposent ensuite, à l'injustice de la loi du serment, la fermeté et la force d'une conscience inébranlable et donnent ainsi un magnifique exemple d'attachement à leurs voeux et à celle qu'elles avaient choisie pour les conduire. Elles bravent même la mort avec la sérénité du courage chrétien ; et si la mort les épargne ce n'est pas qu'elles aient fui devant ses menaces.
Et quand, parcelle par parcelle, la spoliation fut complète, converses, religieuses et abbesse furent jetées dans les rues de Brive, ou dispersées dans leurs familles.
L'une d'elles pourtant, Mrae de Saint-Marsault, semble n'avoir jamais voulu guère s'éloigner des murs de Sainte-Claire qui lui rappelaient tant de souvenirs ! C'est à Brive, en effet, à l'Hospice, le jour de SaintThomas, l'apôtre intrépide de N. S. J. C., qu'elle mourut, le 21 décembre 1805.
— 388 —
Savoir si à cette heure suprême, elle ne fut pas assistée par deux autres religieuses, qui, également chassées de leur communauté de Coyroux, errèrent dans les rues de Brive jusqu'en 1850? C'étaient MmeE Duprat et Laroche. (Vie de S1 Etienne d'Obazine, p. M. Lansade, p. 226.)
Mme de Saint-Marsault put ainsi être le témoin attristé de la profanation de son abbaye et de la vente de ses biens.
Après la dispersion des religieuses, Sainte-Claire, ainsi que les maisons de Lamaze à Uzerche, le château de Saint-Angel, le séminaire de Brive et le grand séminaire de Tulle, servit à emprisonner les femmes; tandis que les hommes étaient détenus à Sainte-Ursule de Brive, à la prison d'Ussel, dans la maison Nayne à Uzerche et au collège de Tulle. (Scènes de la Révolu,- lion, par M. de Seilhac, p. 499.)
Quand, après l'orage, le calme fut revenu, la masure de Sainte-Claire, toujours debout, fut employée à différentes usages. Nous l'avons vue de nos jours, maison d'école tenue par les frères de la Doctrine chrétienne; plus tard, école laïque, tantôt de garçons et tantôt de filles.
Aujourd'hui restaurée, et appropriée à d'autres fins, c'est le gracieux Musée de la ville de Brive, si bien pourvu par les soins intelligents de M. Ernest Rupin, président de la Société Archéologique de la Corrèze dont le siège est à Brive.
Bonnesaigne de Brive avait vécu 33 ans.
Que devint Bonnesaigne de Combressol? La conclusion de cet ouvrage nous l'apprendra.
CONCLUSION
BONNESAIGNE DE COMBRESSOL
Que devint Bonnesaigne de Combressol?
Après le départ des religieuses pour Brive, le petit bourg de Bonnesaigne, que nous avons vu si vivant avec ses avocats, ses juges, ses huissiers, ses médecins, ses apothicaires, ses notaires, ses hommes de loi et de guerre, devint triste et dolent.
Les familles nobles ou bourgeoises, dont nous avons prononcé les noms dans le cours de ce récit, émigrèrent aussi à tour de rôle.
Une des premières disparues, avec le couvent, est la famille Sourzat, qui alla se fixer au Monteil, paroisse de Gollonges, tout en continuant à gérer les affaires que la communauté avait à surveiller dans la montagne. Je trouve, en effet, dans mes notes :
ee Les dames de Bonnesaigne, transférées à Brive, fondèrent par procuration le sieur Jean-François Sourzat, seigneur du Monteil, habitant le bourg de Collonges, Bas-Limousin, pour percevoir les revenus de l'abbaye de Bonnesaigne ».
Il finit par en devenir fermier, le 8 novembre 1773, avons-nous dit.
Le tribunal, la prison, les écuries, les vastes greniers d'abondance disparurent également.
— 390 —
A la place de toutes ces grandeurs déchues ee II y
a trente quatre pauvres chaumières », écrivait
l'abbé Laubie, il y a déjà longtemps.
Aujourd'hui, il parlerait autrement. De nos jours, en effet, grâce à l'aisance que les marchands de loile ou de drap de Bonnesaigne jirès Elboeuf, et les vignerons de Combressol près Talence y ont fait affluer, toutes ces pauvres chaumières, sur deux rangs, parfaitement restaurées ou refaites (en majeure partie du moins), couvertes en ardoises, montant en enfilade des prairies, le long du ressaut au bout duquel se dressait l'abbaye, forment, sans contredit, le plus beau et le plus important village de la paroisse de Combressol ; et plus d'un curé de campagne serait heureux de l'avoir pour chef-lieu de sa paroisse.
Gomme souvenirs de ses grandeurs passées, Bonnesaigne ne garda que ses foires antiques, uniquement établies pour faciliter les approvisionnements de l'abbaye, et que le bourg de Combressol a fini par lui enlever de nos jours.
L'église abbatiale et le couvent bénédictin, que l'on disait si délabrés en 1759, ont vécu autant que SainteGlaire de Brive; et, sans la Révolution, seraient encore debout. La preuve que le couvent et l'église de Bonnesaigne, si bien restaurés par les abbesses de Beaufort, Anne de Montmorin et Claudie de Lévy-Chaiius, n'étaient pas un danger perpétuel pour les personnes qui y entraient, c'est que le couvent continua à être habité après l'émigration des religieuses et que le culte fut toujours célébré dans l'église pour les 250 habitants de l'endroit.
Le vieux chevalier, oncle de l'abbesse Gabrielle
— 391 —
. de Châteauvert, ne voulut pas en effet quitter l'abbaye que sa nièce délaissait; et c'est là qu'il rendit son âme à Dieu le 1er mai 1765 et fut enterré dans l'église abbatiale même, au tombeau de son ancêtre que nous avons vu mourir à Bonnesaigne le 1er mai également, en 1665.
Bien plus, cinq ans plus tard, les enfants de famille continuaient à aller se faire bénir, le jour de leur mariage, dans l'église abbatiale :
ee En 1770, dans l'église abbatiale de Bonnesaigne, fut célébré le mariage de Joseph Mary, avocat au Parlement, du bourg de Saint-Angel, avec MarieMadeleine Despers, fille de maître Michel Despers, notaire royal, et de Demoiselle Marie-Anne Rosa de Mirambel, du bourg de Bonnesaigne » (déjà cité).
En 1781, il y avait toujours le saint Sacrement, avec lampe allumée.
La preuve encore de sa solidité, c'est que, parfaitement sur pied en 1793, lorsque fondirent sur elle les bandes déguenillées d'Ussel et de Meymac, ce fut dans les tombeaux de ses abbesses que les pieux habitants de l'endroit, prévenus à temps, coururent cacher les objets de piété que renfermait leur église, comme statues de N.-D. de Pitié, de saint Antoine, etc., dont nous avons eu occasion de parler ailleurs.
De même pour le monastère.
Parfaitement remis sur pied, après les guerres de religion, par trois grandes abbesses de Bonnesaigne, Mmes de Beaufort, Anne de Montmorin et Claudie de Lévy-Charlus, le couvent bénédictin, quoique abandonné, ne broncha pas, jusqu'aux jours terribles de la Révolution.
— 392 -
Je ne sais même si la dernière abbesse, Mmc Green de Saint-Marsault, ne rêvait pas d'un retour vers nos montagnes. Quoi qu'il en soit, elle veillait à ce que l'abbaye de Bonnesaigne fût entretenue, se trouvant, sans doute, dans l'impossibilité de restaurer SainteGlaire de Brive.
Nous avons vu, en effet, que dans le bail à ferme du 8 novembre 1773, Jean-François Sourzat ee demeurait chargé des meubles et effets qui étaient dans l'abbaye et dont il avait été fait état ; et à la fin du bail (1783), il devait en remettre une liève en bonne et due forme ».
Bien plus, lors des contestations qui surgirent en 1781, l'abbesse lui réclamait ee de très grandes indemnités en raison des diverses dégradations aux bâtiments de l'abbaye, dépérissements de fenêtres, vitres, planchers », etc.
De même le sieur Ninaud, qui lui succéda, devait laisser les bâtiments en bon état.
Le sieur Rixain avait vendu, en 1782, deux portails de l'abbaye, à son père, la somme de 24 livres ; mais il fallut en rendre un compte rigoureux à l'abbesse le 1er août 1788.
Donc, d'après ce qui précède, il est aisé de conclure que l'abbesse de Saint-Marsault ne perdait pas de vue l'abbaye de Bonnesaigne, dont elle avait soin d'imposer l'entretien à ses fermiers.
Quand arriva la bande des sans-culottes d'Ussel et de Meymac, ces bâtiments plus ou moins bien entretenus, malgré les clauses des baux à ferme, furent pillés, saccagés, démantelés, afin de faire disparaître les emblèmes séditieux de la tyrannie et de la
— 393 —
féodalité des ci-devant seigneuresses ; et les propriétés furent vendues au profit de la Nation, ainsi que le sol et les pierres de l'abbaye.
Le temps fit le reste.
Les belles boiseries en noyer, sculptées avec personnages encapuchonnés des religieux de l'ordre bénédictin, des abbesses fameuses de Bonnesaigne, furent vendues ou emportées chez des particuliers. L'ancien curé de Combressol, M. l'abbé Lafon, arriva assez tôt pour en recueillir quelques épaves et s'en faire un bureau de travail avec rétable et placard de toute beauté et d'une grande valeur. A la mort (1887) de cet homme de bien, M. Déguillaume, son successeur, l'acheta à ses héritiers. Qu'est-il devenu, ce bel ouvrage, à la mort prématurée de ce dernier (1890) ?
Le colosse, ainsi renversé, devint la proie des habitants de l'entour, qui s'abattirent sur lui semblables à des vautours affamés.
Ses pierres de taille sont parties, les unes pour Meymac, les autres pour Saint-Angel, Ussel et Neuvic. C'est ainsi, avons-nous dit, qu'en 1874 nous trouvâmes après un paysan de Palisse qui faisait sauter, à coup de pioche ou de massue, les dernières assises des colonnes ; travail de forcené qui devait l'amener à l'exhumation d'un crâne d'abbesse et des statues de saints ci-devant mentionnées.
Aujourd'hui, la ruine de Bonnesaigne est encore plus complète qu'en 1874. Lorsque nous y sommes revenu sur la fin de septembre dernier (1900), avant d'entreprendre la rédaction de ces notes, nous n'avons plus trouvé que des débris, des effritements de pierres formant une espèce de lumulus ee sur lequel on
- 394 -
cultive le seigle et le blé noir », ainsi que s'en exprimait avant nous l'ancien principal Laubie, le fondateur de l'école libre pour filles, tenue par les soeurs de Treignac au village de La Chapelle.
Les noisetiers, les pruniers, les pommiers et divers autres arbres à fruits y croissent aussi, à l'ombre d'un énorme tilleul planté, assurément selon l'usage du temps, en face de la porte de l'église abbatiale.
Seules quelques dalles de l'église, anciennes pierres tombales des abbesses, avec croix grossièrement taillées dans le granit, trop lourdes pour être emportées, gisent encore çà et là sur les flancs du tumulus.
Dans le village, au-dessus des linteaux des portes de fournils, quelques modillons, des têtes de moines à peine ébauchées, ce qui dénote leur âge avec l'enfance de l'art, apparaissent aux voyageurs comme pour leur dire : ee Voyez ce que nous sommes devenus ! Au moins, vous qui passez, ayez pitié de nous ! »
Voilà ce qui reste de Bonnesaigne : rien, rien, absolument rien, pas même la statue de N.-D. du Deveix, qui avait attiré tant de pèlerins à elle en 1874. Nous l'avons vainement demandée, lors de notre dernière visite. Elle avait disparu de la cahute où nous l'avions vénérée lors de sa découverte. A force de nous intéresser à son sort, on nous conduisit dans une maisonnette du milieu du bourg qui sert en même temps d'abri au compagnon de saint Antoine. Là on nous montra, sur un coffre branlant monté sur deux pieds, à côté de la palissade que ne doit pas franchir l'habillé de soie, un bloc informe, bariolé, tout mutilé. Pour le rendre plus intéressant, sans doute, on a fait disparaître, avec un pinceau d'épis
— 395 —
de seigle trempé dans un lait de chaux, les vêtements à couleurs voyantes, bleues et rouges, de Notre-Dame de Pitié ; et, avec un ciseau ou à coups de marteau, on a détaché du groupe les deux Marie qui assistaient la Sainte-Vierge à la descente de la croix de son divin Fils.
Ces deux Marie, également barbouillées à la chaux, sont aujourd'hui encastrées au-dessus de la porte d'entrée de la maisonnette en question.
On a cru bien faire et faire beau !
Mais que sont devenus le crâne abbatial et les deux statues de saint Antoine et de l'évêque crosse et mitre?
Personne n'a pu nous le dire !
O incurie ! ô temps ! ô moeurs !
Je le répète en finissant :
L'abbaye de Bonnesaigne a toujours été la plus dolente des maisons religieuses de nos montagnes. Commencée dans le trouble, elle a vécu dans le malheur, et a fini dans la désolation la plus complète.
Nous avons, en effet, de nobles restes de l'abbaye de Valette ;
Saint-Projet n'a jamais été aussi beau qu'aujourd'hui ;
Bonnaigue, quoique affecté en partie à des usages profanes, est toujours debout ;
Saint-Angel et Meymac sont encore là, dans toute leur splendeur, avec la demeure des anciens religieux et leurs églises vraiment monumentales.
Mais de l'abbaye villageoise, rien que les murailles grisâtres du jardin et. de l'enclos, à certains endroits, au Nord, vers le pré de la Salle, ce hautes, en effet, de près de dix mètres ».
— 3.96 —
Au moins, respect à ces vénérables débris, mutilés par la morsure du temps, mais surtout par la main barbare de l'homme !
Ils sont là pour dire, à ceux qui aiment à vivre de souvenirs : Là fut le jardin, ici la pêcherie, là le lavoir, plus loin la charmille ; à cet endroit, la terrasse ; à cet autre, la promenade des filles de saint Benoit, issues des plus illustres familles du Limousin et des provinces qui l'avoisinent !
En voyant voler en éclats, sur la voie publique, comme nous en fûmes un jour le spectateur attristé (1869), ces pierres blanchies par les siècles, il nous semblait voir entrer dans le néant les témoins silencieusement éloquents des événements les plus mémorables de notre histoire nationale !
Respect donc à ces pans de murs éventrés ! Ils sont là pour dire aux passants :
ee Hic abbalia Bonoesanioe fuit ! »
Bonnesaigne de Combressol avait duré près de onze siècles (730-1793).
Nos ancêtres faisaient grand et oeuvre qui dure !
Depuis le Concordat, le bourg de Bonnesaigne est simple village de la paroisse de Combressol.
Nous voilà de retour de notre voyage au long cours, dans les marais de Bonnesaigne, et prêt à nous embarquer de nouveau sur les flots plus limpides de la Basse-Luzège.
THOMAS BOURNEIX, prêtre.
Nonars, 14 juin 1901.
PIÈCES JUSTIFICATIVES
i
BREF DE PRIVILÈGE ACCORDÉ AUX RELIGIEUSES DE BONNESAIGNE PAR LE PAPE ALEXANDRE III (18 juillet 1165) (1)
Voici cet acte tel que l'a copié, à Bonnesaigne, en 1758, le R. P. Léonard-André Nadaud, frère de l'antiquaire et qui était alors professeur de théologie au couvent des Dominicains de Limoges, mais qui fut aussi prieur du même couvent cette même année 1758.
Il est superflu de faire observer que les noms mis entre parenthèses sont des corrections de Joseph Nadaud, empruntées pour la plupart à Baluze.
Les trois lettres : P.P. M., doivent signifier : In proprio monasterio.
« Alexander episcopus, servus servorum Dei, Dilectisin Christo filiabus, Jloe(en marge Jovitoe) priorissoe monasterii Beatoe Marioe de Bonnasagnia, ejus sororibus, lam proesentibus quàm futuris regulariter sustinentibus in P.P. M. [Religiosam Vitam eiigenlibus. apostolicum convenit adesse proesidium, ne alicujus temeritatis incursus aut eas a proposito revocet aut robur, quod absit, sacroe religionis infringat. Ea propter dilectoe in domino filioe, vestris justis postulationibus clementer annuimus, et proefatam ecclesiam in quà divino estis mancipatoe obsequis, sub Beali
(1) Ce Bref a été donné en note de l'article de M. l'abbé RoyPierrefite, sur Bonnesaigne, avec des lignes préliminaires (pp. 66-8 du T. XI, en 1861, du Bulletin de la Société Arch. et Hist. du [Haut] Limousin).
T. XXV. 3-4
— 398 —
Pétri et nostrà protectione suscipimus, et proesentis scriptis privilegio communimus, statuentes ut quascumque possessiones, quoecumque bona eadem ecclesia in proesentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, aut aliis justis modis, proeestante Domino, poleiit adipisci, firma vobis et his quoe post vos successerint illibala permaneanl. In quibus hoec propriis duximus exprimenda vocabulis :
« Ex dono Eblonis vicecomitis, uxoris et filium (il faut sans doute lire filiorumj ejus, silvam de Bonha Sanha ;
« Ex dono Geraldi, Lemovicensis episcopi, ecclesiam de Combressol ;
« Ex dono proedicti vicecomitis et aliorum virorum quatuor Carteyras, apud Combressol, duos mansos apud Fact, mansum de Chastra, mansum de Bor, mansum Devet, duas bordarias apud Peyralevada, villani de Chaborlinis, villam de Lerlii, las Escuras, duas Carteyras apud Genestinas, mansum del Noudet-Monteil apud Meymac, mansum de Albar cum Broa et cum Forest, mansum de Alba-Ega, quartam parlera decimoe de Ambrajac, bordariam Fabrorum, bordariam Majalaes, bordariam de Monte-Caprino, duas parles de Monteil et de Fonte, quidquid habelis in decimis de Palissis, Ecclesiam de Menoyre, sub annuo censu decem solidorum, quos annuatim ecclesioe débet, mansum de Clunac et fraus de Nova-Villa duos mansos apud Amariavas, apud Lanec unum, el unam bordariam, mansum et chapmansum de Melet et vineas. unum mansum apud Ampolangas, redditus nummorum et annonoe sicut vobis debentur.
« Decernimus ergo ut nulli omnino homini liceal proefatam ecclesiam temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare ; sed omnia intégra conserventur earum proquarum gubernatione et substentatione concessa sunl, usibus omnimodis profeclura, Salva sedis apostolicce auctoritate, et dioecesani Episcopi canonica justilia.
« Si qua igitur in futurum ecclesiastica sacculariave personna liane nostroe constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi realum suum congrua salisfactione correxit, poleslalis honoris sui dignitate careat, reamque se divino judicio exislere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sanctissimo
— 399 —
corpore et sanguine Dei et Domini Redemptoris Domini Nostri J. C. aliéna fiât, atque in extremo examine districtoe ultioni subjaceat.
« Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus, sit pax Domini Nostri J. C. quatenus et hîc fructus bonoe aclionis percipiant. et apud judicem districtum proemia oeterna pacis inveniant. Amen.
Ego Alexander, aposlolicoe ecclesioe episcopus ;
Ego Hubaldus (Hibaldus), presb. card. lit. S. Crucis in Jérusalem ;
Ego Joannes, presb. card. tt. S. Anastasioe (Auberl 1154 ; Baluze col. 488) ;
Ego Guill. presb. card. tt. S. Pétri ad Vincula ;
Ego Aubaldus (Hibaldus), Ostiensis Episcopus (Hugo, en 1154);
Gualterius, Albanensis episcopus ;
Ego Yacinthus, diac. card. S. Marioe in Comedin ;
Ego Odlo (Oddo), diac. card. S. Nicholai in carcere. tt. (Odo, 1154);
Ego Boso, diac. card. S.S. Cosmoe et Dam. ;
Ego Cinlhius, diac. caad. S. Adriani (Cincius Portuensis et S [oe] Rufinoe episcopus) ;
Ego Petrus, diac. card. S. Eustachii juxta templum Aggripinoe ;
Ego Maniedul (Manfridus), card. diac. S. Georgii ad vélum aureum.
Datum apud Claramonl. per manum
Hermantii S. R. E. subdiaconi et notarii, XXAIII kal. jul. indictione XIII, Incarn. Dominicoe anno M. C. LXV, pontifie, vero Domini Alexandri p.p. III an. sexto. .
II
BULLE D'UNION DU PAPE CLÉMENT VI
CLEMENS Episcopus servus servorum Dei Dilectis in Chrislo filiabus, abbatissoe et conventui monasterii Bonnesaigne ordinis s4i Benedicti, Lemovicensis dioecesis, salutem et apostolicam Benedictionem.
Proedictas virgines, quoe mundanis abdicatis illecebris, virginilatem suam Filio virginis, virgini devoventes, se
— 400 —
parant accensis lampadibus obviam ire sponso, tanto propensiori, consuevit apostolica sedes studio, proesertim in earum necessitatibus, prosequi charitatis, qnanto ipsoe majori propter fragililatem sexûs indigere favore ac suffragiis dignoscuntur.
Cum itaque, sicut petilio pro parle nostrâ, nobis nuper exhibila, contineat vos panem et vinum ad sufficientiam, propter vestri monasterii paupertatem non habealis, imo pane siliginis el vino usitalissimo (variante : lymphalissimo), non quidem ad decentem vestram sustentationem opporteat, propter penuriam et paupertatem dicti monasLerii contentari, nobis humiliter supplicatis ut parochialem Ecclesiam de Darnetto, aliàsDar?iez, Lemovicensis dioecesis ad collalionem venerabilis fratris nostri Episcopi Lemovicensis, ut asserlis, pertinentem, vobis et per vos monasterio vestro in sustentationem victûs et relevationem necessitatum vestrarum annectere et unire aucloritale apostolica dignaremur.
Nos IGITUR vobis et eidem monasterio, ut facilius valealis nécessitâtes hujusmodi supportare de alicujus subventionis auxilio, quantum cum DEO possumus procedere, volentes hujusmodi supplicalionibus inclinari, proedictam parochialem Ecclesiam cum omnibus juribus et perlinentiis suis VOBIS et per Vos eidem monasterio, auctoritate proedictà ANNECTIMUS perpeluo et UNIMUS, Ita quod, sedente vel dece dente ipsius Ecclesioe rectore qui nunc est vel quovis aliomodo ipsam Ecclesiam dimittente, per vos vel alium seu alios corporalem possessionem Ecclesioe ac Jurium et pertinentiarum ipsius libère ingredi el apprehendere ipsam Ecclesiam, libère in perpeluum retinere fruclus que in sustentationem necessitalum hujusmodi et aliàs in ulilitatem ejusmodi monasterii convertere valealis, dioecesanà loci vel cujuscumque allerius minime requisità,
RESERVATA TAMEN et ASSIGNATA PRIUS per eumdem dioecesanum de ipsius Ecclesioe proventibus pro perpetuo vicario instituendo canonice in eâdem Domino servituro, parlilione congruà ex quâ isdem vicarius valeat commode suslentari et alià Jura solvere aliaque sibi inconvenienlia onera supportare, non obslante quâcumque reservalione per sedem aposlolicam de ipsâ Ecclesiâ forsan facta, vel si aliqui super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi Ecclesioe vel aliis beneficiis ecclesiasticis, in illis partibus, spéciales vel gène-
— 401 —
raies dicloe Sedis vel Legatorum ejus litteras impetrarunt, eliamsi per eas ad inhibilionem, reservationem et dccretum vel alio quomodolibet sit processum, quas litteras et processus habitos per easdem et quoecumque inde sequla ad proefalam parochialem Ecclesiam, Nolumus non extendi : sed nullum per hoc eis quoad asseculionem Ecclesiarum ac beneficiorum aliorum proevidimus generari, seu quibus cumque privilegiis, indulgentiis ac litteris apostolicis generalibus vel specialibus, quocumque tenore existant, per quoe proesentibus non expresse vel lotaliter inserta effectus eorum impediri valeat quomodolibet vel differi, et de quo cujus que tola tenore habenda sit in noslris nunliatis specialis (?).
Nos insuper decrevimus irritum et aut si secus super his à quâvis auctoritate scienler vel ignoranter contigerit attentari. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam noslroe ennexionis, unionis, voluntatis el inslitutionis infringere, vel si, ausu temerario contraire. Si quis atlentare proesumpseril, indignalionem omnipotenlis et beatorum Pétri et Pauli aposlolorum sciât incursurum.
Datum ponlificalùs nostri anno tertio.
(10 de calendes juin = 23 mai).
III
PROCURATION POUR LIMOGES
In nomine Domini amen ; noverint universi et singuli hoc proesens publicum instrumentum visuri el audiluri, quod seplimo die introïtùs mensis Julii anno Domini 1348, indictione prima ponlificalùs sanclissimi Patris et Domini nostri CLEMENTIS divina providentià Papoe sexti, anno seplimo in proesentià Mei notarii et teslium infrà scriptorum personaliter constitutoe religiosoe Dominoe, Domina Almodia de St 0 Gallo abbalissa monasterii Bonoesanioe, Domina Almodia de Agno et Dna Clementia Del Repayre priorissoe claustrales dicti monasterii de Bonnesaigne, Dna Leoteria Del Leones sacristina dicti monasterii Bonoesanioe, Dna Galliana de Malomonte, Dna Blanchia de Gimello, DnaSoberana et Dna Delphina d'Anglars, Dna Margarita de Meymaco, Dna Margarita de Champieyx, Dna Aleyda d'Ayrains, Dna Guillelma d'Arsala, Dna Margarita de Confolente, Dna Margarita de Corsso,
— 402 —
el Dna Margarita de Santo-Dionisio moniales dicti monasterii Bonoesanioe, unà cum alio conventu proefati monasterii Bonoesanioe, asseruerunt el Dixerunt quod Dominus noster Ponlifex, sibi dictoe dominoe abbatissoe et conventui proedicto gratiam fecerat in forma speciali et super unione et annexione Ecclesioe parochialis de Darnetto eum diclo monasterio de Bonnesaigne prout in quibusdam litteris apostolicis dictoe suoe gratioe asseruit continere. Quoe proedicta domina abbatissa Bonoesanioe et alioe dominoe suprà neminatoe, unà cum alio conventu dicti monasterii Bonoesanioe fecerunt, constituerunt ac eliam ordinaverunt in capitulo Bonoesanioe, pulsatà campanà, cum toto collegio ut moris est simul congregalo, procuratores suos cerlos, veros, indubitalos, générales et spéciales, Videlicet
Venerabilem et scientificum virum magistrum Joannem [de] valibus jurisperitum, Dilectos in Christo, Dominum Petrum de Faito, Dominum Petrum des Manoudes, Dum Bernardum de Floreto presbyleros, Joannem Lajugia Domicellum el eorum quemlibet in solidum.
Itaque non sit melior conditio occupantis, sed quod per unum ipsorum procuratorum suorum ineeptum fuit per alium eorumdem prosequi et mediari valeat et finiri, videlicet ad prosequendum dictam suam gratiam de et super unione el annexione dictoe parochialis Ecclesioe de Darneto, cum dicto monasterio Bonoesanioe per Dum nostrum papam faclam et ad instituendum Bullas seu litteras apostolicas de el super dicta gratiâ confectas Venerando in Christo Patri Domino Lemovicensi Episcopo et omnibus aliis quorum interest seu intererit ad adipiscendum, inlrandum, et lenendum corporalem possessionem Ecclesioe suprà dictoe ac Jurium et pertinentiarum ejus dem, et ad agendum, deffendendum, proponendum, recipiendum, requirendum, supplicandum requestas el supplicationes faciendum, Judicis officium implorandum, litem contestandum, libellum seu libellas dandum et recipiendum, ponendum, articulandum potitionibus et arliculis respondendum, Jurandi de calumnià, el veritate dicendâ in animas dictârum constilutionum, et proeslandum quolibet aliud generis Juramentum, reconveniendum, replicandum, duplicandum, triplicandum lestes, litteras, instrumenta et quascumque alias probationes producendum et producloe per partem ad causam reprobandum, dicendum, quod in testes et dicta testium et beneficium,
— 403 —
restitutiones in integrum et absoluliones petendum et obtinendum, publicandumque interloculiones et definitivas sentantias, audiendum, appellandum et provocandum appellationes seu provocationes quascumque, intimandum et prosequendum apostolos petendum semel, pluries el instanter expressas requirendum, Jurejurandum que, easdem et adjudicatas recipiendum et super eis Jus petendum, Judicis seu commissarios eligendum et sibi suspectos recusandum, suspicionis causa allegandum et probandum et quascumque dilationes seu terminos petendum et exceptiones tam peremptorias quàm dilatorias proponendum, unum vel pluries procuratores et loco sui substituendum et institutos si nocesse sit revocandum, et ad proeestandum aliquem vicarium perpetuum idoneum ad proedictam ecclesiam regendum et gubernandum, necnon et omnia alià faciendum universa et singula quoe in proemissis et circà proemissa necessaria fuere, seu etiam opportuna quoe magis spéciale mandatum exigant ; quibus procuratoribus suis et substitutis ab ipsis et cujuslibet ipsorum dederunt dictoe constituentes plenam et liberam potestatem et mandatum spéciale proemissa faciendum ratum, gratum et firmum habentes dictoe constituenles et perpetuo habitum quidquid per dictos procuratores suos seu subslitutos ab ipsis et eorum quemlibet in solidum actum, procuratum et intimatum, proestatum, receptum fuerit, seu alio quomodolibet expeditum, et promiserunt dictoe constituentes sub spécial! hypotecà et obligatione bonorum suorum et bonorum dicti monasterii mihi notis subscripto pro omnibus quorum interest vel intererit, et proedictis procuratoribus suis et substitutis ab ipsis et ab ipsorum quolibet stipulante rem ratam habere. Judicio steli et Judicatum salvo cum suis clausulis universis relevantes dictoe constituentes sub hypothecà obligatione proedictis proediclos et procuratores suos et substitutos ab ipsis et ab ipsorum quolibet in solidum ab omni onere satis dandum et hoec omnia proemissa significaverunt et significari voluerunt dicloe constituentes omnibus quorum interest vel intererit per hoc pressens publicum instrumentum quod sibi dari petierunt et concedi meliori forma et consilio priori per me notarium subscriptum quod eis concessi.
Nos vero Almodia de Sancto Gallo humilis abbatissa monasterii Bonoesanioe unà cum conventu nostro hujusmodi constitutionem dictorum procuratorum nostrorum et omnia
— 404 —
alia proemissa et singula contenta in dicta procuratione, intimamus per hoc publicum instrumentum quod per subscriptum notarium scribi, grossari et publicari mandavimus et sigilli nostri numine fecimus apponere et Jurari in fidem et.textimonium proemissorum.
Acta fuerunt in capitulo proedicto pulsatâ campanâ, anno, Die, indictione et pontificatus proedictis, proesentibus Dilectis in X 10 Dno Petro de Peyre-Roham, Dno Joanne Dalhon et Dno Joanne Dabris presbyteris, et ago Joannes Belgerii clericus Lemovicensis dioecesis, publicus auctoritate imperiali Notarius Lemovicensis constitutioni procuratorum proedictorum unà cum nominatis teslibus, dictis die loco et anno indictione et pontificatus proediclorum, proesens inlerfui, recepi, scripsi et in liane formam publicam redegi, signoque solito signavi requisitus.
IV
F U L M I N A T I O NT DE LA BULLE D ' U N I 0 N
Décret de l'Èvêque de Limoges
Nos permissione Divina Lemovicensis Episcopus, nolum facimus universis quod decimâ die introilùs mensis Julii anno Dni 1348, apud Ortum, nostroe dioecesis Lemovicensis, ad nostram accedens proesentiam Joannes Lajugia Domicellus procurator el procuraloris nomine Religiosârum Dominârum et abbatissoe el conventus Monasterii de Bonnesaigne dictoe nostroe dioecesis Lemovicensis, dictus procurator per quasdam litteras quarum ténor inferius continetur nobis exibuit el proesentavit quasdam litteras aposlolicas quarum ténor inferius etiam continetur et nos dictus procurator et procuraloris nomine dictarum religiosârum dominarum cum instancià requisivit ac humililer supplicavit quatenus Juxlà tenorem dictarum litterarum apostolicarum taxalionem et assignationemportioniscongruoe pro capellanià seu perpétua vicarià et pro capello seu perpetuo vicario qui erit pro tempore. Ecclesioe de Darnelo nostroe Lemovicensis dioecesis de quâ fit menlio in litteris apostolicis suprà dictis etiam auctoritate noslrà ordinare pro eâdem dignaremur,
ATos autem volentes, sicul et decet, mandalis apostolicis
— 405 —
abedire fecimus per dilectum nostrum venerabilem virum Hugonem de Chalmels capellanum Ecclesioe de Usselo super valore annuo fructuum et emolumentorum Ecclesioe proedictoe de Darneto inquirere cum diligentià veritatem; audilâ que relatione ipsius Capellani de Usselo super proemissis, habita que deliberatione et consilio cum perilis ad laxationem et assignationem dictoe portionis pro capellano seu perpetuo vicario inslituendo in ecclesià suprà dicta processimus et procedimus in hune modum :
VOLUMUS enim et ordinamus quod capellania seu perpétua vicaria et capellanus seu perpetuus vicarius qui erit pro tempore in dicta ecclesià de Darnets, habeat in solidum Caminatam sive Chaminade ecclesioe de Darnets et hortum eidem Caminatoe contiguum et pratum ipsius Ecclesioe el talum emolumentum vertis sive del rerrouil, videlicetomnes obventiones et emolumenta quoe obvenient in dicta Ecclesià et in cemeterio ejusdem et alia quoe cumque quoe advertent dictoe Ecclesioe sive del verrouil pertinere noscuntur el pro emolumento dictoe vertis sive verrouil capellanus seu perpetuus vicarius qui erit pro tempore Solvet et Solvere tenebitur annuatim dictis religiosis Dominabus, Oclo libras commune currenles in patrià duntaxat ; VOLUMUS etiam et ordinamus quod residui fructus et emolumenta dictoe Ecclesioe de Darnets lam in bladis, denariis, decimis, censibus, reditibus ex aliis consistentibus inter dictas Dominas religiosas ex unà parte et capellanum seu perpetuum vicarium dictoe Ecclesioe qui erit pro tempore, ex alià oequaliter dividentur. Ilaque dictus capellanus seu perpetuus vicarius habeat mediatatem eorumdem et dictoe religiosoe Dominoe aliam mediatatem ; proemissa eidem capellanioe seu perpeluoe vicarioe ac capellano seu perpetuo vicario qui erit pro .tempore dictoe Ecclesioe, et proedicta depulata et assignata dictoe capellanioe seu perpeluoe vicarioe ac capellano seu perpetuo vicario qui erit pro tempore taxamus et assignamus pro congruâ portione fructuum et emolumentorum Ecclesioe supradictoe ; pro quâ portione isdem capellanus seu vicarius perpetuus qui erit pro tempore, solvel Jura, décimas et alia onera inlervenientia eidem ecclesioe de Darnets solus in solidum supportabit, et res proemissas illas decernentes etiam causa cognitâ, super proemissis auctoritalem nostram ordinariam interponimus ; decretum Jure noslroe Ecclesioe Lemovicensis et nostra nihilominus semper salvo.
— 406 —
Datum et actum proesente dicto procuratore dictarum Dominarum et sigillo nostro sigillatum in testimonium proemissarum, apud Nobiliacum dictoe nostroe dioecesis, die Decimâ in festo Beati Laurenti anno quo suprà.
V
PROCURATION POUR INSTALLER L'ABBESSE GREEN DE SAINT-MARSAULT
Raymundus Petiniaud, proesbiter sacroe facultalis Parisiensis, doctor theologus, socius Sorbonicus, Ecclesioe Lemovicensis canonicus, nec non officialis, vice gereus diocesis Lemovicensis, Judex et executor apostolicus, hâc in parte, a Sancla Sede specialiter commissus el deputatus, universis présentes litteras inspecturis, Salutem in Domino.
Bullas seu litteras apostolicas provisionis abbatioe regalis, monasterii vulgo Bonnesaigne nuncupati, ordinis sancli Benedicti et in civilate Brivensi, dioecesis Lemovicensis, nunc translati, vacantis per obitum Dominoe de Châteauvert d'Ussel, illius ultimoe abbatissoe nuper defunctoe, Dominoe Franciscoe Green de Saint-Marsault, in antea religiosoe professoe, monasterii nuncupati Sancli Correntini dioecesis Carnutensis, super nominalione Christianissimi Francorum régis, pretexlu concordatorum dudum inter Sanctam Sedem apostolicum et clarâ memorià Franciscum primum Galliarum regem, initorum a S. D. N. Papa Pio Sexto concessa sub data : Datum Romoe apud S. Petruum, anno Incarnationis Dominicoe, 1780, sexto kalendas aprilis, Pontificatus autem sexto, quarum quidem Bullarum nobis commissarum presentationem nobis factam per diclam, Dominam Franciscam Green de Saint-Marsault débita eum instanliâ requisili fuimus quatenus ad executionem earumdem procedere signavimus. Cui quidem supplicationi et inslanlioe, visis proedictis bullis abbatissoe regalis, vulgo de Bonnesaigne, et aliâ bullâ forma Juramenti nuncupatâ, ipsis que per nos apertis, postquam nobis constitit de ejus religionis zelo, vitoe munditiâ, honestate, morum spirilualium providentiâ et temporalium circumspectione, prius Juramento solito fidelitatis Sanctoe Sedi el Summo Pontifici débita secundum formam in diclis bullis contextam proestita ac fidei professione Juxlà
— 407 —
articulos Jampridem a Sancta Sede apostolica proposilos in manibus noslris cmissâ, audila et consentiente promotore generali, proefatas bullas executioni mandare Jussinus et ordinamus et per pressentes, auctoritate apostolica quà funginus, eas fulminavimus et fulminamus. Dictam que abbatissam monasterii vulgo de Bonnesaigne quamdiù vixerit, tenendam et gubernandam per présentes contulinus et donavinus, conferimus et donamus.
Et cum pro ulteriori earumdem bullarum executione ad pradictum monasterium conventuale de Bonnesaigne, has Iransferre ad proesens possumus, Dominum Baptistam Serre presbyterum, priorem commendatorium de Turre SanliAustrilii, canonicum Sancti-Martini, officialem Brivensem, proesentis dioecesis Lemovicensis per amanter precamur atque rogamus dictam dominam de Saint-Marsault in realem et canonicam possessionem dictoe abbatioe de Bonnesaigne Jurium que cum omnibus emolumentis fruclibus et privilegio ipsi annexis, adhibitis solemnilatibus in talibus assuetis. Sub oneribus tamen et clausulis in dictis bullis contentis et proesertim quod in dicto monasterio divinus cultùs nullatenus minuatur et a vassalis et subditis consuela obsequia exhibentur, custodiantur auctoritate apostolica, Jure nostro in omnibus Salvo. in quorum fidem.... proesentes litteras monu nostrà subscriptas unà cum nostro generali promotore et secretario nostro subscribi sigillique, quo in talibus utimur, Jussimus appositione muniri proesentibus Pelro Puimesji ei Michoele Broussaux hujusque urbis testibus notis ad proemissa vocatis et rogatis.
Datum Lemovicis anno Domini millesimo Septengentesimo oclogesimo, die vero duo decimà mensis decembris.
Signé ainsi : DUBART, chanoine, promoteur général; PÉTINIAUD, officiai général; MARBO, proepediti vice gerens ; PUIMESJE , BROUSSEAUX.
El plus bas : De Mandate, el signé Du BREUIL, secretarius, et scellé et contresigné en marge : SERRE, offîcialis, et MARGÙAR, A'e varielur.
— 408 —
VI
PROFESSION DE Melle DE VÉNIS A BONNESAIGNE (1706)
Au parloir des dames de l'abaie royalle de Bonnesagne diocèse de Limoges, le vingt-sixième jour du mois de janvier mil-sept cent-six avant midi, pardevant le notre royal soubsigné. présants les soussignés bas-nommés,
A esté présante et personnellement établie damoiselle Françoise de Venis soeur des Anges novice dans la présante abaie,
Laquelle en présance de messire François de Vénis, chevalier, seigneur des Aussines, la Fernoel (Fournol?) baron de Pierrelevade et autres places, et de noble dame Marie Henriette de S1 Martial ses père et mère résidants ordinairement en leur château des Aussines paroisse de S' Merd ; adressant ses parolles à illustre et révérande dame Catherine de Beauverger de Mongon, dame Abesse de la présante abaie luy a très humblement représanté que depuis quinze mois ou environ elle a esté honoruée de lhabit de novice dans cette Abaye pour le zelle quelle a eu et quelle conserve et conservera toujours de faire profession de religion et son salut ; estant âgée de dix huit ans, à ces fins elle a humblement suplié lad. Révérande dame abesse de la vouloir recevoir à profession ; à laquelle suplication lad. Révérande dame abesse inclinant, après avoir conféré avec les révôrandes daines professes en cette abaye : Marguerite de la Brousse (Prieure), Peyronne de Barmontet, Gabrielle Tineau de Vennac, Jeanne de Saunade, Peyronne Fraisse, Gabrielle de la Mothe, Marguerite de Lacour, Françoise de Servientis, Marguerite Duran. Marie de Laprade, Jeanne de S1 Aubin, Léonarde Lorte, Marianne De Fayac et Marguerite de Gibanel faisant lenlière communauté capitulairement assemblées au son de la cloche à la manière accouplumée pour délibérer au sujet de la profession de lad. soeur des Anges, Lad. Révérande dame abesse et les sud. dames inclinans à ce faire dessus après avoir vu pendan le temps dud. noviciat et au delà les bonnes qualillés personnelles de lad. soeur des Anges, la reçue comme la reçoit par le présan acte a profession, les formaliltés en ce cas requises gardées et observées pour estre nourrie et entretenue dans la présante abaye comme les autres dames de coeur, y faire et garder la règle pour ainsi et de mesme quelle y est à présan gardée, de
— 409 —
quoy lad. soeur des Anges a très humblement remercié lad. révérande dame abesse el susd. révérandes dames religieuses, et pour aider à len lre tien de lad. soeur des Anges, led. Seigneur de Marsilliac son père el lad. Dame de S1Martial sa mère de leur bon gré et vollonté solidèrement et conjointement renonçant a décision en déduction a eux donnée et attandre mesme lad. dame de S' Martial en puissance maritalle or ce touttes lois introduittes ou à produire en faveur des femmes, ont donné comme donnent par ces présantes à lad. soeur des Anges leur fille acceptante la somme de Trente livres de pansion viagère extinguible sur son décès à prandre et recevoir annuellement sur Jean Grandaud et François Mazaux leurs fermiers du village de la Fondilière paroisse dud. S' Merd, moitié au mois de septambre et l'autre moitié à la S' Luc et ainsi annuellement pendan la vie de lad. soeur des Anges leur fille sans qu'il soie besoin dautre mandement que la présante délégation donnée. Du tout ma este requis acte lequel ay concédé aux parties en présance de tous rattifiant juste ce que de besoin le contenu et promese dhabi de religion delad. soeur des Anges qui ne sert qu'une mesme foy, à ce présent Messire curé Antoine Dupuy S'' de S* Pardoux prestre docteur en théologie curé de Meymac et messire Jean Dufaure prestre curé de Perré et ont soubsigné lesd. parties
Sr C. de Beauvergier, Abbesse de Bonnesaigne ;
Sr Marguerite de la Brousse prieure
Sr Gabrielle Thinos, Sr de Barmontet
Sr Jeanne de Sonade, Sr Fraisse, Sr de la Molhe,
Sr de Lacour, Sr de Servienlis, Sr Durand, Sr de Ghauzex
Sr de S* Aubin, S1 Lorte, Sr de Faya,
Sr Dugibanel, Sr de Fornoël,
Marsilliat de Vénis. de Conros Marcilliac Soudeilles, Fayat, du Faure, Saint-Pardoux prestre, Laplène nre royal. Conlrollé à Meymac le 26e Janvier 1706, fol. reclo 24 n° 3 reçu onze sols LAPLÈNE
(V. Sigillographie, p. 418.)
— 410 —
VII
TARNAC-OBAZINE.— CELLE DES FRANCHES (V. Introduction)
Mémoire à l'abbé d'Obazine Joseph Green deSaint-Marsaidt
Mémoire instructif à sujet du droit de dixme que les curés de Tarnac ont de temps immémorial accoutumé de jouir el de percevoir sur le tônement appelle des Franches situé entre les villages de Chabane et du Parneix paroisse de Tarnac et cela selon toute apparence pour la desserte desd. villages que les agens ou ayant cause du seigneur abbé d'Aubazine actuel disputent, refusent même aujourd'hui à l'exposant qui prend la liberté de présenter son présent Mémoire aud. seigneur abbé, aux fins qu'il aye égard à la justice qui est due aud. exposant.
Il est à remarquer qu'anciennement il y avait une communauté de moines de l'ordre de Cytaux, à ce qu'on dit. établie aud. village de Chabanes, dans la suite des temps cette communauté fut réunie à l'abbaye d'Aubazine.- L'exposant n'en a d'autre époque que la tradition.
Lors de cette réunion les revenus de ces moines consistant en dixmes et renies furent aussi reunis à lad. abbaye d'A
ubasine.
Or ces moines en quitlant leur communauté de la Chabanes, selon toute apparence il fut convenu et réglé qu'on délaisserait aux sieurs curés de Tarnac la dixme dud. ténement des Franches pour la desserte desd. deux villages de Chabanes et du Parneix, l'un et l'autre confrontant led. ténement; de sorte que lesd. curés en avaient jouit de temps immémorial, tantôt par eux-mêmes, tantôt par convention entre les habitans, ainsi qu'ils certifient encore el de leur propre aveux : de sorle que lesd. curés de Tarnac avaient toujours joui paisiblement et sans trouble de la dixme dud. ténement, jusques environ 1720 et voici comment.
Environ cette dernière époque, un nommé Lajoubertye, du Bourg de Chamboulive se rendit fermier dud. abbé d'Aubasine, et lors de la récolte et que les habitans de Chabanes voulurent engranger les gerbes ils avertirent led. Lajoubertye pour venir prendre son droit de dixme ; ce dernier s'étant rendu sur les lieux exigea indistinctement toute la dixme ; Les habitans luy représentèrent alors qu'il n'avait
— 411 -
pas droit de dixme sur le ténement appelé des Franches, parceque luy dirent-ils, la dixme de ce ténement appartient au sieur curé de Tarnac, qu'ils la luy avaient toujours payée et entendu dire par leurs ayeux qu'elle appartenait aux sieurs curés de Tarnac et que c'était encore bien peu de chose en considération des peines et embarras que leur occasionnait la desserte desd. villages ; alors led. Lajoubertye, ainsi que rapportent lesd. habitans leur fit lecture d'une prétendue reconnaissance qui donnait sans exception la totalité de la dixme auxd. seigneurs abbés et que le ténement des Franches n'était pas excepté ; il entendait en percevoir la dixme également que du reste du village ; cependant les tenanciers persistèrent toujours dans leur refus en faveur de leur pasteur.
Led. Lajoubertye fermier voyant qu'il ne pouvait pas l'emporter sur l'équité et la bonne foy des tenanciers, fut interpeller l'autorité du seigr de Marcy seigr des Aussines leur maître (car il est à noter ici que tout le village de Chabanes qui a passé à présent au seigr de Fayat appartenait au seigr des Aussines comme propriétaire des fonds dud. village, et les habitans ne le travaillaient qu'en qualité de leurs métayers). Led. Lajoubertye ayant donc porté ses plaintes aud. seigr contre ses métayers sur le refus qu'ils luy avaient fait de la dixme dud. ténement, led. seigr en conséquence de l'exposé dud. Lajoubertye eut la complaisance de se rendre avec luy aud. village de Chabanes et ordonna à sesd. métayers de délivrer aud. requérant la dixme de tout le village même celle du ténement contesté. Les habitans représentèrent alors aud. seigr leur maître qu'ils avaient toujours vu et entendu dire à leurs ancêtres que la dixme de ce ténement appartenait au sieur curé de Tarnac. Mais led. seigr, sans avoir égard à leurs représentations, ordonna avec menace à sesd. méta3rers de délivrer sans aucune exception aud. fermier toute la dixme dud. village ; que la dixme dud. ténement des Franches n'appartenait point aux sieurs curés de Tarnac puisqu'elle n'était point exceptée par l'exposée dud. Lajoubertye. Les métayers alors intimidés par la crainte et par l'autorité de leur maître cédèrent aud. Lajoubertye la dixme dud. ténement. Il y a encore des habitans dans led. village qui ont vu et entendu tous les stratagèmes dud. Lajoubertye et l'ordonnance dud. seigr des Aussines faites à sesd. métayers.
— 412 —
Le sieur Gioux curé de Tarnac lors de ces voyes de fait et d'autorité se contenta, à ce qu'en disent les habitans de faire ses représentations aud. seigr des Aussines avec lequel il était très uni au lieu de faire ses oppositions et enquêtte en conséquence ; ou quo y que soit il ne fit d'autre démarche qui paraisse pour la revendication de ses droits, soit par négligence, soit par bonté ou par esprit de paix ou autrement sans égard aux droits de son bénéfice ; et ainsi la possession et jouissance que les curés de Tarnac avaient de percevoir la dixme sur led. ténement des Franches fut troublée et interrompue depuis lad. époque, c'est-à-dire environ 1720, jusqu'en 1758 ou l'exposant rentra dans sa possession et reprit sa jouissance.
On pourrait alléguer ici à l'exposant pourquoy avait-il tant tardé à rechercher ses droits sur led. ténement et à reprendre sa possession, puisqu'il était en possession de la cure de Tarnac en 1743 et qu'il n'a fait ses recherches qu'en 1758. A cela réplique l'exposant qu'il n'avait aucune connaissance du droit qu'il avait de dixmer led. ténement, que personne ne luy en avait donné de connaissance ny même n'en avait jamais entendu parler ; il est vrai qu'il était fort surpris de se voir obligé de desservir lesd. deux villages sans en retirer quelque rétribution, et il se disait àluy-même que peut-être les seigrs abbés d'Aubasine auraient délaissé par rruelque transaction quelques revenus aux sieurs curés de Tarnac pour la desserte desd. villages ; il demeura dans cette persplécité jusqu'à lad. année 1758 épocme où il commensa à rentrer dans ses droils sur la déposition et les éclaircissements que luy en donnèrent quelques habitans dud. village de Chabanes ainsi que l'exposant va le mettre au jour.
En 1758 environ le mois d'avril, les nommés Gabriel Meyjounial, Pierre Berbeyrolle, et Jean Barrette anciens tenanciers et habitans dud. village de Chabanes, vinrent trouver l'exposant et luy dirent que leur conseil de conscience leur avait dit qu'ils ne pouvaient se dispenser d'avertir l'exposant; que c'était mal à propos, et injustement qu'il ne jouissait point du droit de dixme qui luy était légitimement dû en qualité de curé de Tarnac dans le village de Chabanes sur le lônement appelle des Franches, qu'ils avaient eux-mêmes payée aux sieurs curés ses prédécesseurs, qu'ils avaient entendu dire à leurs auteurs que la dixme de ce ténement n'avait jamais appartenu ny élé payée à d'autres, el que s'il
— 413 —
y avait eu une interruption pour le payement de lad. dixme auxd. curés cela ne provenait que d'une crainte serville, occasionnée par l'autorité du seigr des Aussines leur maître qui leur ordonna avec menasses de ne payer à d'autres lad. dixme qu'aud. Lajoubertye, et qu'ils certifieraient en toute occasion pour la tranquillité de leur conscience.
Sur cet aveu l'exposant se transporta aud. village de Chabanes vers le commencement du mois de mai de la même année où étant il assembla les autres plus anciens dud. village qui conjointement avec les trois susnommés convinrent una voce les uns qu'ils avaient vu jouir les curés de Tarnac de lad. dixme ; qu'ils avaient été témoins occulaires du trouble qui leur avait été suscité en conséquence ; Les autres moins anciens confessèrent qu'ils avaient entendu dire par leurs pères et ayeuls que la dixme dud. ténement avait appartenu aux curés de Tarnac et que mal à propos et injustement ils avaient été troublés dans leur possession et jouissance. C'est même ce que continuent de certifier ceux qui existent à présent dans led. village. Et si led. seigr abbé d'Aubasine actuel voulait se donner la peine de commettre quelqu'un pour se transporter aud. village pour recueillir les témoignages desd. habitans il verrait que l'exposant n'avance rien de luy-même, parceque les habitans le luy ont toujours certifié et continuent de le luy certifier de même.
En conséquence de l'autanlicité de ces témoignages l'exposant dit auxd. habitans de l'avertir lorsqu'ils voudraient engranger les gerbes dud. ténement ce qu'ils firent et l'exposant s'y étant transporté luy même, il y rencontra les nommés Salviat et Regaudie du bourg de Bugeat lors fermiers dud. seigr abbé, qui en cette qualité s'étaient rendus aud. village pour en percevoir la dixme. L'exposant leur dit alors qu'il y était aussy pour percevoir la dime qui luy appartenait " sur le ténement des Franches ; Lesd. fermiers prenant la parolle dirent qu'ils n'avaient point su ny entendu dire que les curés de Tarnac eussent le moindre droit de dixme sur led. village de Chabanes, el que les mrs d'Aubasine en leur affermant n'avaient excepté la dixme d'aucun ténement sur led. village ; alors l'exposant assembla en présence des d. fermiers les plus anciens habitans dud. village qui tous unanimement certifièrent auxd. fermiers que la dixme dud. ténement avait appartenu de tous tems aux curés de Tarnac.
Sur cet aveu lesd. fermiers proposèrent à l'exposant qu'il
T. XXV. 3 — 5
— 414 —
conviendrait de mettre à part les gerbes de la dixme dud. ténement et suspendre le batage jusques à ce qu'ils auraient donné avis du tout à m" d'Aubasine ; l'exposant accepta volontiers la proposition el alors chacun dixma pour ce qui le concernait en attendant le résultat des productions que fourniraient lesd. fermiers.
Selon toute apparence les mrs d'Aubasine ne virent point de jour ny ne trouvèrent aucun moyen pour refuser à l'exposant la dixme dud. ténement, d'après l'exposé que leur en firent lesd. fermiers, parceque ces derniers sans rendre aucune céponse à l'exposant, ny du résultat de ce que leur avaient répondu mrs d'Aubasine, et sans luy donner d'autre avis, ils vinrent faire battre les gerbes du reste du village et laissèrent intactes celles que l'exposant avait perçues sur led. ténement. Ce qu'ayant appris il fut les faire battre et fil conduire les grains dans ses greniers, et depuis cette époque l'eyposant a toujours perçu et joui paisiblement la dixme dud. ténement jusques en 1770 époque où à presque l'exposant eut perçu par luy-même les gerbes dud. ténement. et en attendant qu'il viendrait les faire batre, un nommé Terrade au service de Madame de Fayat, accompagné d'adhérants de son estoc, se transporta aud. village et de son autorité et de voye de fait fit batre les gerbes dud. exposant. Les habitans eurent beau luy représenter l'injustice qu'il faisait à l'exposant, n'importe, possédé par ses irréflexions et inconsidérations ordinaires, ordonna avec toute sorte de menaces aux métayers de lad. dame de céder à son avidité les gerbes dud. exposant, et que s'ils refusaient de les luy indiquer il les prendrait luy-même et qu'il trouverait le moyen de les faire repentir de leur désobéissance ; intimidés par ses menaces ils les luy indiquèrent, les fit batre et en amena le ' produit.
L'exposant sur le point de se pourvoir contre un attentat si téméraire il fut conseillé de porter ses plaintes au criminel contre ce Terrade et ses adhérents sur une telle voye de fait et d'autorité privée si solennellement prohibée et punie en France ; lorsque mr de Vernéjoux seigr du Verdier et frère du seigr abbé d'Aubasine actuel vint chez mr de Tarnac dans le mois d'octobre dernier où l'exposant eut l'honneur de l'aller le voir et de luy rendre ses respects ; et en même temps luy représenter l'injustice que luy avait fait led. Terrade, et luy exposer les droits qu'il avait de percevoir la
— 415 —
dixme dud. ténement. Led. exposant lui exposa aussy l'horreur et l'ôloignement qu'il a pour la chicane ; surtout par le respect qu'il a eu toute sa vie pour la maison du Verdier et pour tout ce qui la regarde.
Sur quoy led. seig 1" du Verdier (frère de l'abbesse de Bonnesaigne) dit à l'exposant de surcire toutes choses jusques à l'arrivée de mr l'abbé d'Aubasine son frère, qui serait au mois de juillet de la présente année, et qu'alors on prendrait les arrangements qu'il conviendrait sur les Mémoires respectivement présentés et qu'en attendant il ferait chercher dans les archives de l'abbaye pour savoir s'il se trouverait quelque transaction passée entre les abbés d'Aubasine et les curés de Tarnac qui indiqua quelque délaissement de la part desd. abbés auxd. curés de Tarnac pour leur servir de rétribution pour la desserte desd. villages. L'exposant acquiessa volontiers aux propositions et y a toujours persisté en attendant des nouvelles dud. seigneur du Verdier à ce sujet, ainsy qu'il le luy avait promis.
L'exposant n'ayant su aucune nouvelle dud. seigr ny crue le seigr d'Aubasine actuel fut en province, se rendit aud. village de Chabanes présente année 1771 pour continuer de dixmer les gerbes dud. ténement qu'il a fait melre à part, toujours en attendant des nouvelles pour parvenir à un arrangement définitif dans l'affaire dont il s'agit ; cependant malgré les promesses d'honneur données et acceptées de la part dud. seigr du Verdier et de l'exposant, led. Terrade toujours accompagné de ses arboulans n'a pas manqué de se rendre aud. village de Chabanes le quatre du présent mois de septembre pour batre les gerbes dud. ténement. Ce qu'ayant appris l'exposant il s'y est rendu et ayant demandé aud. Terrade, en vertu pourquoy et par quelle voye il venait y batre lesd. gerbes ; à quoy led. Terrade répondit qu'il les venait batre par ordre et de l'autorité de mr l'abbé d'Aubasine et dud. seigr du Verdier ; el après avoir accablé l'exposant, en présence des habitans de tout le village, d'injures les plus attroces et les plus répréhensibles, il s'est retiré en deffendant par des menaces et sous des peines les plus rigoures aux habitans dud. village de ne point s'aviser de délivrer lesd. gerbes à l'exposant sous quelque prétexte qu'il put alléguer, ny au témoignage réitéré que purent luy faire les habitans.
Quel phénomène nouveau ! Quoy donc ! les lois divines et
— 416 —
civilles ont été changées ; la justice ne s'exerce-t-elle plus que par des voyes de fait et d'autorité, et n'est-elle plus soutenue que par la loy du plus fort ! Quoy donc ! Est-il devenu possible, juste et raisonnable que les curésde Tarnac soient obligés de desservir gratis les villages de Chabanes et de Parneix, el sans en retirer la moindre rétribution ? Faul-il qu'ils soient forcés à exposer leur santé el leur vie, soit de jour, soit de nuit pour aller secourir des malades, ou exercer les autres fonctions de leur ministère dans des villages éloignés d'une lieue, dans des païs des plus rudes et des plus champêtres du Limousin? L'homme raisonnable peut-il s'imaginer qu'un ministre du Seigr soit obligé de porter le poid du jour et delà chaleur, essuyer les intempéries des nuits et être exposé, dans les rigueurs de l'hiver, d'aller perdre la vie dans quelques combles de neige qui très souvent rendent les chemins impraticables, et avec cela être privé de sa propre subsistance ? De pareilles prétentions ravallent les sens et la raison, et sont diamétralement opposées aux droits naturel, divin, ecclésiastique, civil et humain.
N'est-il pas deffendu de museler le boeuf qui laboure? N'estil pas aussi dit que l'ouvrier est digne de sa récompense? Que celuy qui sert l'autel doit vivre de l'autel? Que celuy qui évangélise doit tirer sa subsistance des facultés de ceux qui sont évangelisés et une infinité d'autres passages tant de l'Ancien que du Nouveau Testament qu'on pourrait citer à des gens qui n'auraient pas la moindre tinture des livres saints, des canons de l'Église ny des lois de l'État ?
Les conciles généraux, nationaux et provinciaux ne se sont-ils pas conformés à ces principes divins et n'ont-ils pas ordonné leur exécution sous les peines y énoncées?
Les loix civilles el humaines ne sont-elles pas intervenues pour en appuyer l'autorité el en ordonner l'exécution ? Est-ce donc mal à propos et injustement que l'exposant recherche une portion de sa subsistance eu égard à la desserte desd. deux villages de Chabanes et du Parneix et les habitans desd. deux villages qui sont en grand nombre, puisqu'ils forment environ le dixième des habitans de la paroisse de l'exposant, ne forment-ils pas une portion du troupeau que J.-C. a confié aux soins dud. exposant ? Iîl si les autres habitans fournissent à sa subsistance pourquoi ceux desd. villages ne devraient-ils pas y contribuer, d'aulant qu'ils ne s'en
— 417 -
dispensent point, mais au contraire ainsi qu'il a été dit au présent Mémoire ?
Nouvelle addition : Mr l'abbé d'Aubasine a des cures à sa nomination; les fait-il desservir gratis? ou plutôt n'est-il pas contrain de leur fournir une honnette subsistance ainsi qu'elle est réglée par la loy du Prince ? Ainsi à pari argumentum ad hominem.
Après des principes si solidement établis, il ne devrait pas paraître juste que les curés de Tarnac fussent privés d'une rétribution proportionnée à la desserte desd. deux villages ; mais en conséquence des incursions réitérées et par respect aux autorités, et aux ordres dont-il doit être revêtu, l'exposant proteste et déclare par ce présent Mémoire qu'il ne veut point de procès, par horreur qu'il a pour la chicane, et qu'il serait très fâché de dépenser le moindre denier pour soutenir un droit si légitimement dû ; car le peu de rétribution qu'il retire de la dixme dud. ténement n'est pas capable de dédomager des peines, des fatigues, des embarras, des tracasseries qu'occasionne aux curés de Tarnac la desserte desd. deux villages. C'est pourquoj^ l'exposant renonce purement, volontairement, et de bon coeur à la jouissance, perception et possession de la dixme dud. ténement ; mais aussi en conséquence, et non autrement, il fait dès à présent comme dès lors un abandon et délaissement desd. deux villages pour la desserte d'iceux, et au cas qu'on ne veuille point s'en raporler à l'abandon desd. deux villages, l'exposant promet et proteste, d'en faire un aussi autentique de droit, à moins cependant que le seigr abbé d'Aubasine ne prouve par quelque transaction que les abbés ses prédécesseurs ont délaissé quelque émolument et rétribution auxd. curés de Tarnac pour la desserte desd. vilages, dans ce cas l'exposant veut bien continuer le service desd. villages.
Et au cas qu'il ne paraisse point de transaction ny de délaissement, l'exposant pour faire plaisir à mr l'abbé se chargera de la desserte desd. villages, pourvu toutesfois que led. seigr abbé veuille se prêter à un accommodement convevenable et proportionné à la desserte desd, villrges ; si non et faute de ce, led. seigr abbé pourra les faire desservir, ?einsi et de même, et par qui il jugera à propos et verra bon être. C'est à quoy et à tout ce que dessus conclut l'exposant.
A Tarnac, le 14e septembre 1771,
— 418 —
Pour le présent Mémoire être communiqué mr l'abbé d'Aubasine.
NOTA. — L'Exposant a oublié d'insérer dans le 'présent Mémoire une circonstance avantageuse à son exposé, et la voici :
Environ l'année 1758, mr l'abbé Duzers (Guillaume-Mathurin du Sers, du diocèse de Rennes), lors seig 1' abbé d'Aubasine fit l'honneur à l'exposant de venir chez luy où il séjourna un jour. L'exposant ne manqua point de luy expliquer, et exposer les faits portés au présent mémoire au sujet de lad. dixme. Led. seigr abbé ne fit d'autre réponse à l'exposant qu'en disant : « Arotre exposé paraît juste. Je suis très éloigné de le contredire, » et se servit de ces paroles de l'Écriture :
« Nemo militât suis stipendiis ».
Après ces mots la conversation passa ailleurs.
(Fin du Mémoire.)
NOTA : Ce Vernéjoux, du Verdier dont il est ici question est le frère aîné de l'abbesse de Bonnesaigne, FrançoiseGabrielle de Saint-Marsault et de l'abbé d'Obasine. Il était marquis du Verdier, seigneur de Vernéjoux — qui est une terre de Condat — lieutenant des Seigneurs les Maréchaux de France. C'est le même que celui dont nous avons parlé, lors de l'installation de la dernière abbesse de Bonnesaigne.
Cet abbé d'Obazine auquel est adressé le Mémoire du curé de Tarnac et que le Mémoire ne nomme pas, est Joseph Green de Saint-Marsault, également frère de l'abbesse de Bonnesaigne, vicaire-généi al deMeaux et premier aumônier de Mme Adélaïde de France, tante de Louis XVI ; nommé abbé d'Obazine le 3 septembre 1769, mis en possession le 3 mars 1770 ; nommé évêque de Pergame in partibus infideliuman 1779. il se démit d'Obazine en décembre 1780, émigra plus tard et mourut à Rome, âgé de 89 ans, en 1818.
En même temps qu'Obazine, il avait euBassac, en Angoumois (1762). Si un acte de 1772 l'appelle M. de Vernéjoux, c'est, nous le répétons, parce que sa famille possédait la terre de ce nom, paroisse de Condat, près Uzerche.
Le Mémoire du curé de Tarnac, que nous tenons de l'obligeance de M. l'abbé Antoine Hospital, enfant de Davignac, doyen actuel de Lapleau, pour lors curé de Tarnac, nous fait connaître ces deux illustrations de la famille de SaintMarsault sous un jour peu avantageux.
— 419 —
Il complète admirablement notre article sur Mme de SaintMarsault ; voilà pourquoi nous avons pensé que cette feuille inédite avait sa place toute marquée dans notre travail sur l'abbaye de Bonnesaigne où l'abbesse Gabrielle occupe une si large place de 1780, l'année même que son frère se démit de l'abbaye d'Obazine, à 1805, date de sa mort à l'Hospice de Brive, treize ans avant celle de l'évêque Pergame à Rome.
VIII
Au Bulletin de Brive (année 1895, 3e livraison, p. 418), on parle d'une Jacquetle de Bar qui aurail été abbesse de Bonnesaigne, dans le milieu du xvne siècle. Elle était fille de Charles de Bar, seigneur de Bar, Puymales; Saint-Michel, conseigneur de Malemort, institué héritier universel de son père en 1599, marié le 29 février 1605 à Jacqueline de Langeac, veuve de Pierre de la Volpilhière, seigneur de Feydit, et soeur de Gilbert de Langeac, seigneur de Dalet, et de François de Langeac, seigneur de Bonnebaud.
De cette union vinrent :
1° Marguerite, mariée à Antoine deLongueval S1 Chamans, escuyer, seig. de Sugarde, suivant contrat du 30 décembre 1627;
2° Gilberte, mariée au seig. deChadebec';
3° Charles, seig. de la Faurie, mort sans alliance ;
4° Jacquette, qui nous occupe, qui fut abbesse de la Règle et de Bonnesaigne, et enfin
5° Guy, qui faillit être maréchal de France.
L'abbesse Jacquette était tante d'Antoine de Bar, général de division, de Jules-Arnaud de Bar, aussi général de division, et de Hugues de Bar, évêque de Lodève.
A cette précieuse communication de M. l'abbé Bessou, curé-doyen de Lubersac. nous répondons :
1° De 1605, date du mariage du père de Jacquette de Bar, 1651, l'abbaye de Bonnesaigne a été occupée par l'intrépide abbesse Gabrielle de Beaufort de Canillac.
2° De 1651 à 1682, Anne de Montmorin, coadjutrice et nièce de Gabrielle de Beaufort, fut abbesse de Bonnesaigne. En 1682, Anne de Montmorin démissionna en faveur de Claude de Lévy de Charlus qui lui fut accordée. Elle occupa
— 420 —
le poste jusqu'en 1701. A son décès, le roi nomma à Bonnesaigne Catherine de Beauverger-Montgon.
Il n'y a donc pas place pour l'abbesse Jacquette de Bar. D'où vient donc que M. Jean de Saint-Germain la signale au Bulletin de Brive ? Voici ce qui a dû arriver : ce serait durant les longs démêlés de l'abbesse de Beaufort, qui entendait toujours ne relever que du saint siège, avec l'évêque de Limoges, qui désirait la soumettre à sa juridiction, que l'abbesse de la Règle, Jacquette de Bar, aurait été chargée par l'autorité épiscopale de l'abbaye de Bonnesaigne sur laquelle pesait l'interdit. Mais Mme de Beaufort tînt bon, sauf à soumettre sa communauté (1648) à la juridiction des abbés de Cluny pour la soustraire à celle de Mgr de La Fayette, et ce ne fut qu'en 1657, six ans après la mort de la célèbre abbesse, qu'eut lieu la soumission tant désirée, sous l'abbesse Anne de Montmorin.
Ainsi doivent s'expliquer les lignes insérées au Bulletin de Brive.
T. B.
Format de téléchargement: : Texte
Vues 1 à 749 sur 749
Nombre de pages: 749
Notice complète:
Titre : Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze
Auteur : Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze. Auteur du texte
Éditeur : (Brive)
Date d'édition : 1886
Type : texte
Type : publication en série imprimée
Langue : français
Langue : Français
Format : Nombre total de vues : 33810
Description : 1886
Description : 1886 (T8).
Description : Collection numérique : Fonds régional : Limousin
Droits : domaine public
Identifiant : ark:/12148/bpt6k4538972
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-89252
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344265167
Provenance : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 15/10/2007
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 96 %.
MEYMAC ET SON ABBAYE
ÉTUDES HISTORIQUES
PAR M. J. TREICH-LAPLÈNE
'HISTOIRE de la ville de Meymac est peu connue; elle est cependant des plus intéressantes car elle se rattache aussi à celle de son abbaye, qui était si importante.
Cette histoire n'est pas à faire aujourd'hui; elle est faite depuis longtemps. Un homme du pays, un homme regretté, M. Joseph TreichLaplène, juge de paix et conseiller général du canton de Meymac, avait apporté à cette œuvre ses loisirs et sa haute intelligence. Il est mort sans la publier, mais son manuscrit est resté. M. Gaston Laveix, son neveu, a bien voulu en confier l'impression à la Société historique et archéologique de la Corrèze; qu'il veuille bien recevoir ici l'expression de notre profonde gratitude.
Brive, 1er janvier 1886.
LE Comité DE PUBLICATION.
KC.LISE DE MEYMAC (corrpze)
MEYMAC ET SON ABBAYE ÉTUDES HISTORIQUES
CHAPITRE PREMIER
Considérations générales. Légende sur Meymac. Archambaud et l'évêque de Limoges. Charte de fondation du monastère de Meymac. Eustorge, nouvel évêque de Limoges. Soumission du monastère de Meymac au monastère d'Uzerche. -Hugues I", prieur de Meymac, se fait proclamer abbé. Lutte avec Bernard d'Auberoche.- Le pape Eugène III. – Sentence de l'archevêque de Bourges. Stéphane d'Arnac, abbé de Meymac. Hugues II nommé abbé de Meymac par l'archevêque de Bourges. Développement de Meymac; les portes de ville et les fortifications. Les reliques de saint Léger, patron de la ville. La légende sur saint Léger. – Les Ventadour. Les abbés de Meymac. Isabelle de Vandal, comtesse de Ventadour. – Tombeau des Ventadour dans l'église de Meymac. Lettres patentes de Charles Vil à la commune de Meymac. Proclamation du comte Louis Lévi de Ventadour. Procès entre le comte de Ventadour et les consuls de Meymac au sujet du droit de chasse. Agnès la cordonnière et les consuls de Meymac.
epuis 1789, la société se meut dans un cercle nouveau, et puisque le sillon de l'avenir est tracé et que tout va se fon-
dre dans cette grande unité qu'on appelle la France, il est bon de jeter un regard rétrospectif pour ne pas laisser tout à fait dans l'oubli son ancienne individualité.
Toutes les villes n'ont pas un écusson glorieux rappelant de grands souvenirs historiques; mais toutes ont vécu de leur vie propre, toutes ont leur cachet particulier d'originalité que n'ont point effacé les siècles et qui ont contribué, dans une mesure relative, à fonder l'histoire de
la nation; que celles qui ne sont pas illustres s'en consolent donc, la gloire se paie toujours au prix des larmes et du sang.
Aussi n'est-ce point l'histoire de Meymac que nous voulons écrire; nous voulons glaner dans le passé, revoir le toit de nos aïeux, les murs protecteurs de la ville et les cloîtres de l'antique abbaye. Si cette étude, aride quelquefois, n'offre pas un grand intérêt historique, elle aura l'avantage de nous faire connaître les mœurs et les usages de ceux qui nous ont précédés aux lieux où nous vivons, tout en nous initiant à leur propre existence. D'ailleurs, se souvenir, c'est étendre les limites que' Dieu met à la vie, c'est pratiquer le culte pieux des morts. Avec nos goûts et nos instincts modernes, avec ces ardeurs de possession et de jouissance qui caractérisent l'homme à notre époque, le bruit du fer des marteaux des métiers, le mugissement de la vapeur, le cliquetis de l'outillage ont seuls du mérite et de l'attrait, le passé c'est un songe, la poésie c'est un malaise dans l'âme, le réalisme est tout.
Est-ce une infériorité? ces éléments de séduction, de progrès, de bien-être nous font défaut; terre inexplorée et primitive, notre contrée n'est riche qu'en vestiges du passé.
Le langage, les mœurs, les croyances naïves y rappellent le souvenir d'un temps bien loin de nous; les races ne se sont point mêlées, les familles sont vieilles, le fils vit là où mourut son père, et nulle autre part l'amour du sol natal n'est plus ardent, plus vif; à la maison
des villes, le paysan préfère son toit de chaume; aux plantureux pays des plaines, son champ de sarrasin, ses moutons blancs, ses bruyères fleuries. Nous sommes vieux comparés à la France où tout a changé d'aspect.
Moins les vastes forêts qui couronnaient les monts, ici les lieux sont les mêmes.
Chaque vallée a des ruisseaux d'eau vive courant sur le gravier, des chênes séculaires, un sentier pour les morts et ses légendes mystérieuses.
Malgré celle que nous allons rapporter, nous ne serions pas éloigné de croire que Meymac a une origine gallo-romaine; son nom se latinise facilement, et de Maimascensis, Maimac, ainsi qu'on le trouve écrit dans les vieux titres, à Mammacus, il n'y a pas loin. Mammacus, au lieu d'être un pieux cénobite, ne fût-il pas un ancien chef commandant une station destinée à protéger la grande voie romaine qu'on retrouve entre Contensouzas et Lascaux et qui se dirigeait vers les montagnes d'Auvergne? C'est toujours près de cette, grande route stratégique que s'élèvent les villes les plus importantes de notre pays Eygurande, Ussel, Meymac, Égletons, et c'est entre ces deux dernières localités, dans les communes de Davignac et de Soudeilles, que ses traces sont surtout appréciables et parfaitement conservées. Meymac est d'ailleurs dans une situation pareille à celle que choisissaient ordinairement les soldats romains pour élire domicile point élevé pour commander et se défendre, vallée fertile,
cours d'eau pour les besoins de la vie et les progrès de la colonisation.
Quoi qu'il en soit, Meymac n'est pas une ville moderne improvisée par de puissantes industries; elle a son rang d'antiquité, elle eut au Moyenâge un château féodal, des fossés et des tours Le bon vieux temps a fui, les tours sont écroulées pourtant il en reste une, seule, isolée dans l'air, qui montre encore le front. On trouve çà et là des traces de créneaux, de portes, de vieux murs, mais sa ceinture a disparu, et sans tarder ses fils ne sauraient dire Là s'élevait l'ancienne ville
Nous avons dit qu'elle était vieille écoutez la légende Un saint homme, appelé Mammacus, vint s'établir au pied d'un des anneaux de cette longue chaine de montagnes qui, depuis les Monédières, s'élève insensiblement jusqu'au plateau de Millevaches, après avoir traversé sur une longue étendue le département de la Corrèze.
Il avait pour richesse sa piété, pour force sa vertu; pour exemple il montrait l'austérité de sa vie. Il avait fui le monde afin de répandre les lumières de la foi jusqu'au sein des peuplades barbares, et seul, sans défense, on le vit pénétrer dans la profondeur des bois et proclamer la grande nouvelle. la venue du rédempteur des hommes. Sa voix fut longtemps méconnue, mais un jour les échos redisent ses paroles, on accourt pour le voir et l'entendre, des familles entières quittent leur demeure et viennent habiter non loin de l'ermitage, au milieu des forêts.
Le site avait été bien choisi. De hautes montagnes protégeaient la bourgade et l'abritaient contre les vents froids, tandis qu'une large vallée, sillonnée par un ruisseau d'eau vive, s'étendait au midi entre deux mamelons.
Réunis par un sentiment commun de foi religieuse, les nouveaux adeptes bâtirent une église qui fut consacrée, en 546, par Rorice II, évêque de Limoges. Cette consécration mit le comble aux vœux du pieux ermite, et peu de jours après il échangeait contre les joies célestes les douleurs de la vie; mais l'oeuvre du saint anachorète devait lui survivre.
Après sa mort, le modeste ermitage fut transformé en prieuré, et le chapitre de Saint-Étienne de Limoges se chargea de pourvoir aux besoins du service religieux (1).
Cette origine, qui porte l'empreinte de la foi naïve des premiers âges, n'a rien qui doive trop surprendre. Des villes, des bourgs, des bourgades se formèrent souvent à l'ombre de la croix, devenue le signe de ralliement de ceux qui souffraient ou qu'avaient éprouvés les déceptions de la vie. Les dieux de l'Olympe s'étaient usés au contact de la civilisation romaine; le culte barbare des peuplades primitives périssait au milieu des guerres et du mélange des peuples; seul, le christianisme remuait le monde.
A la conquête romaine, aux invasions des bar-
(t) Cette légende, extraite du Cartulaire d'Uzerche, a été publiée en 1844 par M. Laborderie.
bares, succéda le régime féodal. Ces luttes, ces dévastations successives, en imposant au peuple de grandes souffrances, prédisposèrent les esprits aux idées religieuses et contribuèrent au progrès du christianisme. L'Église profita de l'influence que lui donnèrent les événements; elle s'arracha aux entraves de la féodalité, s'attacha les faibles qu'elle consolait par sa doctrine, et se fit redouter des puissants qu'elle menaçait de châtiments éternels en expiation de leurs crimes. Bientôt elle put s'imposer à tous et elle inaugura le régime de l'autorité morale.
A partir du xi" siècle, l'idée religieuse éclaire et guide l'humanité de toutes parts se dressent des autels, s'élèvent des églises. C'est le commencement de la Trêve de Dieu.
« Les peuples, dit le moine Glaber, semblaient » alors rivaliser entre eux de magnificence pour » les bâtir; on eût dit que le monde entier, » d'un commun accord, avait secoué ses vieux » haillons pour faire revêtir à ses églises des » robes blanches. »
En ces temps de régénération morale, Archambaud, vicomte de Comborn (1085), sollicita de Guy, évèque de Limoges, l'autorisation d'établir un monastère à Meymac, lieu situé sur les limites du diocèse de Limoges, près de l'Auvergne, non loin de Ventadour, entre la Dordogne et la Vezère. Comme la plupart des seigneurs féodaux de cette époque, Archambaud avait de nombreux crimes à se reprocher, et, pour n'en citer qu'un, nous rappellerons qu'un jour, ivre de colère, il
s'introduisit dans le monastère de Tulle et fit massacrer douze moines qui avaient osé résister à ses désirs.
Devenu vieux, il chercha à expier ses fautes et à en obtenir le pardon par des fondations pieuses et par l'adoption de la vie monastique dans l'abbaye d'Uzerche, où il mourut en 1086.
Ce ne fut pas sans éprouver de la résistance qu'Archambaud fonda le monastère de Meymac, et cette bonne œuvre, qu'il voulait accomplir avant sa mort, serait restée sans effet s'il n'eût consenti à restituer à l'évèque de Limoges l'église d'Otjiac (Objat), qu'il tenait en fief de lui. « Je » me suis adressé, dit Archambaud, à l'évêque de » Limoges et à son clerc, je leur ai demandé » l'autorisation de consacrer à un ordre monas» tique l'église de Meymac, mais je n'ai pu l'ob» tenir qu'à la condition de leur rendre l'église » d'Objat, située dans la châtellenie de Comborn, » et qu'ils désiraient beaucoup obtenir. Quod feci, » je l'ai fait, c'est-à-dire je me suis résigné à ce » sacrifice (1). »
Cette version, extraite du Cartulaire d'Uzerche, ne figure cependant pas dans l'acte de fondation du monastère de Meymac, où il n'est fait au-
(t) Ego qualis cumque comes Archambaldus, cognoscens cujus esset diacuti ves ecclesias possidere adii Guidonem Lemovie pontificem petii que tam clevum ejus quam ipsum ut ecclesiam de Maimac quam de eo in fevo tembum liceret mihi ordini monastico deputare sed obtinere non potui, nisi ecclesiam de Otgiac quam de ipsis similiter in beneficiam habilam in castellania de Comborn et quam multum appetebant redderein quod feci. (Gallia chvisliana, ecclesia Lemovie, page 597,)
cune allusion à l'abandon de l'église d'Objat, comme condition de la faculté d'ériger un monastère à Meymac. On y rapporte seulement qu'Archambaud, pour obtenir la protection divine, demanda à Guy, évêque de Limoges, l'autorisation de fonder en l'honneur de la Sainte-Vierge Marie, un monastère dans l'église de Meymac, ce qui lui fut accordé hoc rogando impetravi.
Mais l'abandon que fit Archambaud, d'après le Cartulaire d'Uzerche, de l'église d'Objat, prouverait, comme nous l'avons dit, l'autorité puissante qu'exerçaient alors les évoques sur les plus fougueux seigneurs. Pour autoriser le vicomte de Comborn à faire une fondation pieuse, on l'oblige à renoncer à un bénéfice qu'on lui avait précédemment octroyé. On lui impose un double sacrifice, et il consent à s'y soumettre avec humilité. La possession par des laïques de bénéfices ecclésiastiques n'était point encore rare à cette époque. Au milieu des luttes qu'elle avait à soutenir, l'Église devait se soumettre aux exigences des temps pour éviter de plus grands maux. Ces sortes de concessions donnèrent naissance aux dîmes inféodées dues primitivement au clergé ces dîmes devenaient quelquefois l'apanage d'un seigneur puissant ou redouté, auquel elles étaient abandonnées comme rémunération d'un service rendu ou d'une protection qu'on en espérait. Ainsi se transformèrent, sous l'empire des nécessités du moment, des droits d'origine purement ecclésiastique qui vinrent augmenter la richesse et l'autorité de certains seigneurs.
T. VIII. · 1–3
La charte de fondation du monastère de Meymac porte la date du 3 février 1085 elle est signée par les noms les plus illustres de la féodalité et de l'Église, et l'on y voit figurer Roteberye, mère du fondateur, Emmengarde sa femme, Gérald, abbé d'Uzerche, et Ganbert, abbé de Tulle (1). Sans revenir sur les motifs qui portèrent Archambaud à créer un monastère à Meymac, nous constaterons les principaux faits qui résultent de l'acte de fondation dont nous avons reproduit le texte. 1° L'église de Meymac existait avant le monastère, puisque le vicomte de Comborn déclare la tenir en fief de l'évèque de Limoges et exige que ce cloître soit uni à l'autel de cotte même église. 2" Le nouvel établissement devait être libre de toute juridiction, exempt de tout droit ou coutume, de môme, que le monastère d'Uzerche, à l'exception du Synode et du Parada. 3° Cette condition devait être inviolable et respectée dans tous les temps.
M. Marvaud, dans son Histoire du Bas-Limousirij nous apprend qu'après avoir fondé le
(1) Ut deus sit nobis propitius rogavi domnum guidonem episcopum Lemovica sedis cum clevo sui ut in illa ecclesia quam abillis in fevo habibam monasterium in honore sancto dei genitricis maria edificare pcrmiterent qua ccclesia vocatur Maimac in qua secundum sancti benedicti regulam ordo monasticus habeatur teneatur et observitur ea lege ut sit condonatum altari ipsius ecclesise sitie calcepnia ali cujus rei et ut sit libera ab omui contentudine sicut monasterium Usercha excepta Synodo et parada et hoc rogando impetravi a domino qui done umberto rabacerio arcliidiaeomo ita ut in nostris ac futuris temporibus hoc conditio inviolabiliter conservetur. (V. Gallia christiana, instrumenta ecclesia Lemovicensis, page 183.)
monastère de Meymac, « Archambaud offrit la » nouvelle abbaye à celle d'Uzeiche, avouant » humblement qu'il savait combien il était dan» gereux et criminel de retenir le spirituel et le » temporel des églises. »
M. Combet, l'historien de la ville d'Uzerche, rapporte « que les religieux établis à Meymac » devaient être choisis parmi les religieux d'U» zerche et soumis à l'autorité de l'abbé d'Uzerche » et de ses successeurs, de manière pourtant » qu'à l'exception de deux droits appelés Synode » et Parada, le prieur de Meymac, une fois » nommé par l'abbé d'Uzerche, fût investi dans » le prieuré du monastère de Meymac, de la » même autorité que l'abbé d'Uzerche exerçait » dans le monastère d'Uzerche. »
Bonaventure de Saint-Amable dit « que le mo» nastère de Meymac fut exempt et libre de toute » charge et coutume, comme celui d'Uzerche, ex» cepté le Synode et son apprest. »
Ducange et M. Combet, qui citent cet auteur et partagent son avis, pensent que la restriction opposée à l'indépendance du monastère de Meymac consistait en deux prohibitions
1° L'abbé de Meymac ne pouvait réunir ses moines en chapitre (Synode) sans l'autorisation de l'abbé d'Uzerche, qui était le seul président légitime de l'assemblée.
2° Si quelque serf attaché à la glèbe, soumis à la puissance de l'abbé de Meymac, prenait la fuite et s'en allait sur les terres d'un autre seigneur, l'abbé de Meymac ne pouvait le faire
poursuivre ou punir sans l'autorisation de l'abbé d'Uzerche.
Telle est, d'après ces auteurs, la signification du mot Parada ou Parafa.
L'opinion de M. Marvaud sur l'offre qu'aurait faite Archambaud du monastère de Meymac à l'abbaye d'Uzerche nous paraît fort contestable; nous en dirons autant de l'interprétation que font MM. Ducange et Combet des mots Syoodo et Parada.
On voit par la charte de fondation de 1085, qui est le titre primitif de l'établissement du monastère da Meymac et dans lequel a figuré Gérald, abbé d'Uzerche, que la liberté du nouveau monastère est expressément réservée. On va plus loin on détermine par un rapprochement- l'étendue de cette liberté; il sera libre, dit-on, comme celui d'Uzerche, à l'exception du Synodo et du Parada, et cette condition sera inviolable et toujours respectée.
Ainsi, entre le fondateur et l'évèque de Limoges, dont l'assentiment comme chef de l'église était nécessaire, il existait un pacte écrit qu'on ne pouvait même violer plus tard sans le consentement des membres de l'ordre monastique (bénédictins), auxquels la nouvelle fondation devait être livrée.
On peut objecter qu'Archambaud, devenu moine d'Uzerche, prêt à quitter la vie, cédant aux instances ou obéissant aux sollicitations de son supérieur l'abbé Gérald, fit cette concession, mais la pr euve ? elle n'existe pas
Il est vrai qu'à cette époque semi-barbare et de transition, la loi, le droit pouvaient être forcés de s'incliner devant le fait brutal. La puissance de l'abbé d'Uzerche était d'ailleurs assez grande pour qu'il pût imposer, même par la force, son autorité à la nouvelle ruche. Mais alors que devient Yoffre, la concession volontaire qu'on attribue à Archambaud?
L'assertion de M. Marvaud provient sans doute de la confusion entre deux époques, car il est vrai que l'église de Meymac fut assujettie, en 1106 ou 1107, à l'église d'Uzerche, et cette violation de la loi écrite ne fut pas, comme nous le verrons, l'œuvre d'Archambaud, mais celle d'Eustorge, qui. remplaça Guy sur le siège épiscopal de Limoges.
Nous avons tenu à constater l'indépendance primitive du monastère de Meymac, par la raison que ce fait nous paraît être dans la vérité historique et qu'il est juste de laisser au vicomte de Comborn le mérite d'une fondation dégagée de liens et d'entraves, et dont il voulait assurer l'existence par la liberté.
Il nous reste à expliquer la nature de la restriction que la charte du 3 février 1085 mot à l'indépendance du monastère de Meymac, en un mot à indiquer la signification exacte de ces deux termes Synodo et Parada.
Le mat Synodus ne signifie pas seulement,. comme l'ont pensé MM. Ducange et Combet, réunion, assemblée, Synode, chapitre, il est employé dans lit charte de fondation du monastère
de Meymac, par abréviation de langage et comme terme fiscal. On donnait, en effet, le nom de Synodus ou Synodalia à un droit que payait à l'évoque du diocèse, toute personne consacrée au culte de Dieu qui assistait aux réunions annuelles ou Synodes (1).
Les moines de Meymac pouvaient donc se réunir en chapitre sans l'autorisation de l'abbé d'Uzerche; mais ceux d'entre eux qui allaient assister aux assemblées diocésaines n'étaient pas, comme les moines de l'abbaye d'Uzerche, exempts de la taxe du cens, qu'on prélevait en faveur de l'évêque.
Du reste, si l'interprétation de M. Combet était exacte, il en résulterait une évidente contradiction avec l'espèce d'autorité qu'il reconnaît au prieur de Meymac, quand il dit que ce prieur, une fois nommé par l'abbé d'Uzerche, était investi d'une autorité semblable à celle qu'exerçait l'abbé d'Uzerche dans son propre monastère. L'abbé d'Uzerche pouvait incontestablement réunir en chapitre les moines de son abbaye donc le prieur de Meymac, puisqu'il était revêtu du même droit, pouvait en faire autant.
Quant au mot Parada ou Parata, il indique aussi un droit fiscal qu'on payait à l'évêque, ou quelquefois au seigneur du lieu, pour l'hospitalité qu'on en recevait Jus Procurationis seu hospitii. C'était une espèce de droit de gîte,
(1) Census qui episcopo a clericis venientibus ad annuas synodos quibus inter esse tenentur neudi solibat.
n'ayant aucun rapport avec la faculté qu'avaient les seigneurs de faire poursuivre et incarcérer les serfs fugitifs. D'ailleurs, le monastère de Meymac ne fut érigé en abbaye que vers l'année 1150, et l'abbé, puisqu'il n'en existait pas antérieurement, ne pouvait avoir de serfs à faire poursuivre sur les terres des seigneurs voisins, d'où la conséquence qu'il n'avait pas à en demander l'autorisation à l'abbé d'Uzerche.
Du reste, l'opinion de Bonaventure de SaintAmable sur le sens à donner au mot Parada, se rapproche beaucoup de la nôtre.
Le monastère de Meymac, dit cet auteur, était libre de toute charge et coutume, comme celui d'Uzerche, excepté le Synode et son apprest; il y a évidemment une ellipse dans la construction de cette seconde partie de phrase, et pour la rendre intelligible, il est nécessaire d'y ajouter le mot droit nous aurons alors excepté le droit de Synode et son apprest. L'apprest, c'était la chose préparée, le préparatif fait pour loger, nourrir et recevoir les étrangers qui venaient assister aux assemblées ou synodes. En échange de cette hospitalité, certains assistants étaient obligés d'acquitter un droit, tandis que d'autres en étaient exemptés.
Parmi les fondations humaines, combien sont éphémères!! mais l'œuvre d'Archambaud a traversé les siècles. Hommes et choses, tout a subi l'influence du vieux cloître, qui a marqué d'une empreinte historique les lieux où il fut édifié. Guy, évéque de Limoges, mourut et laissa son
siège vacant, qui fut occupé par Eustorge en 1106 ou 1107.
Fondé depuis vingt-et-un ans, le monastère de Meymac, comme toutes les institutions qui sont à leur début, eut à subir une série d'épreuves dont la plus dure lui fut imposée par le nouvel évêque. Plein de condescendance pour Uzerche, ce prélat accumule sur cette église tous les bienfaits. Non-seulement il accroît ses richesses; il s'efforce encore, pour mieux assurer sa suprématie, de concentrer dans les mains de son abbé la plus vaste autorité possible et, pour cela, il confie à Gaubert la direction simultanée des monastères d'Uzerche, d'Ahun et de Meymac; il lui donne ces églises avec toutes leurs possessions, pour que ses successeurs et lui en jouissent perpétuellement. La politique d'Eustorge était évi.demment de centraliser l'autorité, de mettre dans la main d'un seul tous les pouvoirs afin d'amener une fusion de ces divers établissements, dont l'abbaye d'Uzerche devait seule profiter. Cet acte, extrait du Cartulaire d'Uzerche, est intitulé Donation par Eustorge, évêque de Limoges à Uzerche, des monastères d'Ahun et de Meymac. Il porte la date de l'année de son avénement au siège épiscopal (1).
(t) Dominus Eustorgius episcopus Lemovicensis commisit domno Gauberto abbati curam et vigimen monasteriorum Usercensis agidunensis et Maimas censis cum ecclesiis et possessi onibus ad eadem monasteria ut perpetuo quiete etinconcusse possideat ipse et successores sui. (V. Gallia christiana, Instrumenta ecclesiœ Lemovicensis, page 175.)
La forme de ce titre n'indique peut-être pas, comme le dit l'intitulé du Cartulaire d'Uzerche, une donation franche et nette; mais .en confiant à l'abbé d'Uzerche le gouvernement des monastères d'Ahun et de Meymac avec la jouissance des possessions qui pouvaient en dépendre, l'évêque de Limoges ne se faisait pas illusion; il savait que le fort absorberait le faible et que la subtilité monacale saurait, tôt ou tard, puiser dans ce mandement les éléments d'un droit. Cet acte d'autorité plus ou moins légitime montre le peu de respect qu'on avait alors pour les clauses insérées dans les chartes de fondation, puisque le bon plaisir d'un évèque pouvait en effacer la lettre, en modifier l'esprit sans respect pour la volonté du fondateur. Il vient encore à l'appui de notre opinion sur l'indépendance primitive du monastère de Meymac. Pourquoi, en effet, le soumettre à l'abbé d'Uzerche, si déjà et par le fait de son fondateur il eût été assujetti à son autorité?
C'est qu'Eustorge, par sa donation, ne vient pas confirmer un droit antérieur; il inaugure, il crée un droit nouveau, droit qui fut toujours contesté, comme on le verra par la suite. Alors probablement commença la lutte entre l'abbé d'Uzerche et le monastère de Meymac. Pendant que le premier se prévalait de la donation faite par Eustorge, le second invoquait sa charte de fondation, réclamait l'indépendance qui lui avait été promise, et refusait de se soumettre à une autorité étrangère imposée pour arrêter son
expansion et le réduire à l'état de vassalité. Il est vrai que la domination d'un monastère par l'autre n'aurait pas eu, par elle-même, une importance bien grande si elle n'eût attribué à l'un d'eux qu'une simple autorité spirituelle ou claustrale mais par le fait, elle donnait au suzerain un pouvoir temporel et administratif considérable, en plaçant sous sa dépendance les hommes et le sol, également soumis au paiement des rentes et des dîmes. Cette dernière considération guida sans doute l'évêque de Limoges et l'amena à sanctionner un acte d'autorité violente contre le monastère de Meymac et contre les populations et les lieux qui lui étaient soumis.
Après sa mort, Eustorge eut pour successeur au siège épiscopal de Limoges Gérard du Cher (Geraldus de Cher), son neveu, qui avait étudié les lettres sous Aldebert, abbé d'Uzerche. Il n'était point rare, à cette époque, de voir les fonctions ecclésiastiques les plus élevées se perpétuer dans les familles; c'était l'âge d'or du népotisme. Cependant Gérard parvînt difficilement à se faire confirmer dans cette haute dignité; un abbé de Saint-Martial de Limoges, nommé Amblard, lui fit opposition, obtint un grand nombre de suffrages et s'empara de fait du siége épiscopal. Afin de faire valider son élection, Gérard se rendit à Rome; ses premières tentatives échouèrent; renouvelées, elles n'eurent pas plus de succès, et voyant ses espérances sans cesse déçues, il eut recours à un stratagème dont les effets furent immédiats. Après avoir réuni une assemblée nom-
breuse à laquelle il avait convié tous les princes de la cour de Rome, il offrit au souverain pontife, qui célébra le service divin, une coupe remplie d'or en disant « Ce trésor m'a été laissé par Eustorge (son prédécesseur et son oncle), je vous l'offre pour le salut de son âme. » II affirma ensuite, sous la foi du serment, que son élection était pure, et le Pape le consacra prêtre et évêque de Limoges (1137) (1).
Ce fait, qui serait réprouvé de nos jours, n'avait rien de trop blessant à l'époque où il s'accomplissait il était la mise en pratique du système de la vénalité des charges appliqué à des fonctions ecclésiastiques élevées, et que justifiaient les mœurs du temps.
La direction du monastère de Meymac était alors confiée à Hugues Ior. Ce prieur, profitant sans doute de la vacance du siège épiscopal et des tiraillements qui devaient en être la suite, leva l'étendard de la révolte; il refusa d'obéir au mandement d'Eustorge, qui avait placé son monastère sous l'autorité de l'abbé d'Uzerche. Rien, dit la chronique, ne put briser l'orgueil des moines de Meymac; ils se montrèrent toujours résistants et récalcitrants, et comme preuve de leur indépendance, déclarèrent que leur monastère était une abbaye dont Hugues fut proclamé l'abbé.
C'était un coup d'État dans toutes les formes, nous prouvant que le besoin de faire respecter
(1) Cette chronique est rapportée dans le Gallia chrisliana, p. 523.
sa propre indépendance domine tout autre sentiment, et que les liens qui resserrent le cercle de l'activité humaine ou qui diminuent l'autorité sont difficilement supportés que même la loi de l'obéissance ne parvient pas à faire accepter de bonne grâce une suprématie contestable, tant il est vrai que les moines se montraient intraitables dès qu'on voulait contester la leur. Cependant, ce besoin instinctif de liberté ne se produit pas seulement chez ceux dont l'éducation est complète, l'intelligence développée; on le voit se manifester encore avec plus de vivacité et de danger peut-être dans les classes populaires, parce qu'il devient alors la raison du plus fort, et que la base de tout pouvoir légitimement constitué, quelle que soit sa nature, repose sur les principes éternels de la justice.
Èble, vicomte de Ventadour, et Gérard, nouvel évêque de Limoges, ne furent pas étrangers aux efforts que firent les moines de Meymac pour se maintenir indépendants. Ils encouragèrent Hugues Ier dans sa résistance en lui faisant entrevoir pour son monastère un avenir brillant, et pour lui-même un pouvoir plus étendu. Cet appui ne pouvait cependant que prolonger la lutte sans en modifier sensiblement les résultats, car Bernard d'Auberoche, alors abbé d'Uzerche, dont l'autorité était reconnue même à Rome, était trop jaloux de sa puissance et de l'éclat qu'il avait su répandre sur son abbaye pour ne pas résister à quiconque aurait été tenté d'y porter atteinte.
La tolérance de l'évêque de Limoges et l'adhésion toute morale qu'il donnait à la conduite du prieur de Meymac ne nous semblent pas mériter le reproche d'ingratitude que lui ont infligé quelques auteurs sur la foi du Cartulaire d'Uzerche. La gratitude n'est pas exclusive de la justice, et Gérard, quoiqu'il eût étudié les lettres au monastère d'Uzerche, quoiqu'il eût puisé dans cet établissement les connaissances qui lui permirent d'aspirer plus tard à l'épiscopat, ne manquait pas aux lois de la reconnaissance en refusant d'approuver les prétentions exorbitantes de l'abbé d'Auberoche, contraires à l'esprit et à la lettre de la charte de fondation du monastère de Meymac (1).
D'ailleurs, le nouveau prélat pouvait considérer comme un danger pour la paix de son église l'élévation sans cesse croissante de l'abbaye d'Uzerche. S'il voyait dans celui qui présidait à ses destinées un rival dont l'autorité ferait un jour contre-poids à la sienne, son droit et son devoir lui prescrivaient d'enrayer, de ralentir cette ardeur envahissante. Quelle que soit, au surplus, l'opinion qu'adopte le lecteur, cette opinion n'aura jamais ce cachet de certitude qui s'attache à certains faits historiques rigoureusement démontrés.
(1) Memorattir in tabulis Userchientibus Vituperatur Geraldus du Cher Autun in hujus loci chronico quod opem impenderit cendam Hugoni qui in prioratu maisnascenci ad jus ecclesiœ Userchiensis spectante contra voluntatem abbatis uovam abbatiam creaverat et se se abbatem constituerat sed hoc mutavit et emandavit litteris datis an 1147. (V. Gallia christiana, page 524.)
Trop de siècles nous séparent de ces événements pour qu'on puisse les soumettre à un contrôle sérieux trop d'intérêts, trop de passions se mêlaient à la lutte pour qu'on croie à l'impartialité rigoureuse du Cartulaire d'Uzerche conservé dans le monastère de cette ville, et chaque jour écrit par les moines, parties intéressées.
L'ambition de Bernard d'Auberoche, l'intrépide abbé d'Uzerche, ne s'était pas bornée à la possession exclusive du monastère de Meymac. Les églises de Salon, de Madranges, de Saint-Médard de Turenne, et de Chamberet, avaient aussi subi sa loi sans trop d'opposition mais comme l'appui censé prêté au prieur de Meymac par l'évêque de Limoges pouvait éterniser la querelle, l'abbé d'Uzerche, fort de son influence dont il tirait plein espoir, soumit au pape Eugène III la décision du débat qui s'agitait entre les deux églises (1). Cette affaire ne parut pas, au souverain pontife, indigne des préoccupations de son gouvernement, et dès qu'il en fut saisi, il ordonna à Pierre, archevêque de Bourges, de faire comparaitre devant lui Bernard, abbé d'Uzerche, et Hugues, prieur de Meymac, et de mettre fin au débat. Les parties comparurent devant les délégués du souverain pontife; l'abbé d'Uzerche réclama l'investiture de l'église de Meymac et soutint que ses prédécesseurs l'avaient toujours possédée à titre de prieuré et sans opposition. Il n'invoqua aucun titre à
(1) V. Gallia christiana instrumenta ecclesiee Lemovic, page 185.
l'appui de sa demande, mais il mit en fait et demanda à prouver
1° Que les prieurs et les autres moines exerçant des fonctions au monastère de Meymac avaient toujours été nommés par les abbés, ses prédécesseurs.
2° Qu'une redevance annuelle était payée par le prieur de Meymac aux moines et frères d'Uzerche. 3° Enfin que les moines qui entraient au monastère de Meymac étaient conduits à Uzerche pour y faire profession aux pieds des autels, selon la coutume monacale.
Hugues, le prieur de Meymac, interrogé à son tour, nia les assertions de son adversaire et soutint l'indépendance de son couvent. Une enquête eut lieu; et, favorable sans doute aux prétentions de l'abbé d'Uzerche, elle servit à motiver la sentence de l'archevêque de Bourges, qui ordonna que l'église de Meymac, avec ses dépendances, seraient restituées à ce dernier. En même temps, il enjoignit à Hugues et aux autres religieux de lui obéir.
C'était en 1106 qu'Eustorge, ancien évêque de Limoges, avait donné à l'abbé d'Uzerche le gouvernement du monastère de Meymac. L'archevêque de Bourges avait rendu sa sentence en 1146. La lutte avait duré quarante ans, et pour calmer momentanément l'ardeur passionnée de ces moines, il avait fallu l'intervention d'un pape En présence de la décision rendue par l'archevêque de Bourges, l'évèque de Limoges, quelle que fut son opinion personnelle sur le fond du
débat, ne put soutenir plus longtemps les prétentions des religieux de Meymac, et par lettres et mandement de 1147, il reconnut et proclama les droits de l'abbaye d'Uzerche. « Alors, dit » M. Combet, Gérard du Cher se transporta à » Meymac. Là, en présence et avec le consen» tement de Èble, vicomte de Ventadour, et de » son épouse Agnès, de ses fils Archambaud, » Èble et Aymon, en présence aussi des moines » de Meymac, de Bernard, abbé d'Uzerche, de » Gérard, abbé d'Ahun, soumis à l'abbé d'Uzer» che, de Gaubert de Mirabel, prieur d'Uzerche, » et de plusieurs autres, l'évèque de Limoges » déclara que le monastère de Meymac serait tou» jours soumis au monastère d'Uzerche comme » une fille à sa mère. L'évêque ayant ensuite » égard à la prière du vicomte et au consen» tement de l'abbé d'Uzerche, érigea le prieuré » de Meymac en abbaye. »
Ainsi fut solennellement promulguée la sentence de l'archevêque de Bourges. On essaya d'en adoucir la rigueur en élevant le monastère de Meymac au rang d'abbaye, et on lui fit payer de sa liberté ce nouveau titre de noblesse. Hugues le prieur fut déposé de ses fonctions, éloigné de Meymac et remplacé par Stéphane d'Arnac, moine d'Uzerche et camérier de cette abbaye.
L'abbé Bernard lui-même, fatigué des luttes incessantes qu'il avait soutenues pendant la durée de ses fonctions abbatiales, résigna le commandement qu'il exerçait à Uzerche pour se retirer à Obazine et y vivre dans la pénitence et le
recueillement. Il comprit qu'il est quelquefois plus sage de s'éloigner à propos du pouvoir que de s'y maintenir trop longtemps; aussi n'a-t-il laissé d'autre souvenir que celui de son habileté et de ses succès.
Stéphane d'Arnac, dont l'administration dura vingt-huit ans, employa tous ses efforts à resserrer les liens qui unissaient l'église de Meymac à celle d'Uzerche. Le temps écoulé depuis les premières luttes, l'habitude d'une soumission constante pouvaient faire supposer l'oubli du passé. Mais l'amour de l'indépendance ou le feu de la rébellion n'étaient pas éteints dans le cœur des religieux de la jeune abbaye, et ces bons pères, dont l'humeur était belliqueuse quoiqu'ils ne dépendissent pas d'un ordre guerrier, ne furent jamais réellement soumis. Le souverain pontife, par l'organe du métropolitain de Bourges, les avait condamnés; l'évêque de Limoges avait ratifié la sentence. Hugues, le prieur révolté, avait été banni; ils ne s'avouèrent pas vaincus, et la mort de l'abbé Stéphane, qui eul lieu en 1175, fut la cause ou le prétexte qu'ils choisirent pour tenter de secouer le joug qu'on leur avait imposé. Cette circonstance, qui permettait à l'abbé d'Uzerche d'invoquer ses anciennes prérogatives pour désigner le nouveau titulaire de l'abbaye de Meymac, donna naissance à une opposition des plus vives de la part des religieux de ce monastère, et sous peine de voir renaître les anciennes luttes, il fallut transiger avec eux. Garinus, archevêque de Bourges, fut alors chargé du soin de vider
ce nouveau différend; il accepta cette mission avec le désir, dit-il, de sauvegarder la dignité de l'église d'Uzerche, et de pourvoir en même temps aux intérêts de celle de Meymac. Après avoir procédé à une information rigoureuse et entendu les observations des parties adverses, ce prélat éleva à la dignité d'abbé Hugues II, de l'ordre de Cluny, et qui était moine de Meymac (1). A partir de cette époque, l'église de Meymac recouvra son entière indépendance.
Nous avons démontré combien avait été éphémère l'autorité des abbés d'Uzerche sur le monastère de Meymac. Nous avons vu le désir de domination des uns combattu par la résistance opiniâtre des autres; aussi, l'oeuvre de conciliation ne put se faire, la fusion s'accomplir, parce que les auxiliaires de toute lutte sont l'intérêt et l'orgueil, puissants leviers qui dirigent presque toujours les actions de l'homme. Aux xie et xne siècles nous ne retrouvons, à Meymac, aucune trace de municipalité ou de commune; l'histoire de l'abbaye semble résumer, à elle seule, celle de la cité. Cependant l'existence assez ancienne de l'église peut faire supposer qu'un certain nombre d'habitants s'étaient fixés près de ses murs pour y vivre réunis, et qu'ils devaient au moins avoir conservé le souvenir des municipalités romaines, car nous retrouvons plus tard les chefs de la ville désignés sous le nom de consuls.
(t) Voyez Gallia christiana, page 598.
A cette époque, l'association devint une nécessité. Partout où se trouvèrent agglomérés des individus, ils s'entendirent pour résister aux seigneurs féodaux, ils opposèrent l'union de tous à la puissance d'un seul; telle fut l'origine des communes. Elles eurent des privilèges et des franchises payés à prix d'argent ou arrachés aux seigneurs; elles furent vaincues ou victorieuses, riches ou humiliées et quelquefois contraintes de fuir; mais elles conservèrent assez d'esprit d'indépendance et de sentiment des besoins sociaux pour aider la royauté à combattre la puissance féodale et à fonder l'unité de la nation. En faisant de Meymac le centre d'une communauté religieuse dont l'éclat se répandit au loin, Archambaud contribua, dans une large mesure, au progrès de cette ville. L'irrésistible influence de la religion tempérait seule alors l'audace et l'ambition des seigneurs. Près des couvents la vie de l'homme était plus assurée, sa liberté mieux garantie il y trouvait toujours une protection efficace, un défenseur pour ses droits lésés et une consolation dans ses misères. Le christianisme fut ainsi l'élément le plus actif du progrès humain. Il appuya sa doctrine de l'exemple le plus touchant que nous montre l'histoire un Dieu fait homme, soumis aux vicissitudes de la vie et s'immolant pour l'humanité. A cet immense saorifice il associe une vierge et proclame ainsi l'émancipation de la femme. 11 réhabilite l'homme à ses propres yeux il jette dans son âme un sentiment de douce poésie; il lui apprend l'es-
pérance, et, tout en lui montrant ses droits, il lui impose des devoirs, il le façonne à la vie sociale.
A l'époque de la fondation du monastère, Meymac n'occupait pas une vaste superficie quelques mètres carrés, ceints de palissades et de murs, avaient dû suffire aux premiers habitants pour abriter leurs familles, se défendre et protéger l'église primitive, où la voix mystérieuse de l'apôtre avait touché et converti leurs pères. Que fallait-il de plus à ces hommes énergiques et sobres, habitués au péril, forts et robustes, fils des montagnes! Mais avec l'oeuvre d'Archambaud commence la transformation; en 1119 l'église s'agrandit. Bientôt, au sommet de la ville, sur un point culminant, s'élève le château suzerain flanqué de tours, il domine et protège. La Luzège, détournée de son lit, vient remplir les fossés creusés aux pieds des murs; plus tard ses eaux, utilisées, s'échapperont pour alimenter des moulins et rendre plus fertile la prairie du seigneur. Pour donner accès à la ville et faciliter les sorties, quatre portes sont construites l'une au couchant, c'est la porte du château, et les deux autres au nord, appelées porte de VArckinal et porte de Rioux ou du Pas Redon; près de cette dernière sont deux tours épaisses, dont l'une, englobée dans les bâtiments de l'hospice, montre sa base, et dont l'autre, située sur une partie de l'emplacement qu'occupe la maison Dupuy-Lafarge, a été détruite
en 1860(1). La quatrième est au midi, non loin du four Banal (2); c'est la porte Chaumon (3); elle est défendue par une tour appelée Latournelle, qui occupait le terrain où fut édifiée la maison Serre. Ces ouvrages, formant un tout complet, sont reliés entre eux par un mur d'enceinte qui longe le canal, la rue de l'Horloge, le .sommet de la prairie, ainsi que les terrains qui contournent l'église; et, pour mieux protéger la dépouille de ceux qui ne sont plus, on place à l'intérieur le champ des morts, ce dernier asile du mystère de la vie.
Au milieu du cercle formé par les remparts de la ville, deux rues principales furent tracées. La première, de l'église s'élevait jusqu'au château, tandis que la seconde, la coupant transversalement, s'étendait dans la direction du four Banal et de la porte Chaumon. Quant à la rue de Lachenale, elle est d'une origine moins ancienne; elle a été fondée sur les vieux murs de ville et tire probablement son nom du voisinage du canal, dont les eaux baignaient le pied des murailles (4).
(1) Cette tour, détruite depuis peu d'années, avait des murs de l™50 d'épaisseur; elle avait appartenu aux héritiers Chaufour, auxquels, par acte du 3 octobre 1746, M. Dapeyron, consul, la céda, et reconnut leur possession moyennant la somme de neuf livres. (2) Le four occupait l'emplacement où ont été construites les maisons des frères Rougerie, près de la route de Limoges à Bort. (3) Nous avons trouvé le nom et la situation de la porte Chaumon dans un titre duxvi" siècle.
(4) Il existe encore, sous les caves de la maison Simandoux, des galeries souterraines communiquant avec les tours détruites. Le jardin des héritiers Chaufour, près des Pradeaux, faisait partie des anciens fossés. Le Il janvier 1780, une décision de la Généralité de
Si l'on s'étonnait de nos jours qu'une localité comme Meymac pût avoir besoin de travaux défensifs, nous répondrions que les murailles étaient, à l'époque que nous décrivons, une nécessité de premier ordre; utiles aux populations, elles les protégeaient en cas d'attaque et permettaient de résister soit aux invasions des Anglais, soit aux guerres que se faisaient entre eux les seigneurs s féodaux. Que de larmes, que de sang dûrent coûter à ceux qui étaient soumis à la construction sur des pics aigus souvent inaccessibles, de ces créneaux, de ces tours gigantesques! mais on ne peut s'empêcher d'admirer la grandeur, l'audace de conception de ces œuvres et l'énergie sauvage qui dût présider à leur exécution. Cette époque eut sa raison d'être; si elle représentait l'ancien état barbare, elle laissait néanmoins entrevoir des horizons nouveaux. Elle fut le creuset par où passa la nationalité française. Les hauts barons de la féodalité, eux-mêmes durs pour le peuple qu'ils considéraient comme pétri d'un sang moins pur que le leur, cruels sans justice, ambitieux et sans frein, jaloux de l'autorité de leurs égaux, tour à tour bienfaiteurs ou spoliateurs des églises, concentrant en leurs mains l'autorité absolue, forcèrent les éléments sociaux désagrégés à se réunir, et aidèrent sans le savoir à la marche de la civilisation et au progrès gé-
Limoges maintint Léonard Chaufour dans la possession de ce jardin, faisant partie des anciens fossés, escarpements, contrescarpes de la ville.
néral. Car le progrès est le but que doit atteindre l'homme ici-bas; il rentre dans les desseins de Dieu résultat de l'expérience des siècles, il est l'oeuvre de chaque jour; on ne saurait l'improviser, et ceux qui réfléchissent aux leçons de l'histoire demeurent frappés du mouvement insensible de l'humanité, de la lenteur qu'elle met dans ses évolutions. Mais l'homme, dans ses rêves et dans son ignorance, veut en calculer la marche, en fixer les étapes; il prend volontiers sa vie comme terme de comparaison, et de là naissent ses déceptions et ses impatiences. Que sont, en effet, les années, quelle durée ont les siècles à côté de l'infini des temps
Depuis Hugues II (1175), désigné par l'archevêque de Rourges pour remplir les fonctions d'abbé de Meymac, jusqu'au xive ou xv' siècle, on ne trouve, dans les anciens auteurs, la mention d'aucun fait saillant relatif à cette abbaye. Cependant, on lit dans la chronique de Geofroy de Vigeois que, durant le xne siècle, les habitants de Meymac vénéraient saint Léger, qui eut la tête tranchée par ordre d'Ébroïn et dont ils possédaient une main et la tëte. Le dépôt de ces reliques dans l'église de Meymac dut contribuer au développement de la richesse de l'abbaye et de la ville elle-même. Toutes les communautés religieuses étaient jalouses alors de pouvoir offrir à la vénération des fidèles des reliques de saints en renom. Leur présence inspirait plus de ferveur, amenait d'abondantes offrandes et répandait de l'éclat sur les lieux où elles reposaient, en attirant un grand
nombre de pèlerins et de visiteurs étrangers. Plusieurs villes se disputèrent souvent la possession des mêmes reliques, et Bonaventure de SaintAmable, en rapportant que le chef et les mains de saint Léger, évêque d'Autun et martyr sous Ébroïn, furent transférées du monastère d'Ébreuil ou Saint-Mexent, en Poitou, en celui de Meymac, ajoute « On ignore le temps et la façon de cette » translation ces saintes reliques sont enfermées » dans un reliquaire d'argent au grand-autel, du » côté de l'Évangile. Les monastères de Mulbar en » la Haute-Alsace, de Jumièges en Neustrie, et de » Pratelle, se glorifient de les posséder et en four» nissent des instruments et des témoignages des » anciens auteurs. Ceux de Meymac ne peuvent » justifier par carthes ou pièces authentiques de » leur ancienne possession. »
11 faut reconnaître l'influence salutaire qu'exerça sur le peuple cet usage de l'ostension des reliques, au point de vue religieux et moral. Toujours, l'homme ainsi vénéré avait fait preuve de hautes vertus chrétiennes ou sociales. Sa vie commentée, ses actions vulgarisées étaient un objet d'admiration enthousiaste ou réfléchie, sa mémoire un objet de respect; tout, jusqu'à l'auréole poétique et souvent mystérieuse qui entourait son nom et sa destinée, devenait un exemple salutaire et un encouragement au bien. Il faut en effet se placer à une certaine élévation de vue pour interprêter sainement les usages et les institutions de l'Église, car si d'un côté apparaît quelquefois l'intérêt matériel ou mondain, de l'autre on est
frappé du sentiment de haute moralité qui les distingue. En les envisageant sous un seul aspect on s'expose, les comprenant mal, à les défigurer et à en méconnaître la portée.
Nous entrerons donc dans quelques détails sur l'épisode qui a trait à saint Léger, patron de la ville de Meymac, et dont le nom rappelle encore à tous les habitants âgés un souvenir de jeunesse, de plaisir et de joie. Après le fait historique nous traduirons la légende locale que l'aïeule aime à redire à ses petits-enfants, et nous la comparerons au récit que fait sur le même sujet dom Pitra, le célèbre bénédictin (1).
Saint Léger, évêque d'Autun, conseiller de Bathilde, régente du royaume et veuve de Clovis II, fut, après la mort de cette dernière, jeté dans la même prison qu'Ebroïn, maire du palais, par Childéric, qui n'ignorait pas l'inimitié qui divisait ces deux hommes. Unis par le malheur, Ébroïn et Léger combinèrent leurs efforts, le premier pour redevenir maire du palais, et le second pour remonter sur son siège épiscopal. La fortune favorisa leurs projets, et dès qu'Ebroïn se fût emparé du pouvoir, il fit de nouveau emprisonner l'évêque et recruta des assassins pour assouvir sa haine. Mais, en présence de leur victime, les meurtriers hésitèrent et ramenèrent en triomphe à Autun celui dont ils devaient répandre le sang.
(t) Voyez, page 409 de la Vie de saint Léger, par le P. Pitra, notes envoyées de Saint-Mexent et conservées à la Bibliothèque nationale.
Alors Ébroïn fit assiéger la ville par le duc de Champagne et le saint prélat, pour mettre un terme à l'effusion du sang, se livra seul à ses ennemis, sacrifiant ainsi sa vie pour son troupeau.
Tel est le fait historique, et voici la légende qui mit Meymac en possession des reliques du saint évêque.
« Le seigneur de Ventadour se décida à bâtir » en ce lieu le monastère de Maymat, où saint » Léger était particulièrement honoré. » Ces derniers mots n'ont pas la même origine que le récit qui les précède, et si l'exactitude du fait qu'ils mentionnent était démontrée, il en résulterait que Meymac était en possession des reliques de saint Léger antérieurement à la fondation du monastère et que leur présence fut le motif déterminant de son érection. Mais la charte primitive ne fait aucune mention de saint Léger et place le nouvel établissement sous la protection de la Sainte-Vierge Marie l'église elle-même était sous l'invocation de saint André, et l'on ne comprendrait pas qu'un fait de cette importance, ayant tous les caractères d'un miracle, eût pu être omis et n'eût pas même été signalé par Archambaud comme l'une des causes inspiratrices de son œuvre, si réellement il s'était produit.
On ne peut rien écrire sur Meymac sans associer à son histoire les Ventadour, qui protégèrent et enrichirent le monastère fondé par un de leurs ancêtres, et qui intervinrent souvent dans
les affaires de la localité, dont ils étaient les seigneurs.
Ce fut pendant le xie siècle que les immenses possessions d'Èble, vicomte de Comborn, furent divisées entre ses enfants. Guilhaume obtint la vicomté de Turenne, et les terres de Comborn et de Ventadour échurent à Archambaud, fils de Rotberge et époux d'Ermengarde. Ce partage donna naissance à une nouvelle branche, celle des Ventadour, qui eut son existence propre et qui alla se fondre, à défaut de rejetons mâles, dans la famille des Lévi la Voulte en 1470.
Leur château, situé près d'Égletons, à peu de distance de Meymac, commandait tout le HautLimousin. Il n'est aujourd'hui qu'un souvenir historique et presque légendaire, quoiqu'il reste des vestiges imposants de sa splendeur passée. L'élévation des forteresses de ce genre, les masses de granit employé, reflétaient exactement les mœurs et les idées de l'époque; elles symbolisaient la force brutale et irrésistible qui dominait alors. Lorsque de loin, par un ciel bleu, on apérçoit inondé de lumière, doré par l'éclat du soleil, le célèbre donjon des Ventadour, les souvenirs s'éveillent et l'ancien manoir apparaît comme un vieux chevalier brillant sous son armure, fier et hardi, prêt au combat. S'approche-t-on du rocher qui le porte? l'illusion fuit; partout des murs dentelés, menaçants. Là, des fossés comblés; ailleurs, des tours épaisses; sur le flanc des murailles, jusqu'au sommet des tours, de tristes bouleaux ont grandi ils inclinent le front; leur longue et brune
chevelure ondule sous le vent; on dirait qu'ils épanchent des larmes sur ces vieux restes d'un autre âge. Tout y est morne et sauvage; tout est tristesse et deuil; la vie n'habite plus ces lieux comme au temps où chantaient les joyeux ménestrels, où résonnait le cliquetis des armes; seul, le vent y gémit au milieu des décombres et des roches amoncelés.
Les souterrains et les cachots que la légende a peuplés de souvenirs terribles se remarquent encore; ils répètent le bruit des pas et du caillou qu'on y laisse tomber; c'est l'écho d'un passé dont les vagues clameurs n'arrivent qu'à peine jusqu'à nous.
Mais bientôt, à la vue de ces témoins muets de gloire, de plaisir, d'orgueil, de force, souvent de vertu, quelquefois d'injustice, le front s'incline et l'âme rêve; elle se perd dans la contemplation idéale des hommes qui remplirent ces solitudes; elle ne regrette pas mais elle prie.
L'intérêt que les Ventadour portèrent au monastère de Meymac ne se démentit jamais; plusieurs membres de cette noble famille ne dédaignèrent pas de diriger les destinées de ce cloître et d'y remplir les fonctions d'abbés, avec toutes les charges et tous les devoirs qu'elles imposaient. D'autres enfin répandirent sur lui de généreux bienfaits, et voulurent que leurs restes mortels y fussent déposés, et que leur mémoire y fùt perpétuellement honorée.
L'avènement de Hugues II aux fonctions d'abbé de Meymac en 1175, consacra l'indépendance ab-
solue de ce monastère et le dégagea des liens qu'avait voulu lui imposer l'église d'Uzerche. De longues années durent s'écouler sans qu'on vit surgir aucun fait remarquable, et le silence qu'ont gardé les anciens historiens sur la plupart des abbés qui se succédèrent jusqu'à l'année 1434, fait supposer que cette abbaye, après les premières difficultés vaincues, était entrée dans une période de vie calme et de repos.
Hugues II mourut en 1201 et fut remplacé par Guilhaume II, allié à la famille de Ventadour. En 1208, ce dernier se retira et eut pour successeur Pierre de la Chassagne, dont le frère, Guilhaume, était prieur de Saint-Angel. Ils furent choisis tous les deux et figurèrent comme témoins à l'acte de donation que fit Roger de la Faye au profit du couvent de Bonnaigue. Pierre de la Chassagne est en outre considéré comme l'auteur de la réconciliation qui eut lieu entre l'abbé de Bonnaigue et les moines de Port-Dieu, à la suite de conflits et de luttes qui avaient duré de longues années. Pour mieux assurer le succès de cette œuvre de paix, il sollicita le concours d'Hélie ou d'Èble d'Ussel, qui le seconda dans l'accomplissement de sa difficile mission. Après sa mort, Guilhaume, son frère, abandonna le prieuré de Saint-Angel qui dépendait aussi de l'ordre des Bénédictins, et lui succéda, en qualité d'abbé, à Meymac, où il mourut lui-même en 1247. Il fut remplacé par Pierre Aymard. Ce dernier accrut l'enclos de la communauté d'un jardin, que lui légua une nommée Agnès; il obtint en outre
d'Èble de Ventadour la confirmation de tous les dons et priviléges que ses ancêtres avaient octroyés à son couvent.
Cet abbé eut pour successeurs Hugues III en 1272; Pierre III en 1273; Hugues IV en 1284; Gérald de Gaufré en 1306; Pierre Gauthier en 1323; Jean Vez en 1331; Guilhaume IV en 1340, qui donna à la communauté une rente annuelle de dix sols pour une messe commémorative le jour anniversaire de sa mort.
En 1346, la direction de l'abbaye passa entre les mains de Pierre Del Poch ou Dupuy, qui créa la fête de Saint-Jacques qu'on célébrait tous les ans au mois de juillet, avec une grande solennité. Il fut aussi l'auteur d'une autre fondation dite de la cène, dont nous aurons encore à parler, et dont le produit était destiné à douze pauvres lé jour de la cène du Seigneur. Les fonctions de cet abbé furent courtes, mais bien remplies, et son oeuvre, modeste en apparence et diversement interprêtée, a pu vivre jusqu'à la Révolution.
Hugues de Lantillac lui succéda en 1349. Fondateur d'une vicairie dite de Saint-Léger, ardent et plein de zèle, il sut augmenter, dans une proportion considérable, les ressources de sa communauté, où durant son administration on ne compta jamais moins de douze moines. Ses successeurs furent Guilhaume de Lantillac en 1367, Bertrand de la Forme en 1384, et enfin Jacques de Lombartez, qui reçut un témoignage éclatant de la munificence et de la piété de la
comtesse de Ventadour. Nous entrerons à ce sujet dans quelques développements qui ne sauraient manquer d'intéresser celui qui ne se déplaît pas au souvenir des choses du passé.
Le comte Robert de Ventadour mourut en 1406 et laissa trois enfants Jacques, qu'il institua son héritier universel avec le titre de comte de Ventadour, Charles et Marguerite. Jeunes encore, ces enfants furent confiés par lui à Isabelle de Vandal, son épouse et leur mère, à laquelle il donna le titre de tutrice et de gouvernante, avec l'administration générale de tous ses biens et de tout le comté.
Les dispositions dernières du comte Robert furent approuvées par le sénéchal du Limousin dans une assemblée nombreuse et choisie, qui avait été convoquée au château de Ventadour. Comme trait de mœurs de l'époque, nous reproduirons les principaux détails de cette cérémonie, qui ne manqua ni de grandeur ni de tristesse. Pierre de Monier de Donzenac, lieutenant aux bailliages de Brive et d'Uzerche, délégué de noble seigneur Guilhaume le Bouteillier, sénéchal du Limousin, représentant la justice royale, se rendit, le 6 décembre 1406, au château de Ventadour, accompagné de Jean Dubois, notaire à SaintAngel, et de Dom Jehan de Nespeuil, chapelain de Saint-Hilaire Foissac, aussi notaire royal; Pierre de Chabanne, prieur du monastère de Ventadour, Guilhaume de Lubertes, seigneur de Lascour, Bertrand de la Lucgie et Guilhaume Bessières, seigneur de Miramont, tous hommes religieux, les
assistaient comme témoins. La noblesse du comté et un grand nombre d'hommes d'armes et de vassaux avaient été conviés à cette grave et touchante solennité.
Le lieutenant du sénéchal écouta d'abord la noblesse et les vassaux, qui lui déclarèrent que Robert, chevalier et comte de Ventadour avait, pendant sa maladie et durant ses derniers jours, fait certaines dispositions, et entre autres avait institué Jacques, son fils aîné, héritier de tous ses biens et des droits qui y étaient attachés; qu'en outre il avait ordonné et voulu que sa très chère épouse, noble dame Isabelle de Vandal, fût tutrice et gouvernante de son héritier et de ses autres enfants, qu'elle administrât tous leurs biens et qu'elle restât en état de veuvage. Ils supplièrent en conséquence le sénéchal du roi de daigner approuver et confirmer, dans les formes du droit, la dame Isabelle dans la tutelle de ses enfants.
Le sénéchal alors entendit la déclaration de plusieurs témoins dignes de foi, vassaux ou serviteurs du comte, et demanda à sa veuve si elle voulait assumer sur elle les charges de la tutelle et de l'administration des biens de ses enfants. Elle répondit a J'accepte pour l'amour et la ten» dresse conjugale que j'ai et que j'ai eue envers » mon seigneur, tant dans la vie que dans la » mort; j'accepte pour l'amour maternel de mes » enfants, avec l'aide de Dieu. »
La noble dame fut alors confirmée par le sénéchal dans tous les droits que lui avait conférés
son époux; elle renonça aux secondes noces et à tout bénéfice introduit en faveur des femmes, soit par la loi civile soit par la loi religieuse, et jura sur les saints Évangiles de consacrer sa vie à ses enfants.
Il y a dans cette scène, où à côté des livres saints figurent le représentant de la justice du roi, la noblesse et les vassaux du comté, les amis du défunt, une femme en deuil, éplorée, sacrifiant tout à l'amour conjugal et maternel, un côté solennel et touchant qui émeut l'âme et se traduit en admiration pour celle qui en fut l'héroïne et la victime volontaire.
Jacques de Ventadour étant mort sans descendants, le comté échut à Charles, son frère, qui épousa Catherine de Beaufort, fille du vicomte de Turenne et de Blanche de Gimel.
L'influence des seigneurs féodaux s'était alors amoindrie à mesure que l'autorité royale s'était étendue. Le repos et la sécurité n'existaient nulle part; des luttes intestines et terribles épuisaient les ressources de la France; l'Anglais était maître d'une partie du sol, et au milieu de ces crises sociales, l'avenir était sombre.
Si de ces faits généraux, nous en venons à l'examen du fait particulier qui nous occupe, que voyons-nous? Le comté de Ventadour dirigé par une femme dont les rêves et les illusions sont à jamais perdus et qui, jeune encore, a vu se briser les plus douces chaines qui l'attachaient à la vie, obsédée par ces difficultés inhérentes à sa hante situation, faible et croyante, éprouvée par
les pertes douloureuses de son époux et de son fils. Isabelle de Vandal dût subir cette loi commune, qui pousse vers la religion et quelquefois jusqu'au mysticisme les âmes saines, aimantes et pures, et elle voua les derniers jours de sa vie à l'accomplissement d'oeuvres pieuses.
En 1434, la veuve du comte Robert songeait sans doute à la mort et aux prières posthumes qui, tout en perpétuant son souvenir, devaient la rendre plus pure devant Dieu. Mais la prière, ce culte pieux des morts, elle la voulait aussi pour le repos de l'âme de son fils, le noble héritier des Ventadour décédé sans postérité, confiant à son autre fils le soin de veiller à l'accomplissement de ses désirs. Quoique riche et puissante, obéie, respectée, l'idée d'une fin prochaine ne l'épouvante pas; chrétienne, c'est pour elle un voyage dont elle règle les apprêts et les détails; mais peut-être subissait-elle l'influence des idées ou de la mode qui dominaient alors? Ses bienfaits mêmes ne servaient-ils pas à déguiser son orgueil? Nous ne le croyons pas; et la lecture de l'acte de fondation que nous allons transcrire indique au contraire un cœur pur, une énergie puissante soutenue par la foi, dont la mystérieuse influence console devant la mort et fait espérer après la vie.
Par cet acte du 5 avril 1434, Isabelle de Vandal fonde d'abord une chapelle dans l'église de Meymac, où se fera sa sabouture (sépulture). Chaque jour, dans cette chapelle, sera célébrée une messe par un des moines du monastère, entre l'aube du T. VIII. 1–5
jour et le soleil levant. Celui qui dira cette messe sera tenu de sonner une cloche qu'on placera dans le petit clocher. Ses tintements dureront assez pour qu'un homme qui sera au lit se puisse être levé et habillé.
Ces détails minutieux, ces -prescriptions naïves indiquent bien l'œuvre d'une femme et l'intérêt qu'elle mettait à ce qu'elle fût scrupuleusement exécutée.
Par le même acte, la comtesse impose aux religieux l'obligation de chanter quatre messes à diacre et sous-diacre de trois mois en trois mois, et de dire le jour des Morts, sur sa sabouture (tombeau), le subvenite et l'absolution générale, à venir chercher son corps pour le transporter à Meymac après son décès, et à chanter une messe en note dans sa chapelle le jeudi après l'Assomption de Notre-Dame, pour le repos de l'âme de Jacques de Ventadour, son fils décédé. En échange de ces biens spirituels et de ces pieux oflices, que dans sa disposition d'esprit elle devait considérer comme assurant son salut, la veuve du comte Robert délaissait au monastère des biens fugitifs et temporels. C'était, d'une part, les mas et village de la Pelatane, la borde de la Pelatane, les Farges et l'étang avec toutes leurs dépendances; les mas appelés Labeyroux-le-Chandergue, le Montel-Chaumont, Chabret-la-Soubrange, la Vergnangeole et la Rebière d'autre part, situés dans les paroisses de Saint-Superyx et de Saint-Frcjoux, se réservant, pour elle et ses successeurs, les droits de haute, moyenne et
basse justice. Elle déclara en même temps que tous ces biens avaient été acquis par elle de noble Aymar de Beaufort et de Zélia d'Aix, son épouse. Cette donation ne comportait pas cependant un abandon complet de la propriété des villages et des tènements dont nous avons donné les noms; le droit réel, ainsi que la jouissance, appartenaient aux possesseurs du sol qui étaient seulement assujettis à payer des droits seigneuriaux, tels que rentes, tailles, cens, vinies, gélines, etc., et ces derniers droits seulement étaient transmis au monastère. Mais avec cette restriction même, ils avaient une importance assez considérable dont nous trouverons la preuve dans des baux authentiques dès que nous nous occuperons des revenus de l'abbaye.
Nous croyons devoir donner le texte des clauses principales de cet acte, passé le 5 avril 1434 devant Pradinas, notaire à Ussel, et Jean Mouraud, notaire à Saint-Angel. Il est écrit moitié en latin, moitié en français.
La copie que nous avons a sans doute été faite sur une expédition primitive ou sur la minute même; elle est signée par le juge de Meymac, le curé et les consuls, à la date du 26 août 1680. In Dei nomine domini amen regnante. domina Elisabelis de Vandal commitissa Ventadoris volens et cupiens salutem animée suœ et suorum promiset et dixit sana mente et corpore en sua bona et sana memoria per Dei gratiam existens ordinavit sepulturam et corpus suum sepeliari in dictum monasterium Maimacum in quadam capella quam dominica comitissa fundavit.
Incipit gallice loqui.
Mémoire soit que aujourd'hui que l'on compte le cinquième jour du mois d'Avril 1434 a esté faict ce traité et apointement entre noble et puissante dame Isabeau de Vandal, comtesse de Ventadour et Jacques Lonbartez abbé du moustier de Maimac, et frère Jean à'Audy prieur et chantre, frère Raymond du Maschani, frère Jean Laschiesas frère Jean Chadenier frère Aymon Mourau (major et sanior pars religiosorum monasterii Maimascensis) religieux de cette abbaye au nom et à cause de une messe cordiaire que la dite dame veult fonder en icelui moustier, auprès de l'église autel de Saint-Jean et de Saint-Jacques dans une chapelle que ma dite dame faict faire laquelle chapelle la dite dame ornera bien et honorablemcnt ainsi qu'elle accorde, et faira faire dedans icelle chapelle sa sabouture belle et honorable.
Item a été dict et accordé par les parties que mon dit sieur Abbé et couvent chanteront icelle messe en bas, un chacun jour perpétuellement entre le soleil levant et l'aube du jour en icelle chapelle, soit fête soit ouvrier.
Item a été accordé que le domadier qui dira icelle messe sonnera une cloche qui sera au clocher petit par l'espace d'une demi heure environ ou quoique soit que un homme qui sera au lit puisse être levé et habillé, laquelle cloche la dite dame faira faire à ses coults et dépans.
Item à la dite icelle messe le domadier sera tenu de dire une absolution soubre la sabouture de ma dite dame et ieter l'eau bénite.
Item a été accordé par les partyes que mon sieur Abbé qui est à présent et ses successeurs au tems advenir seront tenus de chanter quatre messes à diacre et sousdiacre et le jour des morts tous les religieux présents devant sur la sabouture de la dite dame le subvenite et l'absolution générale et ces quatre messes se diront chacune en dehors de trois mois en trois mois solennellement comme dict est c'est à savoir le premier lundi de Mai,
le premier lundi de Juin, le premier lundi de Septembre et le premier lundi de Décembre.
Item a été dict et accordé que mon dit sieur Abbé curé et couvent de Meymac, seront tenus de venir quérir le corps de ma dite dame pour le porter à Maimac. Item plus a été accordé que mon dit sieur Abbé et couvent seront tenus de chanter une messe en note à diacre et sous diacre en icelle Chapelle, pour l'âme de Monseigneur Jacques, jadis comte, le Jeudi après l'Assomption de notre dame chacun an et devant le subvenite et fairont l'absolution générale et fairont sonner toutes les cloches du dit Moustier.
Item a été accordé que pour subvenir à icelle chapelle, icelles messes, icelles cloches, pour les cinq obiels et charges dessus, ma de dame cède et transporte perpétuellement au sieur Abbé couvent et curé, les villaiges, cens, rentes, tailles, vinies qu'elle a ez villages qui s'en suivent les mas de la Pelatane, la Borde de la Pelatane, les farges et l'étang avec dépendances, Les Mas Labeyroux, le Chaudergue, le Monteil Chaumont; Chabret, la Soubrange, la Vergnaugeale et la Rebière, situés paroisses d'Ussel, de Saint-Superyx et Saint-Frejonx lesquels Mas elle a acquis de noble Aymar de Beaufort et de Zélia d'Ayx avec tous leurs droits et devoirs excepté la justice des dits villages, haute, moyenne et basse qui demeurera à ma de Dame et après elle à M. le Comte de Ventadour et aux siens et seront tenus mon dit Sr Abbé et couvent de faire recognaissance et homage à mon dit Seigneur le comte et aux siens ainsi que mon dit Abbé fait des autres choses qu'il tient de lui.
Hac dicta fuerunt et scripta in loco de Peyroto parochia de Liginiac Lemovicis diocesis anno die quibus est supra presentibus et audientibus nobilibus Joannes Pezeyra domino del Bazaneise Antonio de la Bessaria et Hugone de Beynetta honorabilibus et discretis. Au bas de cette pièce on lit les mentions et signatures suivantes vu et collationné par nous, Anthoine
Lachau, advocat en la Cour, juge de la ville de Meymac, et conforme au procès-verbal de Pradinats. Fait le 26 août 1680. Ont signé Lachau, juge; Lafon, curé; RoffiatChassaing, consul; pour avoir lu l'original de Savandy, consul; Démoulin, consul; Treich, consul.
Il est singulier que dans cet acte il soit fait mention du curé de Meymac, conjointement avec ?l'abbé et le couvent, quoique son nom n'y figure pas. Tous les trois cependant semblent contracter, vis-à-vis de la 'comtesse de Ventadour, les mêmes obligations, et c'est à eux tous que sont abandonnés les villages de la Pelatane, les Bordes, etc.; il semble donc qu'une part des bénéfices de cette fondation devait revenir au curé. Cependant il n'en fut pas ainsi; ce fait, paraissant d'abord étrange, s'explique en remontant à' l'origine de l'établissement des cures; les cures étaient des bénéfices attribués quelquefois à des couvents qui demeuraient alors chargés du service de la paroisse. Aussi verrons-nous bientôt les moines revendiquer contre le clergé séculier le titre de curé primitif de l'église de Meymac.
Comme l'abbaye était mouvante du comté de Ventadour, la comtesse, ne voulant renoncer à aucun de ses autres droits, eut soin de se réserver que l'abbé et le couvent seraient tenus de faire reconnaissance et hommage à monseigneur le comte et' aux siens, ainsi que mon dit sieur abbé fait des autres choses qu'il tient de lui. Du reste, les abbés de Meymac n'avaient jamais refusé de rendre foi et hommage aux seigneurs de Ventadour, et nous trouvons relaté dans une
vieille chronique extraite du chartrier de Ventadour, la date de divers aveux qu'ils avaient rendus, notamment en 1322, 1340, 1348, 1349, 1546 et 1681. Nous avons pu voir une copie de l'un d'eux du 10 juillet 1703, fait par Philippe-Louis de Meschatin, comte de Lyon et abbé de Meymac, au prince de Rohan, seigneur de Ventadour; il est ainsi conçu
« A dit et déclare, reconnu et confessé le dit » seigneur abbé, tenir et ses prédécesseurs d'an» cienneté avoir tenu en fief noble et lige ser» ment de fidélité, la dite abbaye de Maimac et » ses dépendances laquelle consiste en ce qui » suit savoir la dite abbaye et monastère avec » ses cloîtres, dortoirs, réfectoires, cimetière et » jardin tant du dit abbé que des religieux. » L'acte qui constate la preuve des bienfaits de la comtesse de Ventadour envers le monastère de Meymac fut dressé au château de Peyroux, paroisse de Liginiac. Au nombre des témoins figurent Jean Pesseyre, seigneur de Bazaneix, Antoine de la Beyssière et Hugues de Beynette. Ce dernier était seigneur d'Ambrugeac.
Cette libéralité, l'une des plus importantes qu'eût reçu le monastère depuis sa fondation, sert à fixer l'époque où les Ventadour eurent droit de sépulture dans l'église de Meymac, en nous apprenant le nom de celle qui fit édifier à ses frais la partie de ce monument où reposaient leurs cendres. L'emplacement qu'occupaient ces tombeaux est à gauche du chœur, un peu à droite de la porte d'entrée qui fait face à la halle.
Il existait autrefois contre la paroi intérieure du mur regardant l'hospice des peintures à fresque, au milieu desquelles se dessinaient les armoiries de cette noble famille. Mais le temps, la Révolution ou l'ignorance ont détruit ou laissé s'effacer ces vestiges qui, tout en rappelant une puissance aujourd'hui déchue et inoffensive, retraçaient encore le souvenir d'un bienfait.
Pendant que le monastère s'enrichissait aux dépens des offrandes données par les grands, la ville de Meymac s'était développée et avait pris assez d'importance pour obtenir du roi Charles VII des lettres patentes d'octroi afin d'en employer le produit à la réparation de ses murailles. Le document où elles sont consignées est daté de Tours, 13 juillet 1430. Nous en extrayons les principaux considérants
« Charles VII, roi de France, ayant reçu humble sup» plication des Consuls, manants et habitants de la ville » et châtellenie de Meymac en Limozin. Considérant que » cette ville de grande ancienneté avant les guerres qui » trop longuement ont duré en iciluy pays de Limozin. » La dicte ville qui est assise en frontière de nos enne» mis, estait une puissance et très belle ville, que les » tailles y ont été levées pour les réparations de fortifi» cations et y ayant été employées, la ville a de présent » très grand besoin et nécessité d'estre remparée et forti» fiée afin de résister aux entreprises de nos dits ennemis, » laquelle chose les dits suppliants ne pourraient bonne» ment faire ne fournir aux charges que pour cette cause » leur faudra scustenir. Sur ce pourquoi nous ce con» sidéré voulant pourvoir à la sùreté et défense de la dite » ville aux dits suppliants avons donné et octroyé, don-
» nons et octroyons de grâce spéciale par ces présentes, » congé et licence que pour faire les dictes réparations » fortifications et remparements pour leur sûreté, garde » et défense percevoir pendant cinq ans dans la ville et » châtellenie de Meymac les droits qui suivent » Sur chaque pinte de vin vendue en détail un denier » tournoi sur chaque queue de vin vendue en gros cinq » sols tournoi, sur chaque aulne de drap mesure de Paris, » deux deniers tournoi sur chaque aulne de toile grosse, » obole tournoi. Sur chaque quarte grosse de scèl vendu » deux deniers tournoi. Pour les deniers qui en issyront » tourner convertir et employer es-dites réparations, for» tifications et remparements et autres choses nécessaires » pour la seureté garde et défense de la dicte ville ainsi » que dessus est dict. Si donnons en mandement par ces » mêmes présentes à notre senéchal de Limozin ou à son » lieutenant que les dicts suppliants il fasse seuffre et » laisse jouir et user paisiblement et pleinement de notre » présent grâce congié et licence, sans les molester, per» turber ou empescher en quelque manière que ce soit et » qu'il ne fasse rien annexer soubs son scel en ces pré» sentes et si aucun empeschement leur estait fait mis au » contraire qu'il les oste ou fasse oster sans delai et mette » tout à plain
» Donné à Tours le XIIIe jour de juillet l'an de grâce » 1430 de notre règne le quatorzième (1). »
A l'époque où furent concédées ces lettres patentes, la couronne chancelait sur la tête du roi de France. Les Anglais étaient maîtres d'une partie du royaume et, pour comble de malheur, Jeanne d'Arc venait de tomber en leur pouvoir.
(1) Le denier représentait environ 14 centimes de notre monnaie la pinte de vin était donc grevée de 14 centimes, et l'aune de drap de 28 centimes.
Pour le peuple dont elle était l'héroïne et la fille, ce fut un immense sujet de tristesse et de deuil, et pour Charles VII, un évènement de nature à lui inspirer des mesures de précaution, soit contre les ennemis du dehors soit contre ceux de l'intérieur, car la vierge de Domrémy semblait tenir en ses mains les destinées de la France.
Sans avoir trop à redouter la puissance des anciens seigneurs féodaux, le roi, en songeant à sa propre sécurité, devait exciter chez ses sujets l'ardeur de la défense et leur en faciliter les moyens. Meymac, comme le disent les lettres patentes, située en frontière des ennemis, pouvait donc craindre encore une invasion des Anglais, ou au moins redouter les exactions et les ravages que commettaient les chefs des partisans dont les bandes pillaient les châteaux et rançonnaient les villes.
Un fait consigné aux archives de la municipalité d'Ussel, postérieur seulement d'une année à l'obtention des lettres patentes de Charles VII, sert à justifier la sagesse des mesures provoquées par les consuls de Meymac. C'était en 1431. Rodrigue de Villandrando, d'origine espagnole, chef au service du roi de France, quitta l'Auvergne dont il avait dépouillé les habitants et se dirigea vers Ussel, l'une des places principales du comté de Ventadour.
A la vue de ces bandes qui, durant leurs loisirs, vivaient de pillage et d'exactions, les habitants, saisis d'effroi, lui font proposer d'épargner la ville.
Rodrigue, qui n'avait d'autre but que le vol et le butin, accepte à charge de rançon. On se cotise alors le comte de Ventadour lui-même prête à la ville huit gobelets, un béringuin et une aiguière d'argent pesant neuf marcs deux onces et demie, et Rodrigue s'éloigne. Mais le total connu de cette rançon avait coûté aux malheureux Usselois 17,065 livres (1).
Tels étaient à cette époque les chefs de partisans on peut juger par là de la confiance qu'ils devaient inspirer et de l'intérêt qu'avaient les villes à être fortifiées.
Les lettres patentes de Charles VII ne constatent pas seulement l'ancienneté et l'importance relative de Meymac à l'époque où elles furent octroyées; elles démontrent encore l'influence qu'exerçait déjà la royauté, la politique nouvelle qu'elle inaugurait et le développement qu'avaient pris les communes. Ce n'est pas sur l'élément féodal, sur la noblesse, puisque le nom du comte de Ventadour n'est pas même prononcé, que le roi cherche son point d'appui. Il s'adresse aux habitants, aux consuls, et il impose aux agents royaux le devoir de faire réussir la nouvelle mesure, d'en surveiller l'exécution et de mettre tout à plain.
Ce sentiment de confiance mutuelle entre la royauté et le peuple, entretenu par la haine commune contre l'Anglais, va former l'esprit national et contribuer à créer l'unité du royaume. Aussi
(t) Les titres relatifs à cet épisode ont été reproduits par M. Paul Huot, dans son travail sur les archives municipales d'Ussel.
rien n'est plus curieux à étudier que l'histoire de cette époque, où chaque évènement semble dirigé par une main providentielle. La faiblesse et l'indolence de Charles VII, qu'on appela le roi bien servi, contribuèrent sans doute au succès de son règne en lui suscitant moins d'ennemis parmi la noblesse; mais la force réelle qui l'aida à dominer les événements, il la reçut de son peuple. Ce pei.ple eut foi en lui malgré ses défauts et malgré son ingratitude envers Jeanne d'Arc. La féodalité, cependant, n'était pas encore vaincue de nouveau elle essaya ses forces contre Louis XI. Après des succès et des revers alternatifs, le dernier coup lui fut porté par ce roi dont l'action décisive a été diversement appréciée, mais dont le caractère et la politique ont semblé, à bon droit, odieux au plus grand nombre. A cette même époque s'éteignit, faute de rejetons mâles, la haute lignée des Ventadour-Comborn, car. Charles, second fils du comte Robert etdlsabelle de Vandal, avait eu de son union avec Catherine de Beaufort une seule fille nommée Blanche, qui porta le comté vers 1472 dans la maison des Lévy-Lavoulte en s'unissant à Louis de Lévy, lequel prit le titre de comte de Ventadour.
La mort du comte Charles fit naitre chez les habitants de Meymac de vives inquiétudes; peutêtre même l'idée de se soustraire à l'autorité de son successeur leur vint-elle à l'espr it chacun dans la ville dut faire des conjectures, créer des hypothèses. D'où venait ce nouveau seigneur, quelle
serait son attitude, devait-on craindre, devait-on espérer? Et comme sans doute l'agitation croissait, excitée par l'esprit de rébellion, le nouveau comte fit promulguer, par les officiers du 3omté, la proclamation qu'on va lire
« Consouls de Maymac, je entands qu'il y a aucuns de » la ville de Maymac qui ont donné entendre au commun )) de la ville que je leur voulais faire perdre leurs privi» léges je ne leur veux rien innouer de leurs droits de » seux qu'ils ont accoutumé d'user et de Jouyr du tems » de feu, Monsieur mon père. Par ces présentes voulons » pardonner mais si depuis son trépas vous enlevz à nos » fils chouses indues et que si eussiez accoutumé de faire )) contre ma justice et mes droits de cela je suis bien )) délibéré de le faire réparer à ceux qui l'ont fait et )) comme premièrement je prends ma poussession je vous » en baille instrument et savez bien que je ne vous fis » ne tort ne offense et pour ce ne croyez point les paroles » de fous ne de méchantes gens car si vous le faites, vous » en repentirez et ne sera plus temps.
» Écrit à la Voulte ce XIX' jour de mars, Loys de Ventadour. »
Cette proclamation, à la fois énergique et conciliante, est une peinture exacte de l'état des esprits à Meymac en 1472, époque où elle dut être publiée. La commune vit déjà de'sa vie propre; elle a des droits et des priviléges, mais des devoirs lui sont imposés vis-à-vis du seigneur. De là une sourde agitation qui, pour se produire, a choisi l'heure d'une mort et d'un avènement. Les paroles "adressées par Louis de Lévy de Ventadour aux consuls de Meymac, qui devaient en comprendre le sens, ne peuvent laisser aucun
doute sur la loyauté de ses intentions. Pour les ramener il s'appuie plutôt sur le sentiment du droit que sur les moyens de violence et de force. Il veut reconnaître et respecter tous leurs privilèges; jamais il ne leur fit ni tort ni offense, mais il entend qu'on respecte les siens.
On voit que les liens sociaux étaient formés. Une promesse n'était plus un vain mot; les idées d'équité, de justice, de respect dû aux contrats étaient proclamées. Chez les grands comme au sein du peuple, la loi morale était comprise; il y avait donc progrès. Mais entre les différentes classes sociales le dissentiment était profond. La royauté et le peuple avaient une tendance commune diminuer les droits et l'influence des seUgneurs. Ceux-ci, au contraire, avec le secret pressentiment de leur déchéance future, résistaient et devenaient quelquefois agressifs. Alors les communes se hâtaient d'intervenir et portaient devant la justice royale la solution du différend chaque tentative d'empiètement, d'où qu'elle vînt, engendrait k résistance et troublait la bonne harmonie entre le suzerain et ses vassaux. Nous produirons quelques faits à" l'appui de cette assertion. Meymac avait quatre consuls annuellement élus qui géraient les affaires communes, possédaient l'exercice personnel de la juridiction, et auxquels était confié le dépôt des clefs des portes de ville. Un des vicomtes de Ventadour, dont le nom n'est pas indiqué, avait fait autrefois aux consuls la concession suivante
« Nous concédons que tout contradicteur ou » détracteur des dits consuls qui leur résistera » indûment ou ne voudra pas leur obéir en cho» ses pour lesquelles il leur est par nous concédé » de se faire obéir, puisse être par eux puni selon » qu'il leur paraîtra raisonnablement appartenir » jusqu'à ce qu'il soit venu à composition avec » les dits consuls. »
En 1458 les consuls Léonard Planet, Léger de Pinat, Léger de Mirambel et Jean de Herment, informés qu'une épidémie meurtrière régnait au pays d'Auvergne, établirent, pour échapper au fléau, une espèce de cordon sanitaire, en ordonnant.que des gardes seraient placés aux portes de ville pour qu'aucuns venant du lieu infecté ne puissent y entrer, et qu'une poterne appelée le Prinel resterait continuellement close jusqu'à ce que l'épidémie eût cessé.
Une nommée Agnès de Treygoite, femme d'un cordonnier, qui sans doute avait des raisons pour trouver incommode la consigne sévère donnée par les consuls, s'adressa à Léonard Planet afin d'obtenir la clef de la poterne. Pour réponse, elle eut un refus qui mit en jeu toute sa sensibilité et lui fixa la haine au cœur. La crainte du fléau, le salut de la ville, la .réflexion qui mûrit les pensées, le temps qui calme les passions, rien n'éteignit le désir de vengeance qui bouillait dans le cœur de la belle artisanne, et l'explosion eut lieu. C'était le dimanche suivant, sur la place publique, au milieu de la foule. Agnès, l'œil en feu, les cheveux déroulés, les coudes arrondis et
la main sur la hanche, aborde le consul Planet, l'injurie et le menace. Ainsi préludent les orages. Le rang, la gravité du magistrat consulaire, rien ne peut le sauver de la main qui le frappe à une, deux et plusieurs reprises, tant au visage qu'à la poitrine. Pareille action ne s'était jamais vue, et dans la ville on en jasa longtemps.
Mais ici-bas toute chose a sa fin; et comme les consuls menaçaient de poursuivre, Agnès, repentante, fit amende honorable, maudissant sa vivacité elle accepta pour juges et arbitres les trois collègues de Planet. On en passa contrat. Alors Léger de Mirambel et Léger de Pinat, réunis à Jean de Herment, instruisirent l'affaire en vertu des pouvoirs à eux conférés, du droit qu'ils tenaient des vicomtes de Ventadour de poursuivre et punir tous détracteurs de leurs actes. Après avoir mûrement réfléchi et tout considéré, les dignes magistrats fixèrent à cent sols l'amende encourue par Agnès au profit de la communauté. Plus sévères quant au fait relatif à leur collègue Planet, ils élevèrent à quatre écus d'or la réparation du dommage qu'on devait lui payer.
Benoît de Treygoite, en mari débonnaire, accepta la sentence et paya en beaux deniers comptants, sans se faire prier.
Tout n'était pas fini. Trois ans après, le procureur fiscal du comté revint sur cette affaire. Il accusa les consuls d'avoir usurpé la justice du seigneur de Ventadour et d'avoir porté la faulx sur la moisson d'autrui, en tenant cour par eux-
mêmes dans la ville de Meymac. Il conclut contre eux en cent livres d'amende, et à ce qu'ils fussent obligés de fournir des explications.
Le procès s'engagea. Quelle en fut la solution? Rien ne l'indique. Mais les consuls résistèrent aux prétentions du seigneur de Ventadour sur l'avis de Me Rigault, leur avocat, dont la consultation se termine ainsi
« Les consuls ont pu fixer et retenir l'amende et l'appli» quer à la communauté; et comme le cas ne s'était pas » présenté, il n'y a pas lieu à prescription. car les lois » sont faites pour que l'humaine audace soit contenue et » que l'innocence soit en sûreté au milieu des méchants, » et que chez ces méchants eux-mêmes l'audace et le pou» voir de nuire soient retenus par la crainte du supplice. » Autant doit être dit des dites franchises et libertés et de » la violence commise sur un consul; elle a pu et dû être » punie par les consuls pour servir d'exemple aux autres, » et un tel exemple est et fut utile à la chose publique. » Et, bien que le cas ne se fût pas encore présenté et que » jamais pareille punition n'ait été prononcée, et que ce » point ne soit pas présenté dans les dites franchises, ils » ont pu et pourront punir de tels actes s'ils se repro» duisent à l'avenir. »
Signé RIGAULT, sauf meilleur avis (1).
Il existe, à la mairie de Meymac, un autre manuscrit relatif à un procès soutenu par la ville contre Louis de Lévy, comte de Ventadour, auteur de la proclamation qu'on a lue plus
(1) Cette pièce, écrite en latin, a été traduite par M. Paul Huot, conseiller en la Cour de Colmar, et publiée dans le Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, en 1864. T. vm, î-e
haut. Ce titre, par lequel les habitants revendiquent le droit de chasse qui leur est contesté par le seigneur, ne manque ni d'énergie, ni de sentiment pratique. Rédigé en latin, nous en avons traduit les parties les plus saillantes afin qu'on pût juger de la forme et de l'originalité du style judiciaire employé au xv" siècle.
Au mois de juin 1496 se tinrent, à Meymac, des assises présidées par honorable maître Jehan Lageneste, juge ordinaire de magnifique et puissant seigneur Louis, comte de Ventadour, et où l'on proclama qu'il était interdit à toute personne non noble de chasser dans l'étendue du comté. Cette prohibition, publiée en un mandement légal, fut considérée par les consuls de Meymac comme portant atteinte aux droits et franchises des habitants. Ils y. formèrent donc opposition devant le sénéchal du Limousin et s'exprimèrent ainsi dans le mémoire qu'ils produisirent
« Meymac a été et est encore une notable ville close, » muréc et fortifiée depuis les temps anciens. Elle a pour » se défendre des tours et des murailles; elle a des portes » et des poternes. »
Item. Les consuls manants et habitants de cette ville depuis les temps anciens ont eu droit de chasser les bêtes féroces, les oiseaux de proie, les sangliers (apros), les mar cassins (operculos) les animaux sauvages, les lièvres et les perdrix.
hem. Les consuls et autres manants et habitants de cette ville ont plusieurs privilèges, ils ont des franchises, des libertés anciennes qu'ils tiennent aussi bien de l'autorité du roi que de celle des comtes de Ventadour. Item. Les consuls manants et habitants de Meymac furent autrefois et sont encore libres de redevances, exempts de ventes, de prestations de tailles à l'exception des tailles qu'ils doivent à notre sire le Roi. les impose de conserver et de défendre leurs franchises et leur liberté. Item. Les consuls manants et habitants de la ville ont des plaines, des bois, des prairies arrosées des terres froides, des monts des franx communs dont ils ont toujours eu la possession et la saisine.
Item. Les consuls manants et habitants de Meymac ont le droit de poursuivre et de saisir les animaux sauvages aussi bien dans leurs terres privées que dans celles d'autrui mais leur droit ne va pas jusqu'à chasser dans les forêts du comte.
Item. Les consuls manants et habitants de la ville ont le droit de chasser dans les eaux, les Étangs, les ruisseaux de la ville et chatellenie de Meymac, partout enfin, excepté dans les étangs du comte. On croirait entendre le chant d'un ancien barde ou d'un vieux chef gaulois répondant à une déclaration de guerre.
La chasse était autrefois considérée comme un plaisir auquel seule la noblesse avait droit, et il n'est pas étonnant que le nouveau comte de Ventadour voulût en interdire l'exercice à ceux que ne protégeait pas un blason. D'ailleurs l'esprit d'antagonisme était tel, entre l'élément féodal et l'élément populaire représenté par la commune, que les actes souvent les plus simples faisaient naître les conflits, qu'envenimaient presque toujours les conseillers et les hommes d'affaires.
(A suivre.)
CHAPITRE IV
Juridictions ecclésiastiques et féodales. Anne de Lévy 1", duc de Ventadour. La dîme: son origine. Cens et rentes. Le château d'Ambrugeac et Hugues de Beynette. Constitution de l'ancienne propriété; rapports entre seigneur et tenancier.-Acte d'aliénation du 21 avril 1449. Origine des noms patronymiques Jean du Boucheron, prieur et curé d'Ambrugeac. Droit de guet. Le Jassonets et Croiziat. La Feuillade et Gouale. Droits de lods et ventes. -Abbés; leur nomination; police intérieure du monastère; bénéfices ecclésiastiques; bénéfices ou commande. M. Jean-Ozène de Basville. Derniers abbés de Meymac cérémonial de l'installation de l'abbé. La peste de 163t. Chapelle votive à saint Roch. -La pomme de terre importée par Turgot. Taux et revenus de l'abbaye. Tableau comparatif du rendement des terres. Rentes portables et rentes quérables.
ndépendamment de ses richesses et de l'influence morale, l'Église possédait encore, au moyen de la juridiction ecclésiastique
et seigneuriale, une immense autorité dont nous allons dire quelques mots.
Ses premiers pouvoirs judiciaires furent modestes au début, car, en principe, les juges d'église ne connurent que des procès des clercs, des ermites, ou des moines laïques. Plus tard, ils retinrent les affaires où étaient intéressés les pauvres, les veuves, les orphelins. Ils statuèrent ensuite sur les discussions relatives aux mariages et aux conventions matrimoniales, aux testaments,
lorsque ces actes étaient reçus par des prêtres, ce qui se produisait fréquemment (1). Ils s'attribuèrent enfin la connaissance des crimes de parjure, de sacrilège, d'adultère, et de toutes les causes où il y avait péché. Cette simple énumération suffit à faire comprendre l'étendue de la juridiction ecclésiastique, qui fut restreinte en 1539 par une ordonnance de François le. A ce sujet, Loyseau s'exprime ainsi dans son Traité des seigneuries
« Toutes ces entreprises de la justice ecclésias» tique ont été tranchées fort bien et à petit bruit » par l'ordonnance de 1539 qui, en six lignes, » l'a remise au juste point de la raison.
» Étant à Sens dans ma jeunesse, j'ai ouï-dire » à deux anciens procureurs d'église qui avaient » vu les temps précédents, qu'il y avait alors plus » de trente procureurs en l'officialité de Sens, tous » bien employés, et qu'il n'y en avait que cinq ou » six au bailliage, bien que ce fût un des quatre » grands bailliages de France; et maintenant, tout » le contraire, il n'y a que cinq ou six procureurs » morfondus en l'ofFicialité, et il y en a plus de » trente au bailliage. »
Quant à la justice laïque, durant le règne des rois de la première race, elle était rendue dans chaque cité par les magistrats municipaux, sous l'autorité des comtes ou ducs. Après l'établisse-
(1) Le 13 octobre 1C59, M. Antoine Faure, vicaire d'Ambrugeat, reçut le testament d'une nommée Léonarde Saulière, et il termine son acte par ces mots Cette femme est fort pauvre; elle m'a fait appeler parce qu'elle a été tropescorcjèe des notaires.
ment définitif de la féodalité, le pouvoir judiciaire fut exercé par les seigneurs ou par les juges royaux, au moins pour les causes civiles, car Charles IX, par son édit de J 560, ordonne « aux » échevins, capitouls, consuls qui ont eu ci-devant » ou présentement exercice des causes civiles, cri» minelles et de police, de continuer l'exercice » du criminel et de police sans pouvoir s'entre» mettre de la connaissance des affaires civiles. » Le droit de justice qu'avaient les seigneurs n'était pas le même pour tous les uns n'exerçaient que la basse justice, tandis que d'autres avaient le privilége d'exercer les trois degrés de basse, moyenne et haute justice.
A côté et au-dessus de la justice seigneuriale, existait la justice du roi, représentée à son degré inférieur par les sénéchaussées ou bailliages dont les décisions, en cas d'appel, étaient soumises aux parlements ou présidiaux. Quant aux jugements rendus par celui qui avait la basse ou moyenne justice, ils pouvaient être réformés par le juge supérieur, tout comme pouvaient l'être par la justice royale toutes les sentences, indistinctement, qui émanaient des seigneurs.
La féodalité et le pouvoir royal, comme le prouve l'édit de Charles IX que nous avons rapporté, s'attribuèrent, au moins quant au civil, l'autorité judiciaire qu'exerçaient anciennement les municipalités, qui n'ont conservé de ces attributions que le droit de connaître des contraventions de simple police; mais de ces faits résulte aussi la preuve que le droit de juger résidait ancien-
nement dans la nation. C'est ainsi, d'ailleurs, que se pratiquèrent les choses dans notre pays, et nous en trouvons un exemple dans les assises qui se tinrent à Meymac en 1496, à l'occasion du procès que soutinrent les consuls contre le comte de Ventadour, et dont les détails sont au chapitre premier. Il est vrai que ces assises étaient présidées par un délégué du comte, mais ce dernier ne prenait aucune part au jugement il présidait l'assemblée, il dirigeait les débats, et peut-être aussi avait-il mission de faire exécuter la sentence que rendaient les notables réunis. Cet état de choses se modifia insensiblement, et il vint une époque où les seigneurs, par eux-mêmes ou par des préposés, rendirent la justice sans le concours des habitants. Leur pouvoir judiciaire s'amoindrit ensuite, à mesure que se développa l 'autorité royale; le souverain fut considéré comme le dispensateur suprême de la justice en France. C'est en vertu de ce dernier principe que nous avons vu, portés devant le sénéchal de Tulle, siège de la justice royale, et devant le Parlement de Bordeaux, les nombreux procès qui surgirent entre le monastère de Meymac, le clergé séculier et les habitants, sans que jamais l'un d'eux ait été déféré au sénéchal de Ventadour.
On retrouve, dans notre pays, l'application des principes généraux que nous venons d'indiquer au sujet de la juridiction seigneuriale. Les seigneurs d'Ambrugeat, de même que les comtes de Ventadour, avaient la haute) la moyenne et la basse justice, mais les premiers usèrent peu de ce droit
féodal dont l'exercice était coûteux. Quant aux Ventadour, ils entretenaient un juge dans les principales localités de leur comté; ainsi, ils eurent toujours à Meymac un représentant de leur justice qui prenait le titre de juge de la châtellenie. Ceux de leurs vassaux qui avaient droit de justice entretenaient à leur tour un juge dans un des lieux qui leur était soumis. L'abbé de Meymac, en sa qualité de seigneur féodal, avait un juge. Bonnesagne, Davignac, Rochefort, St-Germain-la-Volps, et une foule d'autres petites localités, avaient aussi leur juge, dont la juridiction ne s'étendait souvent que sur un territoire fort restreint. Les appels des décisions rendues par ces juges inférieurs étaient portés devant le lieutenant du comte, qui représentait sa haute justice. En 1578, le roi Henri III nomma duc de Ventadour Gilbert de Lévy, qui n'avait que le titre de comte de Vcntadour. Cette érection du comté en duché amena des modifications dans l'ordre judiciaire, et l'on établit à Égletons la sénéchaussée ducale, c'est-à-dire le siége judiciaire du nouveau duc, dont le président avait le titre de lieutenant-général. En 1599, le sénéchal d'Égletons fut transféré à Ussel, et le premier lieutenantgénéral qui siégea dans cette dernière ville fut Nicolas Dupuy, de Meymac.
Cette translation du siège ducal, qui a valu à Ussel le titre de chef-lieu administratif et judiciaire, fut un fait important pour cette localité et doit faire date dans son histoire. Elle fut
accomplie le 15 novembre 1599 par Anne de Lévy, duc de Ventadour.
Quelques détails biographiques sur l'auteur de cette mesure, si féconde en résultats pour les habitants d'Ussel, ne seront pas déplacés ici. Nous les avons extraits d'un vieux livre intitulé Les Chevaliers du Saint-Esprit.
Anne de Lévy, duc de Ventadour, fut pair de France, sénéchal et gouverneur du Haut et du Bas-Limousin, et lieutenant-général du roi au gouvernement de Languedoc. En 1581 il partit, jeune encore, pour aller guerroyer en Flandre avec le duc d'Alençon, qui l'affectionnait particulièrement. Arrivé sous les murs de Cambrai, qu'occupaient les Espagnols, il essaya de s'introduire dans la ville par un audacieux coup de main; mais sa tentative fut aperçue, déjouée, et la petite troupe qu'il commandait fut repoussée et mise en déroute. Seul alors sur le lieu du combat, et entouré de cinq cavaliers ennemis, il tint tête à ses adversaires, eu blessa trois mortellement et ne déposa son épée que lorsque son cheval se fut affaissé sur lui-même. « Très jeune encore, rapporte la chronique, et chéri d'une belle et grande dame, il reçut glorieusement le baptême du feu, et son intrépidité courageuse fit grand bruit à la cour. »
En 1589, il se rendit à son gouvernement du Limousin, où il fit si habilement la guerre qu'il parvint à reprendre en peu de temps les villes de Brive et de Tulle, ainsi que les forts d'Eymoutiers et de Bellechassagne qui étaient au pou-
voir des ligueurs. Peu de temps après, il fut chargé d'étouffer une sédition que le vicomte de Pompadour et l'évêque de Limoges avaient fomentée dans cette dernière ville, et l'on va juger de quelle froide énergie fit preuve, dans cette circonstance, le descendant de ces farouches Comborn, pour lesquels le meurtre était un jeu d'enfant, et la vie humaine un fétu.
Anne de Lévy de Ventadour, arrivé à Limoges pour remplir sa mission, est informé qu'un moine capucin, tout dévoué à l'évêque et au vicomte de Pompadour, a vomi dans son sermon d'atroces invectives contre la mémoire d'Henri III et contre Henri IV, et qu'après avoir soufflé le feu de la révolte, il est sorti de l'église suivi d'une foule nombreuse, tenant un crucifix d'une main, et de l'autre une épée flamboyante.
Ventadour se trouvait alors à l'hôtel de ville, entouré des consuls. Il voit le moine s'avancer; lui-même lui ouvre la porte, le saisit par la barbe, le fait pendre sous ses yeux, et ordonne que son cadavre soit jeté par la fenêtre. Après l'exécution de cet ordre, il quitte l'hôtel de ville et traverse la foule, qui serait devenue audacieuse, insolente et terrible s'il avait paru la craindre, tandis qu'elle se dissipe devant lui sans proférer une menace.
Le 15 novembre 1591, Henri de Noailles, Thémine et Saillant vinrent le joindre; il attaqua, près de Souillac en Quercy, les beaux-fils du duc de Mayenne, dont les troupes furent mises en
complète déroute. Cette victoire fut très importante et eut pour effet d'affaiblir et de déconsidérer le parti de la ligue dans le Quercy, le Rouergue et le Périgord.
L'année suivante, il se rendit en Languedoc et servit très utilement Louis de Montmorency, son oncle, qui devint connétable, et dont il épousa la fille Marguerite en 1593. Le 27 février 1594, il fut désigné pour représenter le comte de Champagne au sacre et au couronnement de Henri IV. Quoique beau-frère du prince de Condé et très ami de MM. de Vendôme, il ne prit part à aucune ligue pendant la régence de Marie de Médicis, et il se tint éloigné de toutes les factions. Le 15 janvier 1599, il fut nommé chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, et en 1622, il tint les États de Languedoc. Il paraît que la cour lui avait promis d'accorder aux États la faveur que ces derniers lui demanderaient, mais la cour changea d'avis, et le chagrin que lui causa ce désaveu amena sa mort le 3 décembre de la même année. Revenons à notre sujet, que ne doit point nous faire oublier cette légère digression. Avec l'ancienne organisation féodale, avec une église doublement puissante, avec des couvents, des communes qui s'administraient à peu près à leur gré, il était diflicile de fonder la grande unité française qui fut l'œuvre du temps, de la royauté et de la nation elle-même. Le pouvoir royal chercha, en effet, à concentrer dans ses mains la puissance et l'autorité disséminées
ailleurs, et de cette politique continuée durant plusieurs règnes naquit la France, qui jusquelà était à peine ébauchée. L'application de ce nouveau système gouvernemental amena la déchéance de la féodalité. L'Église elle-même fit des pertes tout en conservant néanmoins de nombreuses ressources qu'il serait trop long d'énumérer. Cependant nous dirons un mot de la dîme, dont la perception constituait un des principaux revenus de l'abbaye de Meymac et de tous les établissements religieux en général.
L'usage de la dîme repose sur la nature même des choses. Le prêtre doit vivre de l'autel. Dans les pays où les biens du clergé sont séculaires, la dîme a été remplacée par l'impôt du culte ou le budget du culte. Pourvoir au besoin de l'Église est une nécessité sociale parce que c'est une prescription de Dieu. – La parole de l'Évangile est formelle à cet égard.
L'origine des dîmes n'est pas établie d'une manière bien exacte; et sans remonter aux temps anciens, nous nous bornerons à constater que la perception de cette redevance fut admise dans notre pays d'une manière à peu près uniforme, à partir de Charlemagne et de ses successeurs. Beaucoup considérèrent la dime comme un acte de piété, comme une offrande que l'homme devait à Dieu représenté par son Église, tandis que d'autres s'y soumirent par esprit de superstition. Pour ces derniers, donner à l'Église, c'était en quelque sorte acheter son salut et garantir la
conservation de ses biens terrestres contre les fléaux et les vicissitudes de l'avenir.
La dîme équivalait, ainsi que l'indique son nom, à la dixième partie des fruits de la terre ou du produit des animaux. Aussi était-elle soumise à des variations fréquentes causées par l'abondance ou par les disettes qui pouvaient se produire périodiquement. En principe, le produit du travail industriel était soumis à la dîme; mais en fait, et à de rares exceptions, l'usage de percevoir un droit sur l'œuvre de l'artisan ne se généralisa pas et tomba en désuétude. Le décimateur, c'est-à-dire celui qui percevait la dîme, ne pouvait en général invoquer aucun titre écrit en faveur de son droit, mais en cas de résistance de la part d'un assujetti. Ce réclamant était admis à prouver que lui-même ou ses prédécesseurs avaient perçu la dîme, et la justice alors consacrait ses prétentions. Uniquement dues à l'Église dès leur origine, les dîmes devinrent cependant aliénables au moyen de transports qu'en firent souvent à des personnes laïques les évêques, les curés ou les communautés religieuses. Après leur aliénation elles changeaient pour ainsi dire de caractère, et le droit ancien leur donna un rang à part en les désignant sous le nom de dîmes in féodées (1).
(1) Nous trouvons un exemple de dîmes inféodées dans la paroisse de Peyrelevade. Le 18 juin 1510, le curé de Peyrelevade vendit à M. Duboucheron, seigneur d'Ambrugeat, les dîmes de cette paroisse. Durant le xvna siècle, la curé nouveau de cette paroisse attaqua cette inféodation et la fit annuler par le Parle-
Indépendamment des dîmes, le sol était grevé de redevances féodales, cens ou rentes qu'on payait aux seigneurs, en échange le plus souvent de l'abandon de propriétés qu'avaient fait ces derniers et qu'on désignait sous le nom de terres non nobles ou tenues en roture (1).
Les cens et les rentes no représentaient d'ailleurs qu'une partie des charges imposées au sol ou aux habitants. Il existait encore une foule de droits, de prestations en nature ou de services personnels quelquefois ridicules. Ajoutons cependant que dans la plupart des cas on pouvait, au moyen d'une somme d'argent, se soustraire à une partie de ces obligations.
ment de Bordeaux, par suite de l'impossibilité où se trouva l'héritier de M. Boucheron de justifier d'une copie de son titre, qui cependant était relaté dans un inventaire fait après le décès de dame Jeanne de Duvas.
(1) De là est venu le nom de roturier, qui signifiait travailleur de terre, en latin ruptuarius, celui qui rompt, qui défriche le sol.
II
Comme presque toutes les localités d'une certaine importance, Meymac avait son clergé séculier, ses moines, ses notables bourgeois, et l'on voyait dans ses environs des terres seigneuriales. Un des châteaux les plus remarquables était celui d'Ambrugeat, auquel se rattachent de vieux souvenirs par le rang élevé qu'occupèrent ses anciens possesseurs dans la société féodale. Construit sur une plate-forme au pied du Puy-Richard, il est encore debout quand près de lui les murs
et les terrasses croulent. Les hêtres, qui jadis abritaient ses abords, ont été mutilés. La prairie, les moulins, le ruisseau qui courait à ses pieds se sont soustraits au vasselage; il est seul aujourd'hui, et malgré ses robustes assises et ses contremurs vigoureux, son vieux toit délabré fait présager sa ruine.
Au xive siècle, la seigneurie d'Ambrugeat appartenait à Hugues de Beynette, dont les possessions territoriales étaient considérables. Ce personnage ne nous est pas inconnu; déjà nous avons vu son nom figurer à l'acte de donation que fit la comtesse de Ventadour au monastère de Meymac le 5 avril 1434, et il est le plus ancien des seigneurs d'Ambrugeat dont nos recherches dans la localité nous aient permis de bien constater l'existence.
Quelques détails sur les rapports qui existaient autrefois entre les seigneurs et les hommes attachés à leurs terres, et sur la constitution de l'ancienne propriété, ne sauraient être déplacés ici. Ils faciliteront l'étude des modifications successives qui s'accomplirent, et permettront de mieux saisir l'ensemble du chemin parcouru jusqu'à nos jours. Lorsque les grandes familles féodales eurent été mises en possession du sol, elles subirent forcément la loi du travailleur et furent contraintes d'en abandonner une partie aux habitants, qui leur payèrent certaines redevances. Par cet abandon, le seigneur fut censé avoir transmis la propriété utile et s'être réservé la propriété directe; aussi le nommait-on, en langage juridique, pro-
priétaire du fief dominant, tandis que le détenteur était désigné sous le nom de propriétaire du fief servant. Au-dessous de cette classe, tributaire et vassale, il en existait une autre plus infime la classe roturière. Parmi ceux qui en faisaient partie, quelques-uns étaient libres, tandis que d'autres étaient en état de servage, et on les nommait serfs.
Avec le temps les prérogatives du seigneur, qu'on appelait aussi le suzerain, se modifièrent et s'amoindrirent. Il ne conserva, sur les terres par lui délaissées, qu'un droit presque fictif et plus honorifique que réel. Le vassal, au contraire, réunit sur sa tête tous les avantages que donne le titre de propriétaire, à l'exception du pouvoir d'aliéner, qui lui fut rigoureusement interdit; mais l'usage excessif que pouvait faire de ce droit le suzerain, l'intérêt même de ce dernier, le firent tomber en désuétude, et la faculté d'aliéner fut reconnue au vassal, à la charge par lui d'acquitter une taxe appelée droit de lods ou de vente. Toutefois, le seigneur conserva la faculté d'exercer le retrait, féodal, c'est-à-dire qu'il lui fut loisible de se substituer à l'acquéreur en payant au vendeur le prix convenu.
Malgré ces privilèges, les revenus de certains seigneurs allaient sans cesse en s'amoindrissant. Les guerres, les croisades avaient appauvri la noblesse; le numéraire était rare, la terre mal travaillée; de maigres récoltes, et insensiblement, par la force même des choses, la possession du sol revint à ceux qui savaient et qui voulaient
le cultiver. Cependant les seigneurs ne consentirent à aliéner leurs terres que sous l'empire d'une nécessité absolue, et dans ce cas extrême, ils usèrent encore d'un détour et employèrent la forme des baux perpétuels ou emphytéotiques, en se réservant toutes leurs prérogatives féodales. Ils délaissaient au preneur la jouissance du sol et de ses produits, et ce dernier s'obligeait à payer ou une somme d'argent, ou des rentes annuelles et perpétuelles. Cet usage, qui s'est continué jusqu'à la Révolution, est un indice du soin rigoureux qu'apportait la noblesse à maintenir entre elle et les classes inférieures une ligne de démarcation bien tranchée; il prouva encore qu'une modification lente, mais réelle, s'était accomplie au sein de la nation, malgré les obstacles de toute nature qui semblaient s'y opposer.
Afin de compléter le tableau des modifications successives que subit anciennement le droit de propriété, et des moyens qui aidèrent à ces changements, nous n'irons pas au loin chercher des exemples. La reproduction des parties les plus saillantes de certains actes qui ont trait à notre sujet, puisqu'ils concernent les seigneurs d'Ambrugeac, permettra d'étudier sur les lieux mêmes les faits et les conséquences que nous avons voulu mettre en lumière. Les détails contenus dans ces titres, plus saisissants qu'une longue dissertation, en en faisant ressortir les anciennes pratiques et l'esprit du droit féodal, inspireront une idée plus vraie de l'état des mœurs et des usages d'une époque dont on aime à médire, et qui fut le
prélude de notre organisation sociale et des réformes qui se sont accomplies.
Voici un de ces actes; il nous paraît assez intéressant pour mériter d'être reproduit dans son texte original, que nous traduisons en regard; il porte la date du 21 avril 1449
In nomine Domini, amen.
Nota quoi, il loco de Ambrugeaco Lemovicensis diocesis die vigesima prima mensis aprilis pmno Domini millesimo quadragesimo nonno presentibus Joanne del Goumois presbytero, et Petro del Goumois ejusdem parochix deAmbrugeaco personalis constitutus nobilis et discrelus vir Hugo de Beyneta in utroque jure bachelarens dominicus de Ambrugeaco qui gratis scientè et provide, prose et suis arrenduavit accensavit affermavit, et in emphiteos inperpetuum tradidit et investivit Petro de Laubar ejusdem parochise de Ambrugeaco ibidem presente et prose et suis stipulante, mansam, locum, et tenementum suum vulgariter nun cupatum de Las Bordas, situm in eadem parochix
Au nom de Notre-Seigneur, ainsi soit-il.
Il est notoire qu'au lieu d'Ambrugeac, diocèse de Limoges, le vingt-et-unième jour du mois d'avril, l'an du Seigneur mil quatre cent quarante-neuf, en présence de Jean du Goumoueix, prêtre, et de Pierre du Goumoueix, de la même paroisse d'Ambrugeac, personnellement constitué noble et de discrète personne Hugues de Beynette, bachelier en l'un et l'autre droit, seigneur d'Ambrugeac, lequel de son gré et science certaine pour lui et les siens a arrenté, accordé, affermé, et en emphytéose pour toujours a livré et investi Pierre de Laubar, de la même paroisse d'Ambrugeac, ici présent, pour lui et pour les siens, stipulant la manse, lieu et tènement lui appartenant, vulgairement appelé de Las Bordas, situé dans la
de Ambrugeaco confrontatum cum dicto loco de Laubar et cum alio loco de Las Bordas domini Jacobi de Bosco militis et cum paturalibus villx de Jfeymaco. Arruendavit insuper et perpetuo invessivit magister Hugo pro se et suis eidem Petro de Laubar medietatum pro indiviso cujusdam paturalis sive territorii vulgariter nun cupati de Las Maliardas, ejusdem parochix de Ambrugeaco quod quidem paturale tlt ipso partes dixerunt est et esse ab antiquo commune inter dictum locum de Las Bordas pre-arendatum et alium locum de Las Bordas Domini Jacobi de Bosco, militis Sub juribus et sub annuis censibus reditibus, vinata, lailliis et servitiis antiquis et videlicet duodecim solidorum et sex denariorum monetse communiter curentis quatuor sextariorum selliginii, trium sextariorum avense mensure de Maimaco, unius paris bovum vinatx et unius gallinx anno et perpetuo solvendorum et portandorum, per dictum Petrum de Laubar, Hugoni,
même paroisse d'Ambrugeac, confrontant avec le dit lieu de Laubar et avec autre lieu de Las Bordas, appartenant au seigneur Jacques de Bosco, écuyer, et avec les pâtureaux de la ville de Meymac. Maître Hugues a arrenté en outre et pour toujours, investi pour lui et les siens le dit Pierre de Laubar de la moitié par indivis d'un certain pâturai ou territoire, vulgairement appelé de Las Maliardas, situé dans la même paroisse d'Ambrugeac, lequel dit pâtural, ainsi que les parties mêmes l'ont déclaré, est, et a été, depuis les temps anciens, commun entre le dit lieu de Las Bordas, sus-arrenté, et autre dit lieu de Las Bordas, du seigneur Jacques de Bosco, écuyer
sous la réserve des droits, des cens et des rentes annuels, vinade, tailles et services anciens et savoir de payer douze sols et six deniers de monnaie communément courante, quatre setiers de seigle, trois setiers d'avoine mesure de Meymac, une paire de bœufs de vinade, et une poule par année, et qui perpétuellement devront être
T. VIII. 4-8
domino de Ambrugeaco, lailliis expletis et servitiis, secundum usum et xonsentudinem, commilatus Ventadoris terminis et temporibus licitis et consentis et oportunis. fuit dictum appointatum et accordatum, inter easdem partes quod idemPetrus de Laubar pro se et suis tenebitur juvare ipsum dominum de Ambrugeaco et suos in suis filiabus maritandis et sibi dare pro quolibet dictarum filiorum ratione taillée, unum regalem minimum pauderis trium denariorum sen ejuslégitimant valorem.
et voluit idem dominis de Ambrugeaco et perpetuo concessit quod idem Petrus et sui pro se per suos famulos et allocatos, possit capere in nemore suo de 1 Cubessa suwin ealfagium tandiu quam dien dictum locwn de Las Bordas et sui tenebunt et non ultra Et Petrus de Laubar, gratis, pro se et suis recognivit et confessus fuit se esse homo dicte domini de Ambrugeaco, taillabilis
payés et portés par le dit Pierre de Laubar à Hugues, seigneur d'Ambrugeac, les tailles, exploits et services, selon l'usage et la coutume du comté de Ventadour, aux termes et temps licites accoutumés et opportuns. il a été dit, convenu et accordé entre les mêmes parties que le même Pierre de Laubar, pour lui et les siens, sera tenu d'aider le même seigneur d'Ambrugeac et les siens quand il mariera ses filles, et de lui donner pour chacune des dites filles, à raison de la taille, un écu royal du poids de trois deniers ou sa légitime valeur. et a valu le dit seigneur d'Ambrugeac et a perpétuellement concédé que le dit Pierre et les siens, par lui-même et par ses serviteurs et locataires, puisse prendre dans son bois de la Cubesse son chauffage aussi longtemps que le dit lieu de Las Bordas sera détenu par lui ou par les siens, et non au-delà. Et Pierre de Laubar, de son plein gré, pour lui et pour les siens, a reconnu et confessé être homme du dit seigneur d'Ambrugeac, taillable et exploitable comme les m trTTT A a
et exploitabilis est alii homines commitatus Ventadoris, et secundum valorem dicti loci de Las Bordas, et tencri portare et solvere census et redditus quod promisit Et voluerunt partes compelleri per curias dominorum seneschalis regii Lemovicensis, commitatus Ventadoris domini officialis Lemovicensis et ipsius domini de Ambrugeaco.
autres hommes du comté de Ventadour, et suivant la valeur du dit lieu de Las Bordas, et être tenu de porter et payer les cens et les rentes ce qu'il a promis. Et les parties sont soumises pour l'exécution de leurs engagements à la juridiction des cours des seigneurs du sénéchal royal du Limousin, du comte de Veutadour, de monseigneur l'official du Limousin, et du seigneur d'Ambrugeac lui-même Cet acte, par les faits qu'il mentionne, par les conventions dont il cherche à consacrer l'existence et la durée, par les usages dont il rappelle le souvenir, a presque un caractère historique; nous n'en analyserons pas les détails; nous nous bornerons à mettre en relief les points les plus intéressants. Les vastes possessions ne manquent pas au seigneur d'Ambrugeac; mais sans travail, la terre est inféconde. Hugues de Beynette délaisse à Jean de Laubar, son voisin, deux tcnements qui lui appartiennent et un droit de chauffage dans sa forêt de la Guhesse. Indépendamment des charges nouvelles qu'il impose au preneur, Hugues se réserve les cens, rentes, tailles, vinade et services accoutumés; il exige la reconnaissance de son titre de suzerain en faisant déclarer à celui qu'il investit qu'il est homme du seigneur d'Amhru-
geac, taillable et exploitable comme les autres hommes du comté de Ventadour, et proportionnellement à la valeur du bien qui lui est concédé. Pour un surcroit de revenu modique, il se dépouille de ses terres, il grève d'une lourde servitude sa forêt, il attaque l'intégrité de ses domaines, mais il maintient rigoureusement son droit féodal et fait déterminer à l'avance la quotité d'or qui lui sera livrée lorsqu'il mariera ses filles (1).
Tous ces détails ont leur importance; ils nous initient à l'état des mœurs, à l'esprit de l'époque, aux besoins qui demandaient satisfaction, aux idées et aux sentiments des classes qui formaient la nation française, tout en nous dévoilant les usages et les pratiques qui facilitèrent le démembrement de là propriété féodale. Tout est clair dans cet acte; les droits et les devoirs réciproques y sont nettement définis; et afin de ne laisser subsister aucun doute sur la compétence des juges qui pourraient connaître de l'exécution du contrat, les parties acceptent indistinctement ou la justice du roi, ou celle du comte de Ventadour, ou la justice ecclésiastique, et jusqu'à celle du seigneur d'Ambrugeac lui-même. La reconnaissance et l'aveu que fait Pierre de Laubar d'être homme du seigneur d'Ambrugeac, taillable et exploitable comme les autres hommes du comté de Ven-
(1) Il résulte de cette clause que le seigneur d'Amhrugeac percevait la taille aux quatre cas. Le mariage de la fille du seigneur donnait lieu au paiement de cette taxe.
tadour, n'implique pas l'idée d'une égalité parfaite entre les seigneurs d'Ambrugeac et les comtes de Ventadour. Le droit de suzeraineté de ces derniers s'étendait sur Ambrugeac aussi bien que sur Meymac, et par cette clause, Hugues de Beynette exigeait uniquement de son vassal ce que le comte de Ventadour pouvait exiger de lui-même. Enfin, nous terminerons cette dissertation déjà trop longue par une dernière observation; elle a trait aux noms des parties. L'origine du nom de famille est difficile à trouver, et si parfois l'homme a imposé le sien à certaines localités, en général le contraire a eu lieu, surtout dans les familles anciennes, dont les descendants prenaient le nom d'une propriété ou d'un lieu tributaire. Longtemps après l'avènement du christianisme, le nom de baptême fut seul employé pour désigner la personne mais cet usage tomba en désuétude dans les villes où, pour éviter la confusion, on fut obligé de distinguer chacun par un terme quelconque ou par une désignation particulière. Dans les campagnes, où la population était moins dense, on joignait au nom de baptême que portait chaque individu le nom de son village ou de son hameau, et c'est probablement en vertu de cette ancienne pratique que le seigneur d'Ambrugeac, Hugues, nous semble se nommer Hugues de Beynette. Beynette est le nom d'un village peu éloigné d'Ambrugeac, où a existé un ancien château, et qui devait être le siège de la résidence de ce seigneur. Jean de Gouinoueix et Pierre de Goumoucix, qui sont les témoins de cet acte,
devaient simplement s'appeler Jean et Pierre; le mot Goumoueix indique le lieu de leur demeure. C'est aussi le nom d'un village de la commune d'Ambrugeac. Nous en dirons autant de Pierre de Laubar, l'un des contractants; son nom est Pierre, et Laubar est le nom de son village. Ce qui le prouve surabondamment du reste, c'est que le notaire-rédacteur a soin de dire, dans son acte, que le tènement de Las Bordas, cédé à Pierre de Laubar, confronte avec le dit lieu de Laubar (cum dito loco de Laubar), sans assigner à la partie aucun autre lieu de résidence, et sans avoir dit ailleurs que Laubar était un village. Le dernier nom produit est celui de Jacques de Bosco, écuyer, et nous avouerons sans peine que ces mots de Bosco, pour ceux qui considèrent à tort, selon nous, l'emploi de la particule comme un signe de noblesse, ressemblent assez à un nom de famille. Mais notre sentiment n'en est pas modifié, et nous croyons qu'ils désignaient aussi une localité, un lieu, même une seigneurie. Dans de vieux titres de la fin du xve siècle, les mots de Bosco, sont remplacés par ceux-ci du Bois ou des Bois; on disait indistinctement alors le seigneur du Bois, ou le seigneur des Bois, pour désigner le détenteur de la terre seigneuriale du Jassonets. Le mot Dubois paraît être la traduction du vieux mot de Bosco, et ceux qui, déjà au xme siècle, employaient cette expression, entendaient peut-être appeler ce seigneur le seigneur du Bosquet, ou plus poétiquement le maître du Bocage. Nous n'avons pu re-
trouver les noms des successeurs immédiats de Hugues de Beynette; mais à partir du xvie siècle, nous voyons la seigneurie d'Ambrugeac soumise à Jean du Boucheron, qui devint l'époux de Catherine de Soudeilles (1).
Cette union fut féconde et bénie; huit enfants en provinrent six garçons et deux filles. L'une de ces dernières entra en religion et passa sa vie à l'ombre du cloître de Bonnesagne. L'aîné des fils étant mort, Gilebert du Boucheron, son frère cadet, devint le chef de la famille et vit successivement mourir et disparaître ses autres frères, à l'exception de l'un d'eux, Jean Duboucheron, qui entra dans les ordres et fut nommé prieur ej, curé d'Ambrugeac, où il mourut le 27 avril 1690. Un vague souvenir des vertus et de la piété de cet. ancien prieur s'était perpétué jusqu'à nos jours; mais il existe un témoignage écrit de l'estime qu'eurent pour lui ses contemporains. La haute opinion qu'avaient conçue de son mérite les prêtres d'Ambrugeac, ses collaborateurs, est justifiée par les exemples de foi vive, d'abnégation, d'humilité chrétienne, de dévouement aux malheureux qui abondent dans le récit naïf et sincère qu'ils ont fait de sa longue existence, et dont voici quelques extraits
« En l'an de grâce 1690, vingt-septième d'avril, s'en alla à Dieu la belle âme de noble messire Jean Duboucheron d'Ambrugeac, prieur, curé
(1) II existe dans la commune de Davignac, et très près de la commune d'Ambrugeac, un village qui porte le nom de Boucheron.
d'Ambrugeac et de son annexe de Barsanges, environ les six heures du soir, un dimanche, ayant communié dix ou douze fois en viatique et reçu l'extrême-onction même la pénultième fois, dans le dessein de gagner le jubilé universel de notre saint-père le pape Alexandre huitième; fut enseveli le vingt-neuvième du dit mois et an dans le cimetière du dit Ambrugeac, selon sa dernière volonté par testament, le tout avec grande solennité selon son mérite, avec un grand concours de MM. les curés et prêtres du voisinage, de noblesse, de paroissiens et de pauvres, âgé de soixante-dix-huit ans.
» Le jour de son enterrement se trouva être le jour de la Décollation de saint Jean-Baptiste, son patron, auquel il était fort dévot.
» Il était né, au rapport de ses parents et contemporains, l'an 1612, le vingt-cinquième d'octobre, jour du martyre de saint Crépin, saint Crépinien, de noble Jean Duboucheron d'Ambrugeac et de demoiselle Catherine de Soudeilles, qui le destinèrent d'abord à Dieu pour servir son église
» Comme les parents de cet illustre défunt l'avaient destiné pour l'Église, ils avaient eu soin de le faire élever par de bons précepteurs et dans de bons collèges. Sortant de chez M. Dumon de Meymac, qui était le prêtre de ce pays le plus capable et le plus vertueux, il s'en fut au collège de Mandat (Mauriac), qu'il trouvait fort à son goût n'y voyant aucune débauche, et dont la peste le chassa. De là à Tulle, dont la peste le
fit encore retirer, pour aller à Bourges, où il acheva son cours de philosophie vers l'âge de seize ans et y étudia quatre ans en théologie, d'où il s'en alla à Paris pour y étudier en Sorbonne près de cinq ans.
» Il était d'un naturel vif et bouillant, d'une complexion sanguine et bilieuse, d'une riche taille, les cheveux noirs et bouclés, le visage rond, une grosse tête, fort prudent, fort sage, sobre au dernier point, ne faisant qu'un repas depuis plus de vingt-cinq ans, si chaste qu'il évitait la compagnie de ses plus proches parentes, ne voulant jamais parler aux personnes du sexe qu'en compagnie de quelques autres personnes, fort charitable, en un mot un grand homme de bien, car il fut fait prêtre et curé en un temps où le clergé était encore dans le désordre et le peuple dans l'ignorance. Il trouva ses paroissiens et ses deux églises dans une négligence de Dieu tout-à-fait déplorable; mais il a si bien ordonné toute chose durant sa vie, que nonobstant ses maladies continuelles, devant la mort, il fit faire son tombeau où il se faisait porter, pour penser à sa dernière fin durant sa grande maladie qui a duré vingt-et-un mois. » Il a souffert avec une patience digne de Job et de Tobie; il parlait aux autres dans leurs misères et dans leurs douleurs, et dès qu'il avait un peu de relâche, il se faisait porter à l'église pour y entendre la sainte-messe, le lendemain de certains jours où on l'avait cru agonisant. » Après avoir beaucoup travaillé aux répara-
tions des deux églises, qu'il trouva sans aucun vase d'argent, il a donné à celle d'Ambrugeac une belle custode, un porte-Dieu fort joli, un beau calice et une croix d'argent, et à celle de Barsanges un calice, une custode et un porte-Dieu, de son propre argent B M. Dupuy, archiprêtre de Saint-Exupéry, fit l'enterrement (1). »
Les auteurs de cette biographie ont fait du prieur d'Ambrugeac un portrait remarquable. Chez M. Duboucheron, la beauté physique s'allie aux qualités morales. Il est sobre, il est prudent et il est sage. L'âme, chez lui, a vaincu les instincts; la foi a triomphé du sang. Il est charitable, bon pour les pauvres; il leur parle dans leurs douleurs, il les console dans leur misère, il est patient et résigné dans la souffrance, et il espère devant la mort.
Gilebert du Boucheron avait été le chef de la famille jusqu'en 1662, époque où il mourut (20 octobre) en son château de Mareille, prés d'Ussel. Ses restes furent transportés et inhumés dans l'église d'Ambrugeac, le 29 octobre. Charles Duboucheron lui succéda et prit les titres de seigneur d'Ambrugeac-Duchez, de Mareille, de Briolet, de Chalusset, de Messeix (Auvergne) et autres places. Après son décès,' la seigneurie d'Ambrugeac échut à François Duboucheron, son fils, qui s'unit à Mlle Rose de Roque-
(1) Ces détails sont extraits des actes de l'état-civil de la commune d'Ambrugeac.
laure. Des revers de fortune ne permirent pas à ce dernier de conserver et de transmettre intact à ses enfants le vieux patrimoine qu'il tenait de ses aïeux, et dame de Roquelaure, son épouse, se portant forte pour lui, délaissa à Catherine Duboucheron, sa belle- sœur, épouse du seigneur de Beaufort, à titre de dot et de légitime, les cens, rentes, droits et devoirs seigneuriaux que possédait le seigneur d'Ambrugeac sur le village du Maniodeix, paroisse de Meymac. Ces droits consistaient chaque année en vingt setiers de blé, soixante cartes d'avoine, trois livres dix-neuf sols neuf deniers, une vinade, cinq gélines, droit de guet pour quatre feux de chacun cinq sols, avec toute la fondalité et directité, justice haute, moyenne et basse, droit d'investir et de divestir, et taille aux quatre cas.
Mlle Marie Duboucheron, sœur de la précédente, reçut pour le même objet des droits identiques reposant sur le village de Besse, paroisse d'Ambrugeac, sous la réserve que se fit le cédant de se libérer en capital dès qu'il le pourrait, et de reprendre ses deux villages. Mais au lieu de s'améliorer la situation empira, et dans le vieux manoir se firent sentir les tristesses, l'adversité, et les douleurs profondes et inavouables qui servent de cortège à une misère dorée. Parmi les droits féodaux cédés à M. de Beaufort, il en est un dont la dénomination paraît étrange c'est le droit de guet, fixé à cinq sols par chaque feu.
Cet ancien droit n'était pas d'un usage général;
certains villages y étaient assujettis, d'autres en étaient exempts, et il conférait au seigneur le droit de faire garder et surveiller son château par des vassaux qui faisaient le guet(l).
Au commencement du xvni" siècle, la terre d'Ambrugeac passa entre les mains de la famille d'Arche, qui ne joignit jamais à son nom celui d'Ambrugeac. L'avant-dernier membre de cette famille, dont le souvenir est encore gravé dans la mémoire des plus vieux habitants, périt en 1793 victime des terribles passions qui agitèrent cette époque, et au commencement du xixe siècle, son fils unique mourut à Ambrugeac sans aucune descendance.
§ III
Il existait encore, dans les environs de Meymac, autres deux résidences seigneuriales celle du Jassonets et celle de Croiziat. Dès l'année 1307, le seigneur du Jassonets était désigné sous le nom de Bosco ou du Bois, ainsi qu'on le trouve mentionné en un vieux plan où est représenté le château de cette seigneurie, dont les dépendances, nous l'avons vu, allaient toucher aux domaines de Hugues de Beynette, tandis que du côté opposé elles s'étendaient jusqu'aux franchises de Meymac et jusqu'à la terre de Croiziat. Le tènement de Lachau-l'Étang, appelé autrefois Lachalin, subissait aussi la loi du seigneur du Jassonets, qui le
(1) L'acte où nous avons puisé ces renseignements est du 4 novembre 1707. Il est passé en l'abbaye de Bonnaigue en présence de "Valette, notaire, de François de Bosredon et d'Emmanuel de Roque. laure, témoins.
céda plus tard à M. Sarrazin de Croiziat, dont il joignait les domaines.
Vers le milieu du xvf siècle, Étienne Binet, docteur en droit, demeurant à Tulle, devint acquéreur de la terre du Jassonets, et des redevances, cens et rentes qui existaient à son profit, en vertu d'une vente que lui eonsentit le seigneur Dubois du Jassonets et de Villemontel. L'acte constatant la transmission de cette seigneurie fut passé à Tulle devant Malédin, notaire, mais la date n'est pas indiquée, et nous n'avons pu découvrir ni l'expédition, ni l'original de ce titre. Par un testament du 3 avril 1552, passé devant Bonnet, notaire à Tulle, Étienne Binet institua pour héritier Antoine Binet, son frère. A quelle époque ce dernier fut-il mis en possession de cette seigneurie ? Nous l'ignorons; mais sur la copie des cens et rentes dus au seigneur du Jassonets, on lit cette mention « Bertrand et Gabriel Binet firent, en 1599, une recognoissance de foi et hommage au seigneur de Ventadour, leur suzerain. » La famille Binet, dont un des ancêtres fonda une école à Tulle en 1567, possède encore de nos jours la terre du. Jassonets. Sur les murs-de l'ancien château, jadis composé de deux tours rectangulaires rattachées par un corps-de-logis intermédiaire, s'élève une gracieuse habitation moderne, dont la toiture grise tranche gaiement' sur le fond vert des grands pins qui l'entourent. Quant à la seigneurie de Croiziat ou de Croisiac, ainsi qu'on le trouve écrit dans beaucoup de titres, elle appartenait à la famille Sarrazin de
Croisiac, dont la noblesse était incontestée dans le pays. Le nom seul, Sarrazin de Croisiac, en est un indice, et probablement il rappelle un vieux souvenir des croisades, alors que le Croisé luttait contre le Sarrasin.
Le château de Croisiac, possédé anciennement par M. François de Sarrazin, héros d'un épisode que nous avons raconté, dominait une partie de la ville de Meymac et n'en était séparé que par une légère dépression de terrain. Moins vaste peut-être que les châteaux d'Ambrugeac et du Jassonets, il avait sur ses voisins l'avantage de posséder une forme plus gracieuse et d'être mieux proportionné dans son ensemble. Le corps-delogis principal reposait entre deux tours arrondies surmontées de splendides girouettes; un bois de haute futaie le protégeait contre les vents du Nord, tandis que le soleil levant venait inonder de ses feux les vieux vitraux et les tourelles. Ce château subsista jusqu'en 1793. Livré au pillage à cette époque, il fut démoli de fond en comble, la poudre et le canon aidant. La lignée des Sarrazin de Croisiac s'était alors éteinte à défaut d'enfants mâles. La dernière qui porta ce nom fut Louise de Sarrazin, qui s'unit vers l'année 1750 au chevalier Jean de Joussineau, lieutenant de carabiniers. M. de Joussineau, après la mort de sa femme, prit le titre de seigneur de Croisiac, du Fressinet, Reyssac et autres places (1).
(1) Ces derniers détails sont consignés dans un acte du 30 avril 1759 passé devant Lespinasse, notaire.
Il existe encore à Meymac une famillle Sarrazin, qui provenait sans doute d'une branche cadette.
Près de Croisiac, au pied d'une haute montagne, sont deux vastes domaines La Feuillade (anciennement Las Folihadas, ou pays des feuilles) et Gouale (anciennement Gouale-Soubrane), vendues par la nation au préjudice de la famille d'Arche. Au xve siècle, ces terres appartenaient au seigneur Pierre de la Rebeyrotte, qui plaida et guerroya longtemps contre les consuls de Meymac au sujet de la forêt de Bobière, dont à peine il reste des traces.
Alors, la cime et les versants des monts qui dominent Meymac et forment comme un vaste abri à la naissance de la vallée, étaient couverts de riches et verdoyantes forêts. Au lieu de ces pentes roides et dénudées, où croît aujourd'hui la bruyère, au lieu de ces profondes déchirures qui servent de lit aux torrents et dont la vue inspire la tristesse, le feuillage des chênes et des hêtres mêlés et confondus, en préservant le sol, assurait sa fertilité. Mais ces richesses se sont évanouies; la négligence de l'homme, son imprévoyance obstinée, et la dent pernicieuse des bestiaux ont imposé la stérilité à la terre, et aux habitants les frimas. Cette transformation ne remonte cependant pas à une époque fort reculée, car, en 1445, le seigneur Pierre de la Rebeyrotte, propriétaire des manses de La Feuillade et de Goualle, s'opposa à ce que les habitants de Meymac coupassent dans la forêt de Bobière le bois vif leur reconnaissant le droit d'enlever le bois mort à leur cou, sans l'aide de chevaux ou de bêtes portant le bât. Il revendiquait pour lui-même la
faculté de faire paître ses bestiaux et d'exploiter la forêt où, en vertu d'un juste titre et de possession utile, il pouvait enlever soit à bras, soit avec des animaux, les arbres de haute futaie, le bois vif et le bois mort, tant pour les besoins de ses deux manses que pour les réparations et l'édification de ses bâti• ments (1).
Les seigneurs de Ventadour possédaient aussi à Meymac un château dont une seule lour est restée debout. Un pré appelé du Breuil, situé sous le canal du moulin, le four banal et la vaste prairie qui s'étend au bas de la ville, formaient l'ensemble de leurs propriétés particulières. En leur qualité de seigneurs féodaux, les habitants de Meymac leur prêtaient serment de fidélité, et comme seigneurs justiciers, ils percevaient en outre les amendes, confiscations, droits de mouture, ainsi que les redevances de lods et vente, lorsque s'effectuaient des mutations de propriété dans les lieux soumis à leur juridiction. Ce dernier droit, qu'il n'est pas possible d'évaluer exactement, donnait un produit variable subordonné au nombre des ventes qui avaient lieu. Quant à la quotité du droit lui-même, elle était d'environ sept pour cent du prix principal, et la perception en était faite par un agent ou régisseur du comte, qui en faisait mention sur la copie du contrat. L'acquéreur qui négligeait de se libérer
(1) Les titres de ce procès sont aux archives de la mairie de Meymac.
du droit de lotis et vente était poursuivi devant la justice seigneuriale lorsque le prix de l'immeuble était inférieur à mille livres, et devant le grand Conseil ou conseil d'État du roi lorsqu'il était supérieur à cette somme. Il nous est facile, du reste, à l'exception des amendes, confiscations, droits de lods et vente, de déterminer approximativement le produit des biens que possédaient à Meymac les Ventadour, et après eux les Soubise, en prenant pour base un bail à ferme du 3 octobre 1720. Par cet acte, le seigneur de Ventadour afferma à Jean Laplène, notaire, les biens immeubles et les droits de four banal qu'il avait à Meymac moyennant 1,850 livres, sous la réserve des droits de lods et ventes, amendes et confiscations. Nous devons ajouter que les cens et les rentes perçus par les seigneurs de Ventadour sur les habitants de Meymac étaient peu considérables. Ces droits purement immobiliers, reposant sur le sol, avaient passé, par suite de donations faites par cette famille, à l'abbé et au monastère. En appréciant les faits accomplis dans notre localité, et sans recourir à des documents historiques étrangers, nous avons pu nous rendre compte des droits qu'exerçaient les seigneurs, des devoirs qui incombaient aux vassaux, de l'ancienne organisation judiciaire, des entraves qui s'opposaient au développement de la propriété, et des modifications lentes, mais réelles, qui s'accomplirent avec le temps et le progrès des mœurs. Que voyons-nous d'abord?
La terre possédée par les grands vassaux. Cette
richesse, inféconde sans travail, se divise peu à peu entre les tenanciers et maints notables qui, à leur tour, finissent par acquérir la propriété utile des terres, dont ils n'avaient qu'un droit d'usage limité et onéreux.
Les servitudes corporelles elles-mêmes disparaissent en devenant rachetables. La loi de JésusChrist pénètre la société de sa bienfaisante influence, et en nous apprenant notre destinée, elle donne aux petits et aux faibles le sentiment de la haute dignité de l'homme; elle convie le puissant à ne pas mal user d'une autorité dont il devra compte à Dieu, et lui rappelle en même temps le néant de sa puissance Mémento quia pulcis es, lui dit-elle.
IV
Nous avons indiqué déjà les causes particulières et générales qui contribuèrent à amoindrir et à rendre presque nulle l'autorité des abbés dans leur couvent; et si nous revenons sur ce sujet, c'est afin de démontrer les transformations successives que subit cette institution, et d'apprécier le rôle effacé, au moins quant au spirituel, que jouèrent dans leur monastère les derniers abbés de Meymac.
A l'origine de la vie monastique, les religieux de chaque communauté, réunis en assemblée générale, nommaient leur chef; mais plus tard, le droit d'élection tomba en désuétude, et en France la nomination des abbés fut faite par le souve-
rain et approuvée par la cour de Rome, qui délivrait des provisions bénéficiâtes.
D'après la règle de saint Benoît, l'abbé était le premier du couvent, et il devait être aussi le premier esclave de la règle. A lui seul appartenait le soin de conduire les religieux, de les guider, de les instruire, et de pourvoir à leurs besoins. Il exerçait dans sa maison tous les pouvoirs administratifs, et là s'arrêtaient les limites de son autorité, car dans les affaires communes il devait consulter d'abord les anciens, réunir en assemblée ses moines et délibérer avec eux. Du reste, les abbés étaient placés, par les canonistes, immédiatement après les évêques; plusieurs même obtenaient du saint-siége le droit de porter la mitre et le bâton pastoral (1).
A partir de l'époque où est introduite à Meymac la réforme de saint Maur, la direction morale de la communauté et l'action administrative passent aux mains du prieur, qui agit et dirige seul. Aucun lien ne l'unit à l'abbé; les intérêts temporels les divisent, et ce dernier devient un simple seigneur féodal, qui jouit des prérogatives attachées à ce rang.
A l'origine, ceux qui furent pourvus de bénéfices ecclésiastiques eurent un privilège; mais en échange ils durent remplir certains offices déterminés soit par l'usage, soit'par les titres. De cet état de choses naquirent des abus, et l'arbitraire,
(1) Abbas in abbatiâ videlur in primo gradu dignitatis, sicut episcopus.
le bon plaisir dénaturèrent souvent l'esprit qui avait présidé à l'établissement de ces fondations et en altérèrent le principe. Les abbayes, les prieurés, les cures, les vicairies étaient des bénéfices ecclésiastiques. Les prieurs touchaient des dîmes ou des rentes que leur payaient certains villages, et ils devaient, à des époques déterminées, dire des messes dans l'oratoire souvent fort éloigné de leur résidence. Les curés percevaient aussi les dîmes en échange du service paroissial qui leur incombait. Enfin, les titulaires de vicairies célébraient à l'autel spécial d'une église des cérémonies religieuses, et comme rémunération de ces offices, ils prélevaient annuellement la somme allouée par le fondateur. De tous ces bénéfices, l'un des plus importants était la possession d'une abbaye, et les abbés, par les services qu'ils rendirent, ne purent en général se faire pardonner le rang exceptionnel qu'ils occupèrent et les nombreux avantages que leur assura la monarchie. Depuis la fondation du monastère de Meymac jusqu'à 1707, trente-huit abbés avaient été titulaires de cette abbaye, et la liste qu'en donne le Gallia christiana s'arrête à cette date et comprend Maurice Rochette, docteur en Sorbonne et vicaire-général à Clermont-Ferrand. Les anciens auteurs ne mentionnent pas les noms de ceux qui lui succédèrent; mais l'examen des baux à ferme des revenus de l'abbaye, depuis 1707 jusqu'à la Révolution, nous permettra de combler cette lacune. M. Maurice Rochette résida toujours à ClermontFerrand il ne se rendit à Meymac qu'à de rares
intervalles et pour toucher les revenus de son abbaye. Peu bienveillant pour les religieux du monastère, il entretint toujours de bons rapports avec le clergé séculier et se montra l'ami de M. Dupuy de Saint-Pardoux, curé de Meymac, avec lequel il eut une longue correspondance déposée aux archives de l'hospice.
Le 23 août 1727, M. Jean-Ozène de Basville, prêtre, docteur en Sorbonne, prieur commendataire, seigneur spirituel et temporel des bourgs et prieurés de Lihons en Sangterre, fut nommé abbé commendataire de Meymac (1).
Le trait le plus saillant du caractère de cet abbé, qui jamais n'habita le monastère de Meymac, fut un goût prononcé pour les procès. Son humeur querelleuse, entretenue peut-être par les circonstances particulières dans lesquelles il se trouva, lui fit entreprendre de longues et dispen.dieuses luttes dont il paya les frais, soit contre les habitants de la ville, soit contre les religieux .eux-mêmes.
Par un arrêt du 12 mars 1737, le grand Conseil avait ordonné le partage en trois lots des biens de l'abbaye de Meymac, et renvoyé les parties devant le lieutenant-général de Tulle pour procéder à cette division. Des difficultés d'interprétation s'étant produites, l'affaire fut de nouveau soumise au grand Conseil, qui ordonna une
(1) Le commendataire était celui qui était pourvu d'un bénéfice en commende. La commende était un bénéfice régulier accordé à un séculier. M. Ozène de Basville était un séculier dispensé, car il n'appartenait pas à l'ordre des Bénédictins.
nouvelle évaluation de chaque lot. Le 9 décembre 1740, les parties firent une transaction devant les notaires du Châtelet de Paris, et les religieux de Meymac furent reconnus créanciers de M. Ozène de Basville de cinq cent soixante-six setiers de seigle ou de froment, et de trois mille cinq cent quatre-vingt-onze livres d'argent.
Il fut convenu, dans cet acte, que les religieux entretiendraient l'église et les lieux réguliers; qu'ils fourniraient le linge, les ornements et les vases sacrés, et que l'abbé Ozène, en payant chaque année deux cents livres, ne serait jamais recherché, excepté le cas d'incendie de l'église et de la maison conventuelle, par chute de tonnerre et autres accidents imprévus. Les honoraires du médecin et les gages du chirurgien de l'abbaye, évalués à quarante livres par an, furent mis à la charge de l'abbé; il en fut de même des frais de réception d'hôtes et d'étrangers. Les religieux réclamaient encore à l'abbé le remboursement du prix du clocher qu'ils avaient récemment fait construire sur la nef de l'église; mais ils finirent par abandonner cette prétention, et l'on put raisonnablement espérer que rien à l'avenir ne viendrait troubler la paix et la concorde. Cependant, il n'en fut pas ainsi. Les moulins de Meymac donnèrent lieu à un nouveau procès, dont les détails sont racontés par l'abbé lui-même dans une procuration scellée de ses armes, et qui porte la date du 9 octobre 1749. Quelques détails sur ces anciennes usines ne seront pas déplacés ici.
Les moulins de Meymac, dont l'un était appelé Grand-Moulin et l'autre Moulin-Sarrasin, avaient été moulins banaux et devinrent ensuite la propriété du monastère. Grevés d'une rente de vingt setiers et une carte de blé-seigle au profit du seigneur du Jassonets, ces usines furent presque toujours à charge à ceux qui les possédèrent et n'enrichirent jamais personne. Dès 1419 elles appartenaient au monastère, et Jean Chadenier, alors moine, essaya de racheter cette rente en remboursant une somme d'argent. Le seigneur du Jassonets, qui était alors Jacques del Bos ou du Bois, le même peut-être que nous avons désigné plus haut sous le nom de Bosco, accepta, en échange de la rente, une somme de quatre-vingts livres, sous la réserve, pendant un temps déterminé, de rentrer dans ses droits en restituant ce capital. C'est ainsi que se passèrent les choses, car, en 1420, Jacques del Bos parvint à se libérer et à maintenir sous sa loi les moulins de Meymac. Plus tard, les religieux eux-mêmes aliénèrent ces propriétés moyennant une rente annuelle de huit setiers de froment et de vingt setiers de seigle, et, en 1670, nous les voyons aux mains de M. Savandy, procureur, qui les céda à son tour à Léonard Bournel, dont les héritiers les délaissèrent à l'abbé Ozène de Basville, par suite de l'impossibilité où ils furent de servir les rentes dues au couvent.
Par la transaction du 9 décembre 1746, l'abbé avait reconnu le droit des moines sur les moulins. Cependant il essaya de faire comprendre cette
rente au nombre des objets qui formaient le lot de l'abbaye; et après avoir vainement épuisé tous les degrés de juridiction, il fut condamné par arrêt du grand Conseil du 29 mars 1749, à payer la rente de seigle et de froment avec les arrérages, si mieux il n'aime déguerpir et rapporter les fruits perçus.
L'abbé Ozène de Basville usa de cette dernière faculté, et le 5 novembre 1749, le procureur d'office de l'abbaye livra les clefs des moulins à Dom Simon Thoret, religieux et mandataire des autres moines (1).
A cet abbé succéda M. Louis Lebascle-d'Argenteuil, qui fut pourvu en 1754. Cet abbé chargea M. Louis-Charles de Combarel, seigneur baron de Sartige, résidant au château de la Rebeyrotte, paroisse de Sarran, de percevoir ses revenus; et afin de se soustraire aux ennuis de l'administration, il l'autorisa à donner à ferme aux religieux les dîmes, cens, rentes et autres droits féodaux qu'il avait à Meymac. M. d'Argenteuil ne jouit de ce bénéfice que pendant trois ans; en 1757, il y renonça et fut nommé aumônier du roi (2).
Le dernier abbé de Meymac, celui probablement qui a clos la liste de ces heureux privilégiés, car il vivait encore en 1787 ou 1788, est M. Pierre Guillon de Saint-Val, prêtre du diocèse
(1) Acte du 5 novembre 1749 passé devant M' Lespinasse, notaire. (2) Ce fait est consigné dans un acte passé au Châtelet de Paris le 20 mars 1758.
de Paris, où il habitait, rue du grand faubourg Saint-Germain, paroisse de Saint-Sulpice. Pourvu par brevet du roi du 13 novembre 1757, et par bulles expédiées de Rome le 10 janvier suivant, M. Guillon de Saint-Val prit possession de son abbaye le 1er mai 1758 et se fit représenter à cette cérémonie par Dom Martinet, prieur du couvent, auquel il avait confié sa procuration. Nous donnerons une idée des formes usitées à cette époque pour ces sortes d'installation, formes et détails qui se reproduisaient à chaque nomination d'un nouveau bénéficiaire. La prise de possession d'une abbaye n'était pas seulement un acte religieux, elle avait le caractère d'une investiture féodale. Outre les dîmes ecclésiastiques, les abbés percevaient des cens et des rentes, des droits de lods et de vente sur les contrats d'acquisition; ils avaient droit de justice et entretenaient un juge de l'abbaye, dont la rétribution annuelle trois setiers de seigle, si elle était proportionnée au nombre des affaires qui lui étaient soumises, indiquait une juridiction fort restreinte, ou des justiciables d'humeur paisible.
Le 1er mai 1758, le R. P. Dom Jean Martinet, prieur du monastère de Meymac, mandataire de l'abbé Guillon de Saint-Val; Jean-Baptiste Faucher, prêtre, docteur en théologie et curé de la paroisse de Pérols, délégué par l'official de Limoges; M. Antoine Conchon, seigneur des Chausses, conseiller du roi et son procureur en la maison de ville d'Ussel; M. Jacques Tourseiller, archiviste de
la ville de Saint-Flour, suivis d'un grand nombre d'habitants, se présentèrent sous le porche de l'église abbatiale de Meymac, où se trouvaient MM. Sage et Lespinasse, notaires royaux apostoliques.
Dom Martinet expose à haute voix que messire Pierre Guillon de Saint-Val, licencié de l'Université de Paris, a été pourvu par sa Majesté le roi, le 13 novembre 1757, de l'abbaye de Meymac au diocèse de Limoges; que le 10 janvier dernier, notre saint-père le Pape lui a délivré des bulles apostoliques fulminées en l'officialité de Limoges le 27 avril dernier, et qu'il demande à M. Faucher, délégué épiscopal, d'être mis, au nom de M. Guillon de Saint-Val, par la libre entrée de l'église, en possession réelle, actuelle et corporelle de l'abbaye de Saint-André de Meymac et de ses membres en dépendant.
Dom Martinet exhibe alors aux notaires les titres et provisions en vertu desquels il agit. Bientôt les grandes portes de l'église s'ouvrent; il y entre suivi d'un nombreux cortège et s'avance jusqu'au bénitier, où il fait le signe de la croix. Il saisit ensuite les cordes du grand et du petit clocher, fait tinter chaque cloche, et après s'être dirigé vers l'autel de l'Assomption, où se célébrait l'office paroissial, il fait une génuflexion, visite les vases sacrés et va prendre séance dans le chœur des religieux, en occupant la place abbatiale. Ces cérémonies achevées, l'un des notaires demande à haute voix s'il existe des oppositions à cette investiture, et comme le silence répond seul à cette
interpellation, il proclame M. Guillon de SaintVal saisi corporellement de l'abbaye de Meymac, pour en jouir avec honneur, droits, prééminence, fruits, profits, revenus et émoluments. Après ces paroles sacramentelles, les cloches du grand et du petit clocher font entendre leurs bruyants carillons, des groupes se forment dans les rues, et la ville est en liesse jusqu'à la fin du jour en l'honneur de celui qui a pris rang.
Nulle part nous n'avons pu trouver des traces du passage ou de la présence de M. Guillon de Saint-Val à Meymac, et dans tous les actes publics où nous avons vu figurer son nom, il est représenté par un mandataire qui veille à ses intérêts. C'est de la ville de Gand que sont datées plusieurs des procurations qu'il transmet, et cette circonstance, sans doute, inspira à M" Lespinasse, notaire scrupuleux, l'idée naïve de qualifier dans ses actes son noble client de seigneur abbé de l'abbaye royale de Meymac et de Flandre. M. Guillon de Saint-Val n'a pas dû avoir de successeur à l'abbaye de Meymac, ou s'il en a eu, le nouvel abbé n'a pas pu jouir longtemps de ce bénéfice, car il n'a laissé dans le pays aucune trace de son élévation à cette dignité. En 1787 M. de Saint-Val vivait encore; il exerçait ses droits, il usait de ses priviléges que convoitaient un grand nombre de compétiteurs gradués, qui eurent soin de lui faire notifier par acte de notaire, et leur titre, et leur désir de recueillir sa succession. Cet ancien usage contredit l'opinion de ceux qui pensent que la passion des places
ou des emplois est née avec nos institutions modernes.
§ V
Dans ce temps le plus cruel des fléaux, la famine, venait répandre le deuil et dans les champs et dans les villes. A ce désastre en succédaient deux autres, la misère et la peste, et partout on payait le tribut à- la mort.
Nos contrées n'échappèrent pas à ces cruelles épreuves, et le souvenir de la peste de 1631 et 1632 ne s'est pas encore effacé « Partout, dit Bertrand de Latour, des soupirs et des larmes avec les gémissements qui les accompagnent. La peste s'emparait des hommes subitement et les frappait de mort. Un grand nombre succombaient aussi pour avoir usé d'aliments contraires à l'homme, n'ayant rien autre chose pour satisfaire leurs besoins (1). »
Cette épidémie ravagea le Limousin pendant sept mois, et les habitants de Tulle élevèrent une chapelle au Rocher des Malades, situé près de la ville, tandis que Jean de Vailhac, leur évêque, faisait lui-même un vœu à saint Roch dans l'église de Rocamadour.
Meymac ne fut pas épargné par le fléau. La terreur répandue augmenta le nombre des victimes, dont plusieurs ne furent pas secourues. La crainte inspirée par cette épidémie n'eut pas de limites, et fut telle que les notaires appelés à
(l) Traduction de M. Bonneiye.
recevoir le testament des malades se tenaient à la porte de l'appartement, afin de se soustraire aux émanations morbides que répandait le corps des pestiférés. On suspendit au sommet du clocher de l'église des lambeaux de chair de bœuf, espérant par ce moyen purifier l'air vicié, et donner un aliment à la contagion. Mais tout fut inutile la mort faucha dans les rangs de l'homme comme fauche le moissonneur dans une rangée d'épis. Alors on transporta les malades en dehors de la ville, sur un point élevé qui a conservé le nom de La Maladie, et voyant leur impuissance à combattre le mal, les habitants de Meymac, à l'exemple de ceux de Tulle, firent un vœu à saint Roch et lui élevèrent une chapelle sur le mamelon de La Maladie. Le 20 avril 1791 la commune de Meymac, sur le réquisitoire de Robert, procureur, décida que cette chapelle dépendait de l'église de Meymac, que les revenus y attachés, ainsi que les ornements, calices qui s'y trouvaient, seraient remis à l'église, et que Marie Feuillade, trésorière de cette chapelle depuis longues années, rendrait compte de sa gestion (1). L'humble monument a disparu, et une croix en pierre le remplace pour perpétuer son souvenir; mais le vœu que firent nos pères s'accomplit pieusement encore, et chaque année après la fête de l'Assomption, les fidèles, précédés du clergé, s'acheminent processionnellement vers la croix de saint Roch.
(1) Extrait du livre de délibération de la commune de Moymac (20 avril 1791).
Toutes ces calamités provenaient du défaut de soins et de l'abandon dans lequel on laissait la terre trop négligée; elle refusait ses produits à l'homme. A la culture du seigle et du sarrasin, déjà en usage, vint se joindre, durant le xvme siècle, la culture de la pomme de terre, bienfaisante importation de Parmentier en Europe, de Turgot en Limousin et des moines à Meymac. La pomme de terre est l'ennemi des famines; elle est la seule conquête agricole qu'ait pu faire ici l'habitant, conquête bien précieuse, car on peut considérer le produit de ce tubercule comme entrant pour un tiers dans l'alimentation générale; depuis plus d'un siècle le rendement des céréales ne s'est pas augmenté, la richesse publique ne s'est pas accrue. Cependant la loi est uniforme en France, la propriété est accessible à tous, les rentes et les dîmes ne grèvent plus le sol, et les entraves qui existaient autrefois semblent anéanties. Le climat est-il trop rigoureux, la terre serait-elle inféconde? Non. La cause de cette infériorité, de ce malaise chronique est ailleurs elle est le résultat du délaissement de notre contrée, de son manque de voies de communications et surtout de chemins de fer, et du défaut des moyens qui peuvent conduire au progrès matériel et au progrès moral, deux choses fort distinctes, mais qui ont entre elles de si nombreuses affinités que l'une paraît toujours subordonnée à l'autre. En fait, et au point de vue de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, les réformes sociales
et économiques accomplies depuis 1789 ont été pour nos contrées sans influence.
Nous avons dit plus haut qu'indépendamment des charges féodales, le détenteur du sol était contraint de payer la dîme à l'Église. La dîme constituait un des principaux revenus de l'abbaye de Meymac, et après le partage certaines localités furent comprises dans le lot de l'abbé, d'autres dans le lot des moines. L'acte qui consacra ce nouveau mode de jouissance ne put indiquer que le nom des lieux échus à l'une ou à l'autre des parties, sans fixer la quotité de grains que ces lieux pouvaient rendre, la dîme étant essentiellement variable. Mais nous comblerons cette lacune en prenant la moyenne du produit des fermages faits en nature pendant le xvme siècle; si ce travail est aride il n'est pas sans intérêt. Dès que nous connaîtrons la nature et la quantité de grains ou de bestiaux délivrés par chaque village pendant une longue période d'années, nous serons très exactement fixés sur l'ancienne production agricole de notre pays, et nous pourrons juger de ses ressources, du progrès accompli ou de la déchéance encourue.
Le plus ancien bail à ferme mis sous nos yeux est du 3 mai 1690, et le prix en est fixé en argent. Par cet acte, messire Auguste Langlois de Blafort, abbé commendataire de Meymac, afferma à Jean Raffiet, prieur, à Louis Guilhaumin, sousprieur, à François Vozin, à Jacques Fauchier, à Benoît Borel, à Jean Lebrun et à Sébastien de Beauvoir, tous religieux du monastère de Meymac,
les dîmes auxquelles il avait droit, moyennant treize cent cinquante livres, charges déduites, et sous la réserve de ses droits seigneuriaux et de lods et de vente. Quoique cette somme représentât alors une valeur assez considérable comme revenu, elle était loin d'indiquer le produit réel de la dîme que percevait l'abbaye à la fin du xvne siècle, car les moines, en devenant fermiers, n'assumaient pas gratuitement et pour complaire à leur abbé, la responsabilité et les ennuis d'une perception toujours difficile et onéreuse.
A partir de cette époque, et jusqu'au milieu du xvme siècle, nous ne trouvons que des baux isolés ayant trait à un seul village, ou à des rentes particulières et déterminées. Il est probable que pendant une longue période, les abbés eurent des régisseurs qui prélevèrent directement leurs dîmes et leurs rentes. Les longs procès qu'eurent à soutenir les moines contre les habitants et le clergé séculier, les difficultés nombreuses qui s'élevèrent entre eux et l'abbé jusqu'en 1749, rendent plausible cette supposition. Le dernier abbé de Meymac, M. Guillon de Saint-Val, resté étranger aux luttes locales, n'ayant jamais visité son abbaye, n'imita point l'exemple de ses prédécesseurs. Nous avons vu qu'il s'était fait représenter, lors de sa prise de possession, par le prieur du monastère. Cette tentative de rapprochement ne fut pas infructueuse car, le 14 novembre 1758, il afferma aux religieux pour neuf années les revenus de l'abbaye, moyennant quarante-huit setiers de bléseigle et 3,271 livres d'argent, charges déduites,
sous la réserve du membre de Chirac et de la fondation de Ventadour, qu'il avait précédemment donnés à bail à M. Conchon des Chausses, d'Ussel, au prix de 820 livres par an. Sous la dénomination de membre de Chirac et de fondation de Ventadour, étaient compris les droits délaissés au monastère de Meymac par Isabelle de Vandal le 5 avril 1434, et dont il a été question au chapitre premier (1).
Fixés dès à présent sur le revenu que procurait l'abbaye de Meymac au possesseur de ce benefj.ce, nous cherchons à déterminer la proportion dans laquelle chaque localité contribuait à payer cette charge.
La disparition des vieux titres et du livre terrier, contenant l'énumération par article des rentes et des cens dus à l'abbé, ne nous permet pas de donner le détail complet de ces divers produits; quant aux dîmes, les données sont certaines, les renseignements sûrs puisqu'ils reposent sur des baux authentiques. Cela suffit à faire apprécier très exactement l'ancien état de notre agriculture. Avant d'entrer dans le détail des noms et des chiffres, nous ferons remarquer que le décimateur affermait presque toujours les dîmes en nature, c'est-à-dire que le fermier, au lieu de lui payer un prix en argent, lui délivrait le produit même. Cet usage était d'une application générale, excepté cependant pour les fermages des dîmes d'agneaux,
(t) Ces deux baux à ferme sont passés devant Fuzillat. uotair à Meymac.
dont le prix était stipulé payable en monnaie courante.
En 1754, les dîmes à percevoir sur la terre du Jassonets et sur le village de Lespinat, qui faisaient partie du lot de l'abbé, furent affermées en nature quarante setiers de blé, mesure de Meymac (40 hectolitres). En 1758, la dîme à percevoir sur les mêmes propriétés fut donnée à bail moyennant trente-cinq setiers de blé-seigle, la récolte sans doute ayant une moins belle apparence. Ces dîmes étaient ordinairement adjugées aux enchères, et dans tous les baux on lisait invariablement cette clause
« Le preneur livrera du blé sec, net et marchand; il le fera transporter dans les greniers de l'abbaye et le fera mesurer à ses frais. » Cette charge était assez lourde, puisqu'elle comprenait le battage, le transport, et venait augmenter dans une certaine proportion le prix ou la valeur des objets que devait donner le fermier, et l'on peut raisonnablement supposer qu'il en tenait compte dans les évaluations qu'il faisait avant de devenir adjudicataire. Ces premiers faits établis, si nous prenons pour base de nos calculs la production connue des dimes pour ces deux années, nous arriverons à constater d'une manière à peu près certaine que la récolte des domaines du Jassonets et de Lespinat fut, en 1754, de quatre cents setiers ou de quatre cents hectolitres de grains, tandis qu'en 1758 la récolte de ces mêmes villages ne s'éleva qu'à trois ceut cinquante setiers. L'écart entre 1754 et 1758 fut d'un huitième, et la moyenne des produits de ces deux années fut de trois cent soixante-quinze setiers. A ce chiffre moyen, ajoutons vingt-cinq setiers, quantité nécessaire pour couvrir le fermier de ses frais et lui assurer le bénéfice légitime sur lequel il pouvait raisonnablement compter, et T. VIII. 4-4
nous aurons la quantité presque exacte des grains que produisaient ces deux villages à l'époque dont nous parlons, soit quatre cents setiers de blé (1).
Tel est le bilan du passé. Le présent vaut-il mieux?
Nous n'oserions le dire. Le pays est plus vieux d'un siècle, et dans les annales de la contrée on ne trouve qu'un nom qui réponde à des actes. Et ce nom est celui de Turgot.
Afin de rendre plus frappants les deux faits que nous voulons mettre en lumière, savoir le tribut que le sol payait à l'abbé de Meymac et l'état de l'ancienne production agricole, nous dressons un tableau ou figure le nom de chaque localité, avec le montant de la dime qu'elle devait. En regard de ce dernier produit, nous porterons le total des grains récoltés en prenant la base indiquée plus haut.
(Voir le tableau ci-contre.)
(1) Le Jassonets et Lespinat étaient et sont de nos jours deux localités renommées pour la production des céréales. Les deux baux à ferme auxquels nous avons fait allusion sont reçus par Lospiuasse, notaire, le 0 juin 1754 et le 30 juin1758.
Etat des dîmes et de la production des céréales dans les villages compris au lot de l'abbé.
NOMS..ê W s 1 NOMS B 1 e •S NOMS DES VILLAGES des a • -i « & -g “ PAROISSES °* S g g § °- <. J -§ S" -a o PAROISSES °" .se :o .3 Seliers Setierl
1758 Le Jassonets et Lespinas. Meymac. 35 350 1758 Lagrange. Meymac. 10 100 1758 Le Breuil, le Vert en Caux. Meymac. 50 500 1758 Le Pradinas. Meymac. 8 80 1758 La Vialle. Meymac. 18 160 1758 Lontrade. Meymac. 17 170 1758 Le Janoueix et Maniodeix. Meymac. 24 210 1758 Les Manoux. Meymac. 4 40 1758 Les Chaises. Meymac. 8 80 1758 La Mazière. Meymac. 12 120 1758 Les Communaux de Meymac Meymac. 74 74(l 1758 LaMontagne d'Ambrugeac.
comprenant les villages de
Lafont, La Sagne, Bey-
nette, Beynas, Le Las. Ambrugeac. 171 1.710 Totaux 429 4.290
OBSERVATIONS. Le village de Lontrade comprenait deux domaines. La dîme des villages du Janoueix, du Maniodeix et des Manoux était de 32 setiers; mais, d'après le partage, les religieux avaient droit à un quart de cette dîme, l'abbé prenait les trois-quarts, soit 24 setiers. La ferme du village de la Montagne d'Ambrugeac, comprenant les villages de Lafont, La Sagne, Beynette, Beynas, Le Las, était de 228 setiers de blé, mais l'abbé n'en avait que les trois quarts; le dernier quart était compris dans le lot des moines. La production totale de ces villages était donc de 2,280 setiers de seigle.
Le tableau qui précède établit rigoureusement le mininum de la dîme prélevée par l'abbé dans les villages dont nous avons indiqué les noms, et, par suite, il permet d'apprécier les produits
en grains que donnaient ces localités. Quatre cent vingt-neuf setiers en dimes représentaient au moins un produit total de quatre mille deux cent quatre-vingt-dix seticrs. Mais, comme nous l'avons déjà dit, ce produit était supérieur puisque, dans l'espèce posée, l'abbé n'agissait pas lui-même; il était représenté par un intermédiaire, un fermier, qui réalisait à son tour des bénéfices.
Les villages de Peyrelevade et de Saint-Setiers, situés aujourd'hui dans le canton de Sornac, étaient également assujettis à la dîme de grains et d'agneaux envers les abbés de Meymac, et le droit de prélever les dimes dans ces localités était cédé, moyennant une somme d'argent, le 10 décembre 1758. M. Desassis, juge de Rochefort, en devint fermier au prix de 244 livres. Les villages de la paroisse de Meymac qui payaient la dime d'agneaux étaient aussi les seuls qui produisaient des bêtes à laine à cette époque. En voici l'énumération Le Breuil, Le Vert, La Grange, Contenssouzas, Le Mons, Le Treich, Lavaur, Lamazière, La Cheyppe, Triosijoux, Les Manoux, Lestrade et Lontrade.
Sans être des plus riches, les abbés de Meymac ne pouvaient trop se plaindre de la rigueur du sort. Leurs fonctions, devenues infécondes, leur laissaient des loisirs; leur titre leur assurait des privilèges et des revenus prélevés sur le travail du laboureur (1).
(1) Nous donnons le détail de quelques-unes des rentes que pcrcevaient les abbés de Meymac; ce sont les seules relatées dans les
8 VI
Les anciens établissements religieux eurent en général un début modeste; la fortune ne leur vint pas tout d'un coup, et leur longue existence fut une des principales causes de leur prospérité. S'ils reçurent quelquefois de grandes et riches dotations, ils ne dédaignèrent jamais l'humble offrande, et Bonaventure de Saint-Amable, en rapportant que Gerbert, damoiseau de Meymac, donna en 1256 quelques métairies à notre monastère, ajoute « En 1248, le même établissement avait été doté par Èbles de Ventadour d'une rente annuelle de 10 sols à prendre sur les moulins de Neuvic, et il avait reçu des bienfaits do Guilhaume de Maumont, chanoine de Limoges, et de Pierre de Maumont, chevalier. »
actes qui ont été à notre disposition. Les tènements et villages de La Vialle, Le Vert, Le Breuil, Le Meynial en Caux et Le Pradinas, paroisse de Meymac, payaient à l'abbé argent 13 livres 3 sols, froment cinq setiers, seigle dix-neuf setiers, avoine soixante-cinq quartes.
Le village des Chazaux lui payait une rente de 2 livres argent, quatre setiers de seigle, huit quartes d'avoine.
Le village de La Maladie lui devait quatre setiers de froment et 5 livres d'argent.
Le village du Colomby un setier de froment.
Le tènement du Marsaleix lui devait un setier de froment, douze setiers de seigle, cinquante quartes d'avoine; argent 52 sols, trentesix oeufs de géline, cinq gélines, une vinade, deux trousses de foin. Le village du Madesclaire, paroisse de Saint-Germain-la-Volps, lui payait une rente considérable un setier de froment, quatorze setiers de seigle, cent deux quartes d'avoine, 5 livres 8 sols d'argent, onze gélines (poules), une vinade de quatre paires de boeufs. Le village de Theillac, paroisse de Péret, était soumis à une rente de cinq setiers, mesure d'Égletons.
L'association, la vie en commun pratiquées par les moines, favorisaient bien mieux le développement de leurs richesses que la division des intérêts. Dans le succès, dans les revers, ils étaient solidaires; l'avoir des uns constituait la fortune des autres, et tout le désir personnel, toute susceptibilité individuelle s'effaçaient devant cette loi supérieure le bien général. Ce système que pratique l'Église depuis des siècles, les novateurs modernes tendent à l'introduire dans la société civile. Les institutions de crédit, de secours, de coopération, n'ont d'autre but que de substituer la force collective à l'effort isolé, personnel. Les revenus du monastère de Meymac se composaient de trois éléments principaux le produit des propriétés particulières, le produit des dimes et des rentes. Nous ferons remarquer qu'au sud et à l'est de la paroisse de Meymac, l'abbaye ne percevait aucun droit. Les habitants de ces localités n'étaient pas exempts de tribut, mais ils étaient soumis à d'autres maisons religieuses telles que Bonneval, Bonnesagne et Saint-Angel. L'autorité de la maison conventuelle de Meymac s'étendait surtout au nord, à Saint-Sulpice-les-Bois, à Sornac, à Peyrelevade, à Saint-Setiers et à SaintMerd-les-Oussines. Il est probable que dans le principe, l'abbaye de Meymac avait exercé son action religieuse et civilisatrice sur ces contrées désertes et montagneuses, et qu'avec le temps elle leur avait imposé sa loi.
Deux moulins situés à Meymac, des étangs, un domaine au village de Lavaur, un second
domaine au village de Lascaux, quelques prés, composaient la propriété privée du couvent, qui jouissait par colonage du domaine de Lavaur(l). Quant à la propriété de Lascaux, elle fut affermée en 1754 moyennant vingt-deux setiers de bléseigle, dix quartes d'avoine, neuf livres de beurre et neuf livres de fromage, trente bouillards de paille, dix livres pour vinade (transport du vin), vingt-deux livres d'argent, et à la charge par le preneur de payer les tailles et impôts royaux ainsi que les cens et rentes dûs au seigneur, consistant en deux coupes et demi de froment, dix setiers de blé-seigle, trente-six quartes d'avoine, le tout mesure de Meymac, et en argent la somme de 15 livres, trois sols, 6 deniers, pendant neuf ans, durée du bail (2).
Le monastère de Meymac possédait encore quelques bénéfices ecclésiastiques, tels que les prieurés de Ste-Marie-Magdeleine du Longeyroux, de SaintJean-de-Neuf-Jours et du Mont, paroisse de SaintOradoux, province de La Marche. Ce dernier bénéfice était assez important, car il fut affermé le 26 février 1694 par bail, reçu Fuzillat, notaire, à Jean Lavétizoux, moyennant 450 livres, sous la réserve des offrandes qui se faisaient dans l'église de Saint-Oradoux, et à la charge par le pre-
(1) De 1724 à 1754, nous n'avons trouvé que des baux à moitié fruits. On peut se faire une idée assez juste de la valeur et du produit de cette propriété par le cheptel qui la garnissait, composé en 1730 de six bœufs, trois vaches, un taureau, estimés 515 livres. Bail du 18 mai 1730. Reçu Lespinasse. (2) Bail du 14 février 1754, reçu Lespinasse.
neur de défrayer les religieux et tin valet quatre fois l'an, quand ils se rendraient à Saint-Or 'adoux.
Enfin, comme l'abbé, les moines de Meymac percevaient la dîme sur les villages qui tombèrent dans leur lot.
L'état suivant, conforme à celui que nous avons dressé pour les dîmes de l'abbé, permettra d'apprécier l'importance de celles qui leur avaient été attribuées par le partage
(Voir le tableau ci-contre.)
État des dîmes et de la production des céréales dans les villages compris au lot des moines.
M 1< NOMS | g- g :| Vol" c
?S NOMS DES VILLAGES dos | .§ •§ § | oc g pç -s -f> PAROISSES te 3 ê" w => •«I .S P Selier» Sttieri
1750 Le Chadenier. Meymac. 23 230 1750 Le Colomby. Meymac. 20 200 1750 Lestrade. Meymac. 17 170 1750 La Feuillade. Meymac. 12 120 1750 Gouale- Meymac. 12 120 1758 Les Mas. Meymac. 8 80 1758 Lavaur. Meymac. 37 370 1758 Le Mas Chevalier. Meymac. 97 970 1758 Le Mas Cheni. Meyma.c. 97 970 1758 Le Bourg. Meymac, 97 970 1758 Le Gloup. Meymac. 97 970 1758 Lachau-Grandval. Meymac. 97 970 1750 Les Farges. Meymac. 17 170 1758 Le Mons. Meymac. 20 200 1758 Le Treieh. Meymac. 20 200 1750 Contenssouzas. Meymac. 9 90 1750 Celle. Meymac. 27 270 1758 Le Janoueix. Meymac. 8 80 1758 Le Maniodeix. Meymac. 8 80 1758 Le Longeyroux. Meymac. 7 70 1757 Freyte. St-Sulpice. 51 510 1757 Neuvialte. Sornac. 51 510 1757 Fargettas. St-Jtferd- 66 660 1757 Farniéras. ) les- 66 660 1757 Niarfeix. Oussines. 66 660 1757 Lafont. Ambrugeac. 57 570 1757 La Sagne. Ambrugeac. 57 570 1757 Beynette. Ambrugeac. 57 570 1757 Beynas. Ambrugeac. 57 570 1757 Le Las. Ambrugeac. 57 570 Totaux. 488 4.880
Nous ferons quelques observations sur l'état que nous venons d'établir Les villages de Chadenier,
Fargettas, Farniéras et Niarfeix, en sus de la dîme, payaient encore des rentes. Les Mas était alors appelé Mas Las Planchas. Lavaur, le Mas Chevalier, le Mas Cheni, Le Bourg, Le Cloup et Lachau-Grandval étaient désignés sous le nom de Lacombe; en 1750, les dîmes en avaient été affermées cent vingt-cinq setiers; les villages Lafont, La Sagne, Beynette, Beynas et Le Las comprenaient la partie désignée sous le nom de Montagnes d' Ambrugeat. Nous feronsaussi remarquer que dans les chiffres donnés, nous n'avons compris que le quart des dîmes qui revenaient aux moines, les trois autres quarts figurant quelquefois au lot de l'abbé, comme nous l'avons déjà vu.
Il résulte en outre des deux tableaux qui précèdent que les moines et l'abbé de Meymac prélevaient chaque année, pour leur droit de décimateur, neuf cent dix-sept hectolitres de grains sur un produit annuel de céréales évalué à neuf mille cent soixante-dix hectolitres, et cependant nous ne tenons aucun compte des bénéfices que faisaient les fermiers, et dont les populations payaient les frais.
Quant aux dîmes d'agneaux appelées droit de charnelage, elles étaient converties en argent, sans que les baux indiquent la quantité probable de la production locale.
Les moines de Meymac jouissaient dans les villages de Fargettas, Farniéras, Le Niarfeix, paroisse de Saint-Merd-les-Oussines. 'Il est probable aussi que les rentes que leur payaient les villages
de Lafont, La Sagne, Beynas et Beynettc leur venaient de la munificence des seigneurs d'Ambrugeac. Quelques-unes de ces rentes étaient portables au monastère, tandis que d'autres étaient perçues sur les lieux arrentés, c'est-à-dire qu'elles étaient quérables. Dans ce dernier cas, un moine du couvent se transportait, après l'échéance, dans le village soumis à la perception, afin de se faire délivrer en argent ou en nature les objets qui étaient dûs. Si les habitants n'étaient plus les mômes, si le sol avait été divisé ou vendu ou si la prescription du titre était prochaine, ce moine se faisait assister d'un notaire, qui dressait procèsverbal des noms des tenanciers, de leur refus ou de leur soumission au paiement de la rente. Voici un épisode de cet ancien usage féodal; nous le, trouvons relaté dans un acte authentique Eeynette est un village qui porte encore le nom de cet ancien seigneur d'Ambrugeac, dont nous avons parlé au présent chapitre. D'un abord difficile et dépourvu de voies de communication, les chaumières qui composent ce hameau sont éparses; elles s'élèvent au flanc d'une haute montagne qui va s'unir aux Monédières, à peu de distance de Corrèze. Les bois de La Saulière, de Beynas et de La Cubesse occupent les hauteurs, garnissent les versants, et la vallée, qui semble naître au-dessous du village, apparaît de loin comme une gorge profonde, inaccessible et sans issue.
Au xvme siècle, ce village possédait encore un oratoire modeste, symbole de l'autorité féodale et
religieuse qu'exerçait sur son territoire l'abbaye de Meymac, car c'était à l'oratoire que s'effectuait la livraison des rentes. Le 7 mars 1752, le PuyRichard, qui divise en deux parts la paroisse d'Ambrugeac, n'était pas dépouillé des traces de l'hiver; les vents chauds n'avaient pas soufflé, les grands faïols (1) de La Cubesse n'avaient pas tressailli sous le flux de la sève, les champs étaient déserts, rien n'égayait la marche du père Dom Grégoire Dumas, syndic des moines de Meymac, que suivait M" Lespinasse escorté de ses deux témoins.
Où se dirigeaient-ils de la sorte?
A Beynette.
Dans quel but?
Pour percevoir les rentes.
Dès que le calme est rétabli, le notaire convoque à haute voix les tenanciers du lieu, et le premier qui se présente est Jean Cisterne, surnommé le Renard. On examine, on vérifie. Ce nom n'est pas porté sur le livre terrier; enfin on s'explique. Le Renard remplace Pierre Escure et délivre, comme substituant ce dernier, une quarte, quatre coupes de seigle et trois sols de monnaie.
Il en est ainsi pour les autres chaque appelé verse à son tour le montant de sa rente en seigle, en argent, en avoine ou en foin, en gélines ou en œufs de géline.
(1) Dans tous les actes de cette époque, le hêtre est désigné sous le nom de faïol.
Mais, parmi les habitants, il en est qui sont pauvres; pour quelques-uns la moisson a été mauvaise d'autres, atteints de maladie, ont laissé leurs champs sans culture. Celui-là vit d'emprunt, cet autre de charité. Qu'importe! la rente est due, il faudra la payer. Gilbert Vaur et Pierre Janoueix invoquent leur misère en disant n'avoir ni grain, ni argent pour se libérer de leur rente, et n'être en état de le faire cette année, attendu leur grande pauvreté, et le notaire proteste et réserve au couvent la faculté de se pourvoir par les voies et rigueurs contre les sus-nommés (1). Quant aux autres rentes, qui avaient été comprises dans le lot des religieux, nous énumérons ci-après les noms des villages qui étaient astreints à les payer. Cette énumération est fort incomplète mais pour ne point blesser la vérité historique, nous avons tenu à ne relater que celles dont nous avons vu la mention dans des titres authentiques (2).
(A suivre.)
(1) Ces faits sont extraits du procès-verbal rédigé sur les lieux par M' Lespinasse, notaire, le 7 mars 1752.
(2) Les rentes suivantes étaient comprises dans le lot des moines Les villages de Fargettas, Farniéras et Le Niarfeix, sans que la part contingente de ces trois villages soit indiquée, payaient, outre los dîmes, une rente annuelle de vingt-deux setiers de blé-seigle, cent douze quartes d'avoine mesure de Meymac, et 35 livres d'argent. Les tenanciers de Longeyroux payaint une rente foncière de dixhuit setiers de seigle, soixante-huit quartes d'avoines, deux quartes defroment, le tout mesure de Meymac, et 10 livres et 15 sols d'argent.
Les tenanciers du village de La Gautherie, paroisse d'Ambru-
geac, payaient une rente de trois setiers, une quarte de seigle, six quartes d'avoine, cent livres de foin et 29 sols d'argent. Ceux de Lontrade payaient une rente de deux setiers de bléseigle.
Le village du Chadenier était grevé d'une rente de dix-sept setiers de seigle, cent-deux quartes d'avoine, un setier de froment, 16 livres Il sols d'argent.
Le village du Colomby devait en grande partie sa rente à l'abbé. Cette rente avait été divisée, et la part comprise dans le lot des moines n'était que d'un setier de seigle et trois quartes de froment. Enfin, ils percevaient encore la rente do Beynette dont nous avons parlé plus haut.
Format de téléchargement: : Texte
Vues 1 à 673 sur 673
Nombre de pages: 673
Notice complète:
Titre : Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze
Auteur : Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze. Auteur du texte
Éditeur : (Brive)
Date d'édition : 1890
Type : texte
Type : publication en série imprimée
Langue : français
Langue : Français
Format : Nombre total de vues : 33810
Description : 1890
Description : 1890 (T12).
Description : Collection numérique : Fonds régional : Limousin
Droits : domaine public
Identifiant : ark:/12148/bpt6k4539010
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-89252
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344265167
Provenance : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 03/11/2008
ARCHIVES HISTORIQUES
DF. F,
LA CORRÈZE (ANCIEN BAS-LIMOUSIN)
Recueil de documents inédits depuis les origines
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
PROMESSE PAR ÉBLES, VICOMTE DE VENTADOUR, DE PRETER SERMENT DE FIDÉLITÉ AU ROI D'ANGLETERRE LORSQU'lL EN SERA REQUIS. 11 MAI 1277.
Universis litteras présentes inspectuvis, Ebalo vicecomes de Ventadur salutem in domino seinpitmiam. Sciatis qitod ad instantialll diligentem domini mei Edwardi regis Angliœ illustris concessi et prornisi eidem domino meo quod gratanter et sine contradictione juramentum meum prrestabo quod illustris rex Francorum petit fieri a me et aliis tenentibus prsefati domini mei regis Edwardi, juxta formam pacis dudum initse inter inclitie mémorise Ludovicum quondam regem Francorum. patrem regis Francorum prredicti qui nunc est, et Heiirieuin quondam regem Anglorum, patrem dicti domini mei Edwardi regis, cum a nunciis ipsius domini mei Edwardi regis, quos pro eodem juramento requirendo ad partes transmarinas est transmissurus, et super hoc fuero requisitus. In cujus rei testimonium sigillum meum prœsentibus duxi apponendum. DatumLondoniae die Ascensionis domini anno gratiœ millesimo ducentesimo septuagesimo septimo (1).
(Ibidem, f 103.)
(1) Le vicomte de Ventadour était parmi les privilégiés, mais nous avons vu qu'Èbles VII et sa mère avaient renoncé à ce privilège, en l'année 1260. Pourtant, en 1277, Èbles VII n'avait pas encore rendu son hommage et prêté le serment de fidélité au duc de Guienne. Lorsque Édouard d'Angleterre (fils de Henri III) partit pour son expédition de Terre-Sainte, le vicomte de Ventadour le suivit. et Édouard le fit chevalier devant Tunis. Ils revinrent ensemble en Europe, et à son passage à Londres Èbles s'engagea à prêter enfin son serment, lorsque rentré dans ses domaines il en serait requis. Il est dit dans l'acte qu'il fait cette promesse à la prière du roi de France, qui demande que ce serment soit prêté par lui et les autres vassaux du roi d'Angleterre, aux termes de la paix de 1259 faite entre Louis IX et Henri III. Èbles était revenu de la Palestine dans un grave état de maladie, étique, d'après une lettre d'Edouard au Pape, auprès duquel il intercède afin que son vassal ne soit pas contraint de retourner en Terre-Sainte, ainsi que Sa Sainteté le lui ordonne. Cette curieuse lettre est transcrite dans Rymer, t. I. partie 2mo, p. 159.
TAULE GÉNÉALOGIQUE DES VICOMTES DE VENTADOUR ISSUS DE LA MAISON DE COMBORN
III. Archambaud II, vicomte de Comborn.
IV. Ebles I", vicomte de Ventadour. Archambaud 111.
V. Ebles IJ, vicomte de Ventadour. Archambauld.
VI. Ebles III, vicomte de Ventadour.
VU. Ehles IV, vicomte Guillaume. Ebles. Bernard. Guy. de Ventadour. Raymond. Helies. Ebles. Matabrune.
VIH. Ebles V, vicomte Bernard. Ebles. Raymond. de Ventadour. Aymon. Ebles.
IX. Ebles VI, vicomte Raymond. Hélies. Bernard. de Ventadour. Marie.
X. Ebles VII, vicomte Bernard. Isabel. de Veutadour.
X Hélie, vicomte Archambaud. Ebles. de Ventadour. Gérard. Ebles. Guillaume. Blanche.
Jeanne. Galienne.
XII. Bernard, vicomte Ebles. Ilelie. Guy. Marguerite. Autre Marguerite. de Ventadour.
Branche des vicomtes de Ventadour, issus de la maison
de Comborn.
IV, ÈBLES Ier. VICOMTE DE VENTAnOUB.
Archambaud If, vicomte de Comborn, eust plusieurs
enfans de Rotberge de Rochechouart, sa femme, entre
autres Archambaud III, qui continua la lignée des vicomtes de Comborn, et Èbles, vicomte de Ventadour celui cy a esté le chef d'une branche illustre qui a duré plusieurs siècles.
Il espousa Almodie de Montberon, sœur d'Arduin Gorrel, qui fust père de Rotbert de Montberon. Ce mariage est prouvé par Geoffroy de Vigeois et par le Cartulaire de Tulle.
Ce vicomte estant près de la mort se fit religieux dans l'abbaye de Tulle, à laquelle il donna deux domaines (1). Ce fust l'an MXCV (1095), et l'année suivante estant desia mort, sa femme et ses enfans firent don de deux autres domaines dans le mesme lieu.
Enfans d'Èbles Ier, vicomte de Ventadour, et d'Almodie de Montberon, sa femme
5. Archambaud, vicomte, est nommé le premier dans tous les actes, ce qui fait croire qu'il estoit l'aisné; il ne paroist point qu'il ait eu de postérité.
5. Èblcs II, vicomte de Ventadour, continua la famille. V. Ebles II, VICOMTE DE VENTADOUR.
Il fut surnommé le Chanteur, parce qu'il faisoit bien des vers en langue vulgaire, à quoy les princes et granus seigneurs de ce temps s'occupoint beaucoup. Cet amour de la poésie le lia d'amitié avec Guillaume, comte de Poitou, et Geoffroy de Vigeois rapporte plusieurs histoires agréables arrivées entre eux.
Il espousa Agnès, fille de Guillaume, seigneur de Montlusson en Bourbonnois.
L'an MCIX (1109), il donna le lieu de Cervesanges (2) (1) Daluze, Hist. Tut., col. 437-438, ne met qu'une date pour ces deux donations, dont la première est plus vraisemblablement pla.cée par ce manuscrit en 1095.
(2) Baluze, Ilist. Tut., col. 459. Mais c'est à tort que Baluze attribue à Èbles I", en sa table de référence, ce deuxième don de Cervesanges. Conférez col. 437.
à l'abbaye de Tulle. Revenant de la Terre-Sainte, il mourust au mont Cassin et y fust enterré.
Enfans d'Èbles II, vicomte de Ventadour, et d'Agnès de Montlusson, sa femme
6. Èbles III, vicomte de Ventadour, qui suit.
6. Aymon de Ventadour, nommé dans un acte d'Èbles VI. Son neveu, de l'an 1174.
VI. Èbles III, VICOMTE DE Ventadour.
Ce vicomte espousa en premières nopces Marguerite de Turenne, veufve d'Aymar IV, vicomte de Limoges, dont il eust une seule fille, et l'ayant gardée deux ans, il la répudia à cause de la parenté qu'il avoit avec son premier mary. 11 est vray qu'Èbles III et Aymar IV, vicomte de Limoges, estoint parens au troisiesme degré, comme estans tous deux issus d'Archambaud II, vicomte de Comborn, leur bysayeul commun. Il est vray aussy qu'Èbles III et Marguerite de Turenne, sa femme, estoint t parens au quatriesme degré comme descendans d'Èbles Ier, vicomte de Comborn, leur trisayeul commun. Marguerite de Turenne, estant ainsy abandonnée par le vicomte de Ventadour, espousa en troisiesmes nopces Guillaume Taillefer, comte d'Angoulesme, dont elle eust des enfans. Le vicomte Èbles. estant séparé de sa première femme, espousa en secondes nopces Alix de Montpellier, fille de Guillaume, seigneur de Montpellier, et de Mahaud de Bourgogne, laquelle cstoit aussy sa parente du quatriesme au cinquiesme degré, parce que Mahaud de Bourgogne, mère d'Alix, estoit fille d'Eudes II, duc de Bourgogne, et de Mahaud de Turenne, fille de Boson Ier, vicomte de Turenne, qui descendoit d'Èbles Ior, vicomte de Comborn, aussy bien que le vicomte de Ventadour, comme nous l'avons désia dit.
Enfans d'Èbles III, vicomte de Ventadour, et de Marguerite de Turenne sa première femme
7. Matabrune de Ventadour espousa 1° Regnaud, vicomte d'Aubusson, surnommé le Lépreux; 2° elle espousa
Eschivard de Chabanès, ft'ère de Jourdain de Chabanès, et de Raymond, abbé de L'Eyterp.
Enfans d'Èbles III, vicomte de Ventadour, et d'Alix de Montpellier sa seconde femme
7. Èbles IV, vicomte de Ventadour qui suit.
7. Guillaume, abbé de Tulle, mort jeune.
7. Èbles, religieux de Cluny, doyen de Mauriac.
7. Bernard, religieux de Tulle.
7. Guy, chanoine de Maguelonne.
7. Raymond et Hélies, chanoines de Limoges.
7. Èbles eust plusieurs différens et guerres avec son frère aisné.
VII. ÈBLES IV, VICOMTE DE VENTADOUR.
Il fust surnommé Archambaud au baptesme et espousa Sibille. fille de Raoul de Faye, qui estoit frère de Guillaume, vicomte de Chastelleraud, de laquelle il eust plusieurs enfans, quoique Geoffroy de Vigeois ne nomme que l'aisné seul pour dresser la généalogie.
Nous apprenons par un titre de l'eglise de Tulle de l'an MCCXIV (1214), que Bernard, abbé de Tulle, estoit frère d'Èbles V, fils aisné d'Èbles IV, dont nous parlons; et ce mesme abbé Bernard, dans un autre acte, nomme plusieurs autres de ses frères dont nous allons faire mention.
L'an MCLXXIV (1174), ce vicomte Èbles donna le passage par ses terres, sans payer aucun droit de péage, à l'abbaye (1) de Dalonne, ez mains de l'abbé Guillaume qu'il appelle son cousin, et qui estoit frère de Hugues, comte de Rhodez, tesmoins Raymond, chanoine de Limoges, frère d'Èbles. Aymon son oncle, Alix sa mère, et S., vicomtesse, sa femme.
(1) Nous avons copie ancienne de ce Cartulaire de Dallon, que nous pourrions publier, si on nous y invite, dans le Bulletin de Périgueux, déjà si hospitalier pour nous à l'occasion de notre vicairie de Mouncys et de nos critiques du Dictionnaire de Gourgues.
Eblcs IV se trouve aussy nommé dans des actes de l'abbaye de D'Alonne ez années MCLXXIX (1179) et MGLXXXI (1181).
Enfans d'Èbles IV, vicomte de Ventadour, et de Sibille de Faye, sa femme
8. Èbles V, vicomte de Ventadour, qui suit.
8. Bernard, abbé de Tulle.
8. Èbles, abbé de Figeac (1).
(1) Voyez Baluze, Hist. de Tulle, col. 515-516.
8. Raymond, chantre de..
8. Aymon, moine et prévost de Maguelonne, nommé dans l'obituaire de Tulle.
8. Èbles, chevalier.
VIII. Èbles V, VICOMTE de VENTADOUR.
Ce seigneur fust marié deux fois. Sa première femme fust Marie, fille d'Aymar V, vicomte de Limoges, et de Sara d'Angleterre, sa femme, laquelle estant morte sans enfans, Èbles espousa en secondes nopces Marie, sœur de Raymond, vicomte de Turenne.
L'an MCCXIV (1214), le cinquième (1) des nones de juin, ce vicomte estant dans l'assemblée du chapitre général de l'abbaye de Tulle, y fist une donation considérable en présance de Bernard, abbé de Tulle, son frère, de P. et Hugues, abbés d'Uzerche et de Saint-Augustin de Limoges, de P. Fouchers, Hugues de Corsou, B. de Saint-Yriex, Èbles de Boussac, chevaliers, et plusieurs autres.
Enfin ce seigneur, mû par un grand zèle de piété, abandonna le monde et se fist religieux (2) en l'abbaye de Grammont, chef de l'ordre, du consentement et en présence de Marie, sa femme, de Raymond et Èbles, ses (1) Voyez Baluze, Hist. de Tulle, col. 513-514. Mais Baluze dit le 4 des nones.
(2) Le texte latin en est à la colonne 537 de l'Histoire de Tulle de Baluze.
enfans, soumettant toutes ses terres à la jurisdiction de l'archevesque de Bourges et de l'évesque de Limoges pour le payement de ses debtes, et pour toutes les demandes qu'on pourroit faire au prieur de Grammond et à tout son ordre, par rapport à sa réception et donna pour cautions Raymond, vicomte de Turenne, et R. son frère; Guillaume, abbé de Maismac Bertrand de Molceau, Constantin de la Chassaighne, et Hugues son frère, chevaliers. Cet acte fust passé en présance des abbés de Tulle et de Maismac, Guillaume, official de Limoges, Guillaume de Maumont, chanoine de Limoges, et plusieurs autres, à Grammont, dans les octaves de Pentecoste, l'an MCCXXI (1221).
Enfans d'Èbles V, vicomte de Ventadour, et de Marie de Turenne, sa seconde femme
9. Raymond se trouve nommé le premier dans les actes.. Ce qui fait juger qu'il estoit l'aisné. Je n'ay point de preuve qu'il ait esté vicomte de Ventadour, ni qu'il ait laissé de postérité.
9. Èbles VI, vicomte de Ventadour, qui suit.
9. Hélie estoit prévost de Tulle et chapellain du Pape en l'an MCCXXVII (1227).
9. Bernard, évesque du Puy, nommé dans un acte des chartres du roy en MCCXXXIV.
9. Marie espousa Bernard de Malaguise, dont vint une fille nommée Almodie, mariée au seigneur de Cosnac. IX. ÈBLES VI, VICOMTE DE VENTADOUR.
Ce vicomte espousa une dame nommée Delphine. Ce mariage est prouvé par acte d'un registre de la Chambre des comptes, à Paris, du mois de juin MCCXLVII (1247), par lequel Louis, roy de France, déclare à son féal et amé Èbles, vicomte de Ventadour, qu'il l'a receu à foy et hommage, et luy promet de ne le mettre jamais hors de sa main et dans un domaine étranger contre sa volonté. Cet acte fust représenté en original à Bertrand de Cardaillac, chevalier, sénéchal de Limosin, Quercy et Péri-
gort pour ]e roi d'Angleterre, par noble dame Delphine, vicomtesse de Ventadour, et Èbles, vicomte, son fils, le jour de l'invention de Sainte-Croix, l'an MCCLX (1260). On voit par là qu'Èbles VI estoit mort avant cette date. Enfans d'Èbles VI, vicomte de Ventadour, et de Delphine, sa femme
10. Èbles VII, vicomte de Ventadour, qui suit.
10. Bernard, chappelain du Pape, chanoine et archidiacre de l'esglise de Limoges, MCCLXIII (1263), MCCL XXXI (1281).
10. Isabel espousa Robert, seigneur de Montberon, l'an MCCLXXVI (1276).
X. Èbles VII, VICOMTE DE VENTADOUR.
L'acte de l'an MCCLX (1260) rapporté dans l'article précédent, fait cognoitre qu'il estoit fils de Delphine et d'Èbles VI.
L'an MCGLXXII (1272), le lundy après le dimanche reminiscere (1), estant au chapitre de l'abbaye de Tulle, il recognust tenir en fief le chasteau et chastellenie de Molseau en présance d'un grand nombre de tesmoins. L'an MCCLXXVII (1277), et le jour de l'Ascension, estant à Londres, il déclare qu'à l'instance de son seigneur Édoüard, roy d'Angleterre, il a promis de prester le serment que le roy de France requiert des vassaux du susdit roy Édouard, suivant la forme du traité de paix fait jadis entre Louis, roy de France, père du roy régnant, et Henry, roi d'Angleterre, père d'Édouard. L'an MCCXCIV (1294), Bertrand de Molceau, damoiseau, fils de Hugues de Molceau, chevalier, ayant vendu des domaines, dans la parroisse de Sainte-Fortunade, à Raymond de Tulle. damoiseau, le vicomte Èbles y donna (1) Voyez Hist. Tut., col. 577, où Baluze, qui a sans doute ajouté ses preuves hâtivement, a groupé plusieurs hommages de diverses dates sous celle de 1270. Il faut ici 6 mars 1272. Voyez Pardessus, continuateur de Bréquigny.
son consentement comme seigneur de tief. Nous présumons qu'il mourust peu après cette date. Nous n'avons pas trouvé le nom de sa femme, nous scavons pourtant qu'il eust les enfans suivans
Enfans d'Èbles VII, vicomte de Ventadour, et de sa femme
Il. Hélie, vicomte de Ventadour, qui suit.
Il. Èbles fait la branche des seigneurs de Donzenac. 11. Archambaud. chanoine d'Esmoutiers en MCGXCIX (1299) et MCCCXXIII (1323).
XI. HÉLIE, VICOMTE DE VENTADOUR.
Ce seigneur rendit hommage à l'évesque de Limoges en l'an MCCXCVII (1297) pour plusieurs terres, comme avoint fait ses prédécesseurs.
Il espousa Marguerite de Beaujeu. fille de Louis de Beaujeu, seigneur de Montferrand, et de Marguerite de Bornés, dame de Chasteaumeilland. Ce mariage est prouvé par des arrets rapportés par Duchesne en l'Histoire de Dreux, où il paroist que Bernard, vicomte de Ventadour, plaidoit pour les droits de sa mère, pour lesquels il eust la terre de Montpensier et plusieurs autres. Le mesme autheur dit que Blanche de Ventadour, femme de Guischard de Comborn, estoit jointe à ce procès.
L'an MCCCXIV (1314), il maria Èbles, son fils aisné, avec Mathe de Comborn, fille de Guischard de Comborn, seigneur de Treignhac, et de Marie de Comborn, sa femme.
Enfans d'Hélie, vicomte de Ventadour, et de sa femme 12. Èbles VIII, vicomte de Ventadour, espousa Mathe de Comborn et mourust sans enfans.
12. Bernard, vicomte de Ventadour, après son frère. 12. Helie et Guy, nommés dans un acte de l'an MCCC XXXIX (1339).
12. Marguerite, mariée avec Raymond, vicomte de Turenne, avant l'an MCCCI (1301).
12. Marguerite II espousa Guillaume Balene, chevalier.
seigneur de Rlanhac, en la séneschaussée de Toulouse; morte avant l'an MCCCXXXIX (1339).
XII. Bernard Ier, comte DE Ventadour.
Ce seigneur est encore appelle vicomte dans des actes de l'an MCCCLXIII (1363). Mais dans ceux de l'an MCCC LXVII (1367) il est nommé comte, ainsy que ses successeurs.
Il rendit hommage à l'évesque de Limoges comme nouveau seigneur, en l'an MCCCXXIX (1329).
Il doit y avoir deux degrés entre ce comte Bernard et Charles, dernier comte de Ventadour, qui, en MCCCCLIV, espousa Catherine de Beaufort, fille de Pierre de Beaufort, vicomte de Turenne, et de Blanche de Gimel. De ce mariage vint une fille unique, Blanche, dame et comtesse de Ventadour, qui, en MCCCCLXXII, espousa Louis de Lévis, seigneur de la Voute. De ce mariage sortent les comtes et ducs de Ventadour de la maison de Lévis.
Branche des seigneurs de Donzenac, issus des vicomtes de Ventadour.
XI. EBLES DE VENTADOUR, SEIGNEUR DE DONZENAC. Cet Èbles estoit second fils d'Èbles, septième vicomte de Ventadour. Son père le maria avec Galiène de Malemort, fille et héritière de Gérard de Malemort, seigneur de Donzenac. En l'an MCCXCVII (1297), il rendit hommage à l'évesque de Limoges pour les biens que luy et sa femme tenoint à Malemort, Donzenac et autres lieux. Il y a un autre hommage de l'an MCCCX (1310) pour des biens très considérables que ce seigneur possédoit. Enfans d'Èbles, seigneur de Donzenac, et de Galienne de Malemort, sa femme
12. Èbles se trouve nommé dans un acte de vente que son père et luy font à l'évesque de Limoges. Il y a apparence qu'il estoit l'aisné, et n'a pas eu de suite.
12. Géraud, seigneur de Donzenac, qui suit.
12. Guillaume, doyen de Rieupeiroux (1), puis abbé de Saint-Martial de Limoges en MCCCXXXIX (1339;. 12. Blanche espousa Bernard de Comborn, seigneur de Beaumont. puis vicomte de Comborn. Il est prouvé dans l'histoire de Comborn, dans le mariage d'Eustache de Comborn, sa fille, avec Guy de Chanac, qu'elle estoit seur de Gérard et fille d'Èbles, seigneur de Donzenac; que Bernard, vicomte de Comborn, son mary, mourust en MCCCXX (1320) et qu'elle agissoit encore en qualité de sa veufve en l'an MCCGXXXTV (1334) (2).
XII. GÉRARD DE VENTADOUR, SEIGNEUR DE DONZENAC. Je n'ay point trouvé qu'elle a esté la femme de ce seigneur de Donzenac, car les temps ne permettent pas de luy donner pour femme, comme font quelques uns, Marguerite, fille de Guillaume Rogier, comte de Beaufort, frère du pape Clément VI, les filles de ce seigneur de Donzenac ayant esté mariées peut estre aussi tost que Guillaume Rogier. son prétandu beau père.
Ce seigneur de Donzenac vivoit encore en MCCCLXII (1362), car il se trouve des hommages par luy rendus à l'évesque de Limoges de cette date.
Il eust de son mariage les deux filles qui suivent. Enfans de Géraud de Ventadour, seigneur de Donzenac, et de sa femme
XIII. Jeanne de Ventadour espousa, l'an MCCCXXXII (1) Probablement le chef-lieu de canton de ce nom, dans l'Aveyron, où le culte de saint Martial était assez en faveur, notamment à Asprières, dont il était le patron.
(2) Puis vient ce paragraphe, qui est bâtonné (cancellé), très probablement par la même main « II paroist que Guischard de Com» born, troisième seigneur de Treignhac, avoit espousé une Blanche » de Ventadour, qu'il laissa encore veufve, de laquelle il est fait » mention jusques en l'an MCCCLXVII. C'est peut estre la mesme » Blanche qui espousa ces deux seigneurs. »
(1332), Guy d'Aubusson, fils de Reynaud d'Aubusson, seigneur de la Borne.
XIII. Galienne de Ventadour espousa, en MCCCXXX VIII (1338), Hélie de Chanac, fils de Guy, seigneur de Chanac.
J.-B. CHAMPEVAL.